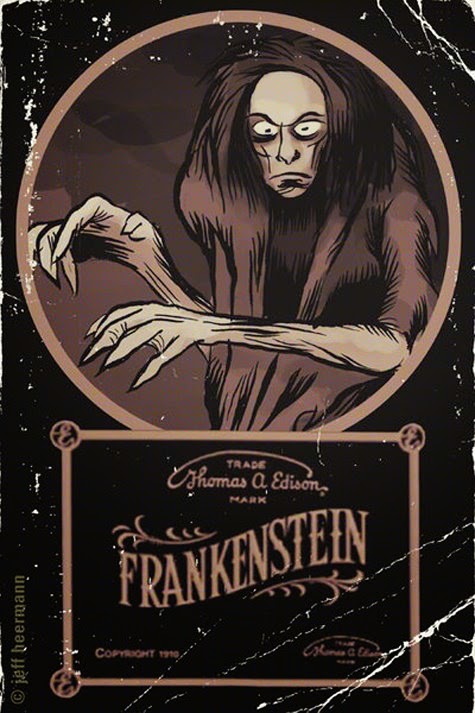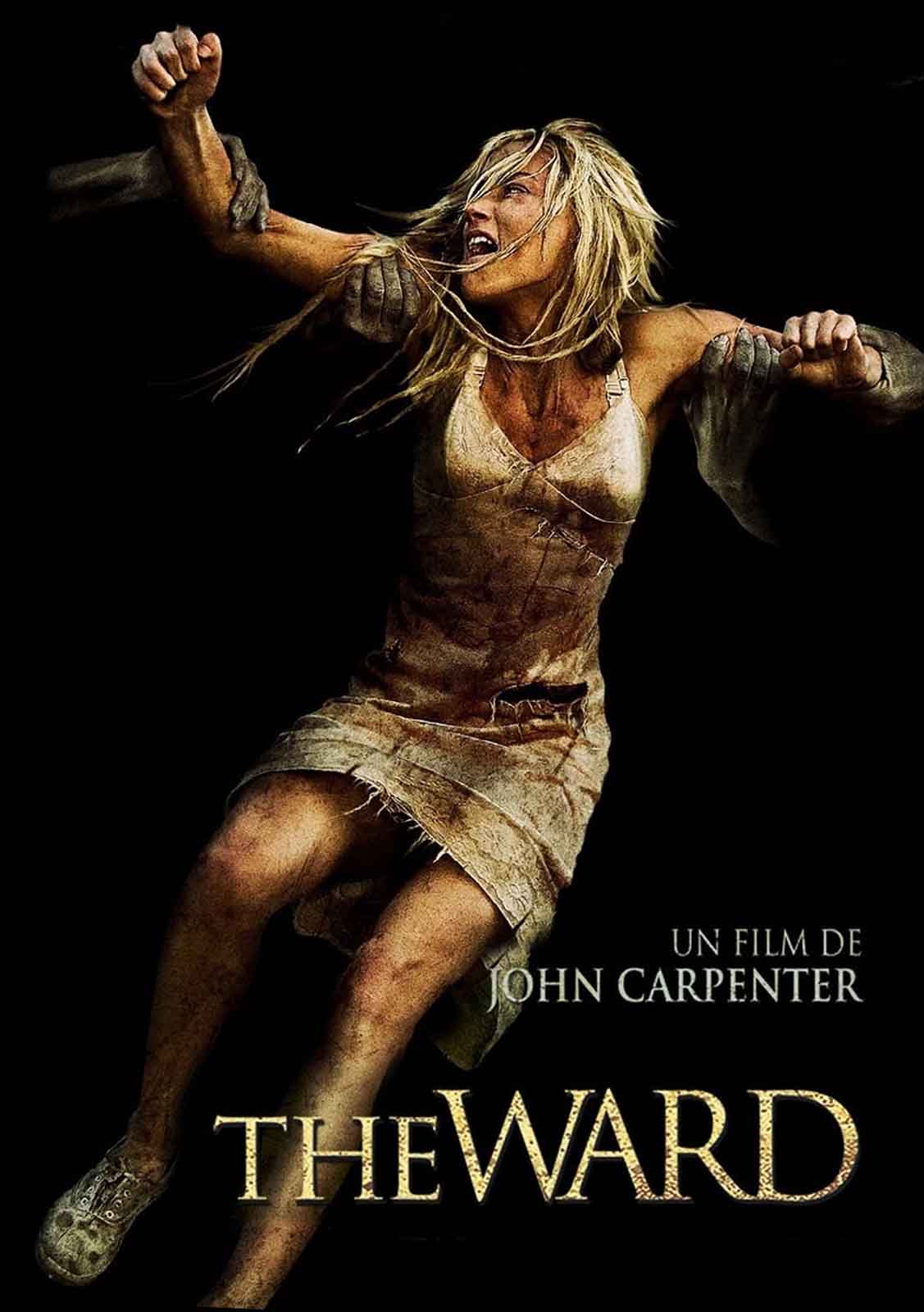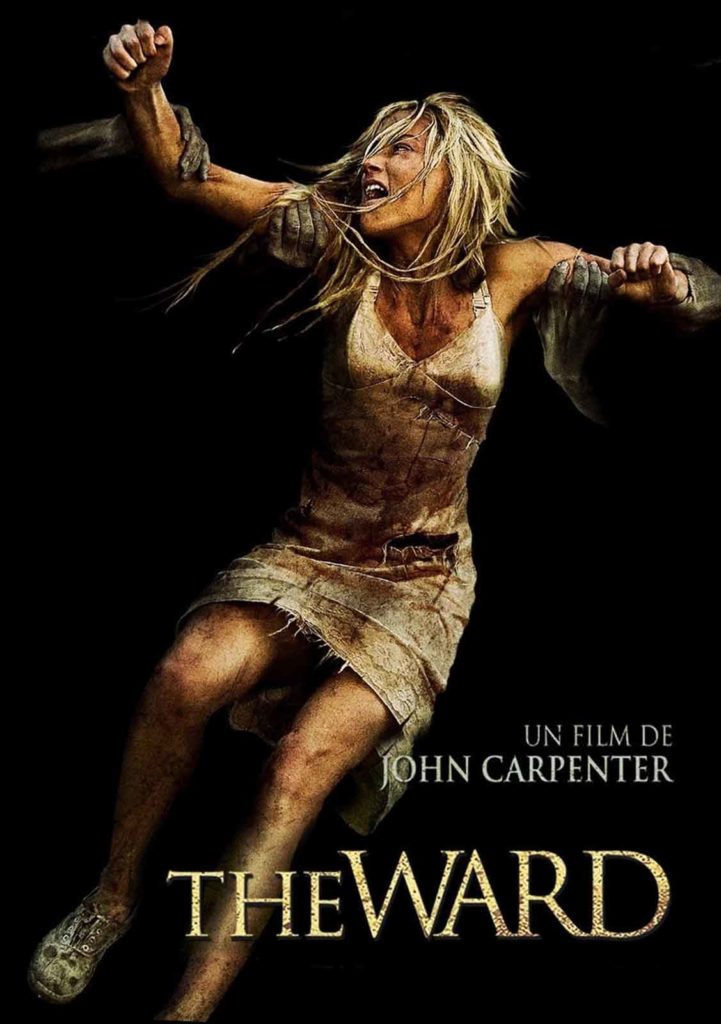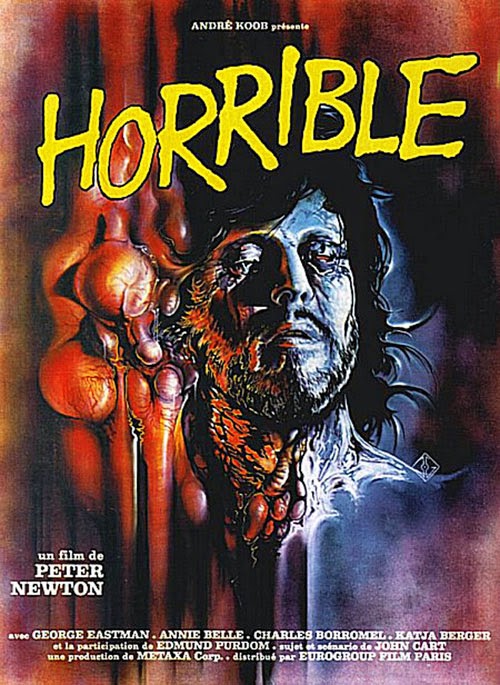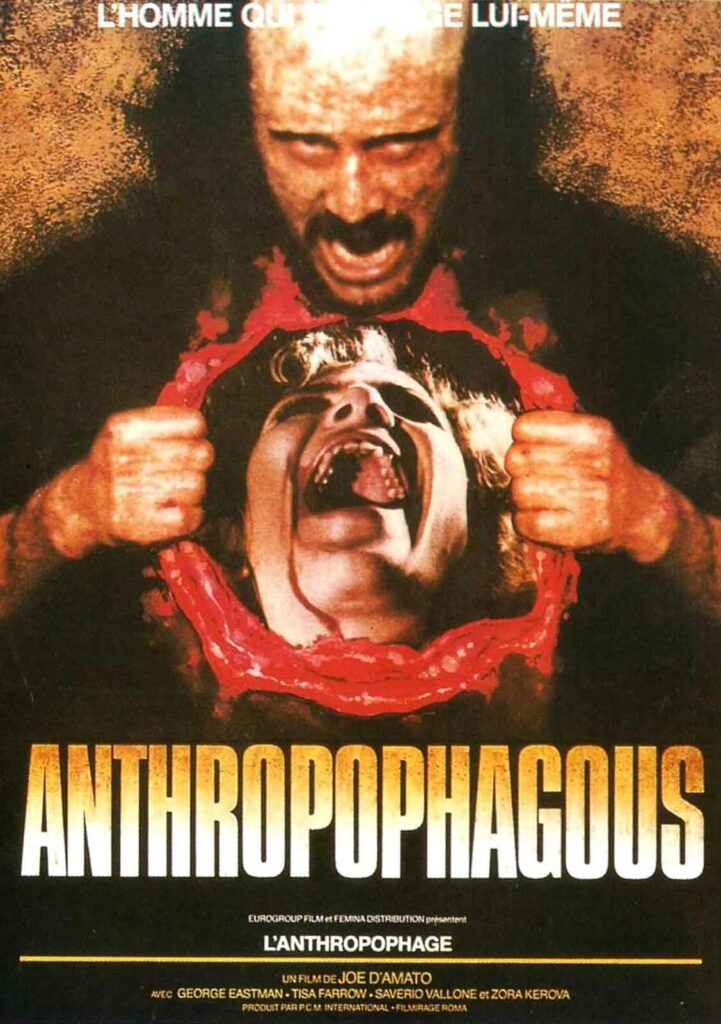Deuxième volet de la saga des Trois Mères, cette fausse suite de Suspiria joue à fond la carte du surréalisme
INFERNO
1979 – ITALIE
Réalisé par Dario Argento
Avec Leigh McCloskey, Irene Miracle, Eleonora Giorgi, Daria Nicolodi, Sacha Pitoëff, Alida Valli, Ania Pieroni
THEMA SORCELLERIE ET MAGIE I SAGA LES TROIS MERES I SAGA DARIO ARGENTO
Plutôt qu’une suite de Suspiria, Inferno est une variante sur un mythe imaginé de toutes pièces par Dario Argento, alors en pleine élaboration d’une version adulte, gore et flamboyante des contes de fées qui marquèrent son enfance. « Au départ, la mythologie des “Trois Mères“ n’était pas aussi élaborée qu’aujourd’hui », explique-t-il. « J’avais simplement mis en place cette histoire de sorcières pour servir de support au scénario de Suspiria. Etant donné que je n’avais pas encore envisagé d’autres films autour du même thème, je restais d’ailleurs assez flou sur leur passé et leur mode de fonctionnement. J’ai pu développer et enrichir ce mythe dans Inferno. » (1) Ce second opus nous apprend ainsi que l’architecte Virelli a fait bâtir, sur les ordres de la Mère des Ténèbres, un immeuble à New York, à Fribourg et à Rome. Il fait ces révélations dans un ouvrage qu’il a rédigé en latin à la fin du 19ème siècle, et où il dénonce les maléfices des Trois Mères : Mater Suspirorum (la Mère des Soupirs), Mater Lachrymarum (la Mère des Larmes) et Mater Tenebrarum (la Mère des Ténèbres). La lecture de ce livre apprend à Rose que la maison qu’elle habite à New York serait sous l’emprise de la Mère des Ténèbres. Elle prévient alors son frère Mark qui vit à Rome, prélude d’une inexorable descente aux Enfers.


Les excès visuels d’Argento irradient chaque centimètre de pellicule d’Inferno, à travers ses somptueux décors baroques, ses lumières saturées, ses actrices photogéniques et ses meurtres esthétisés. « Je m’inspire à chaque fois de tableaux et de peintres différents, selon les films, leur ambiance et leur thème », nous explique-t-il. « Les éclairages rouges et bleus d’Inferno sont ainsi influencés par les peintures préraphaélites. » (2) Du côté de la bande originale, Keith Emerson prend le relais du groupe Goblin et signe une partition emphatique à la croisée de l’opéra et du rock. La Mère des Soupirs ayant fait son apparition dans Suspiria, c’est désormais celle des Ténèbres qui nimbe de sa présence vénéneuse le scénario d’Inferno.
Le regard de la Mère des Larmes
Future antagoniste d’un troisième volet tardif et décevant, la Mère des Larmes fait tout de même une apparition dans cet épisode central, d’une manière certes furtive mais inoubliable. Sous les traits envoûtants d’Ania Pieroni, elle braque ses yeux verts sur le spectateur, tout en caressant un énigmatique chat blanc, pendant qu’une louma fonce sur elle à travers les bancs d’une école de musique. « Ce sont des tableaux insolites qui se passent de dialogues et d’explications, qui reposent entièrement sur la caméra et la présence des acteurs », explique Argento. « Le spectateur est libre d’appréhender des séquences de ce type avec sa propre sensibilité. Et si l’on possède un esprit assez ouvert, on se laisse transporter même si l’on ne comprend pas tout. » (3) Parmi les autres passages marquants d’Inferno, on se souvient du gag du vendeur de hot-dogs qui, au lieu de secourir un personnage agressé par des rats, l’achève d’un coup de couteau, de l’attaque d’une jeune femme par des chats aussi virulents que Les Oiseaux d’Hitchcock, de la visite sous-marine des fondations inondées de la maison maudite et l’incendie final, qui clôt en beauté un film échappant volontairement aux règles traditionnelles de la narration.
(1), (2) et (3) Propos recueillis par votre serviteur en février 2011
© Gilles Penso
Partagez cet article