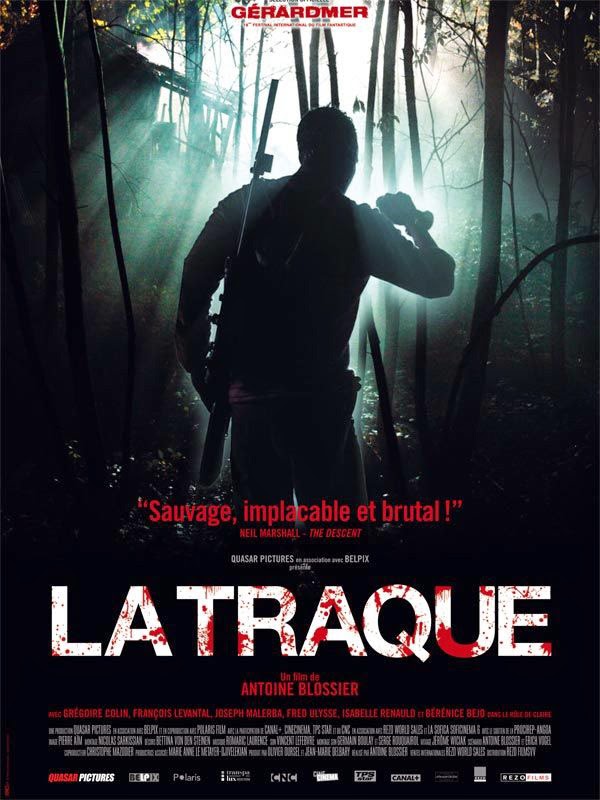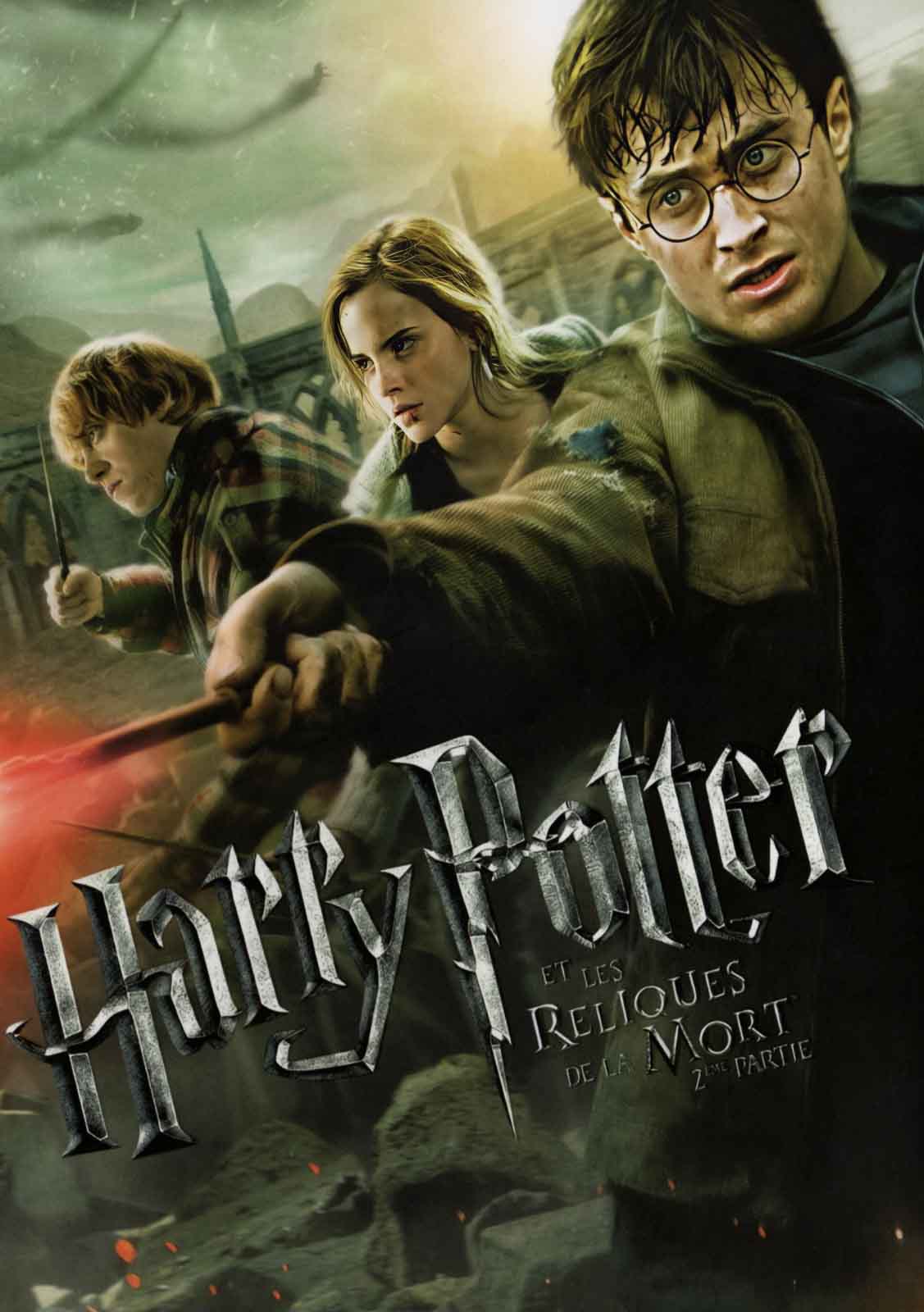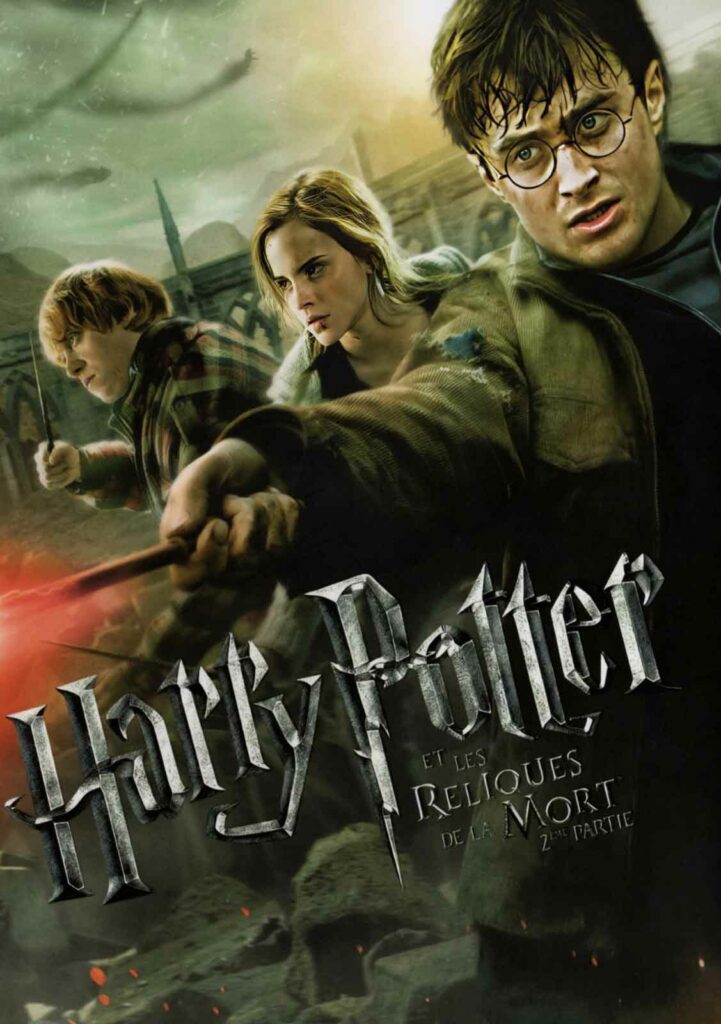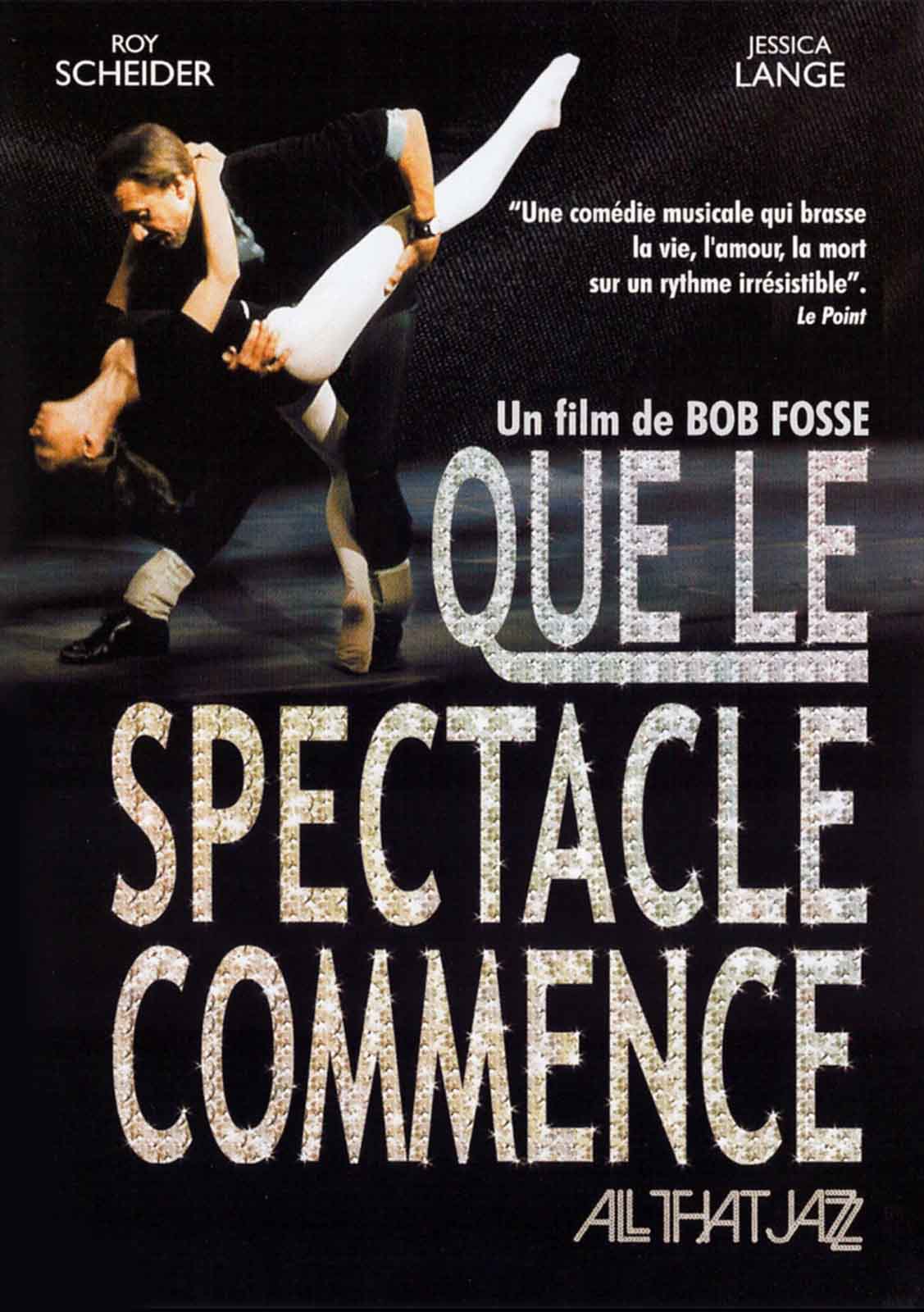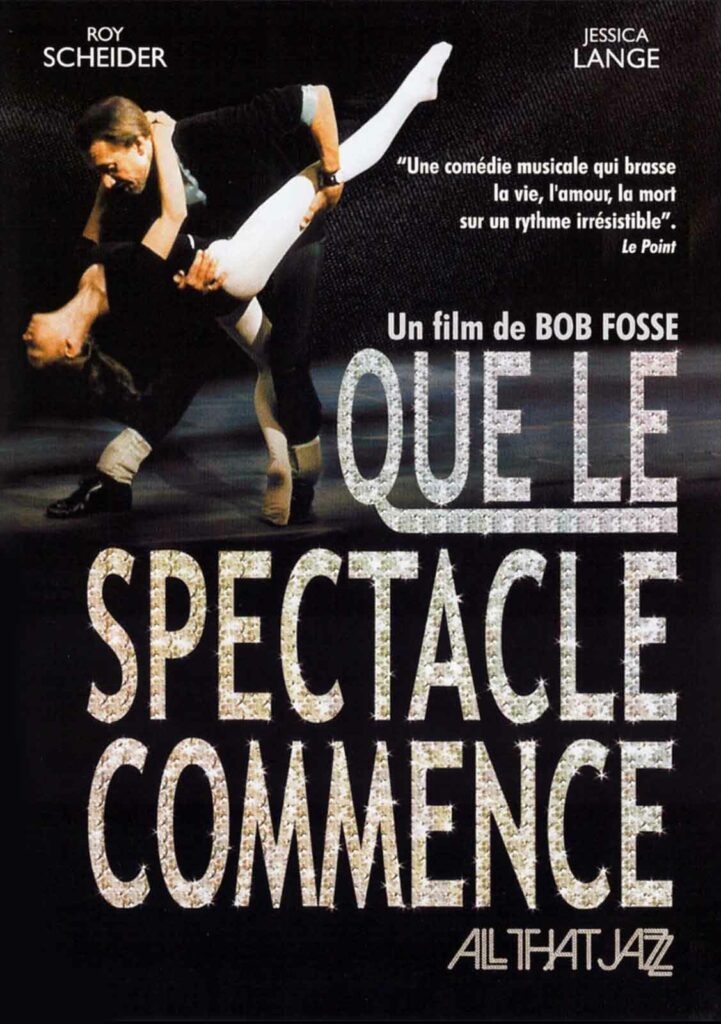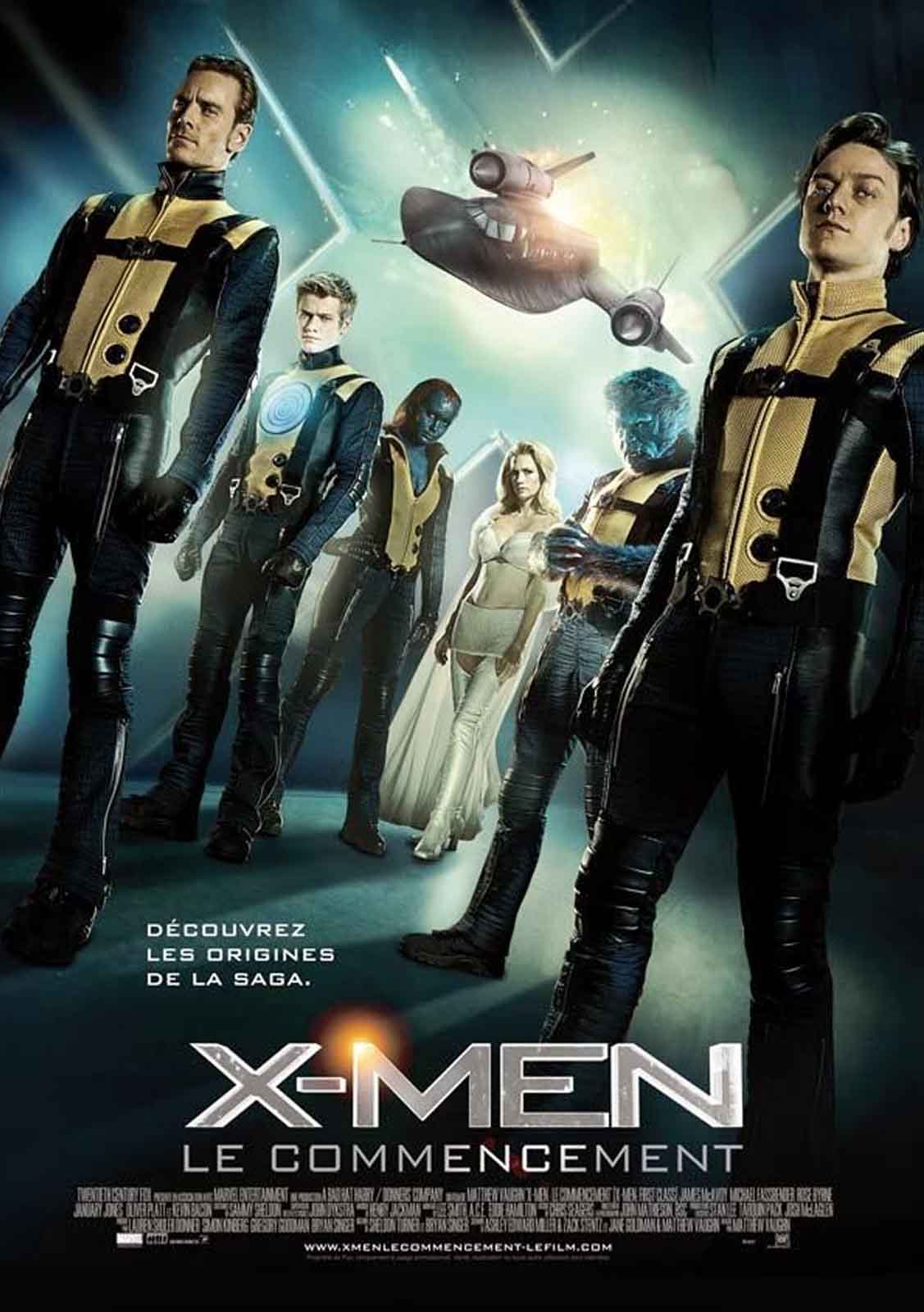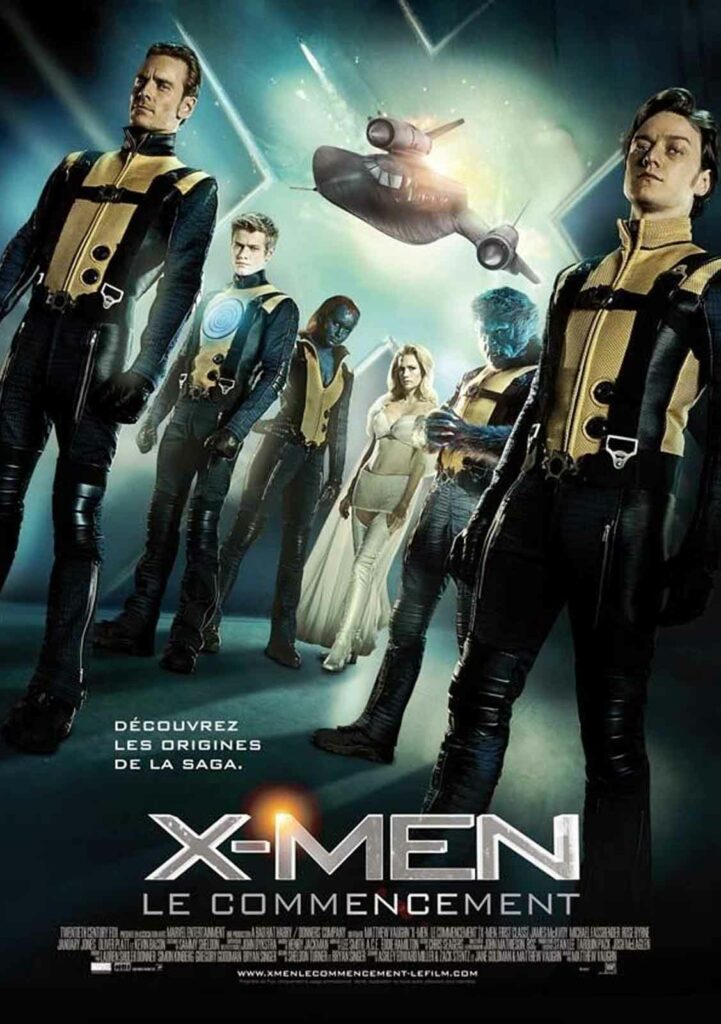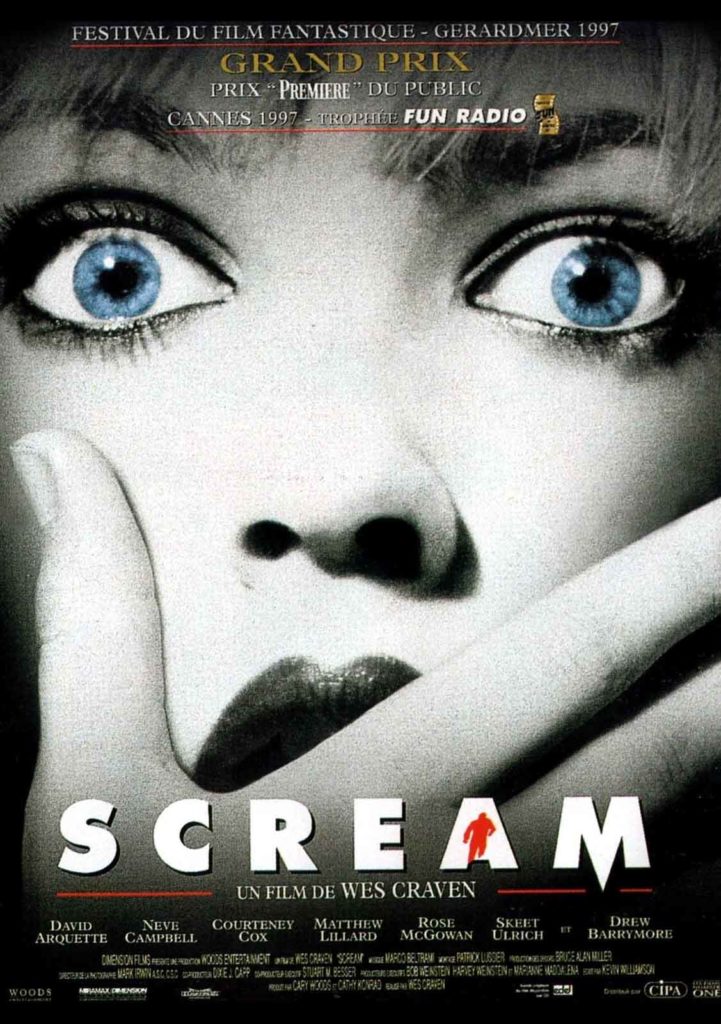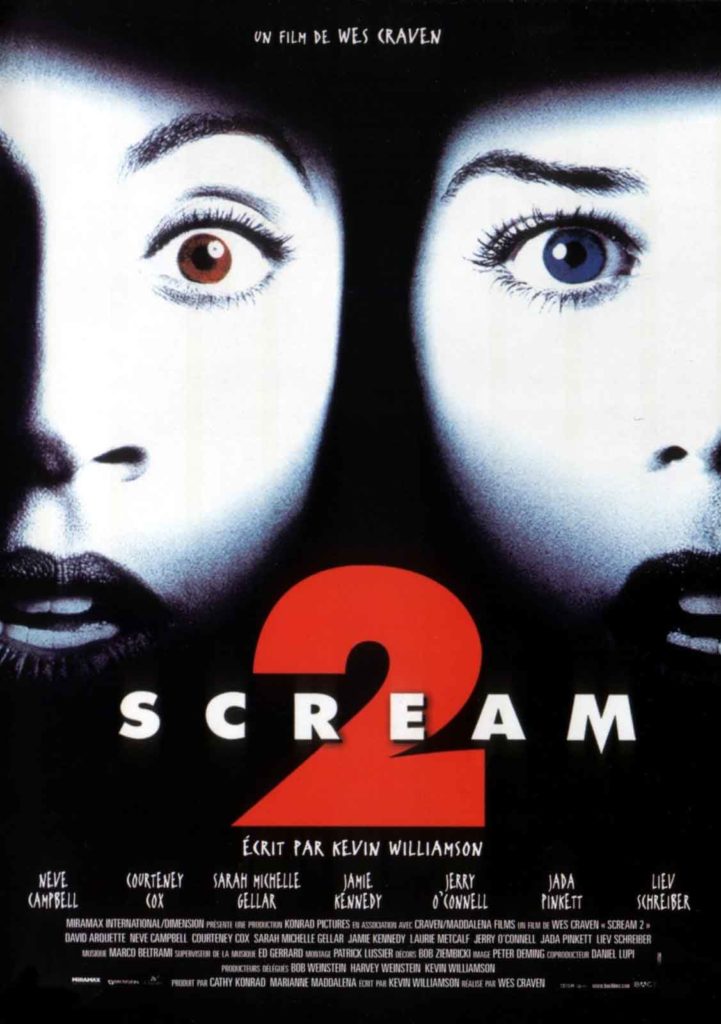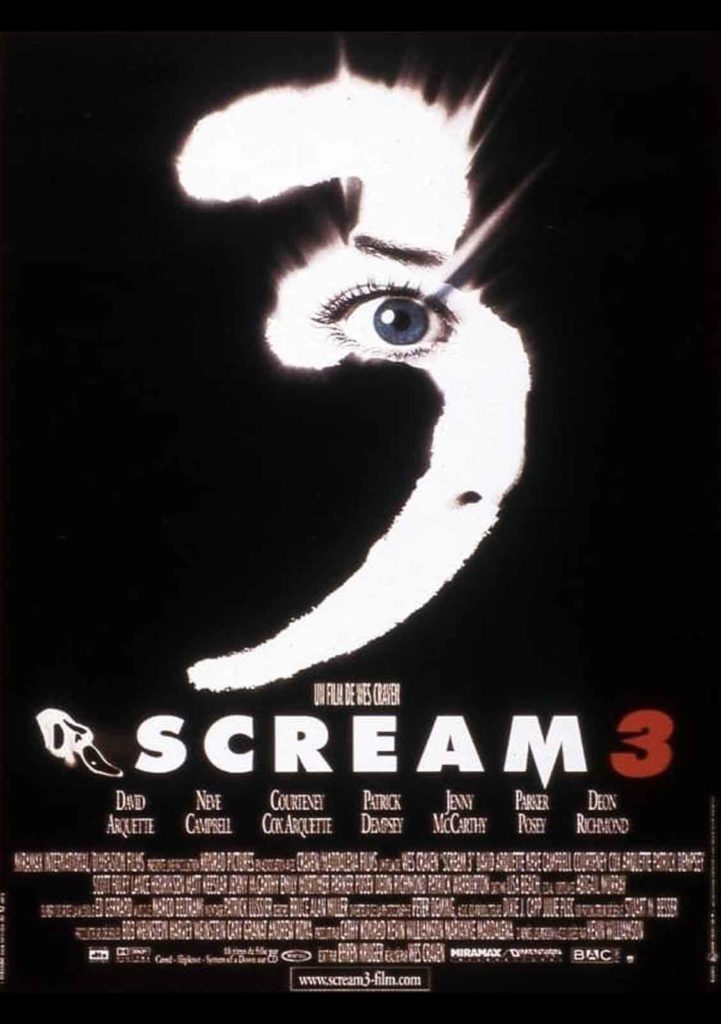Produit par M. Night Shyamalan, ce huis-clos dans un ascenseur bloqué convoque le Diable en personne…
DEVIL
2010 – USA
Réalisé par John Erick Doodle
Avec Chris Messina, Logan Marshall-Green ; Geoffrey Arend, Bojana Novakovic, Jenny O’Hara, Bokeem Woodbine, Matt Craven
THEMA DIABLE ET DEMONS
Produit par M. Night Shyamalan, qui n’a jamais tout à fait su transformer l’essai miraculeux de Sixième sens, et réalisé par John Erick Dowdle, signataire d’un parfaitement inutile En Quarantaine, Devil ne partait pas avec toutes les chances de son côté. Pourtant, les toutes premières images du film sont prometteuses. Aux accents d’une imposante partition cuivrée de Fernando Velasquez, la caméra survole les buildings de Philadelphie. Ce type de plan aérien, ultra banalisé, prend ici une tournure inattendue dans la mesure où les images sont inversées. La tête en bas, les immeubles s’offrent à nos yeux sous un jour inquiétant et un indicible sentiment de malaise s’installe. Avec une virtuosité empruntée à un David Fincher, les prises de vues foncent en plan séquence à l’intérieur d’un des bâtiments, où un agent d’entretien nettoie les sols tandis qu’à l’arrière-plan un corps tombe dans le vide et s’écrase sur le toit d’une camionnette. Voilà une entrée en matière pour le moins intrigante, qui nous rappelle que l’auteur de Phénomènes a toujours su soigner ses prologues.


Alors que l’inspecteur Bowden (Chris Messina) enquête sur ce trépas violent, cinq personnes qui ne se connaissent pas entrent dans l’ascenseur de l’immeuble : un agent de sécurité, une jeune femme séduisante, un jeune homme introverti, un VRP bavard et une vieille dame. Ici aussi, la caméra sait surprendre, captant en plan séquence l’entrée successive des acteurs du drame dans la cabine jusqu’à faire face au miroir. Brusquement, l’ascenseur se bloque entre deux étages. De la simple contrariété, la situation dégénère peu à peu et vire au cauchemar… Le pitch, voisin de celui de Cube, est intéressant, mais sa mise en application s’avère bien vite besogneuse, jusqu’à ce que les cimes du grotesque soient peu à peu atteintes, annihilant tout l’impact de ce Devil finalement bien vain.
La tartine qui tombe du mauvais côté
Premier problème : incapable de gérer son concept jusqu’au bout, le film refuse de jouer la carte de la claustrophobie, en collectant finalement plus de séquences extérieures que de scènes confinées dans la cabine. Deuxième problème : la répétition des situations (la lumière s’éteint, quelqu’un meurt, et ainsi de suite) finit vite par lasser. Troisième problème, le plus grave : une volonté opiniâtre de tout expliquer en prenant le spectateur par la main de peur qu’il soit incapable de suivre l’intrigue tout seul. D’où cette voix off puérile et omniprésente qui, tout au long du métrage, nous raconte que le diable s’immisce parfois parmi les humains pour emporter leur âme. Pire : le gardien stéréotypé campé par Jacob Vargas qui s’avère bardé de superstitions bigotes (normal, c’est un latino) et qui passe son temps à raconter aux autres personnages le mode de fonctionnement du Diable. Summum du grotesque : la scène de la tartine qui tombe du mauvais côté quand Satan est dans les parages (!) et celle du « Je vous salue Marie » que ledit gardien entonne à l’attention des prisonniers de la cabine (au secours !). Bref, ce « Diable dans l’ascenseur » perd tous ses atouts en cours de route, malgré ses nombreuses qualités formelles (auxquelles il faut ajouter la photographie stylisée de Tak Fujimoto) et le jeu plutôt convainquant de Chris Messina et Logan Marshall-Green.
© Gilles Penso
Partagez cet article