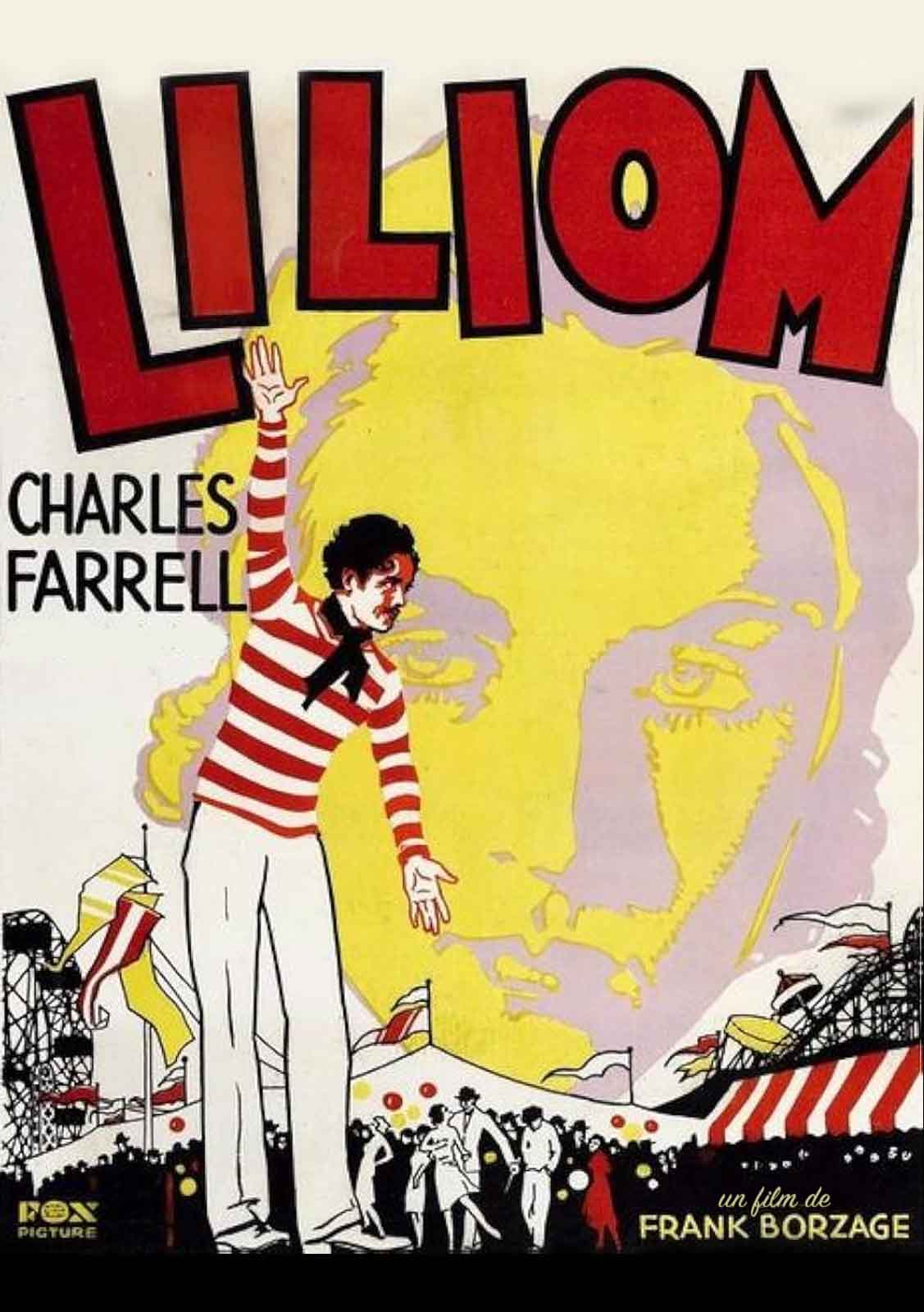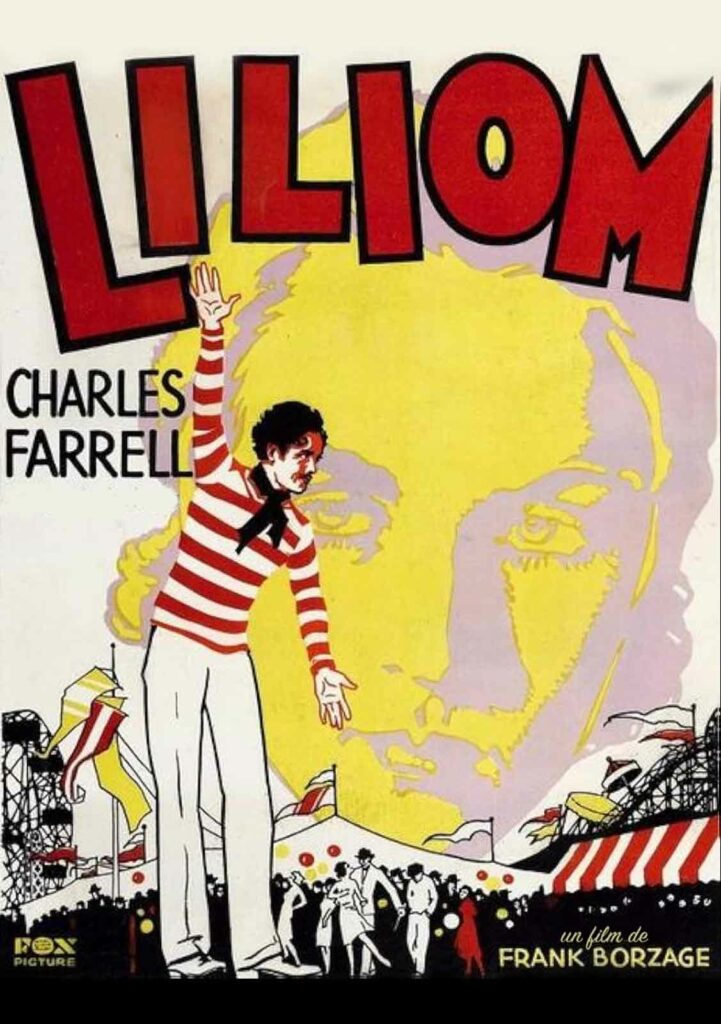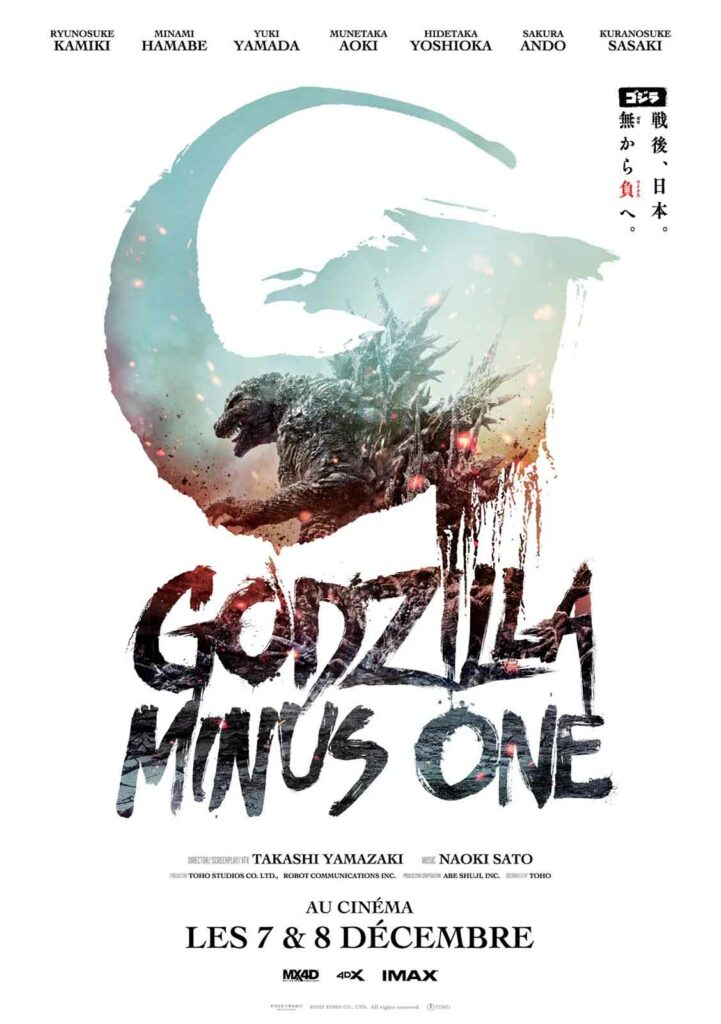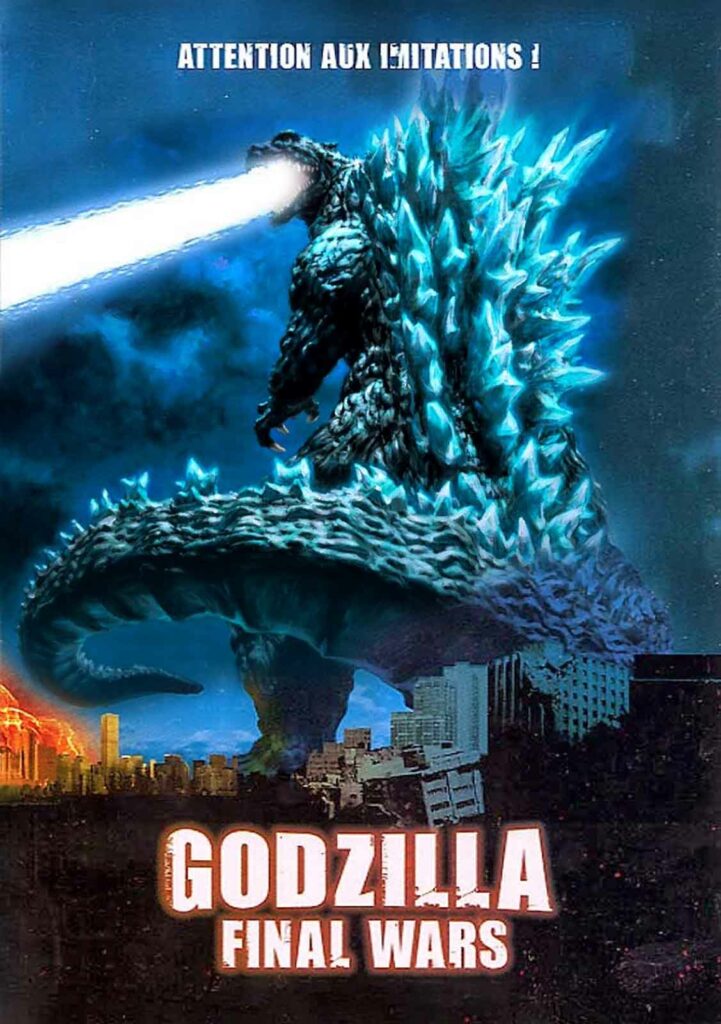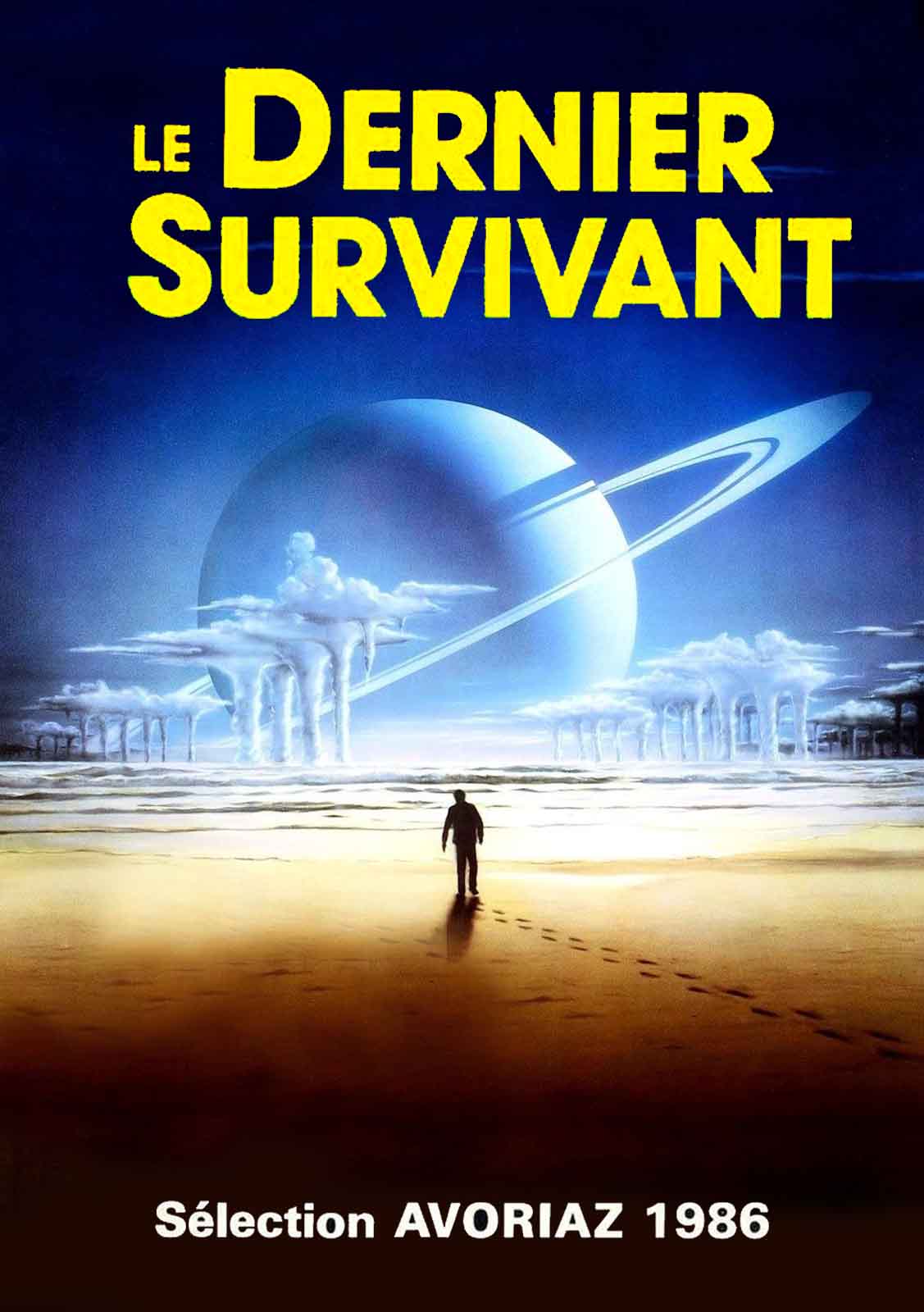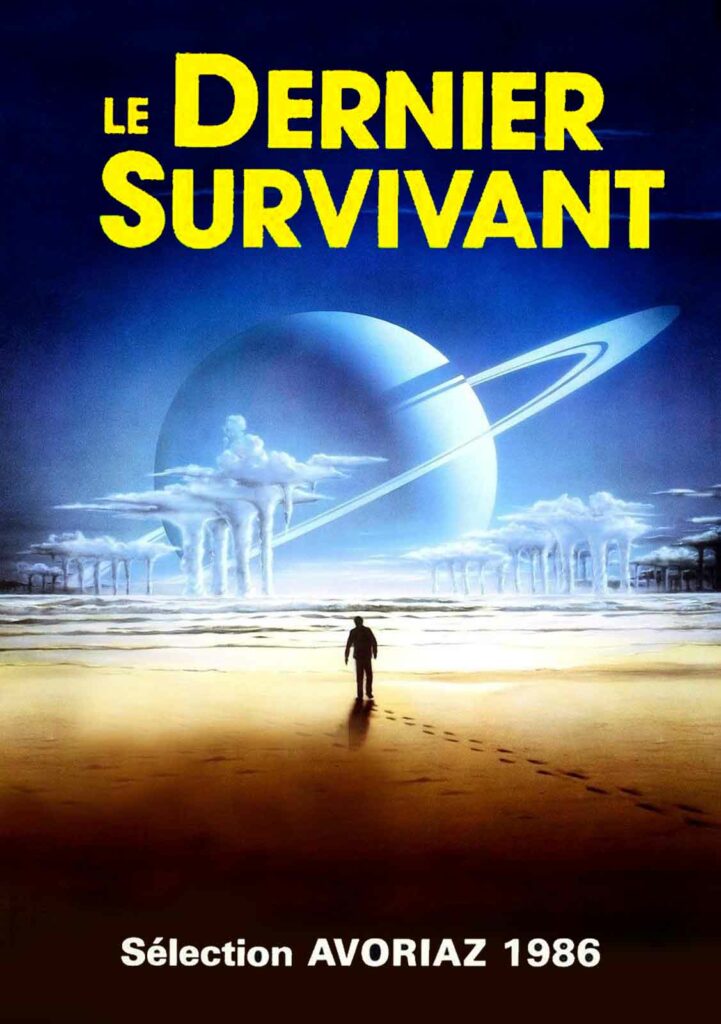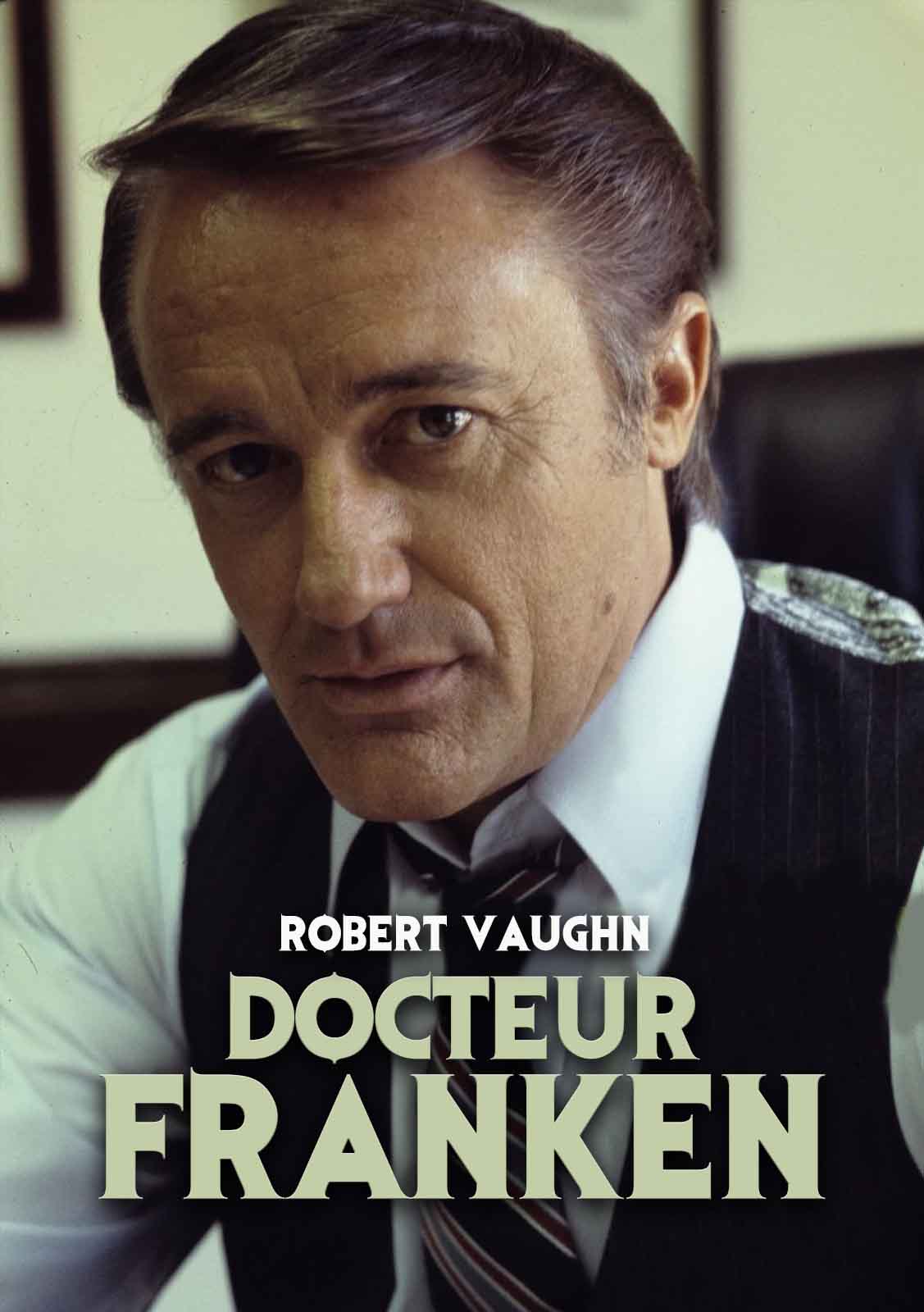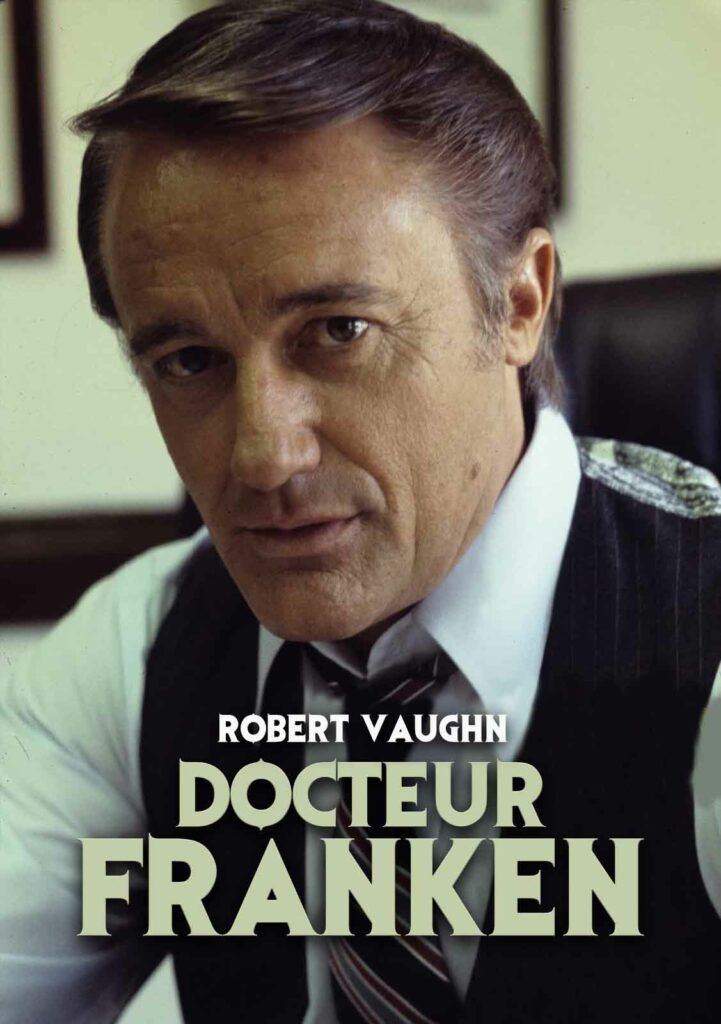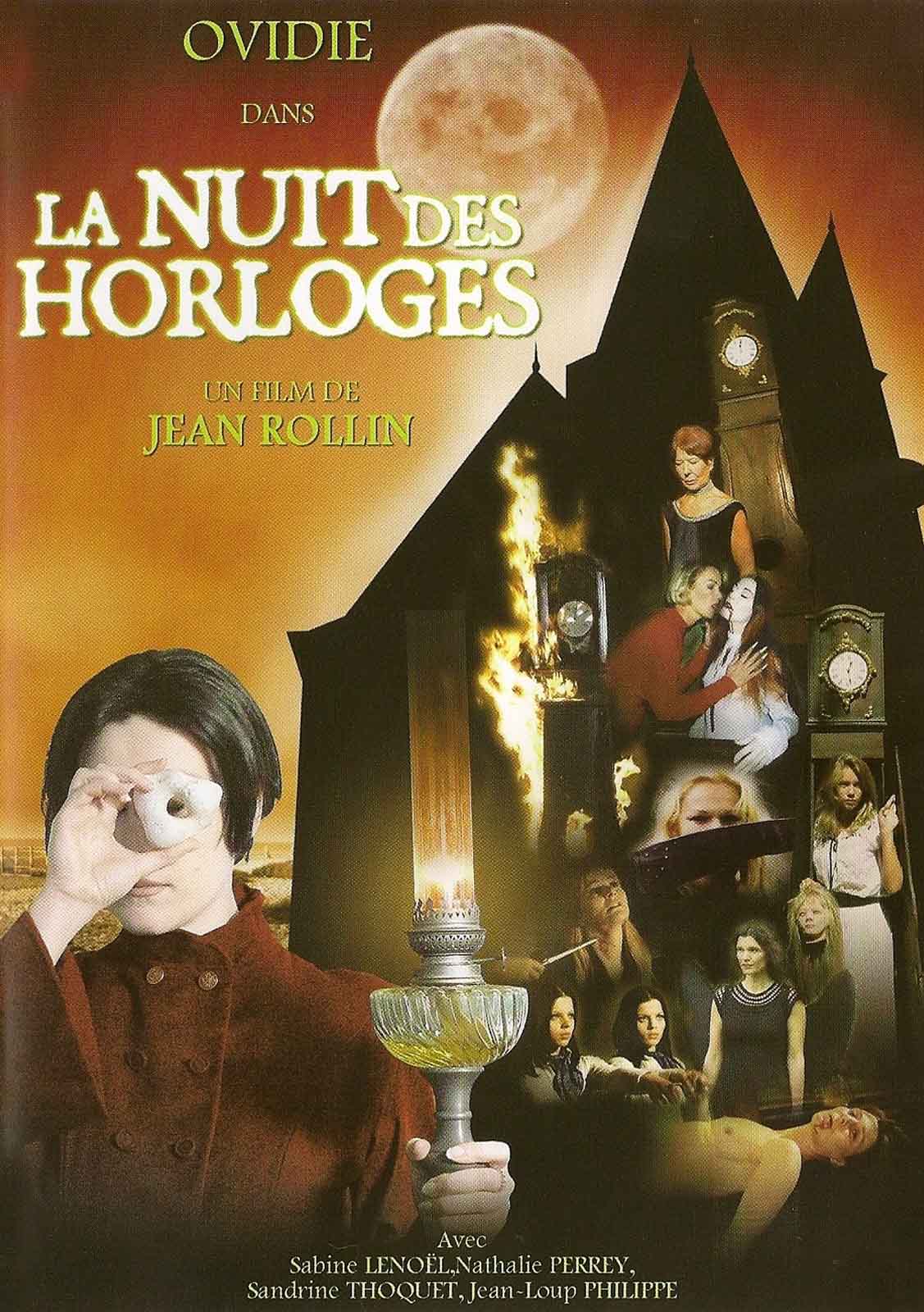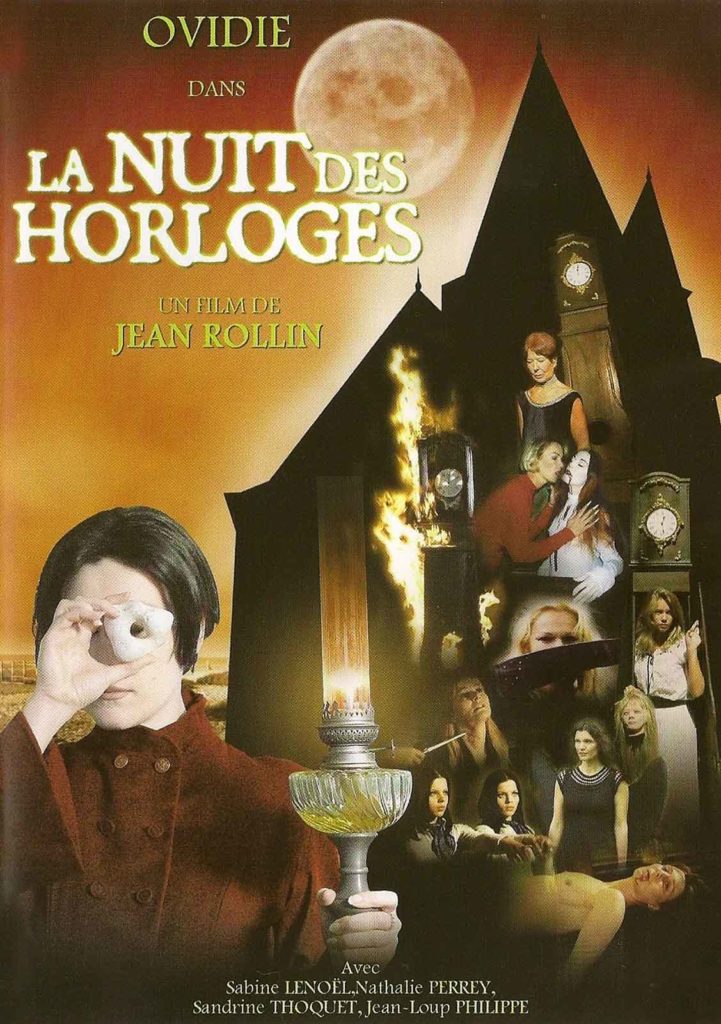Abel Gance réalise un remake de son pamphlet antimilitariste de 1919 en laissant l’horreur surnaturelle envahir la réalité…
J’ACCUSE !
1938 – FRANCE
Réalisé par Abel Gance
Avec Victor Francen, Line Noro, Marie Lou, Jean-Max, Paul Amiot, Georges Saillard, Jean-Louis Barrault, Marcel Delaître, Renée Devillers, Romuald Joubé, André Nox
THEMA MORT
Abel Gance est un cinéaste perfectionniste, ce que son monumental Napoléon a prouvé au monde entier. Ainsi, après avoir réalisé J’accuse ! en 1919, il décide de refaire le film dans une version parlante pour pouvoir revenir en quelque sorte sur l’ouvrage et le perfectionner. L’ironie veut que la première mouture de cette fable violemment antimilitariste soit sortie sur les écrans au lendemain de la première guerre mondiale, et que son remake ait été réalisé un an avant que n’éclate la seconde. Le générique annonce immédiatement la couleur, positionnant le film comme une « fresque tragique des temps modernes vue et réalisée par Abel Gance », après avoir affirmé son objectif premier : « aider au maintien et à la sauvegarde de la paix. » L’une des premières images est déjà lourde de sens : le sang coule sur le corps d’une colombe morte. La guerre de 14-18 pétarade partout, mêlant les images de fiction et celles de la réalité en un cocktail troublant. Même pendant les moments de trêve, le cinéaste montre que le conflit continue à rugir sa soif de destruction, comme lors de ce montage parallèle surprenant où la chanson joyeuse de l’aubergiste Flo (Marie Lou) est rythmée par les tirs assourdissants des canons. Alors que tout le monde guette l’armistice avec impatience, une patrouille est tirée au sort pour une mission à l’issue de laquelle les chances de survie sont minimes. « Y’aura bientôt plus d’arbre pour faire des croix » se désespère l’un des poilus, aussi désemparé que ses camarades…


Lorsque sonne enfin le cessez le feu, l’euphorie cohabite avec une profonde tristesse. Car le nombre de soldats tombés au champ de bataille est colossal. La dernière patrouille envoyée en mission suicide est revenue les pieds devant, à l’exception de Jean Diaz (Victor Francen) qui s’en sort par miracle et revient à la vie civile. Il peut désormais reprendre ses recherches là où il les avait interrompues et permettre au drame de guerre de basculer dans le fantastique et la science-fiction. Car Jean est persuadé qu’il a trouvé un moyen scientifique imparable pour faire cesser définitivement toute guerre. Dit-il vrai, ou est-ce l’éclat d’obus fiché dans son crâne qui porte atteinte à son raisonnement ? Une nuit d’orage, dans une atmosphère sinistre digne d’un Frankenstein d’Universal, il semble basculer dans la folie en affirmant avec terreur qu’il a réussi. Mais réussi quoi ? Il faudra attendre le climax du film pour le savoir…
La mort de la guerre
Quand Diaz s’exclame, le regard fou, « j’accuse les hommes de ne pas avoir tiré la leçon du gigantesque cataclysme et d’attendre les bras croisés qu’il recommence », cette colère face à l’éternelle absurdité de l’humanité semble bien être celle d’Abel Gance lui-même, qui transpose son utopie, sa hargne et son désespoir chez ce protagoniste tourmenté, que Francen joue avec une emphase étourdissante. L’entendre répéter en hurlant « J’accuse ! » avec dans les yeux un écarquillement digne de celui de Bela Lugosi procure un malaise grandissant. Progressivement, le film se dévêt de son enveloppe hyperréaliste pour tendre vers la politique fiction puis vers l’horreur dans ce qu’elle a de plus surnaturel. Mais pour brouiller les pistes, Gance sollicite de véritables « gueules cassées » qui offrent à la morbide sarabande finale (ancêtre des visions cauchemardesques que concocteront George Romero et Lucio Fulci) une tangibilité extrêmement inconfortable. Malgré cette solution de la dernière chance imaginée par un savant pacifiste au bout du rouleau, le final reste empli de désespoir, laissant augurer que même face à l’abomination l’homme ne retiendra rien et continuera à répéter les mêmes erreurs. La réalité rattrapera d’ailleurs la fiction. Vingt mois après la sortie de J’accuse ! sur les écrans, l’Allemagne envahit la Pologne et déclenche la seconde guerre mondiale…
© Gilles Penso
Partagez cet article