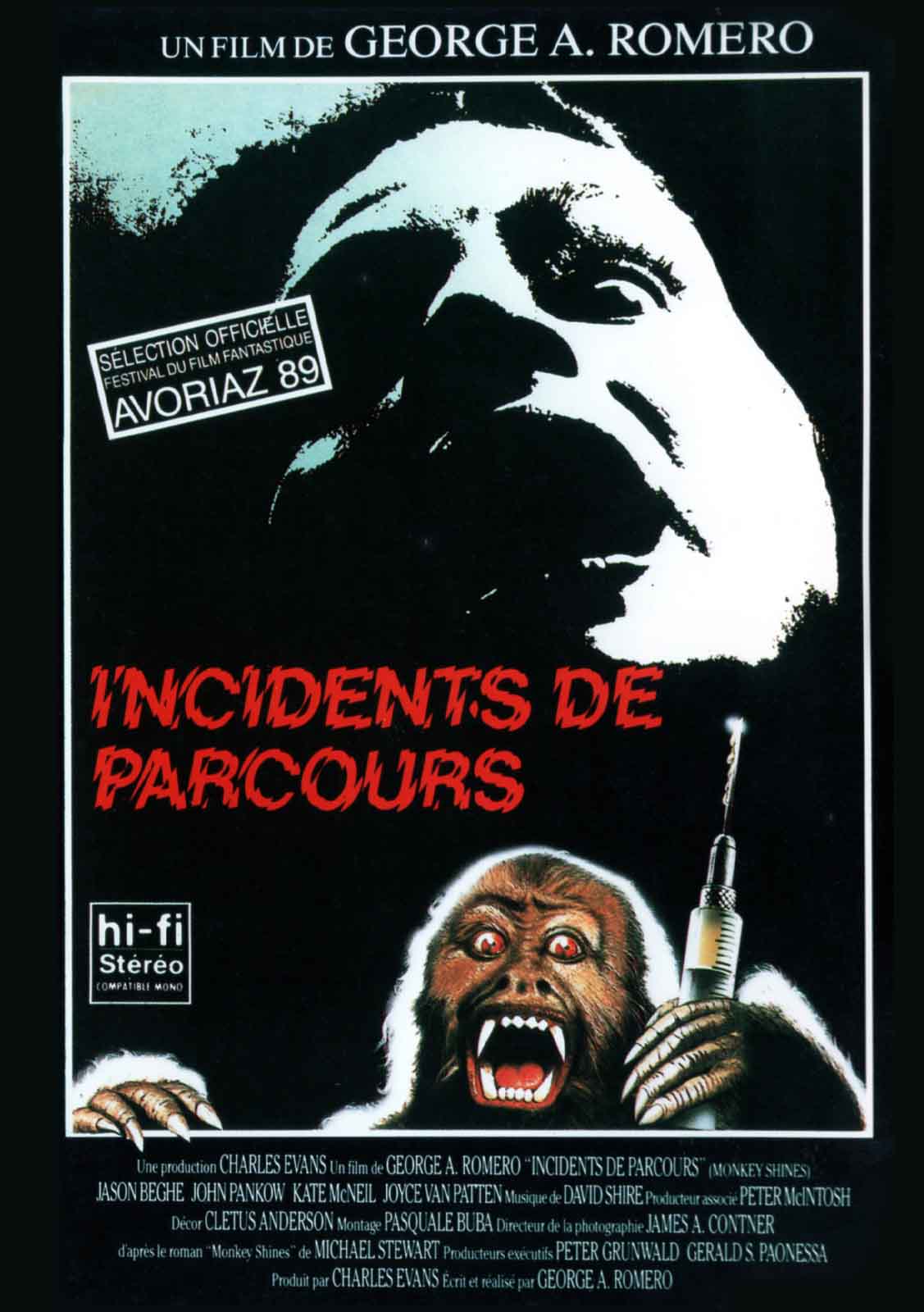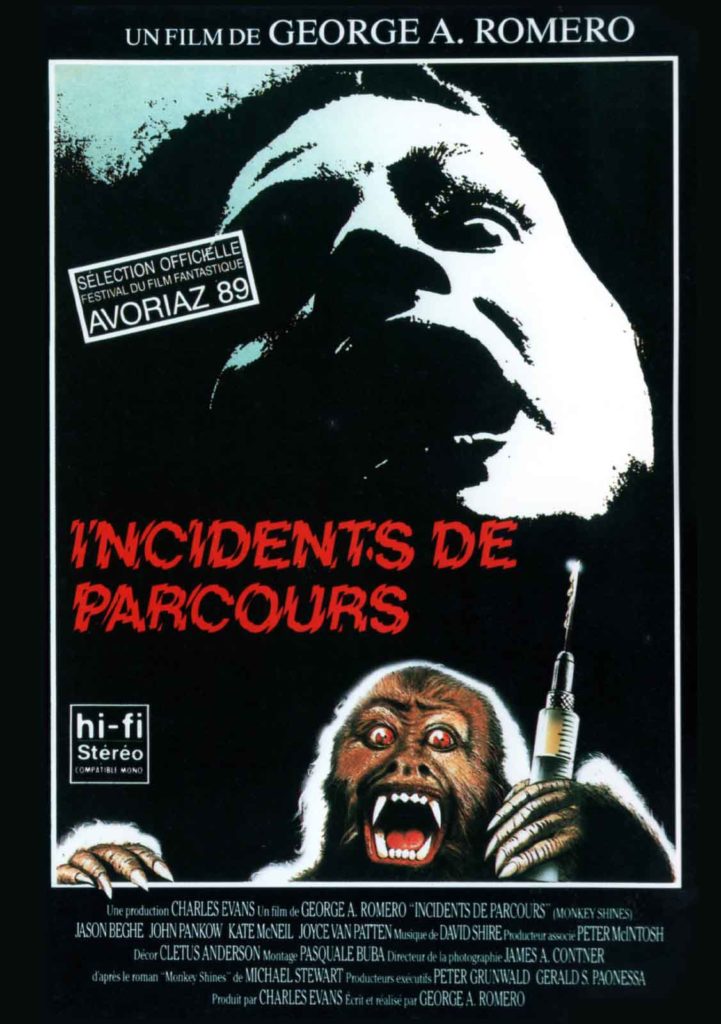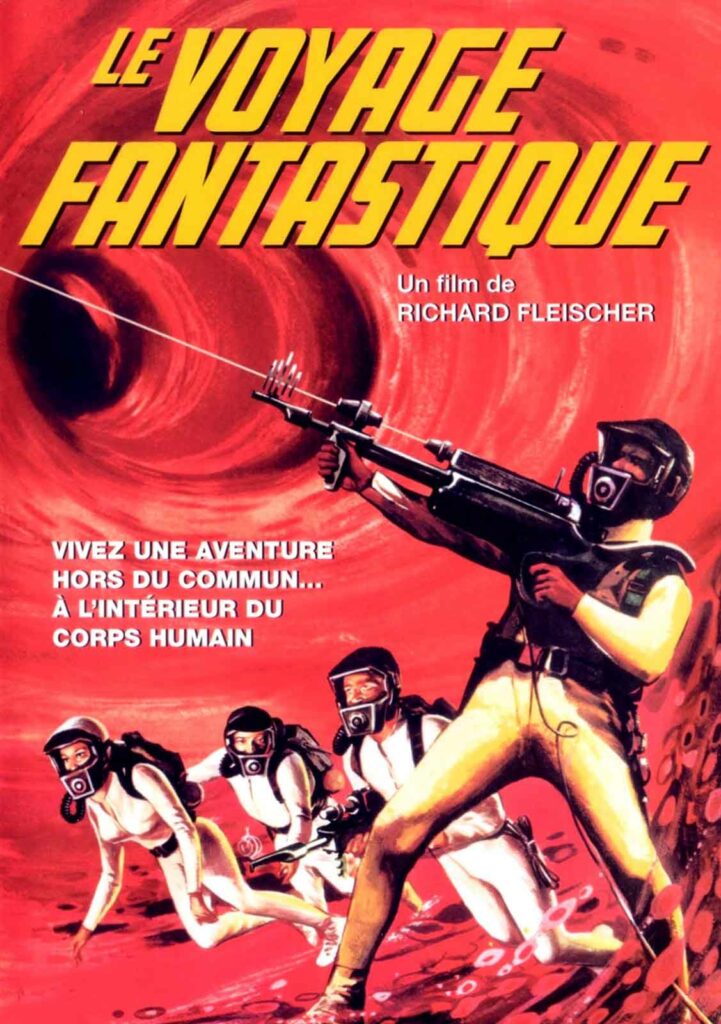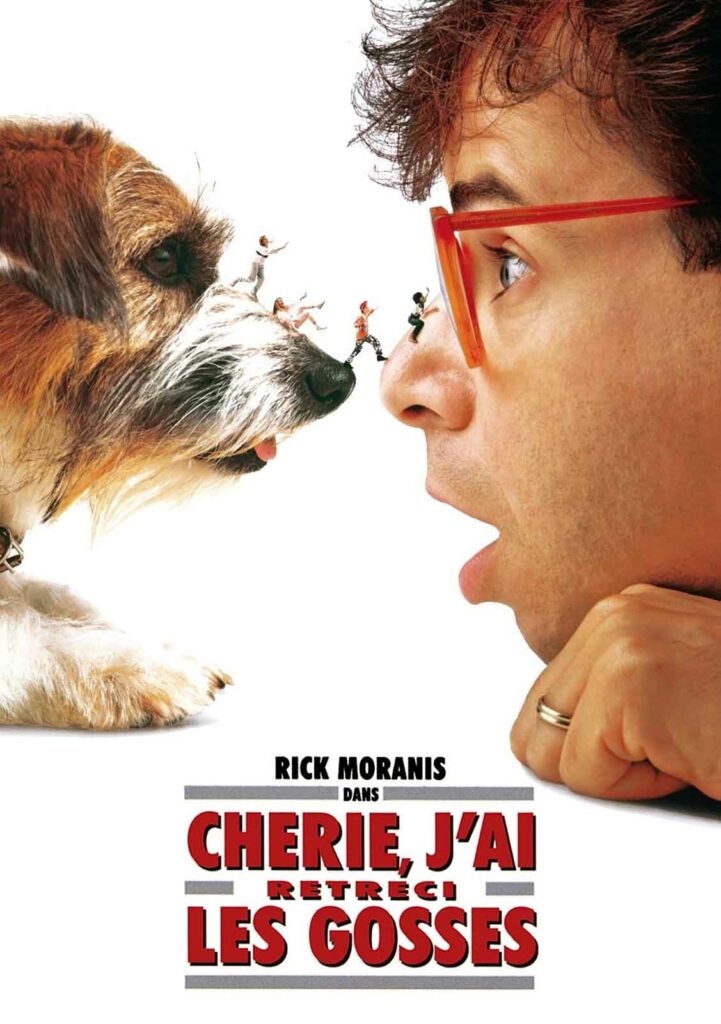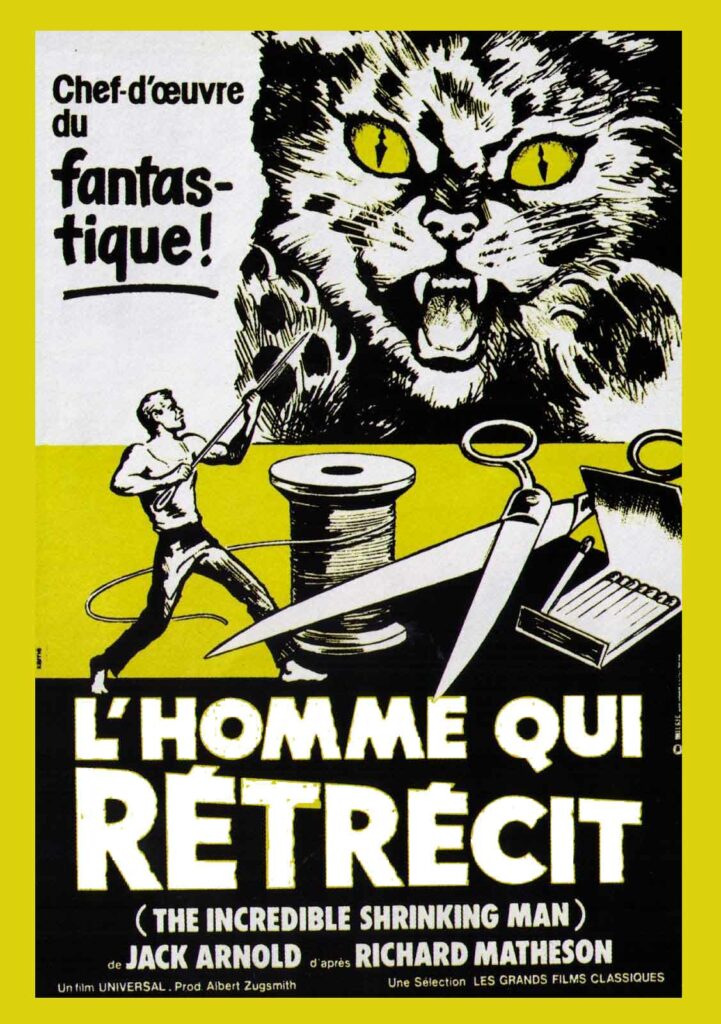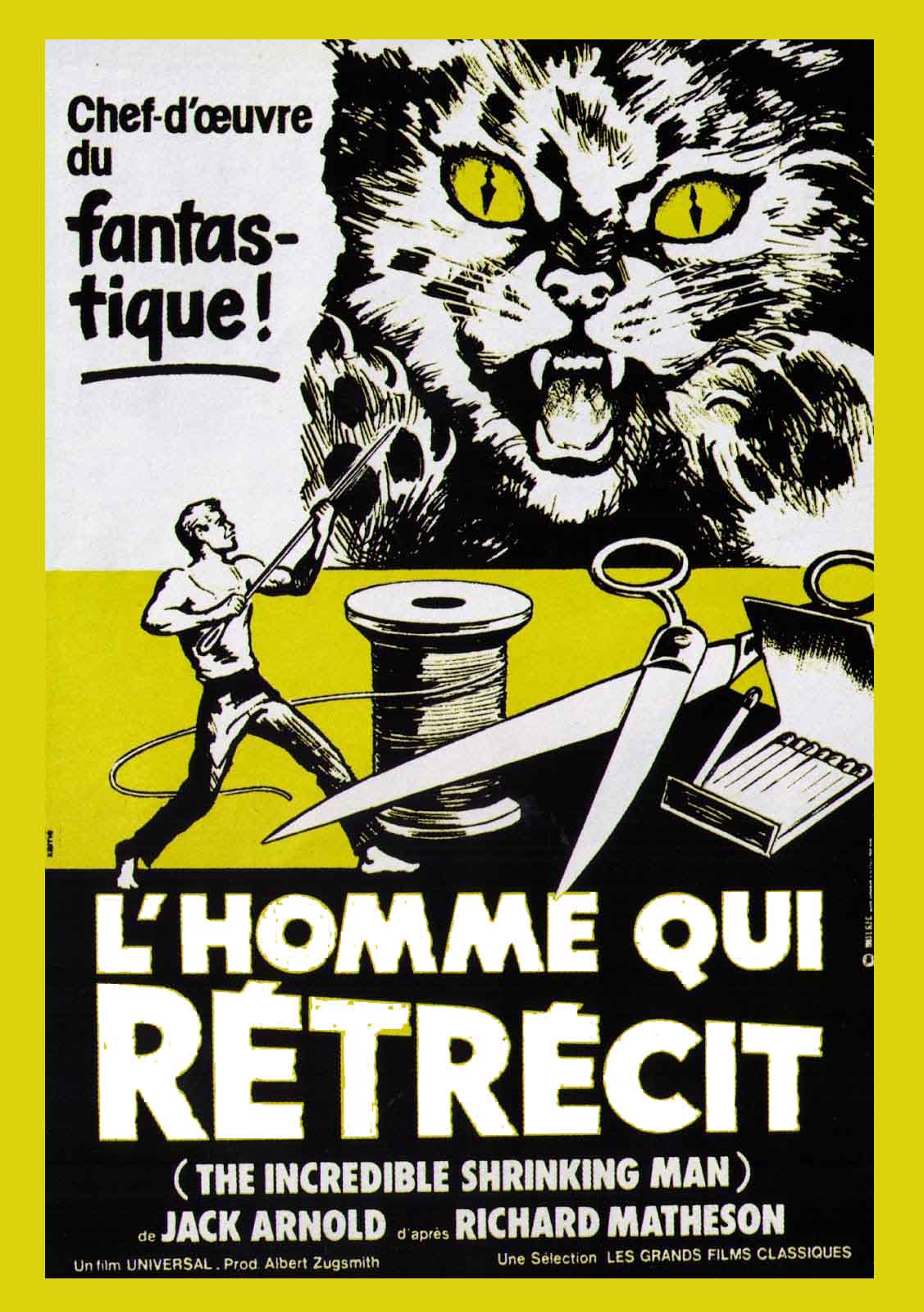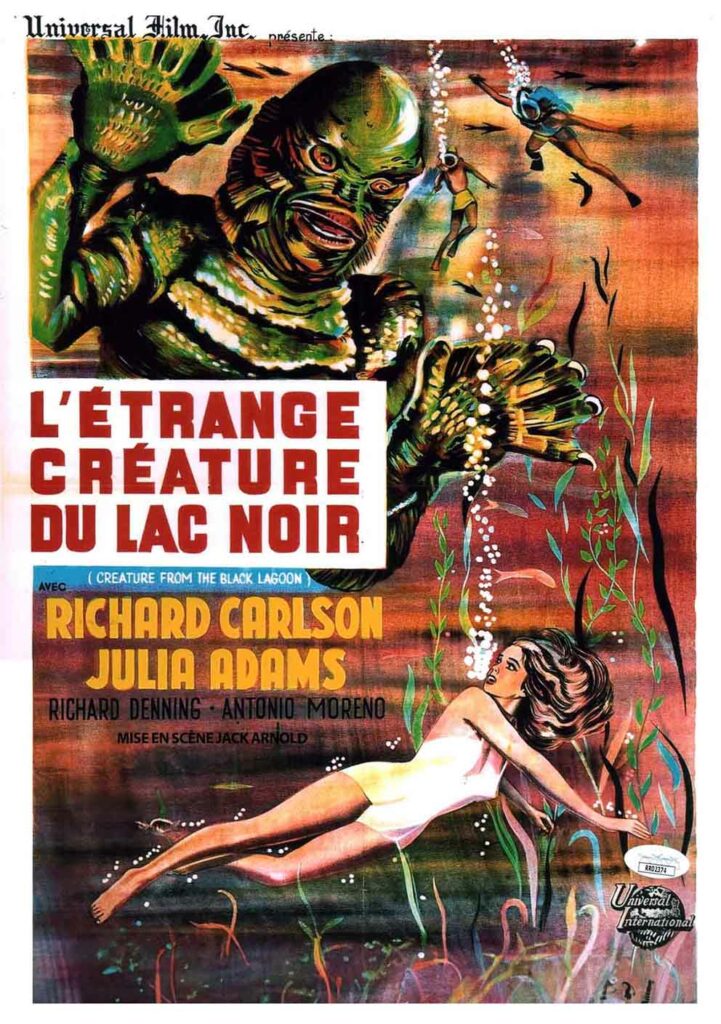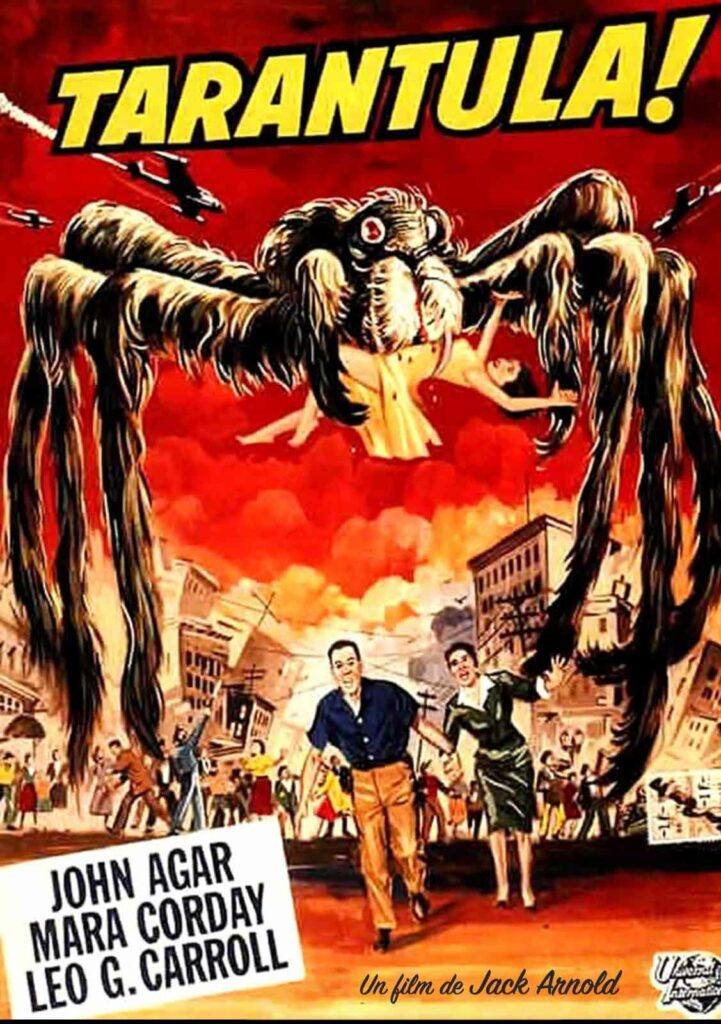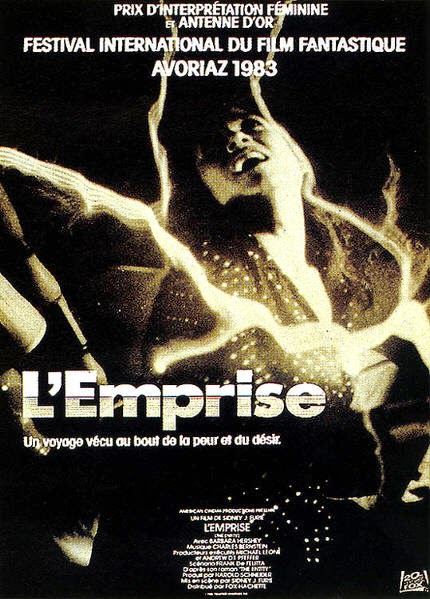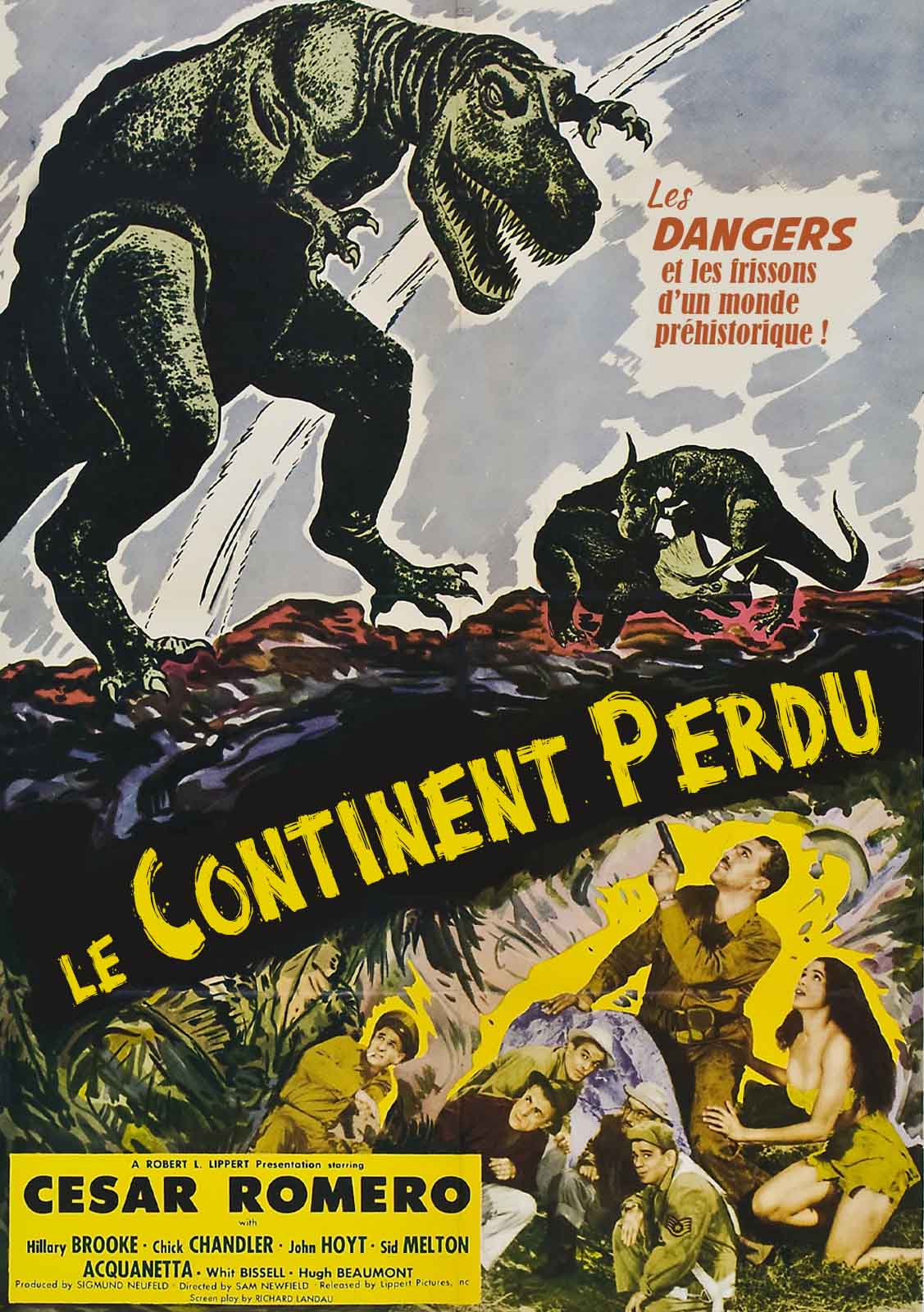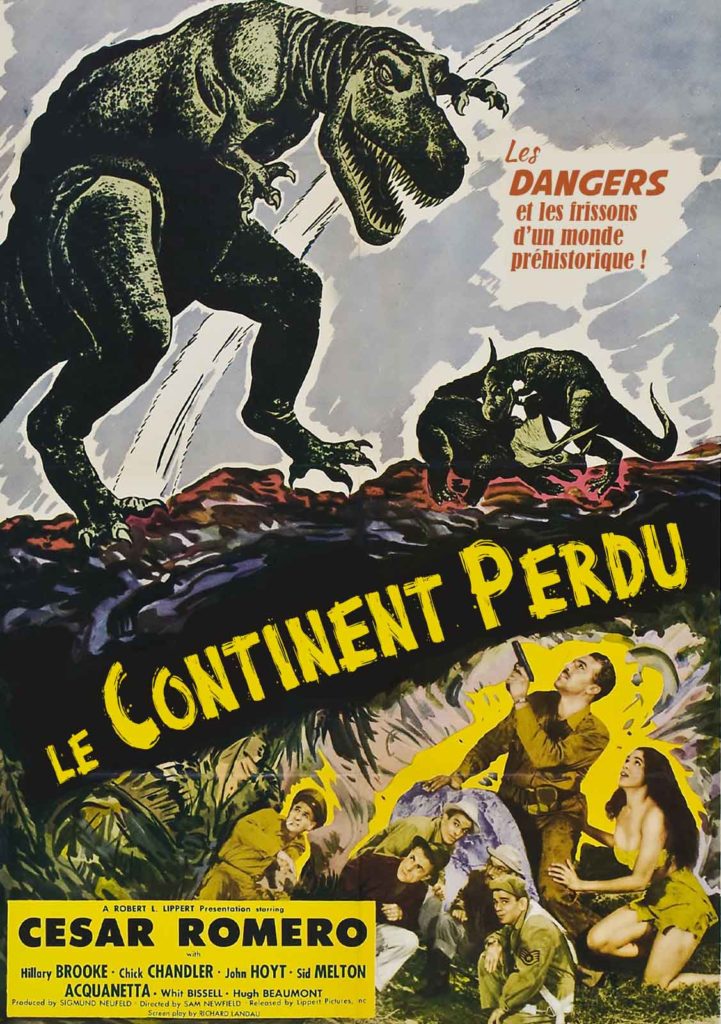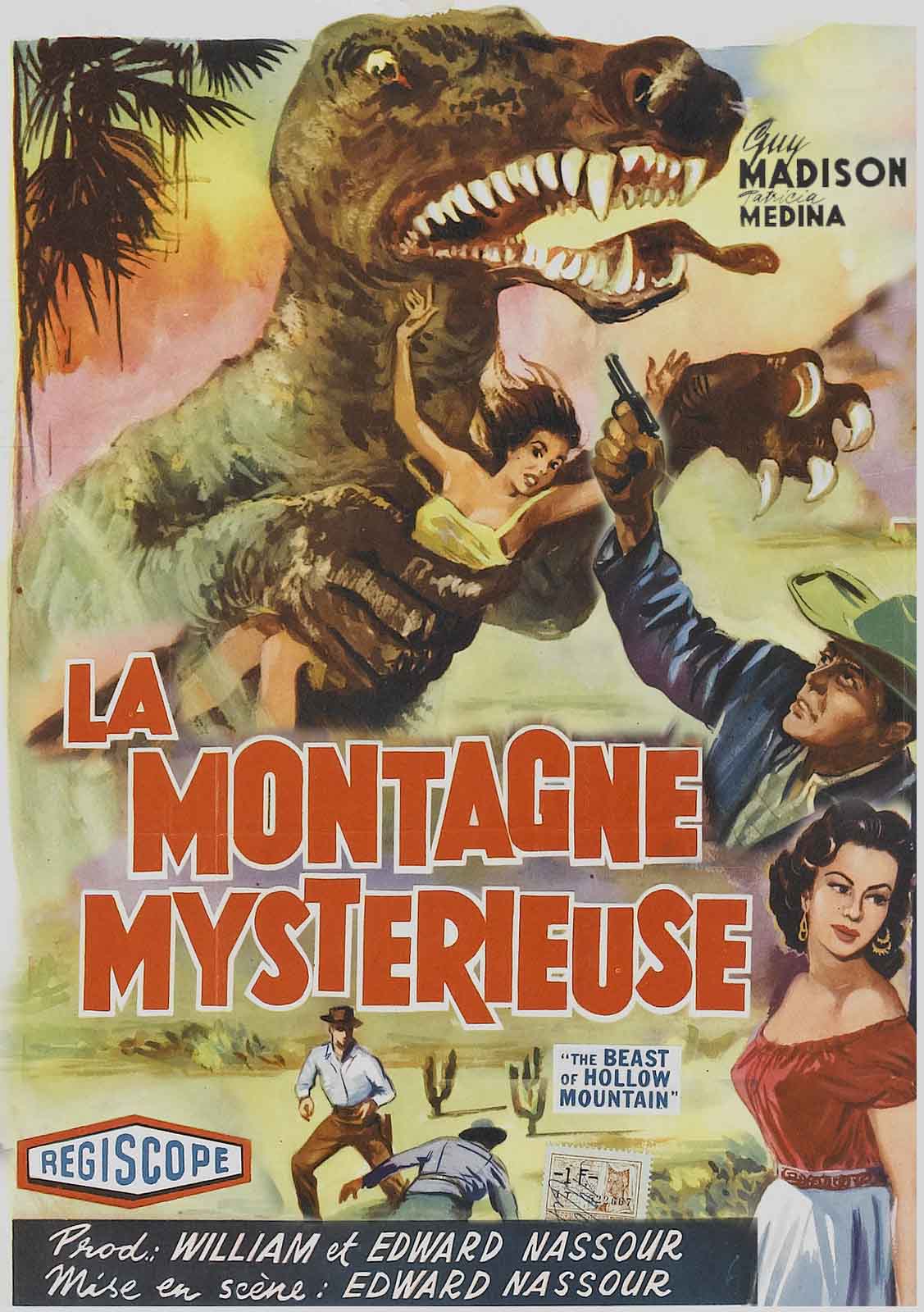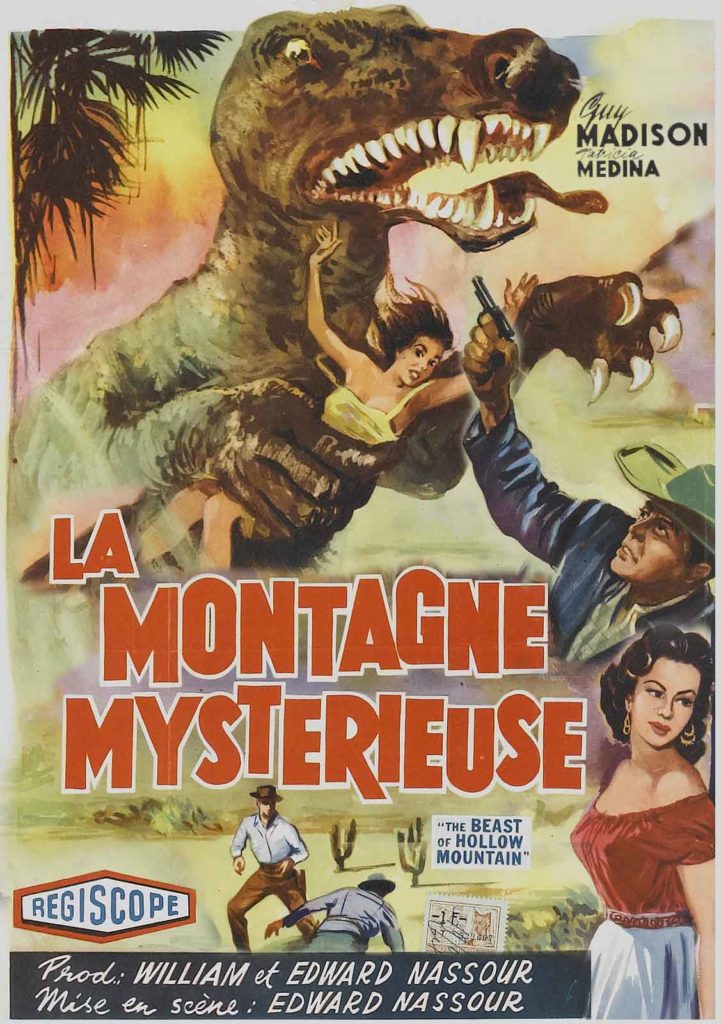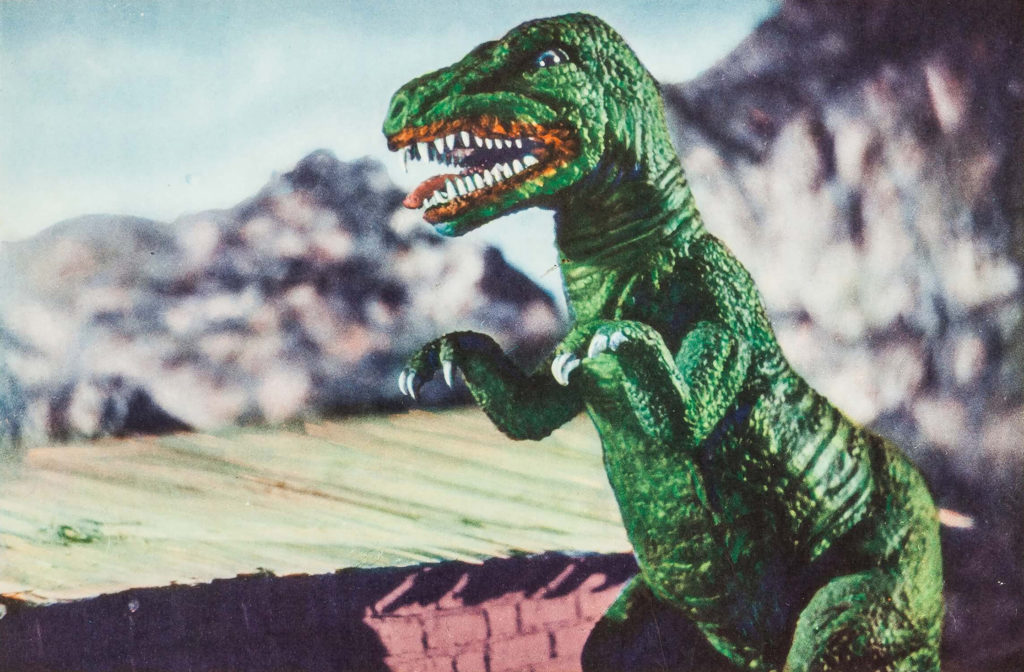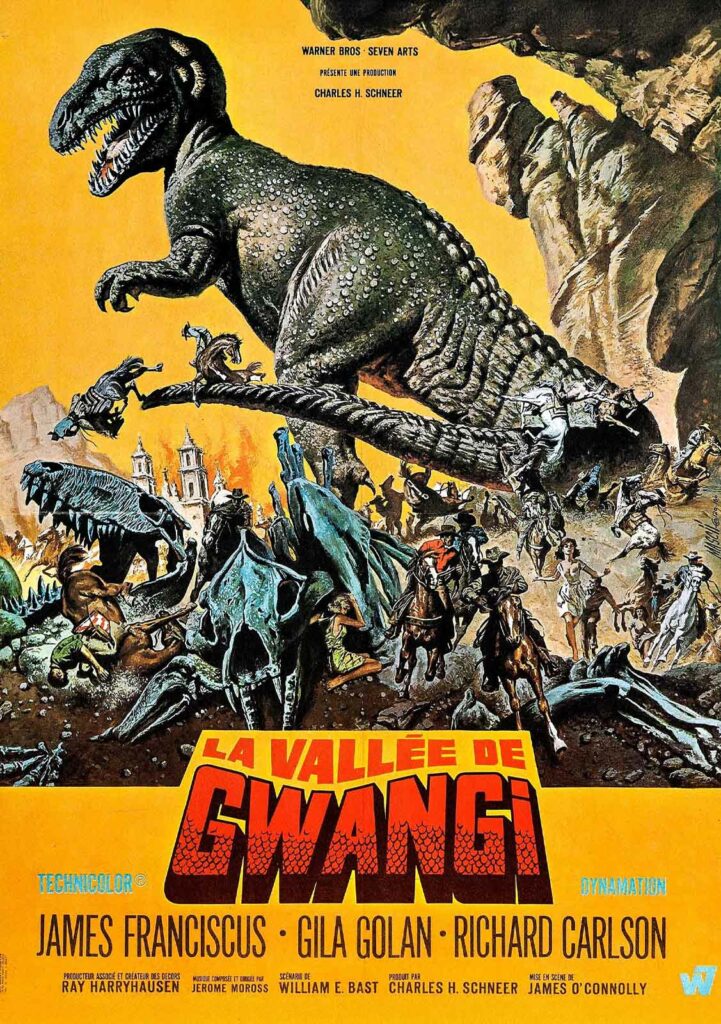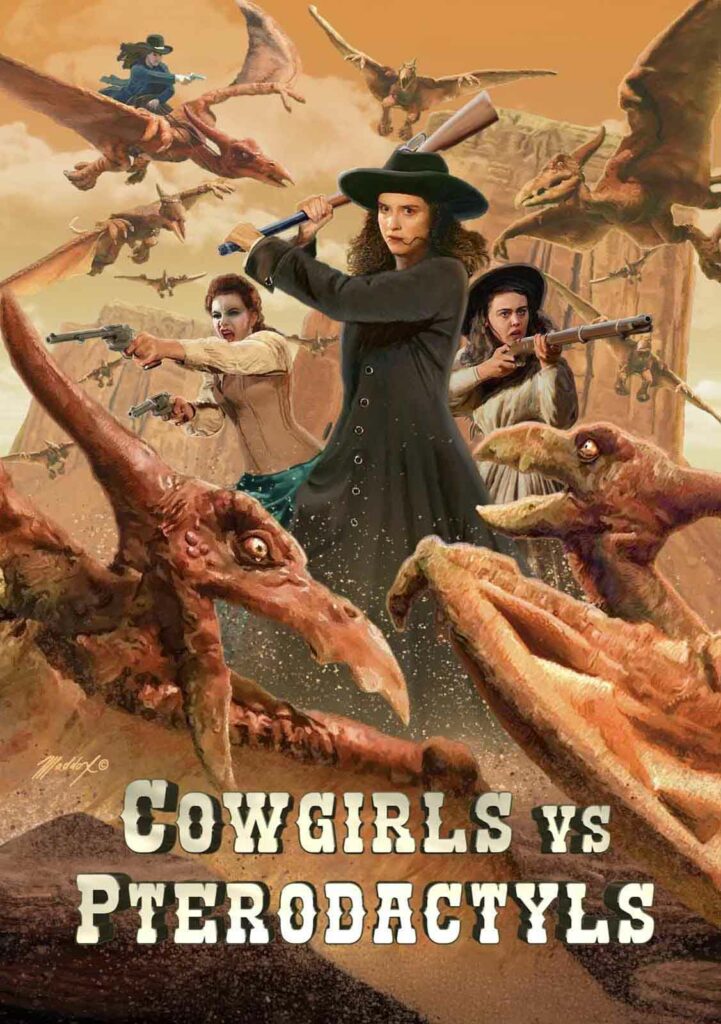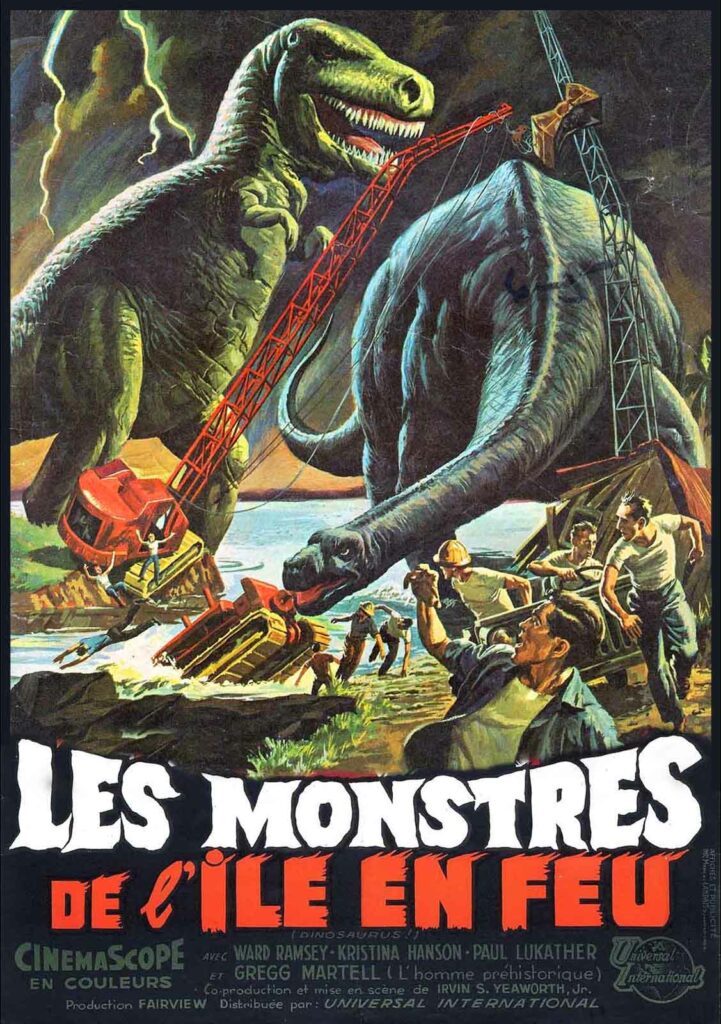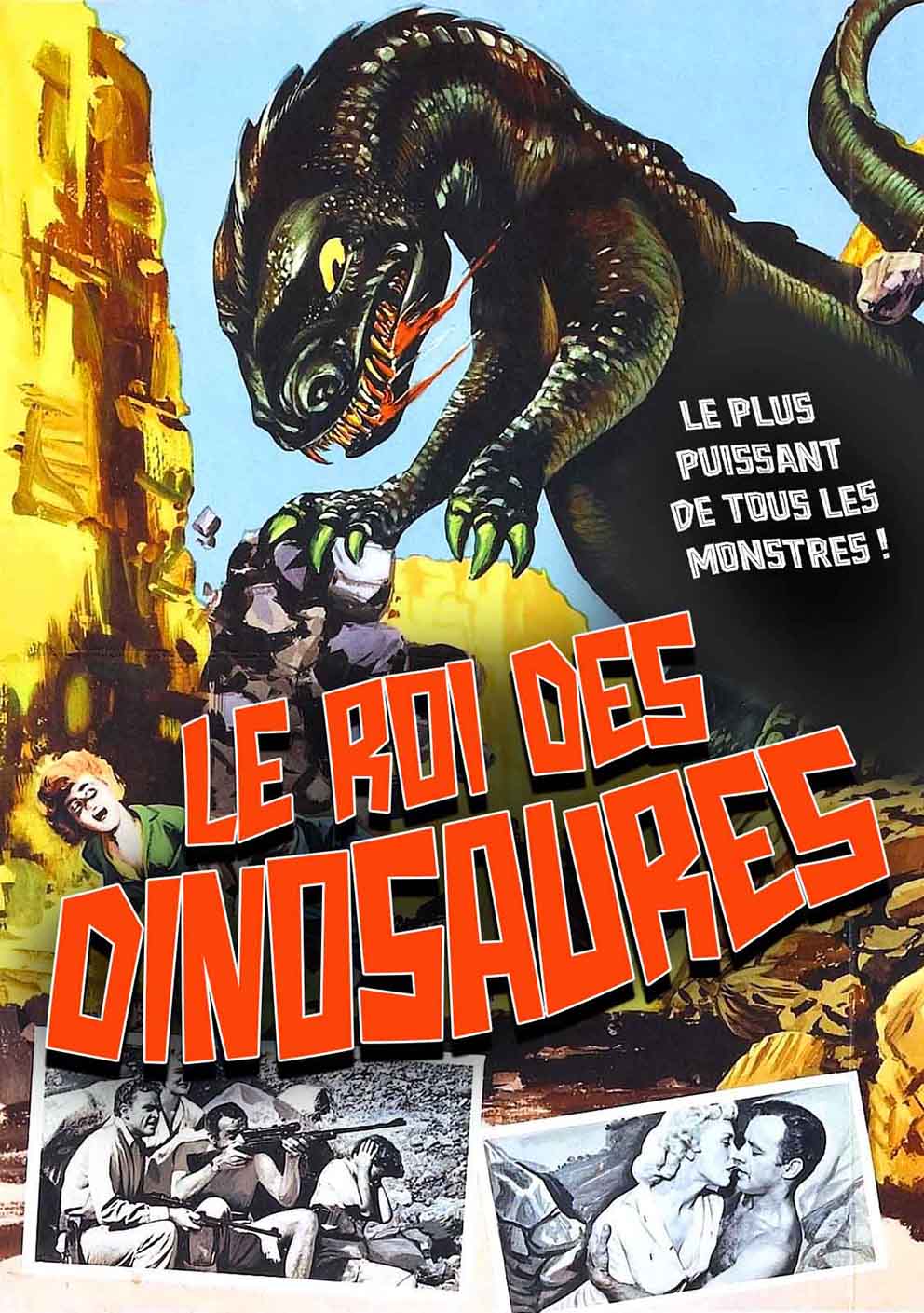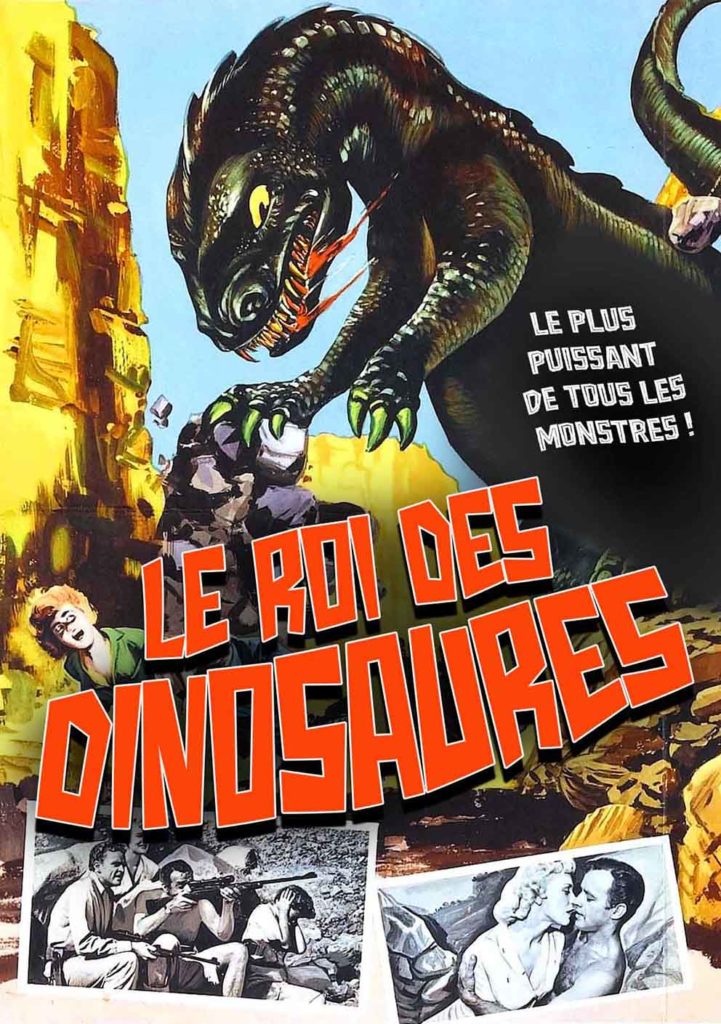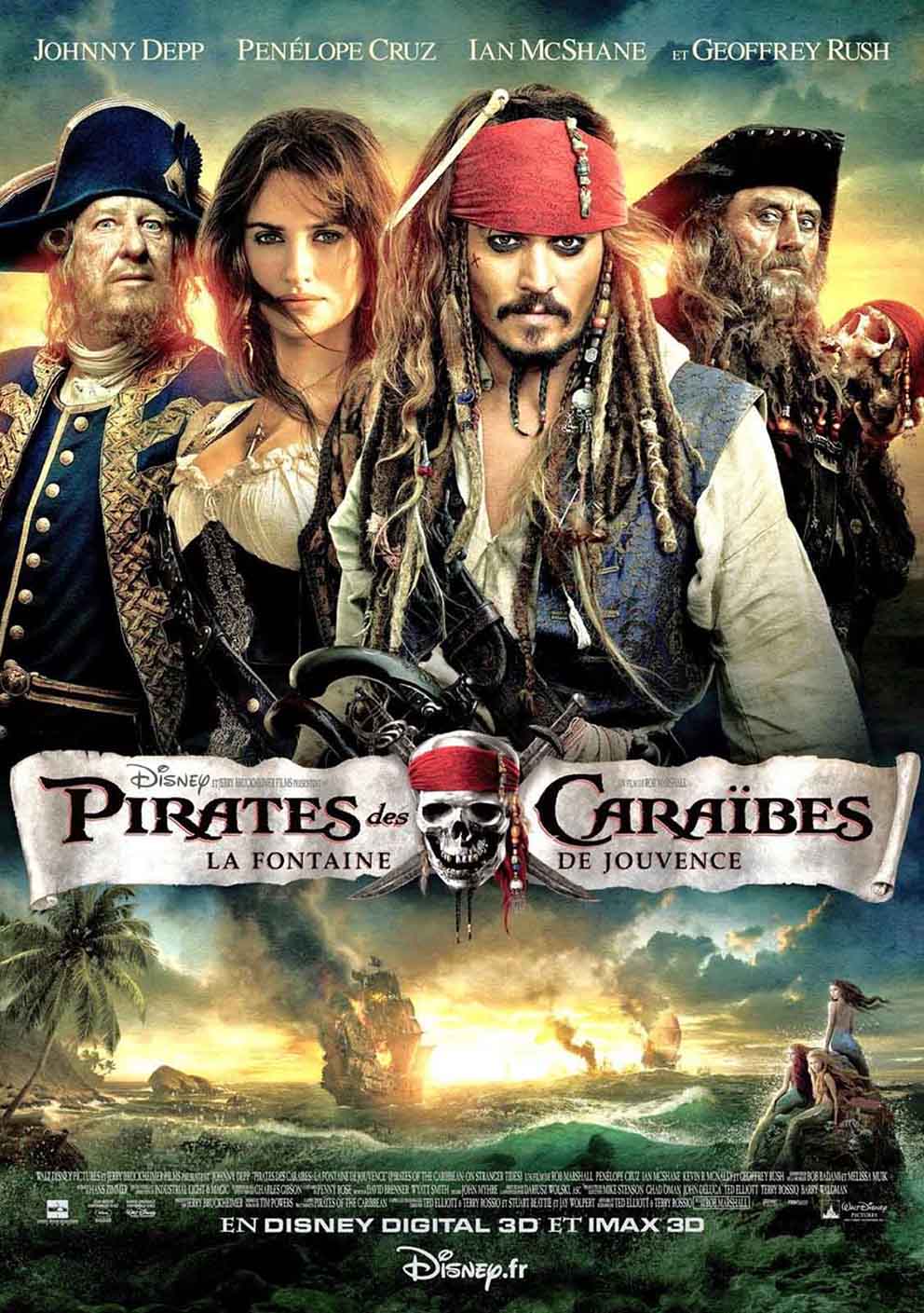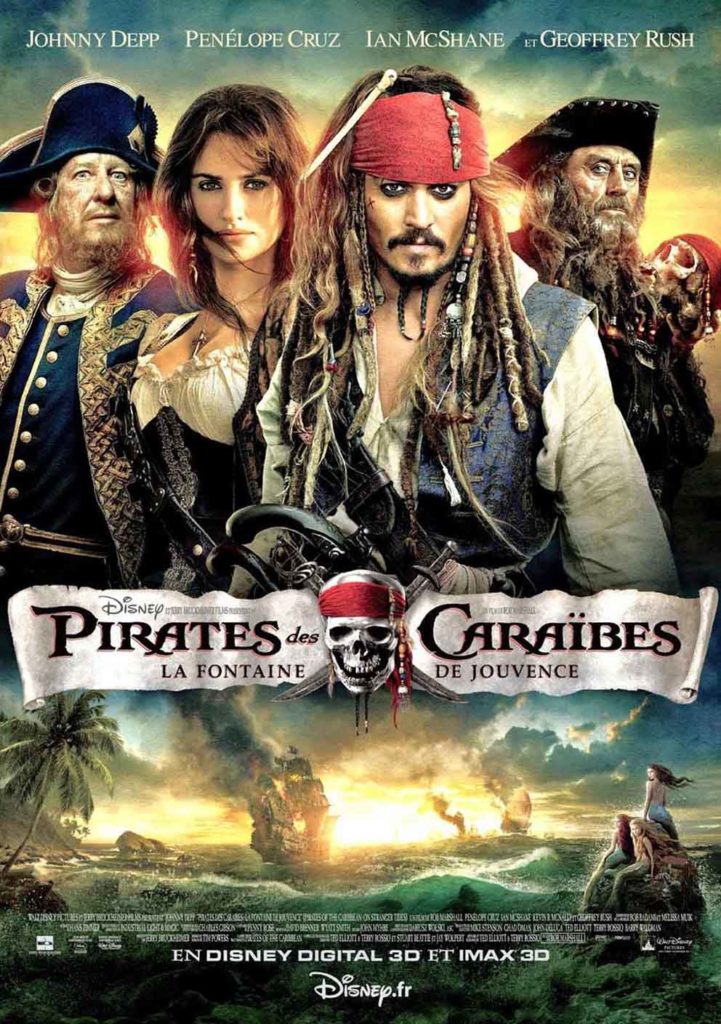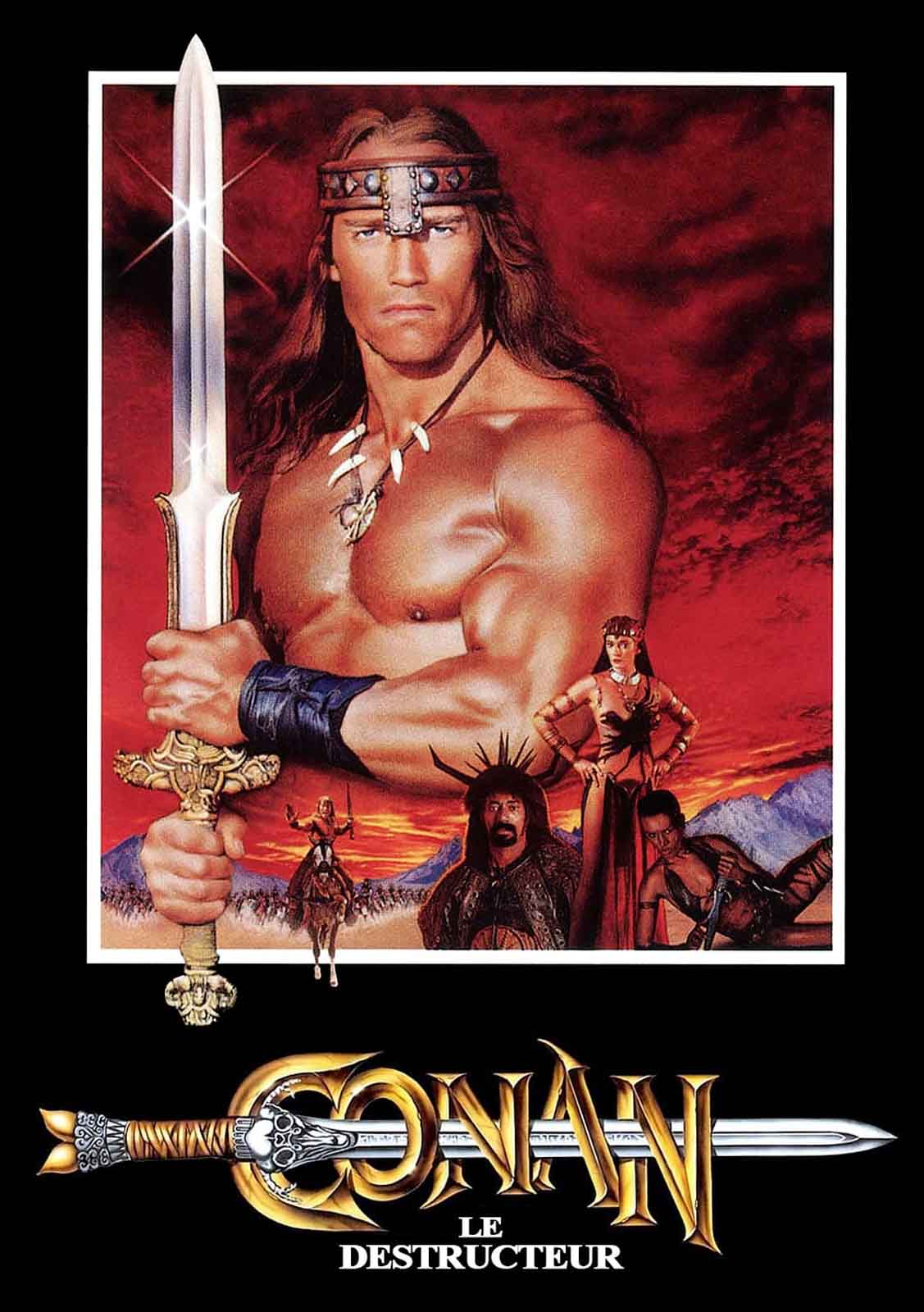Derrière ce titre français énigmatique se cache une œuvre déviante de David Cronenberg dans laquelle, une fois de plus, les émotions fortes prennent corps et chair
THE BROOD
1979 – CANADA
Réalisé par David Cronenberg
Avec Oliver Reed, Samantha Eggar, Art Hindle, Nuala Fitzgerald, Henry Beckham, Susan Hogan
THEMA MEDECINE EN FOLIE I ENFANTS
Il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine, David Cronenberg, metteur en scène actuellement adoubé par l’intelligentsia cinéphile, réalisait d’obscures séries B gore et déviantes, ne vous en déplaise. Chromosome 3, dont on préférera le titre original, qu’on peut traduire littéralement par « la couvée », est de cette race de films tétanisants qui vous hantent à vie. La « Cronenberg touch », savant mélange entre des postulats scientifiques crédibles et des métaphores horrifiques troublantes, y fonctionne à plein régime. Le sujet est passionnant : un psychiatre (Oliver Reed, solide) applique une méthode révolutionnaire pour soigner ses patients, les poussant à extérioriser et exorciser physiquement leurs traumatismes les plus profonds au cours d’éprouvantes thérapies. Mais les effets secondaires provoqués chez Nola Carveth (dérangeante Samantha Eggar) vont le dépasser complètement… Impossible d’en dire plus sans déflorer une intrigue à tiroirs absolument inédite et terrifiante. Cette matérialisation de la colère peut certes vaguement rappeler le formidable Planète interdite de Fred McLeod Wilcox, mais Cronenberg, animé par une rage toute personnelle (à l’époque en plein divorce, il fut contraint d’arracher sa fille des griffes d’une secte antipsychiatrique qui avait déjà embrigadé sa femme), défie ici toute concurrence en explosant les limites de l’horreur psychologique.


Le spectateur assiste, hypnotisé par le rythme lancinant et l’atmosphère dépressive, à un crescendo de séquences graphiquement traumatisantes (la scène de la cuisine, le meurtre à l’école, les enfants marchant sur la route enneigée) menant à un final totalement autre, gorgé d’images fantasmagoriques que ne renierait pas un Jodorowsky. Le tout emmené brillamment par la stridente musique d’un Howard Shore ayant retenu les leçons anxiogènes du Herrmann de Psychose… Mais là ou un tâcheron aurait simplement cédé à une déferlante gratuite de plans sanglants, Cronenberg réalise le tour de force de lier intimement la violence la plus crasse à l’analyse psychique la plus subtile. Chaque événement dramatique, chaque sentiment exacerbé induit immédiatement une cause physique, et un rebondissement scénaristique.
Jusqu'au-boutiste et autobiographique
L’aspect émotionnel n’est pas en reste (touchante tristesse du père de Nola apprenant la mort de sa femme), l’hypocentre de l’histoire étant le déchirement d’une famille et les traumatismes de l’enfance se transmettant d’une génération à une autre. Tout manichéisme est également exclus, chaque protagoniste demeurant trouble bien qu’animé d’intentions compréhensibles : le docteur Raglan cherche à faire avancer la science, mais au détriment de la morale la plus élémentaire, Nola se comporte en protectrice avec sa fille mais reproduit les erreurs de sa propre mère, Franck Carveth, l’ex-mari et « héros », est plutôt antipathique et ne pense qu’à son enfant, rejetant sans compassion aucune les problèmes mentaux de sa femme. Chromosome 3 s’impose donc comme le film le plus jusqu’au-boutiste et autobiographique de son réalisateur, qui n’aura de cesse par la suite de se renouveler, tout en creusant un sillon passionnant et identifiable entre tous.
© Julien Cassarino
Partagez cet article