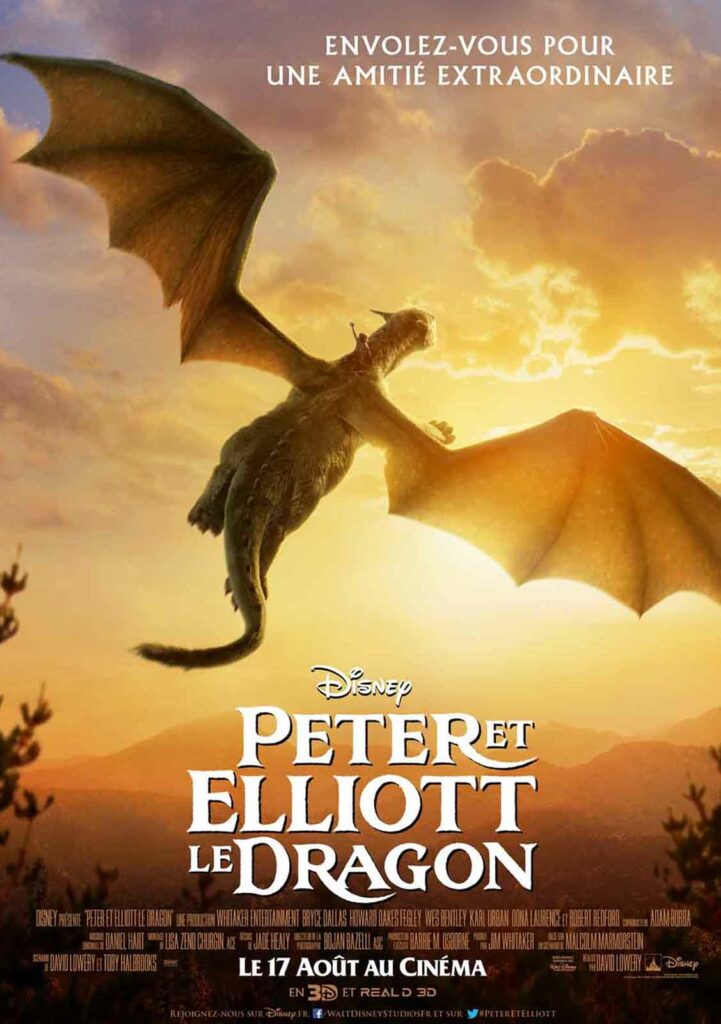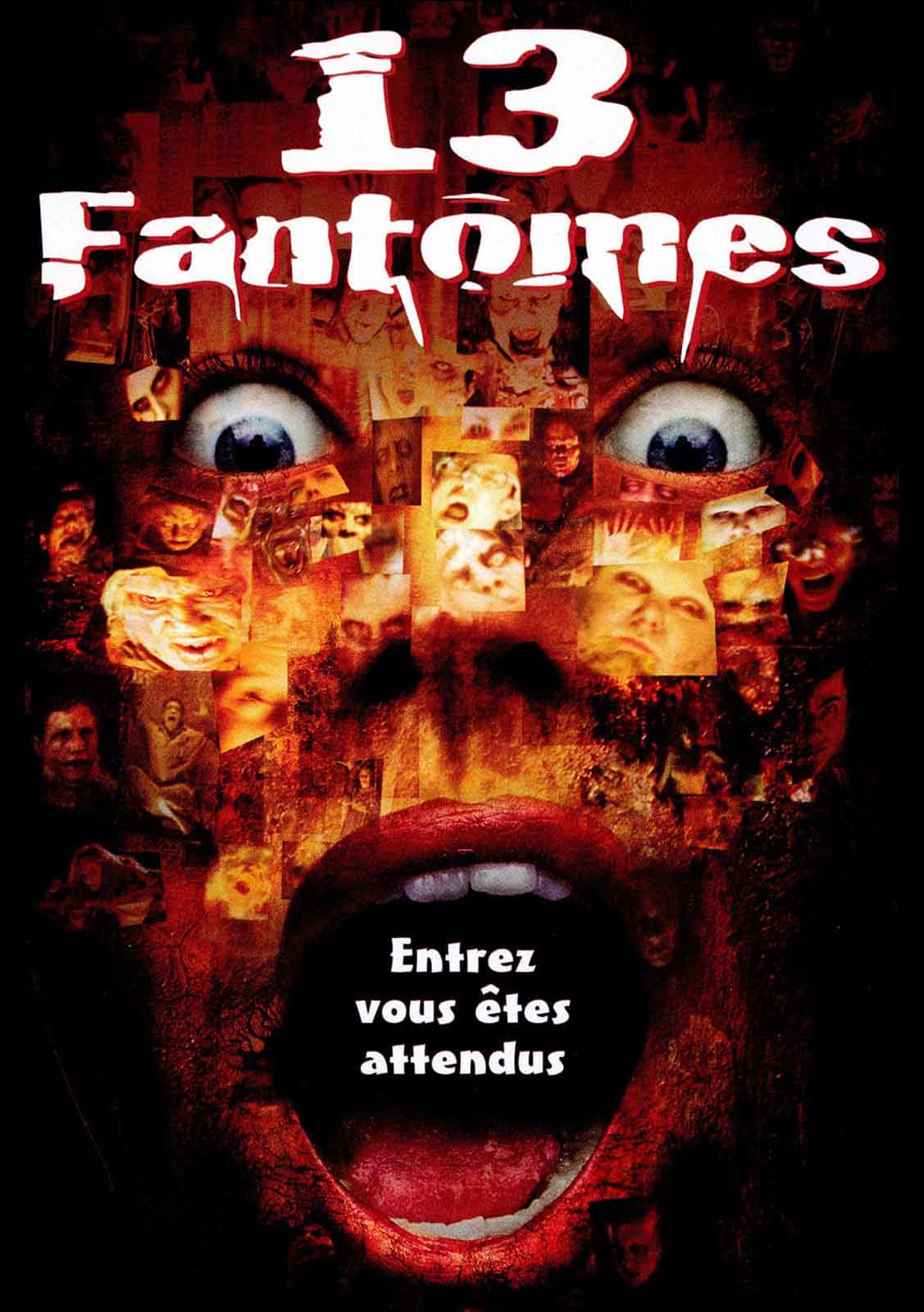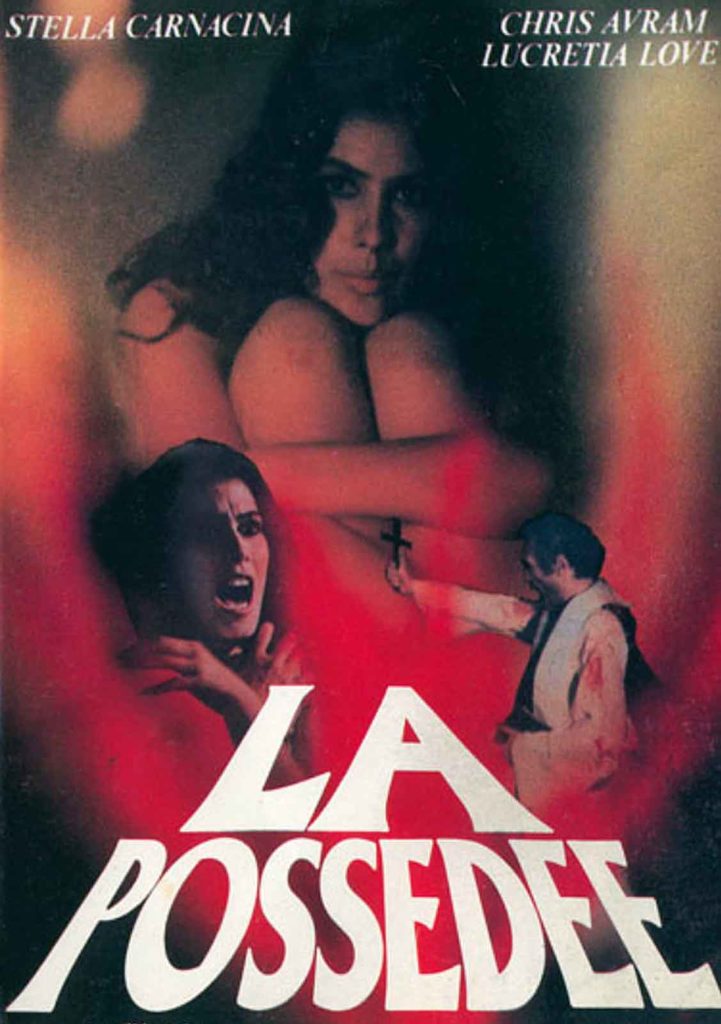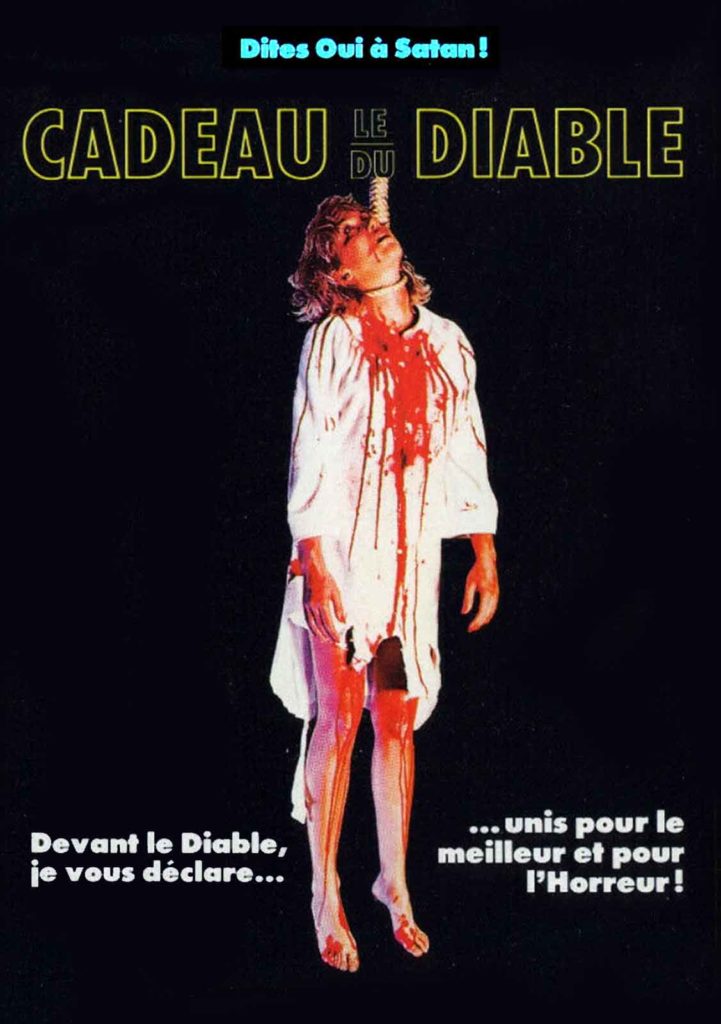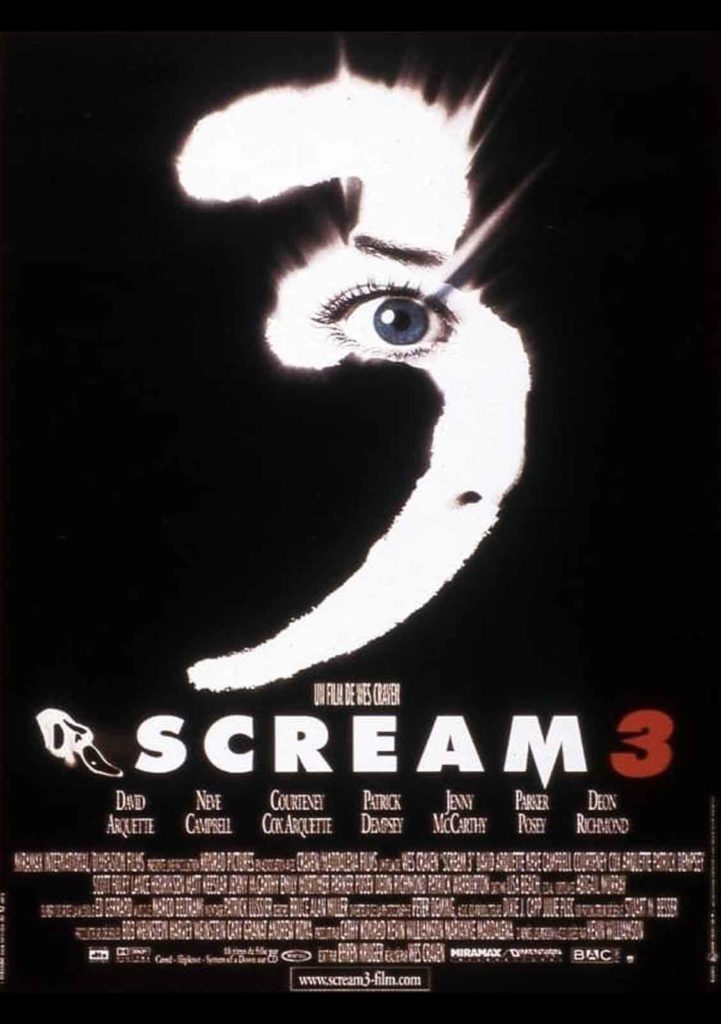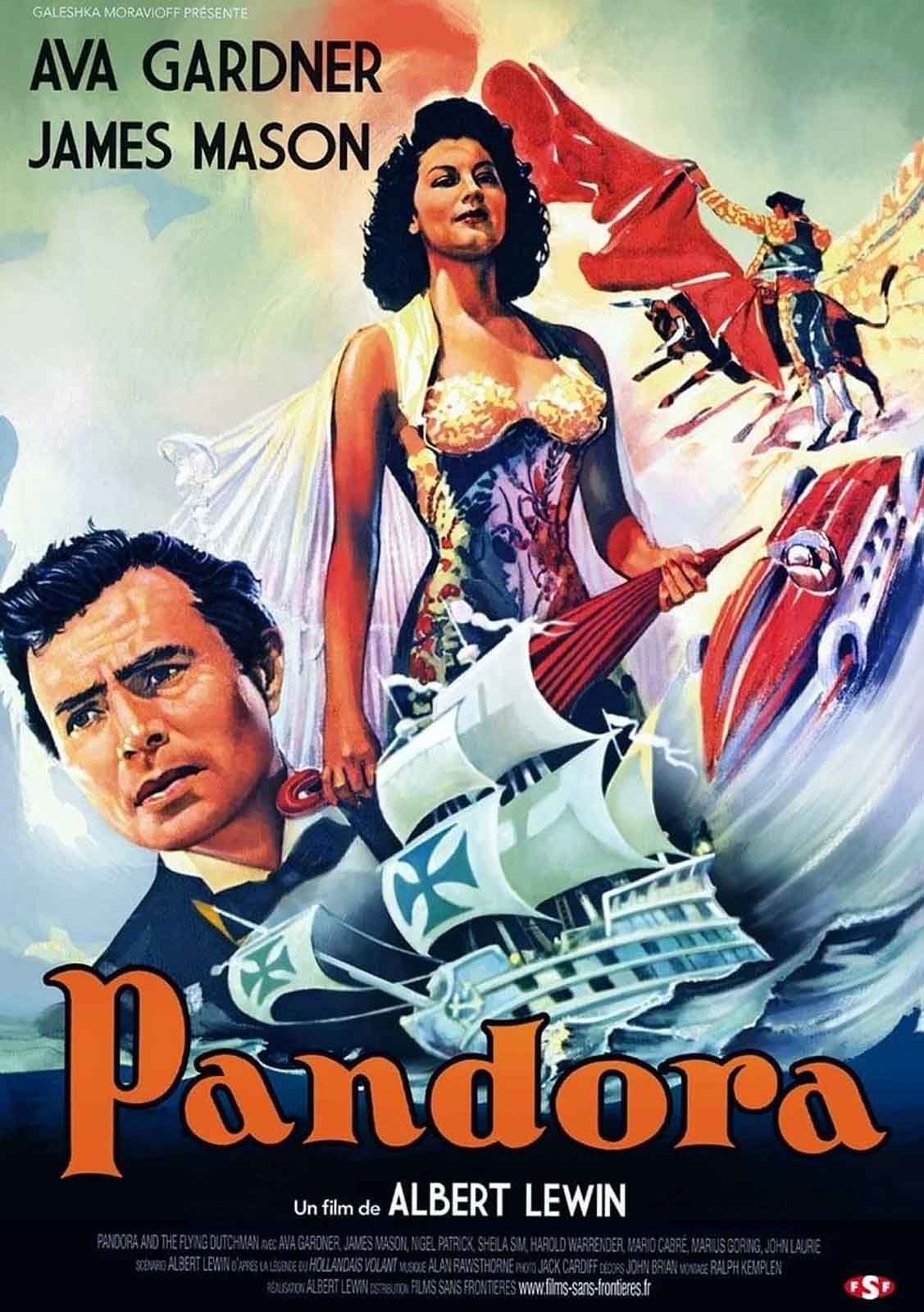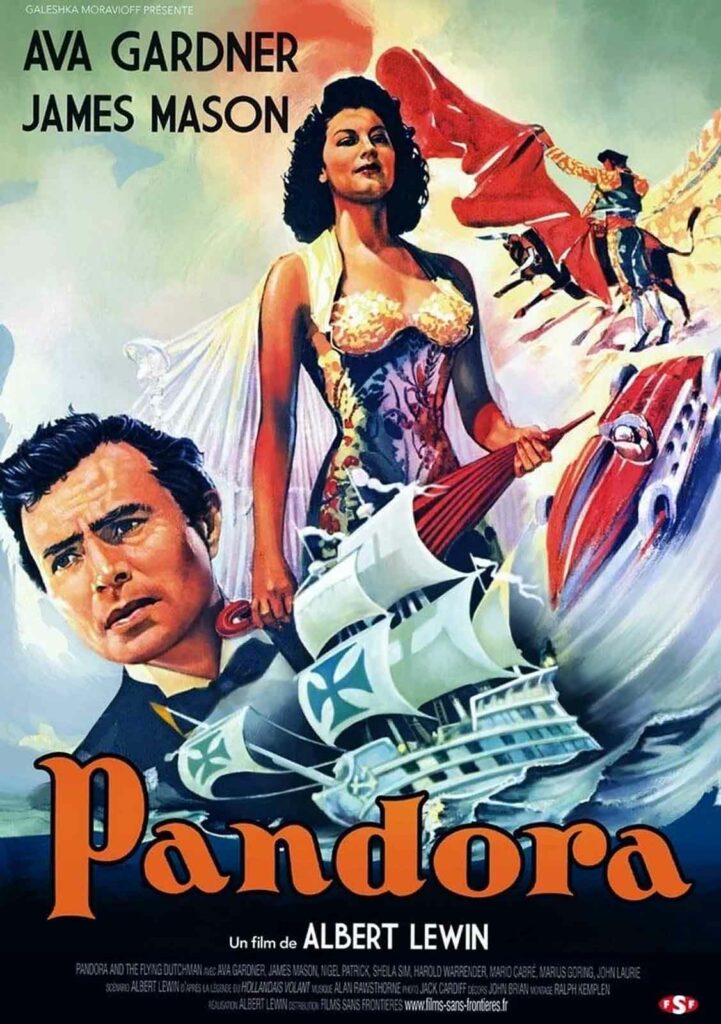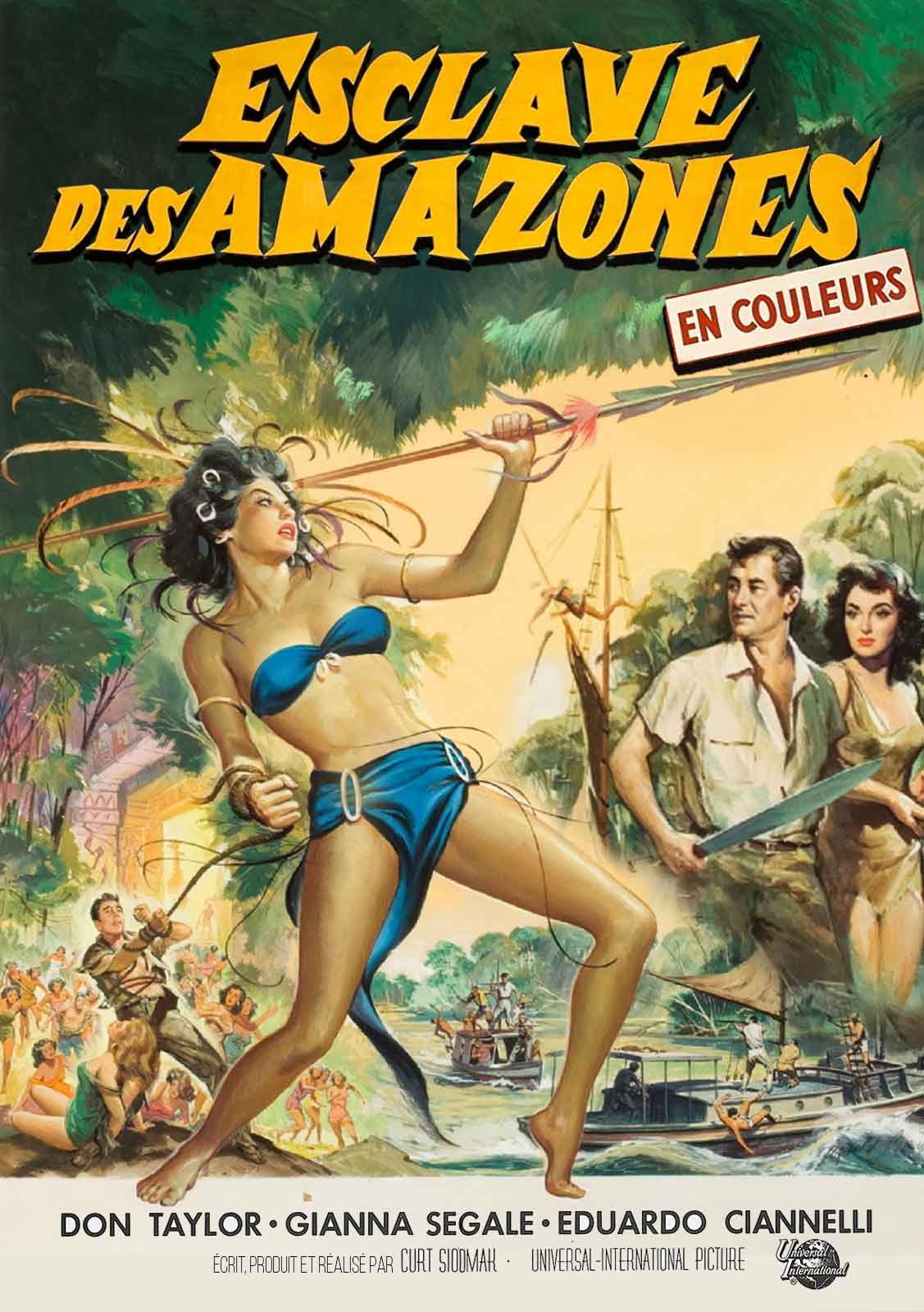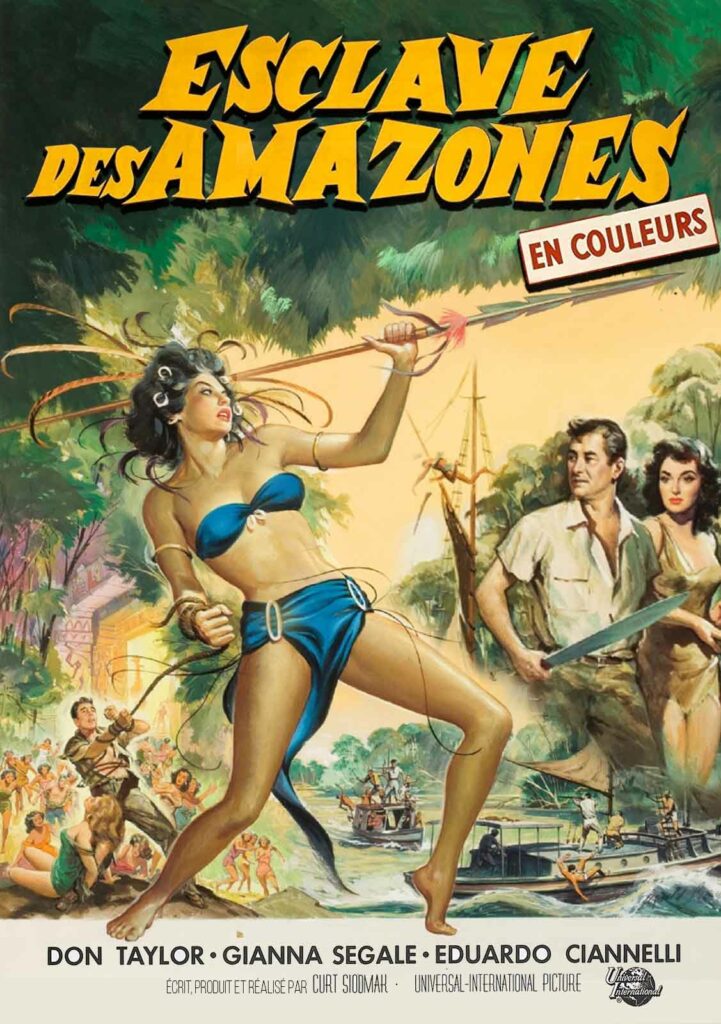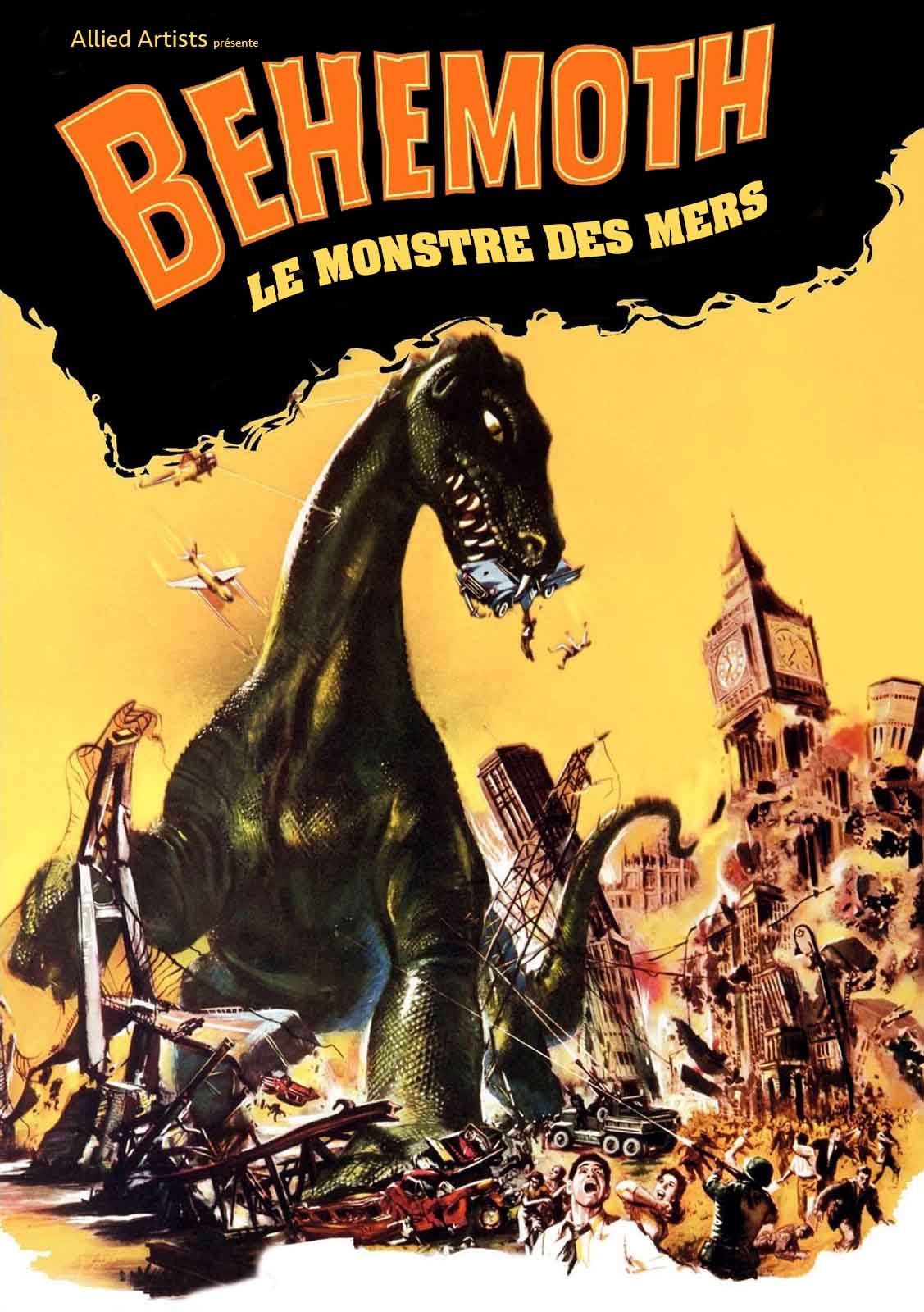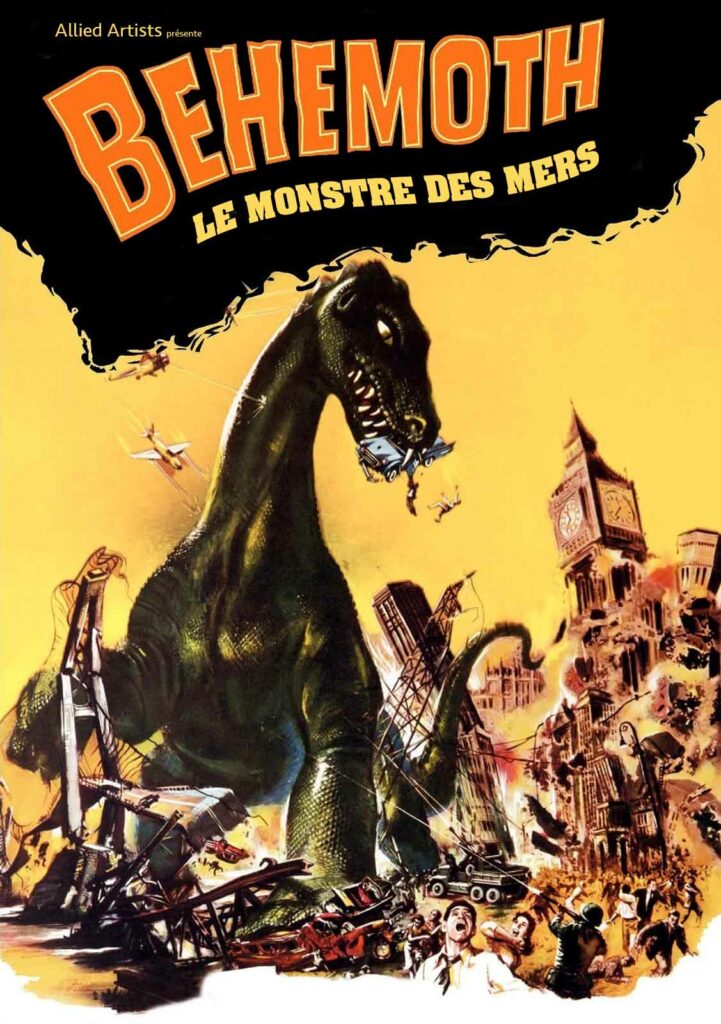Le réalisateur de Ghost Story se lance dans un remake en chair et en os du classique animé de Disney…
PETER PAN AND WENDY
2023 – USA
Réalisé par David Lowery
Avec Jude Law, Alexander Molony, Ever Anderson, Yara Shahidi, Alyssa Wapanatahk, Joshua Pickering, Jacobi Jupe, Molly Parker, Alan Tudyk
THEMA CONTES
Lancée officiellement en 2016 avec Le Livre de la jungle de Jon Favreau (même s’il y eut quelques précédents comme Les 101 Dalmatiens de Stephen Herek), la transformation systématique de tous les classiques animés de Disney en remakes « live » s’accélère à une cadence vertigineuse. Après La Belle et la Bête, Dumbo, Aladdin, La Belle et le clochard, Mulan et Pinocchio, voici donc Peter Pan et Wendy. L’initiative n’avait rien de particulièrement réjouissant, même si le nom du réalisateur choisi pour ce « relifting » laissait planer quelques espoirs. David Lowery est en effet le metteur en scène de plusieurs films indépendants très remarqués, dont l’audacieux A Ghost Story, mais aussi d’un remake original de Peter et Elliott le dragon qui s’éloignait de l’esthétique de son modèle pour offrir aux spectateurs une vision et une sensibilité nouvelles. Il semblait donc être l’homme de la situation pour réinventer le Peter Pan de 1953, d’autant que le conte narré par James Barrie le titille depuis de nombreuses années. Co-auteur du scénario avec Toby Halbrooks (son partenaire d’écriture sur Peter et Elliott), Lowery se met en tête de soigner chaque détail de cette adaptation en opérant au passage quelques retouches afin de mieux coller aux préoccupations sociales de son époque. Nous étions curieux de voir le résultat…


La première déception occasionnée par le film est liée à son casting, loin d’être convaincant. Aucun des comédiens – enfant ou adulte – ne parvient à rivaliser avec ses nombreux prédécesseurs cinématographiques, notamment ceux du Peter Pan de P.J. Hogan qui demeure aujourd’hui encore l’une des adaptations les plus réussies de Barrie, toutes époques confondues. Alexander Molony (pour ses débuts au cinéma) est un bien fade Peter Pan, Ever Anderson campe une Wendy charmante mais transparente. Quant à Jude Law, il endosse la défroque du capitaine Crochet sans parvenir à doter le personnage d’une quelconque aura. L’autre problème de Peter Pan et Wendy est son aliénation au dessin animé de Clyde Geronimi, qui supprime toute possibilité de surprise, à quelques exceptions près. En désespoir de cause, le spectateur tue le temps en comparant les deux œuvres, toujours en défaveur du long-métrage de David Lowery. À ce jeu, même Hook aurait tendance à être réévalué à la hausse. Malgré ses nombreuses maladresses, la version proposée par Steven Spielberg avait au moins le mérite de revisiter le conte sous un angle nouveau. Certes, les effets visuels sont très réussis, la mise en scène efficace et les décors naturels – captés sur les îles Féroé du Danemark – résolument photogéniques. Mais cela suffit-il à rendre le film mémorable ? Non, bien sûr. Rien ne s’avère particulièrement percutant derrière cette patine.
Le progressisme inversé
Les « modernisations » opérées par le cinéaste sont quant à elles dérisoires, pour ne pas dire contre-productives. La fée clochette a désormais la peau noire. Pourquoi pas ? Cette quête de diversité – qui semble bien plus obéir à un cahier des charges établi par le studio Disney qu’à une volonté sincère de valoriser les acteurs noirs – serait intéressante si elle influait si les origines de Clochette, son personnage et son comportement. Or la petite fée est parfaitement insipide. Le caractère pétillant et explosif de la Clochette animée cède ici le pas à une jovialité béate sans saveur. Pire : Lowery a cru bon d’intégrer plusieurs filles dans le clan des garçons perdus. C’est mal connaître les intentions initiales de Barrie, qui spécifiait clairement que les filles étaient plus intelligentes que les garçons, ce qui les empêchait d’être perdues. C’est ce qu’on pourrait appeler du progressisme inversé ! Le seul point véritablement intéressant du film est la relativisation du manichéisme de Peter et Crochet, tous deux ayant été les meilleurs amis du monde avant que le second, banni par le premier pour avoir osé exprimer le besoin de revoir sa mère, ne se transforme en adulte diabolique. Jude Law sort alors de l’archétype caricatural dans lequel il s’était enfermé pour laisser paraître des failles. « Ma joie est perdue à jamais » avoue-t-il à Wendy. Mais ce sursaut est éphémère et se noie aussitôt dans la masse. Diffusé sur la plateforme Disney + à l’occasion du 70ème anniversaire du film original, Peter Pan et Wendy n’aura finalement pas convaincu grand-monde.
© Gilles Penso
À découvrir dans le même genre…
Partagez cet article