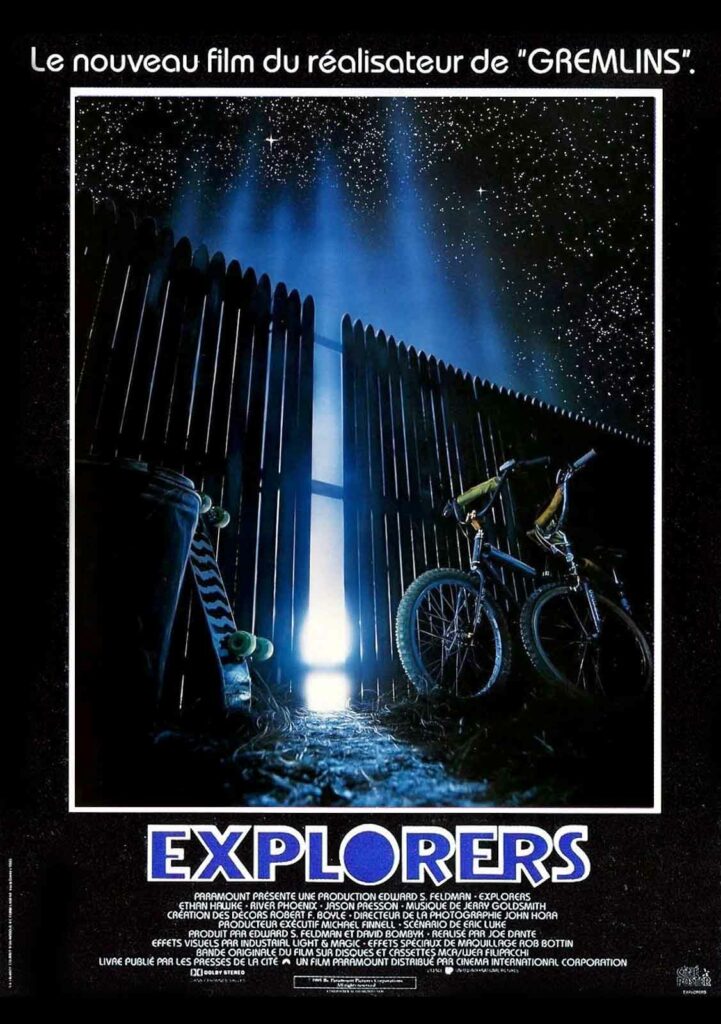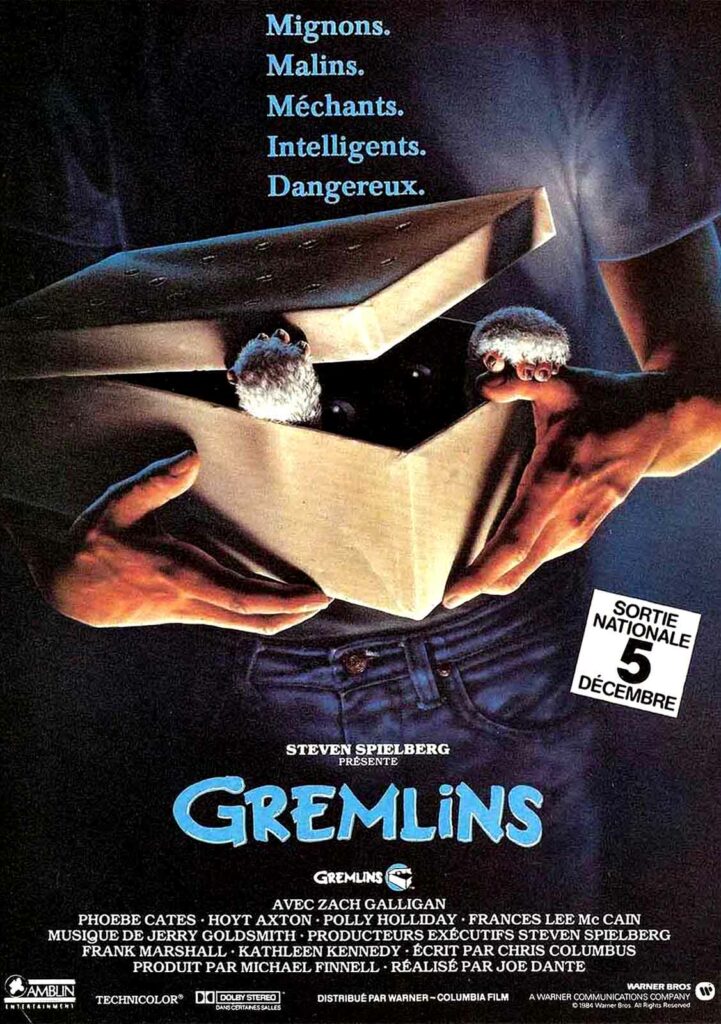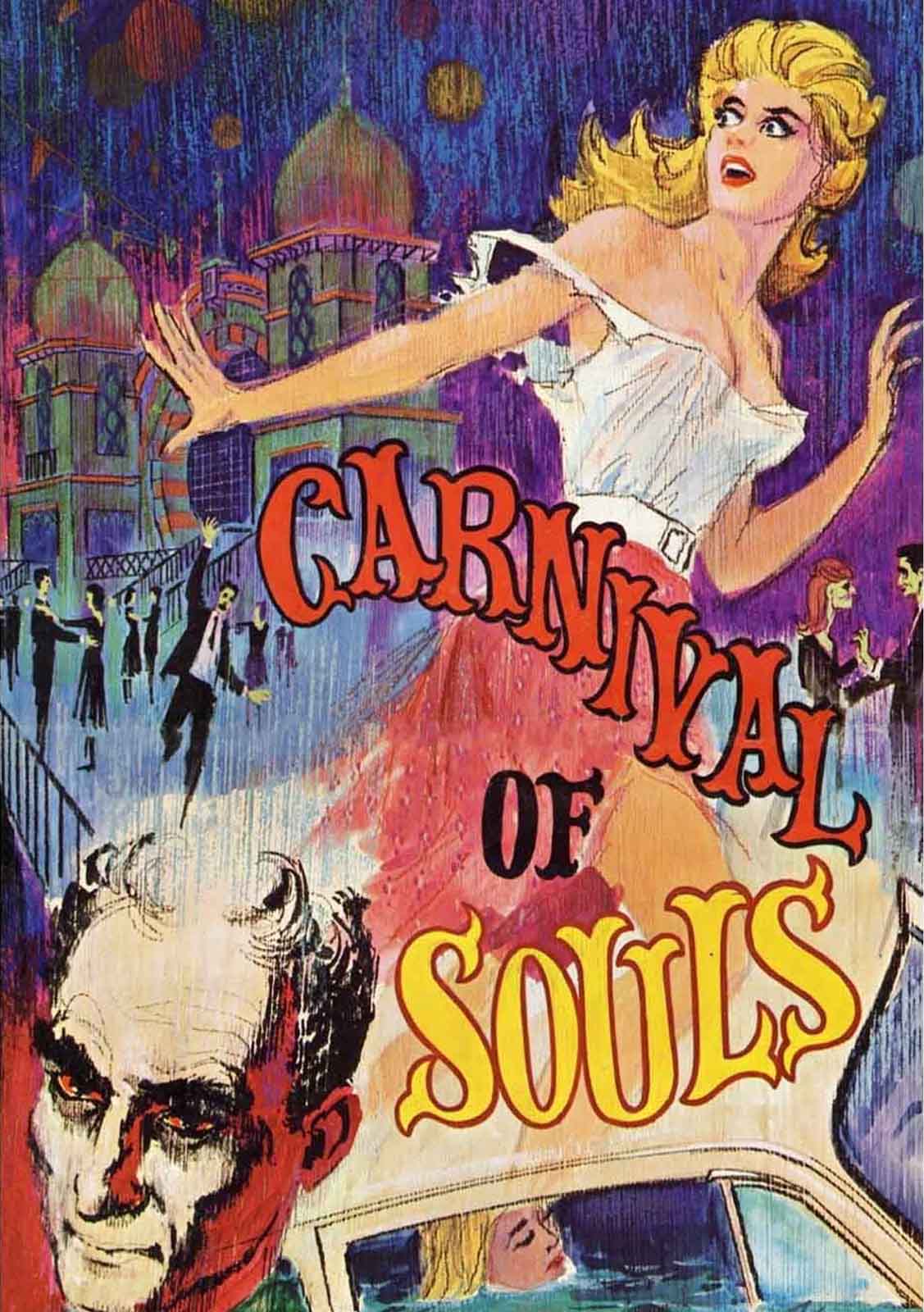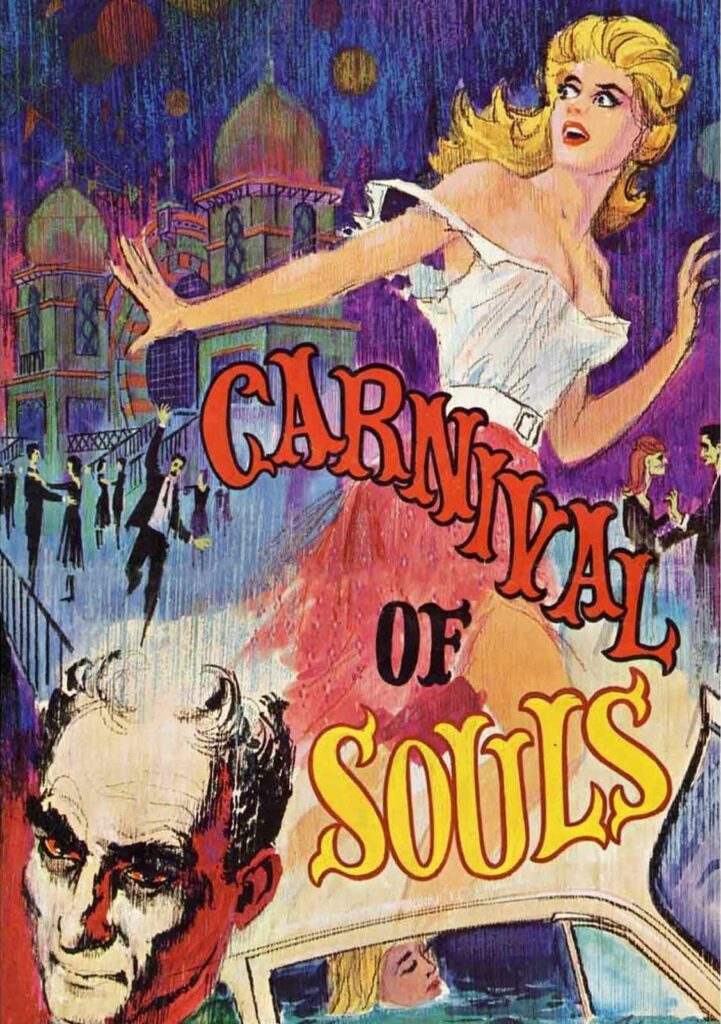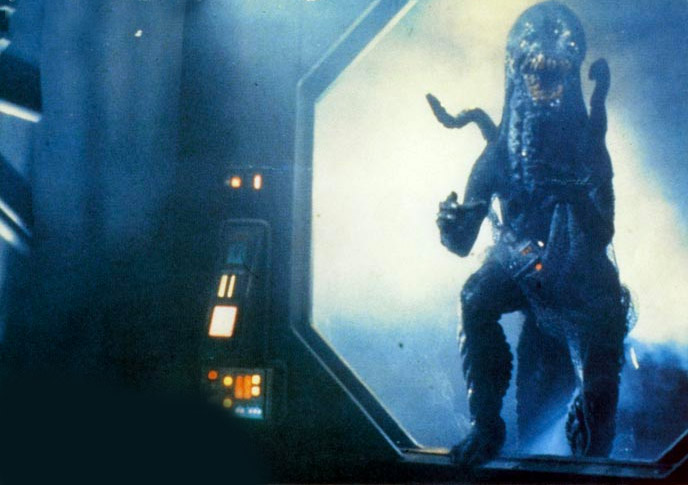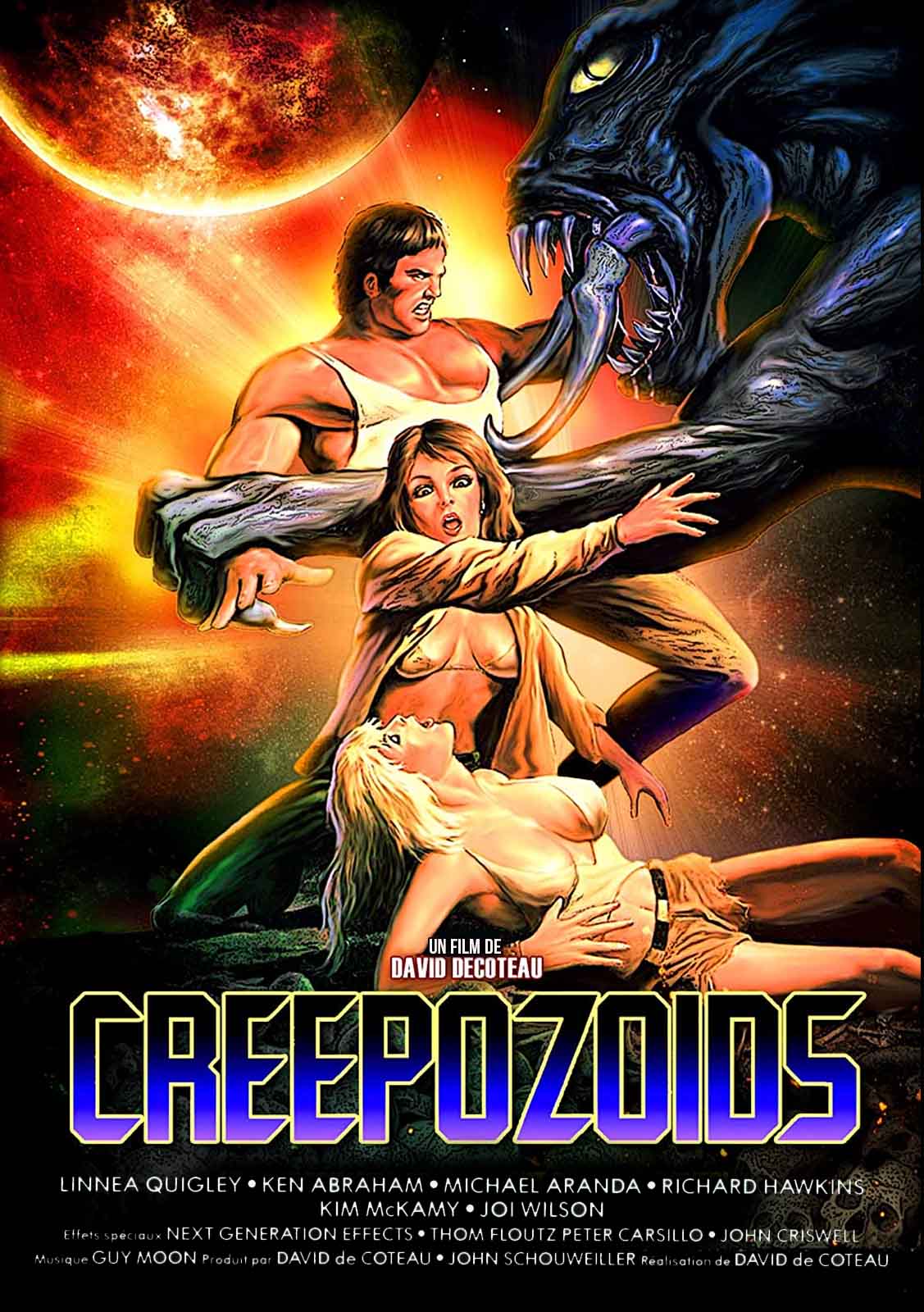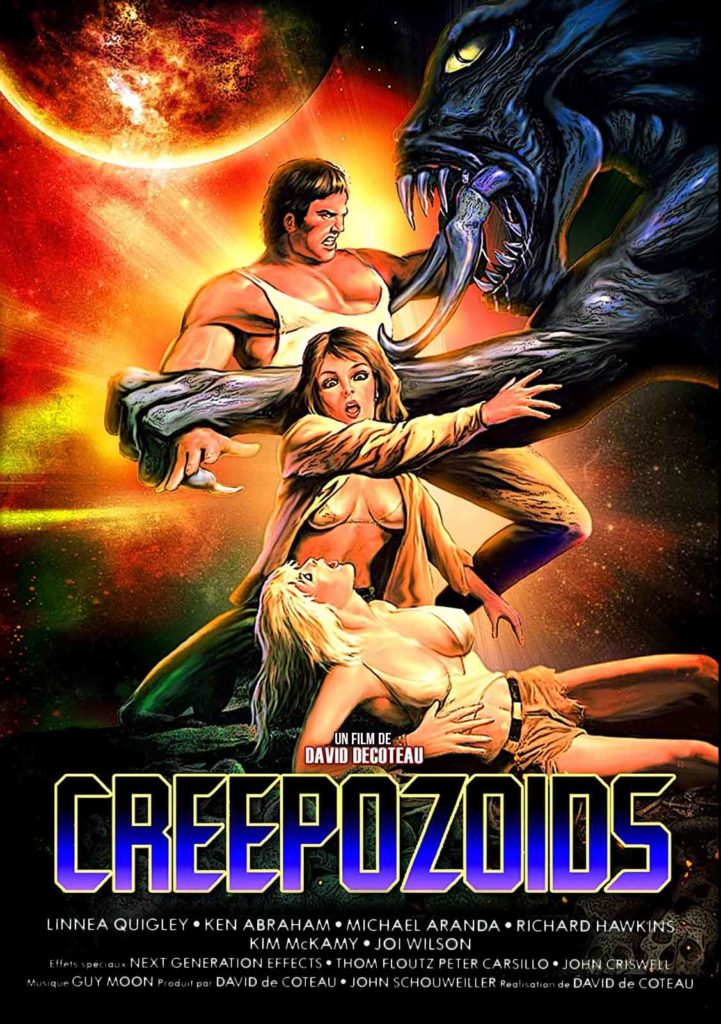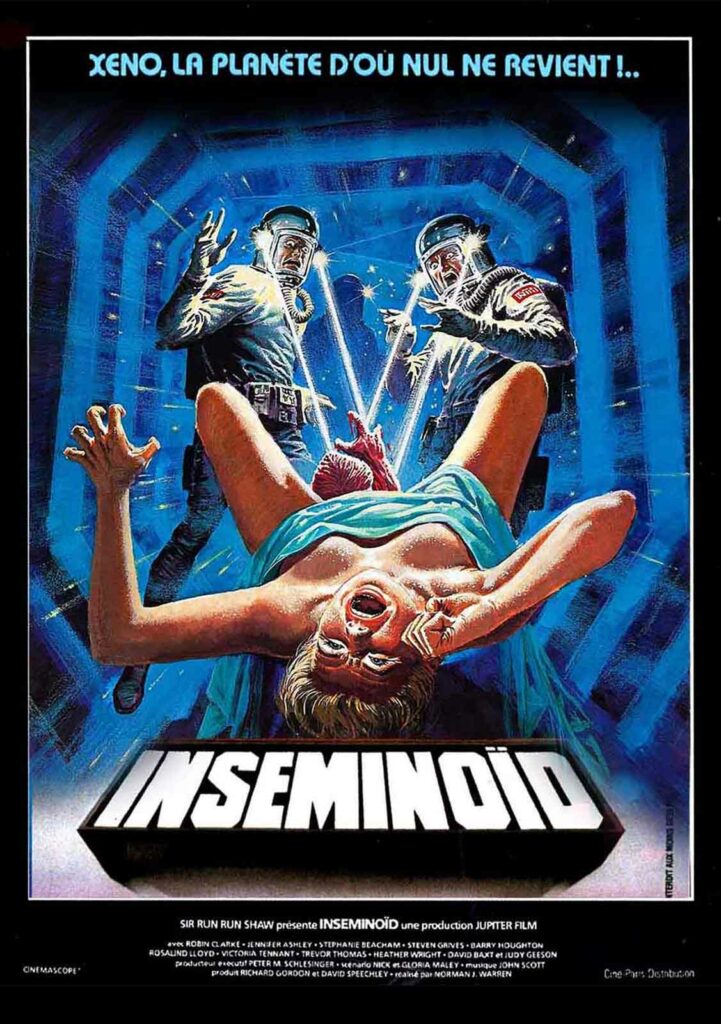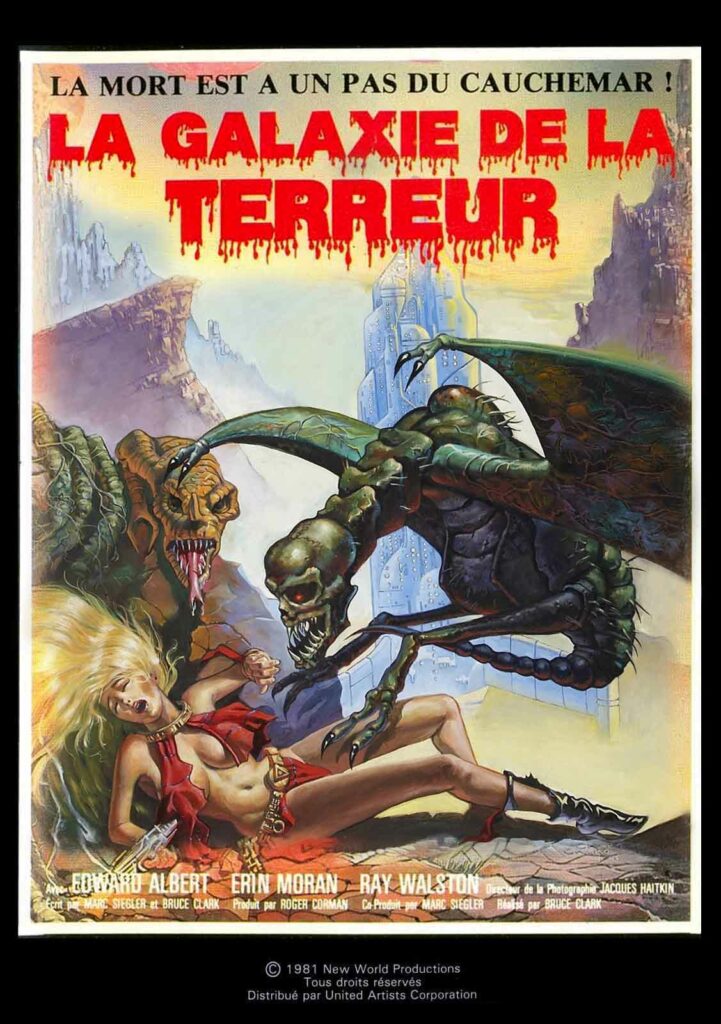Brian de Palma s'empare de la série culte de Bruce Geller pour en tirer un techno-thriller d'espionnage de haut niveau
MISSION IMPOSSIBLE
1996 – USA
Réalisé par Brian de Palma
Avec Tom Cruise, Emmanuelle Beart, Ving Rhames, Jean Reno, Jon Voigt, Kristin Scott Thomas
THEMA ESPIONNAGE ET SCIENCE-FICTION I SAGA MISSION IMPOSSIBLE
Parmi les sources d’inspiration des scénaristes hollywoodiens, les séries TV se mirent à occuper une place croissante au cours des années 90. La qualité des résultats variait, en fonction de l’intérêt de la série initiale mais aussi et surtout du choix de l’approche. Trop de fidélité pouvait sans doute nuire, et le succès fracassant des versions grand écran des Incorruptibles ou du Fugitif semblaient le confirmer. Tout récent producteur ayant créé sa propre société avec Paula Wagner, Tom Cruise décida, pour sa part, d’adapter Mission Impossible. Adulé par Cruise, maître du suspense et auteur justement de la version cinéma des Incorruptibles, Brian de Palma était le réalisateur idéal pour moderniser la série culte de Bruce Geller. Fruit de la collaboration de David Koepp (Jurassic Park) et Robert Towne (Greystoke), le scénario tisse des liens étroits avec la série pour mieux s’en défaire un quart d’heure plus tard et emmener l’intrigue au-delà de ce que le spectateur pouvait imaginer.


Tout commence lorsque Jim Phelps (Jon Voigt) annonce à son équipe une nouvelle mission : infiltrer une soirée à l’ambassade américaine de Prague pour y coincer l’agent secret Alexandre Golitsyn, lequel vient de subtiliser une disquette où figure la liste complète des espions américains agissant dans l’Europe de l’Est. Contre toute attente – et contre les principes soigneusement établis au cours des sept années de diffusion de la série – la mission est un sanglant fiasco, et Ethan Hunt (Tom Cruise), seul survivant, décide de monter une nouvelle équipe pour découvrir les dessous de la sombre machination dont il est devenu la victime. Avec un goût immodéré pour le spectaculaire et la démesure, le film accumule les morceaux d’anthologie, en particulier l’explosion gigantesque d’un aquarium couvrant la fuite d’Ethan ou une incroyable séquence de suspense pur, située dans une salle d’ordinateurs, mettant les nerfs du spectateur à rude épreuve.
Hélicoptère contre TGV
« Tom Cruise a tenu à faire lui-même de nombreuses cascades, notamment celle où il est suspendu par un filin dans la salle de la CIA », nous révèle la productrice Paula Wagner. « Il en était très fier, mais je vous avoue que pendant le tournage je tremblais comme une feuille. Pour un producteur, ce n’est guère rassurant ! Cela dit, étant donné qu’il est extrêmement prudent et très précis, nous n’avons eu à déplorer aucun incident… » (1) Mais le clou du spectacle est indéniablement cette poursuite finale sur le toit d’un train, un lieu commun en règle générale, mais transcendé ici par le fait qu’il s’agit d’un TGV Eurostar déboulant dans un tunnel à une allure démente, poursuivi en outre par un hélicoptère qui s’engouffre sous le tunnel à son tour. Remplaçant au pied levé Alan Silvestri (débarqué du film après avoir composé une demi heure de musique qu’il recycla pour L’Effaçeur), Danny Elfman se réapproprie le célèbre thème de Lalo Schifrin et livre une bande originale extrêmement énergique. A vrai dire, ce Mission Impossible n’a plus grand chose à voir avec la série homonyme, et les nostalgiques doivent oublier un peu leur soif de fidélité s’ils veulent profiter à sa juste valeur de ce spectacle décapant dont le climax offre une révélation pour le moins surprenante.
(1) Propos recueillis par votre serviteur en avril 2006
© Gilles Penso
À découvrir dans le même genre…
Partagez cet article