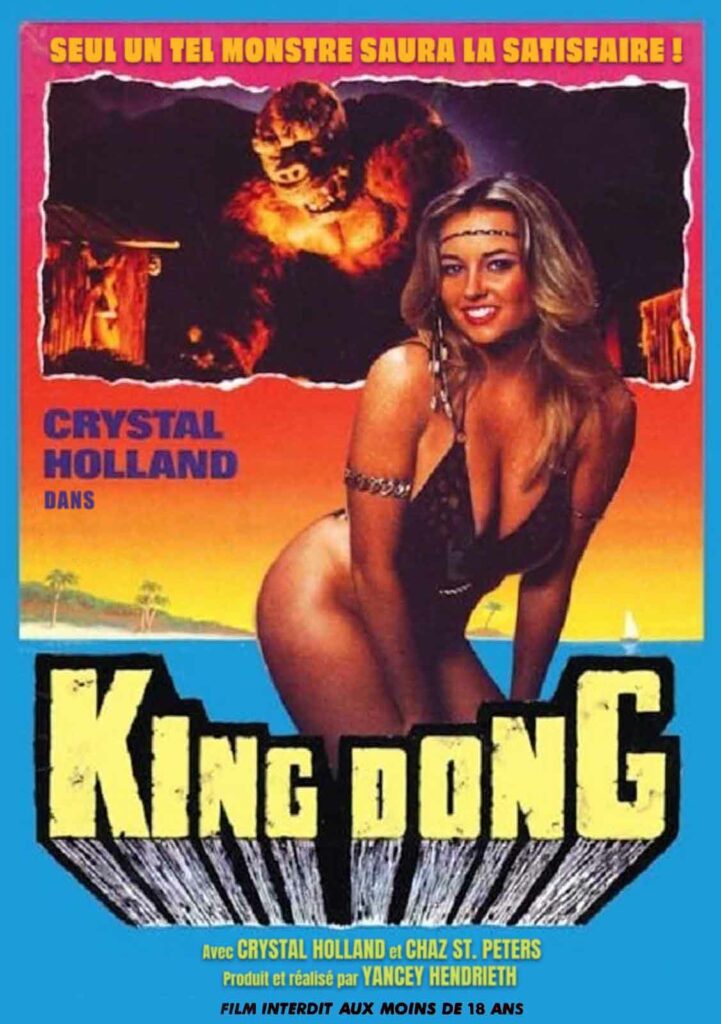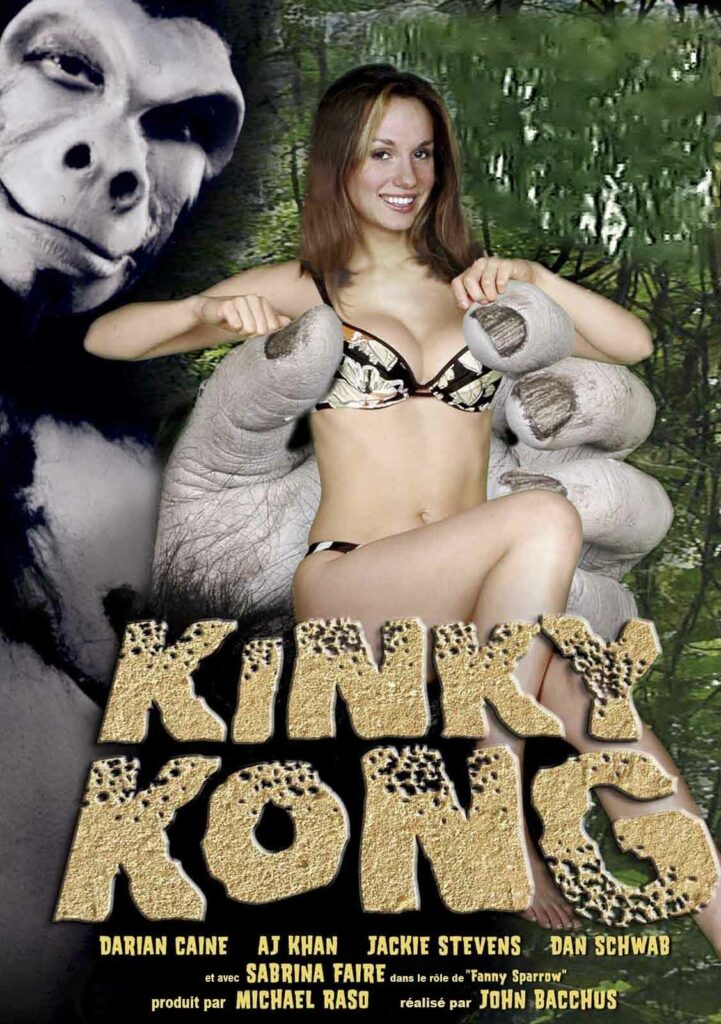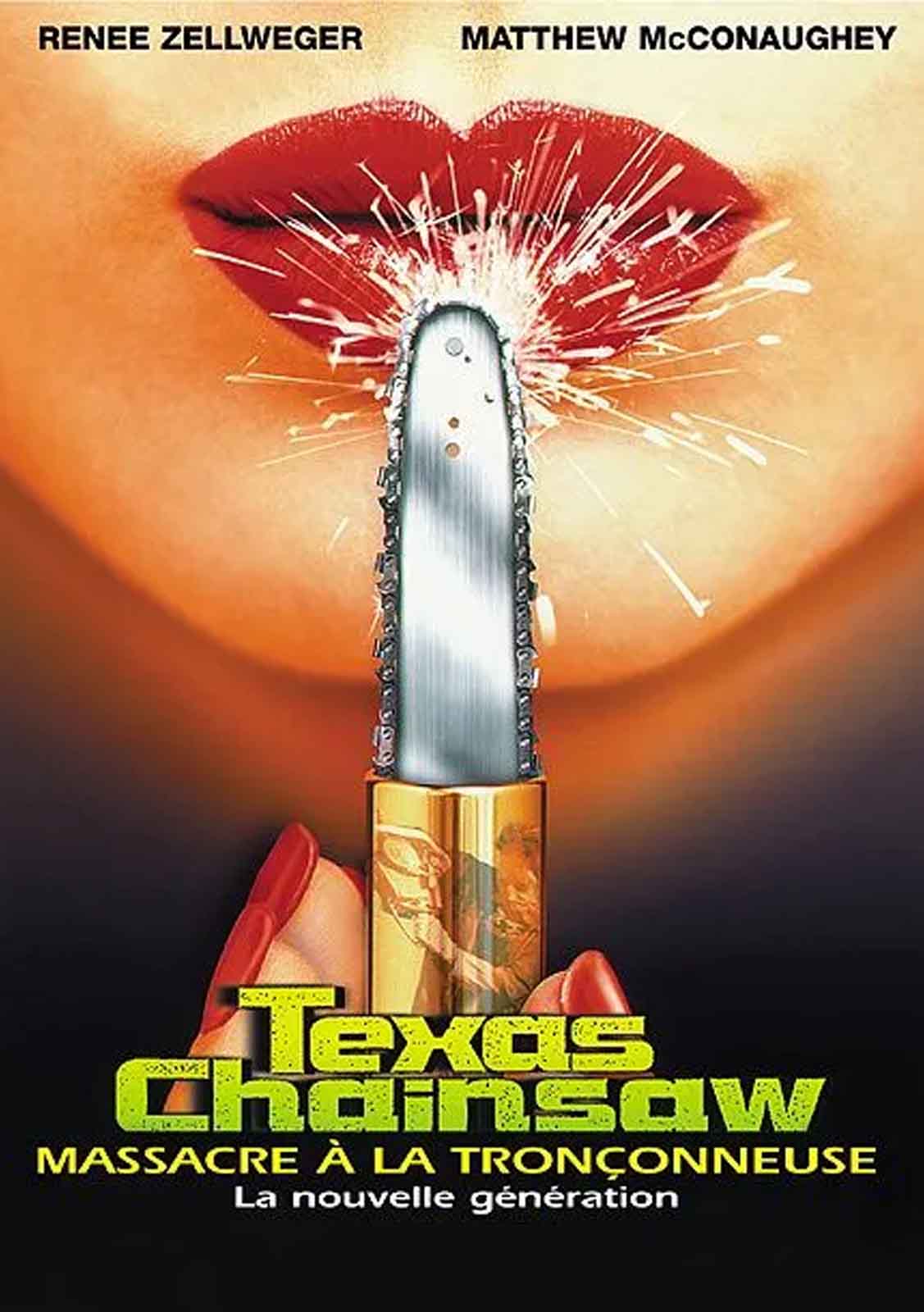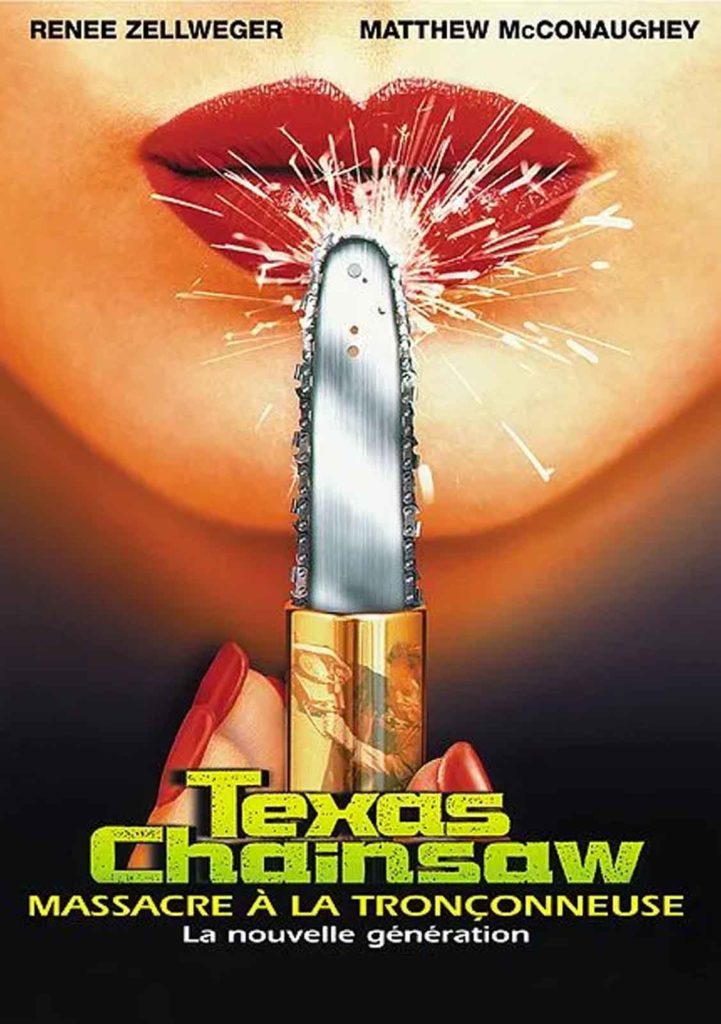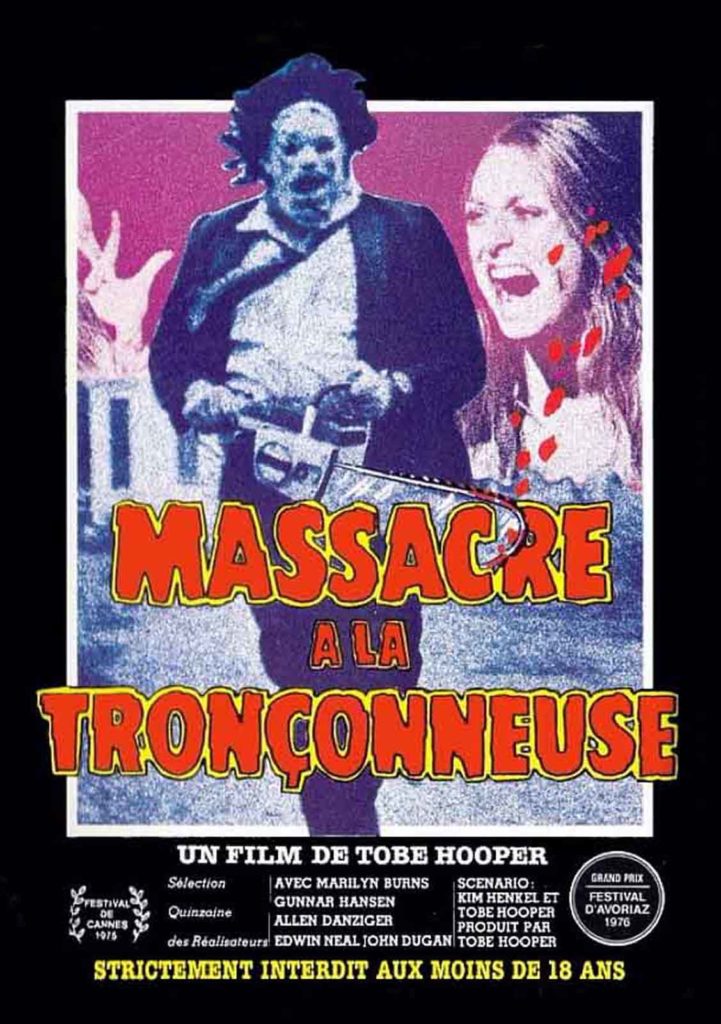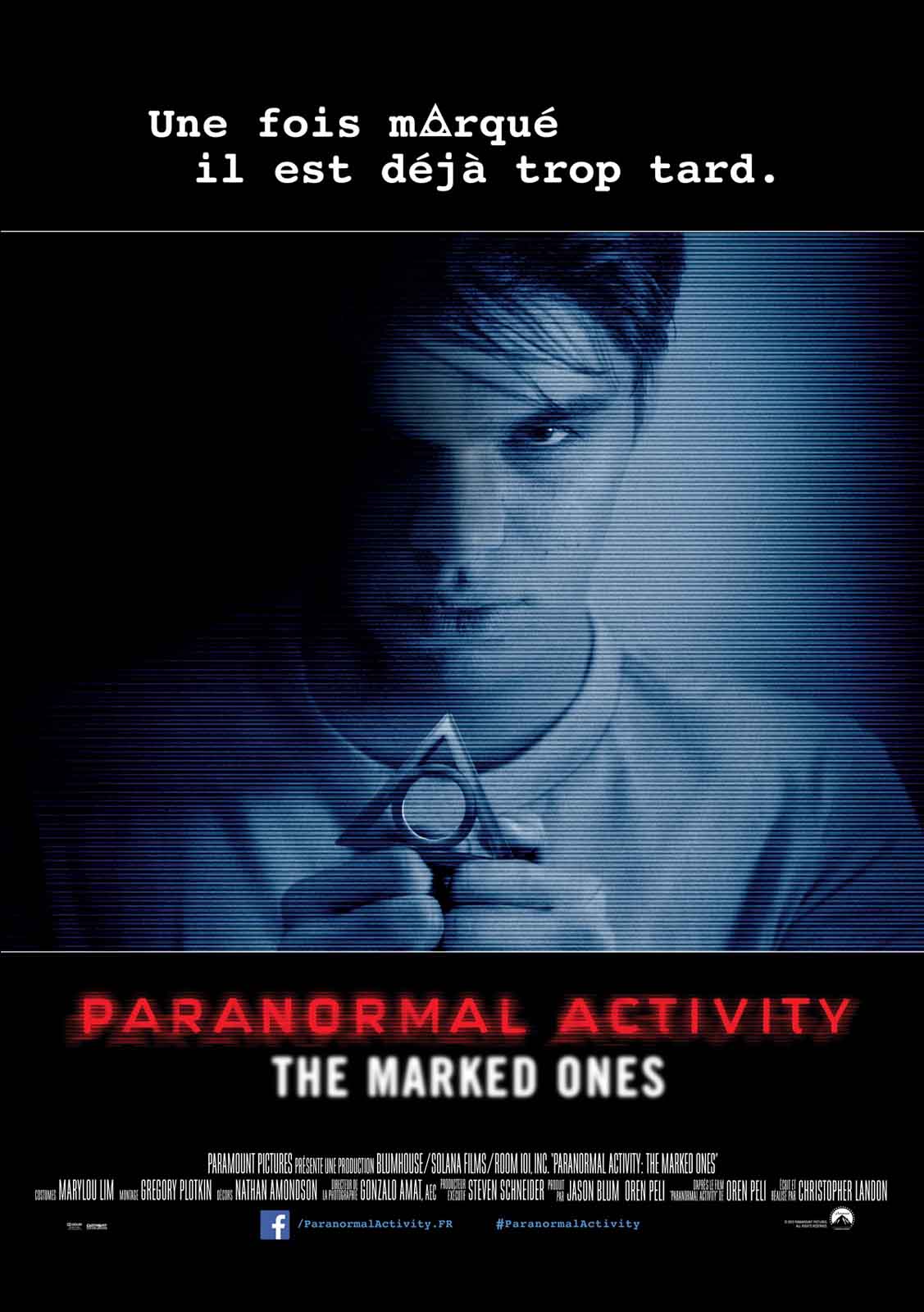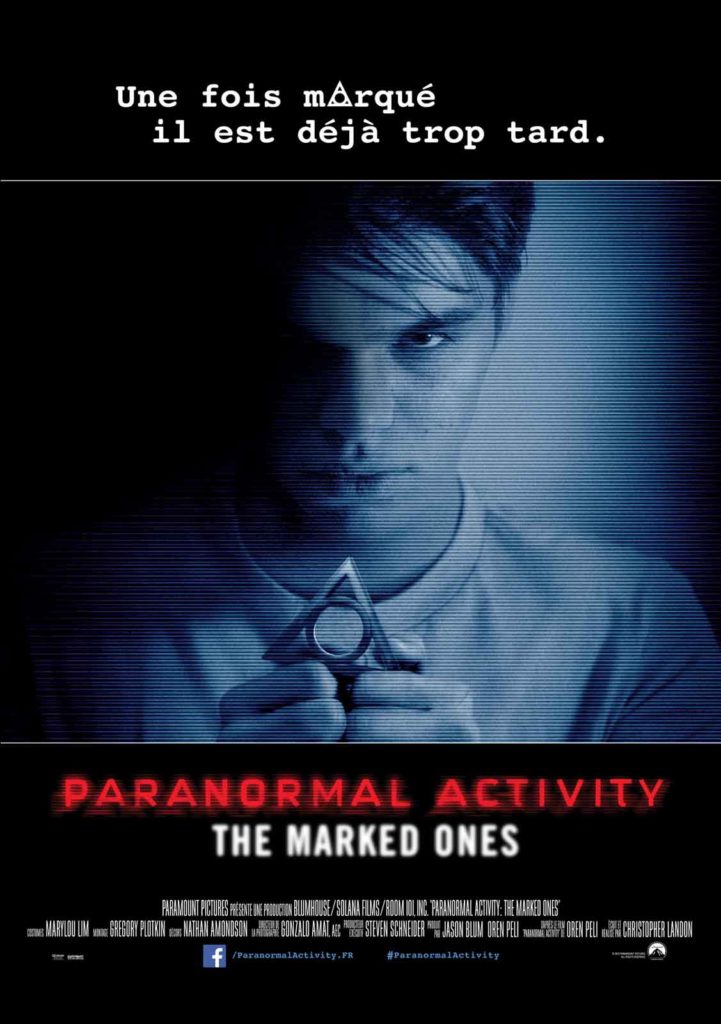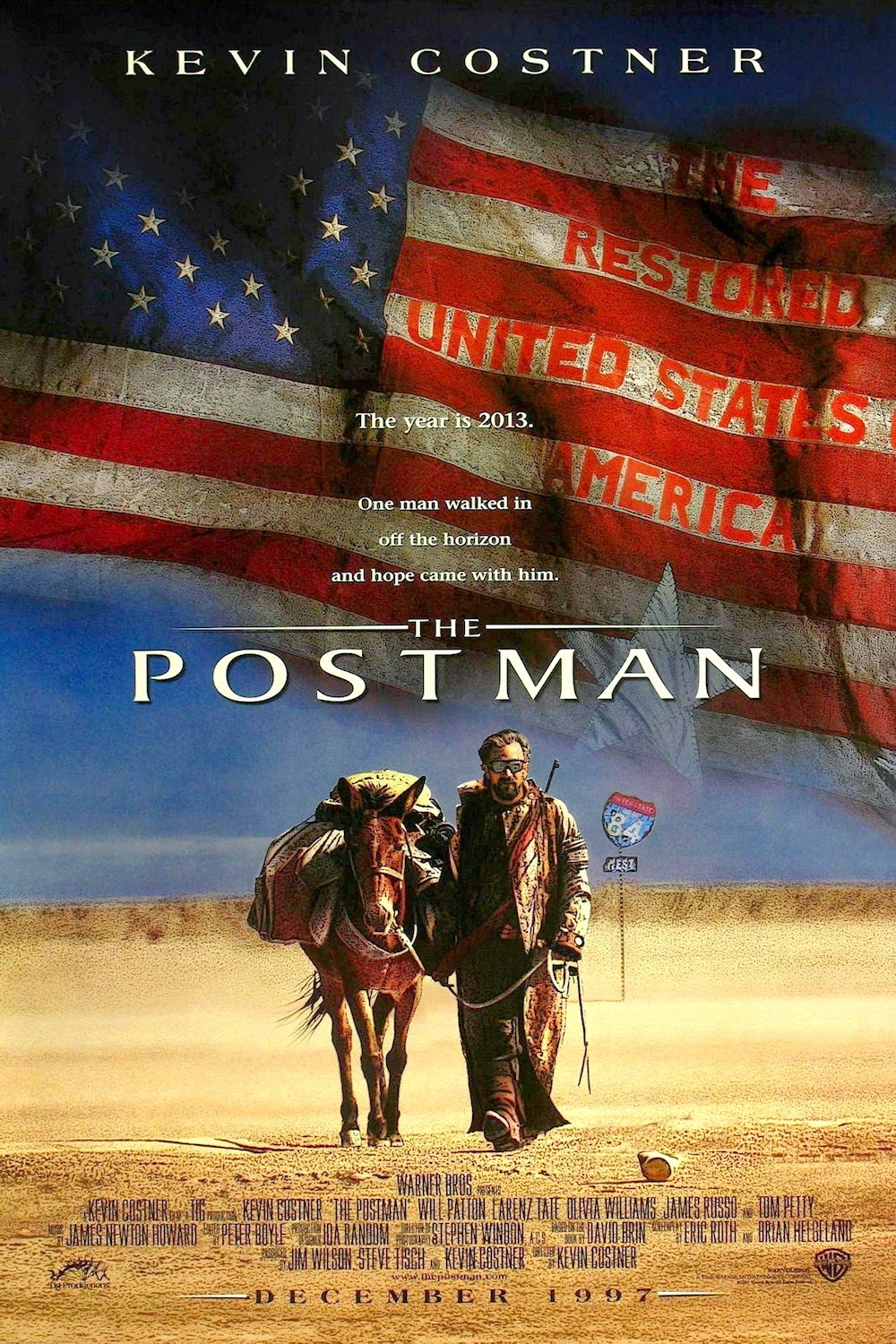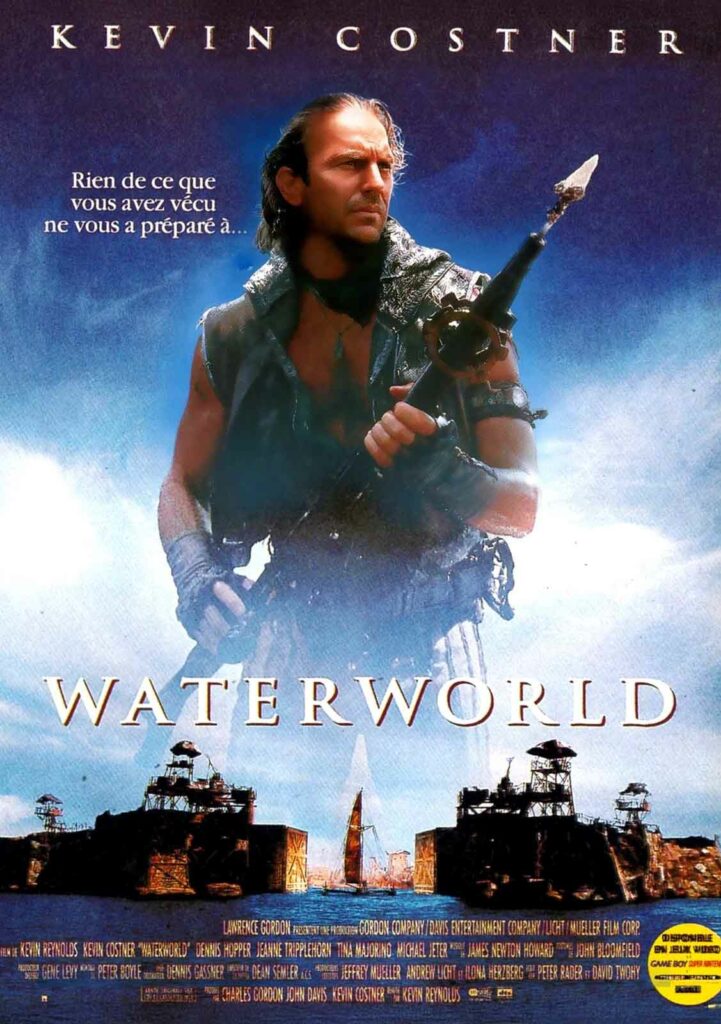Chasse aux sorcières, fanatisme religieux et tortures sanglantes sont au programme de ce film sans concession
HEXEN BIS AUFS BLUT GEQUÄLT / MARK OF THE DEVIL
1970 – ALLEMAGNE
Réalisé par Michael Armstrong
Avec Udo Kier, Herbert Lom, Reggie Nalder, OliveraVuco, Herbert Fux, Johannes Buzalski, Michael Maien
THEMA SORCELLERIE ET MAGIE
A la fin des années 60, les mœurs se libérèrent suffisamment pour que le champ des possibles du cinéma d’horreur s’élargisse et pour que de nouveaux thèmes s’y taillent une place de choix. Après les vampires et les monstres classiques magnifiés par la Hammer, les atrocités bien réelles de l’inquisition s’invitèrent donc sur les écrans, comme en témoigne l’impact du Grand inquisiteur de Michael Reeves. Désireux de surfer sur cette vague, le producteur Adrian Hoven concocta La Marque du Diable et Reeves fut même envisagé pour le réaliser, mais il décéda avant de pouvoir se lancer dans ce projet. Michael Armstrong (qui fut l’assistant de Reeves sur Le Grand inquisiteur) lui succéda donc et développa un scénario particulièrement audacieux. Dans un petit village européen, le sinistre évêque Albino (Reggie Nalder, dont le visage de rapace glace le sang), auto-proclamé chasseur de sorcières, torture et brûle à tout va, établissant sans scrupule de faux actes d’accusation pour mettre sur le bûcher les femmes qui refusent ses avances.


Lorsque le jeune juge Christian von Meruh (Udo Kier) débarque avec ses grands yeux clairs et son visage d’ange, un semblant de paix semble revenir sur les lieux, car cet homme d’église entend bien ramener un peu de justice et de morale en attendant l’arrivée de son maître, le vénérable Lord Cumberland (Herbert Lom, débordant de charisme). « Je vis pour servir Dieu et pour chasser le mal de ce monde », affirme-t-il d’ailleurs avec ferveur. Mais la tentation de la chair a raison de ses belles aspirations, et Christian succombe vite aux charmes de Vanessa Benedikt (Olivera Vuco), la plantureuse serveuse de l’auberge locale. Lorsque Cumberland s’installe dans le village, sa politique semble ferme mais juste. Moins charitable que Christian mais moins fanatique qu’Albino, il s’efforce de ne pas condamner ses prochains à la légère. Jusqu’au jour où quelqu’un remet en cause sa vigueur sexuelle et le fait sortir de ses gongs. Le juge durcit soudainement ses positions, accuse tout son entourage de sorcellerie et se laisse peu à peu aller aux tentations les plus viles…
Des sacs à vomi distribués dans les salles de cinéma !
La Marque du Diable est surtout connu pour ses scènes de tortures répétées et éprouvantes, dont le point d’orgue est la fameuse langue arrachée qui orne la plupart des posters du film. La campagne promotionnelle de cette production germanique abonda généreusement dans ce sens, jusqu’à la distribution de sacs à vomi dans les salles de cinéma ! Mais on ne peut réduire La Marque du Diable à ces gimmicks commerciaux. Le film est avant tout un violent pamphlet contre l’abus de pouvoir, dressant un portrait détestable du mâle dominant (lequel violente le sexe opposé pour tenter d’affirmer sa virilité défaillante) et du fanatisme religieux (l’église y est décrite comme spoliatrice et perfide). Débordant d’idées visuelles, Michael Armstrong fut jugé trop lent pour pouvoir respecter les délais imposés par la production. C’est donc Adrian Hoven qui termina le film à sa place en s’efforçant de respecter sa vision première et de conserver la terrible noirceur de cette œuvre troublante et vénéneuse.
© Gilles Penso
Partagez cet article