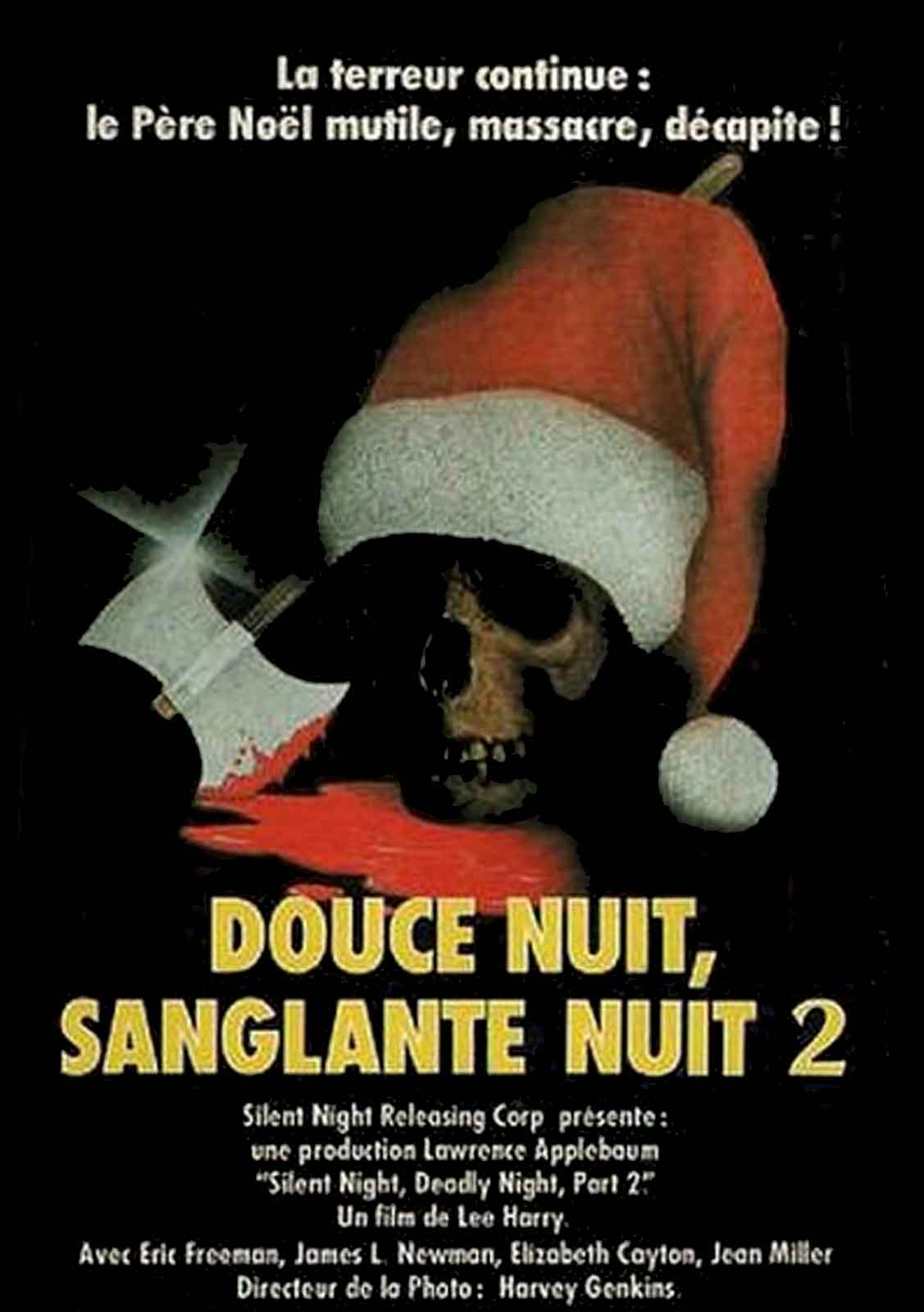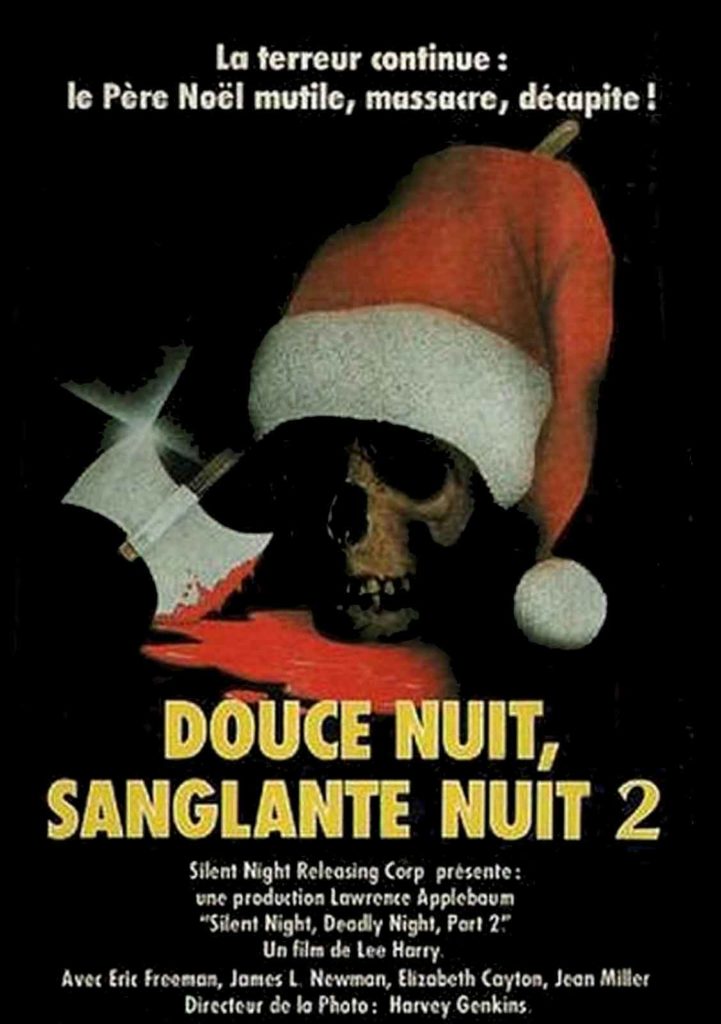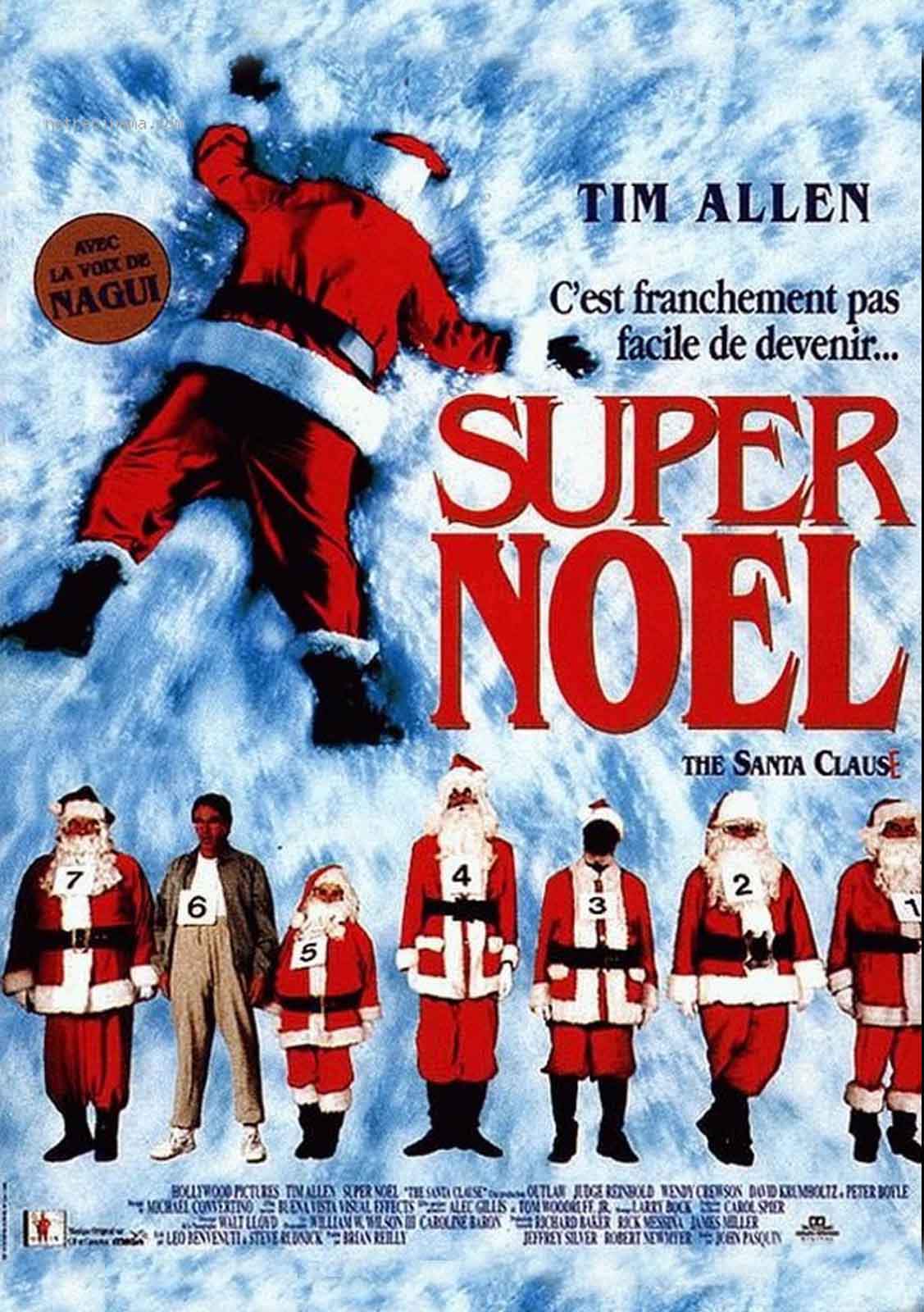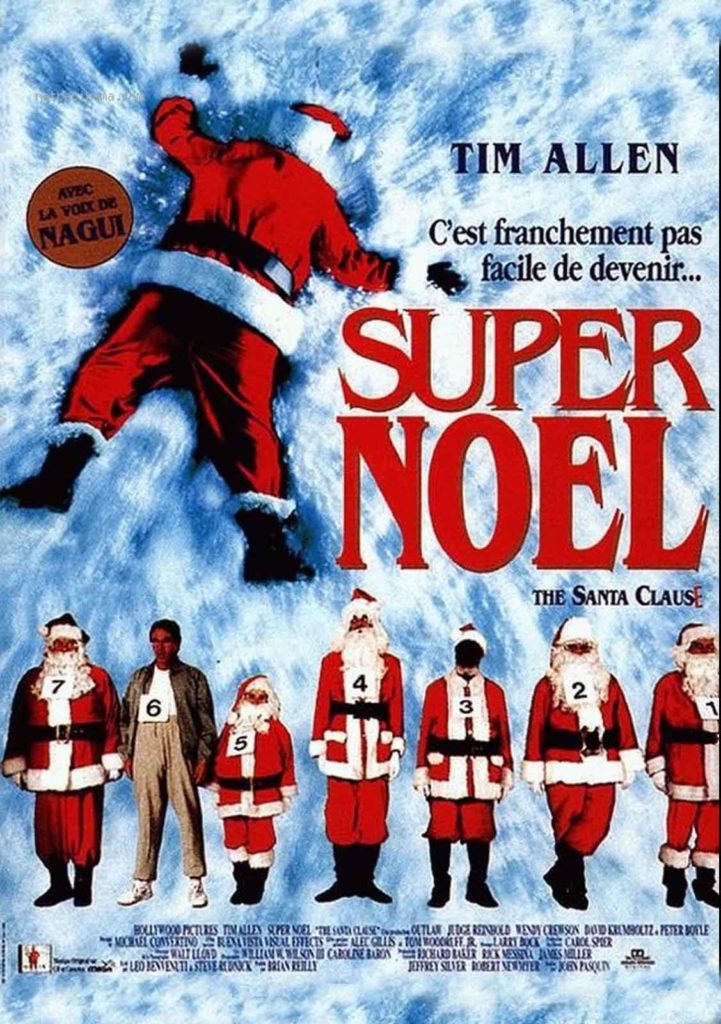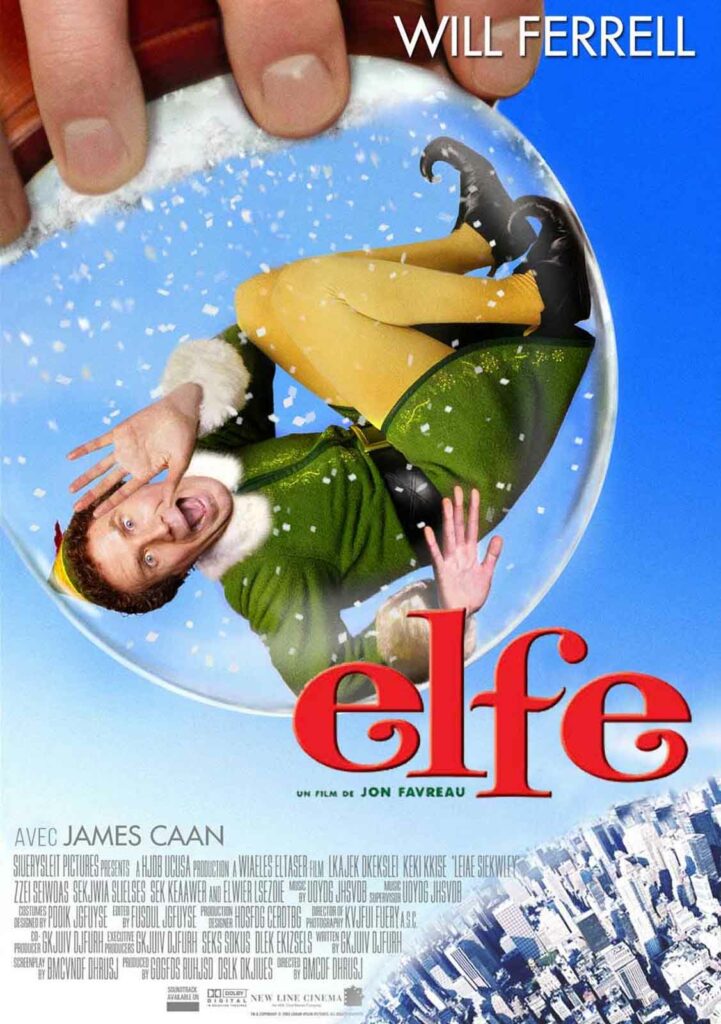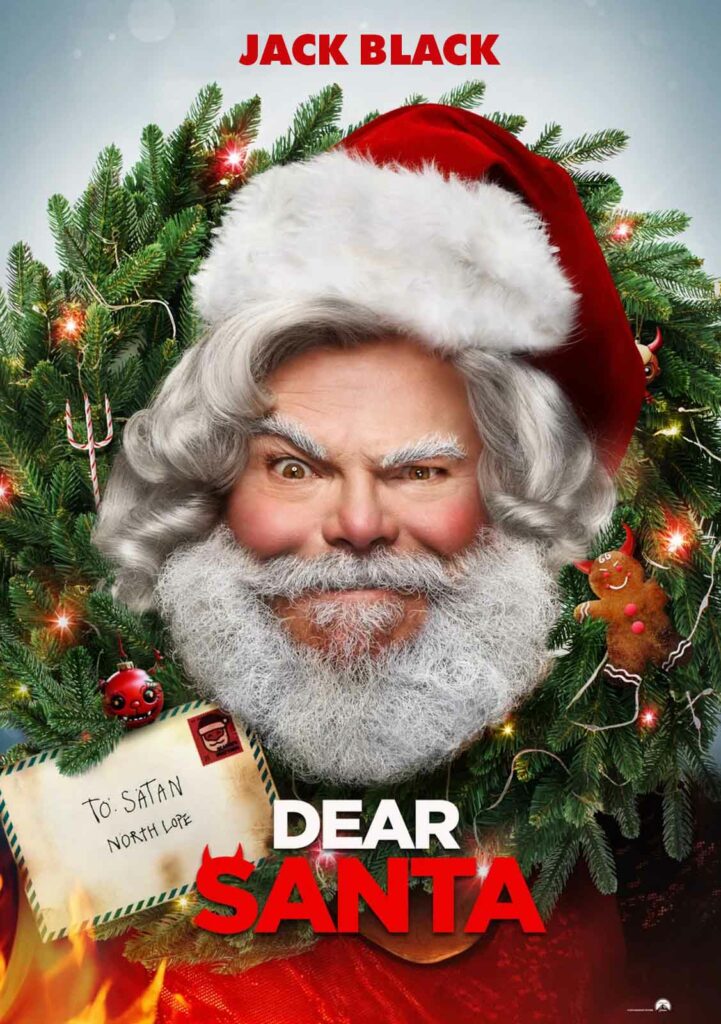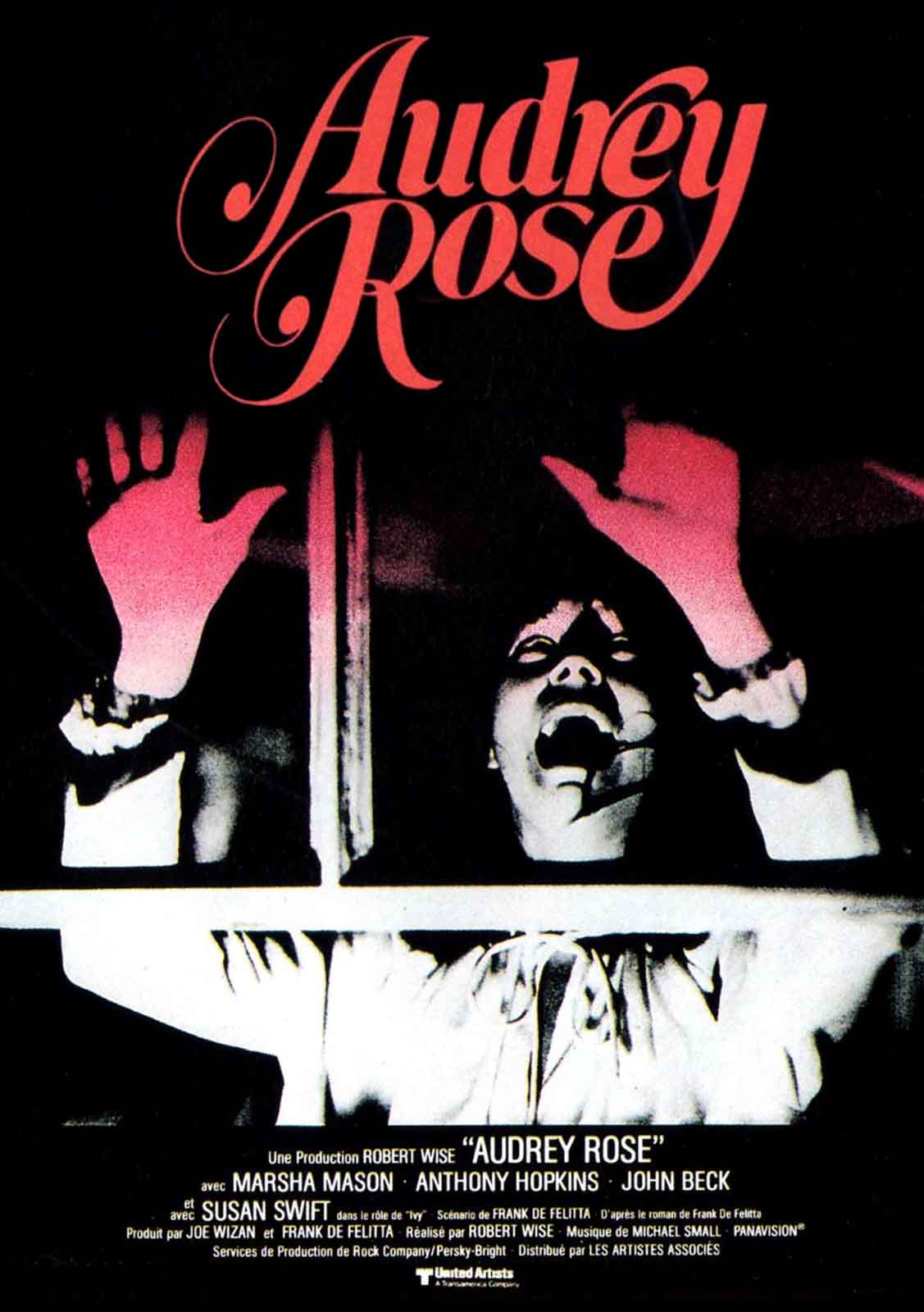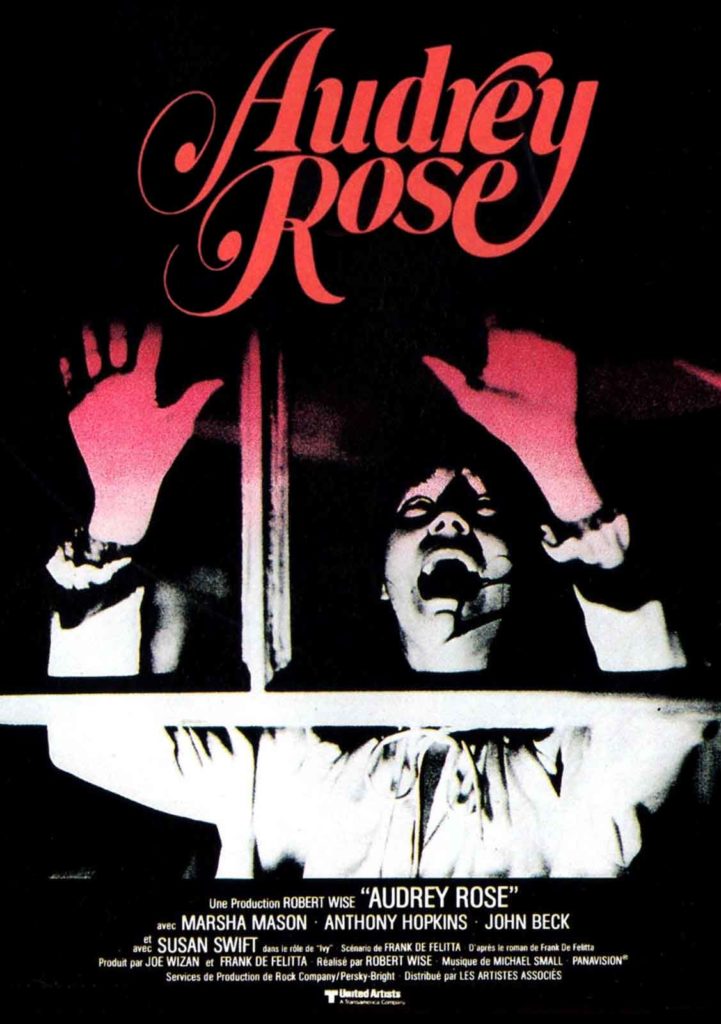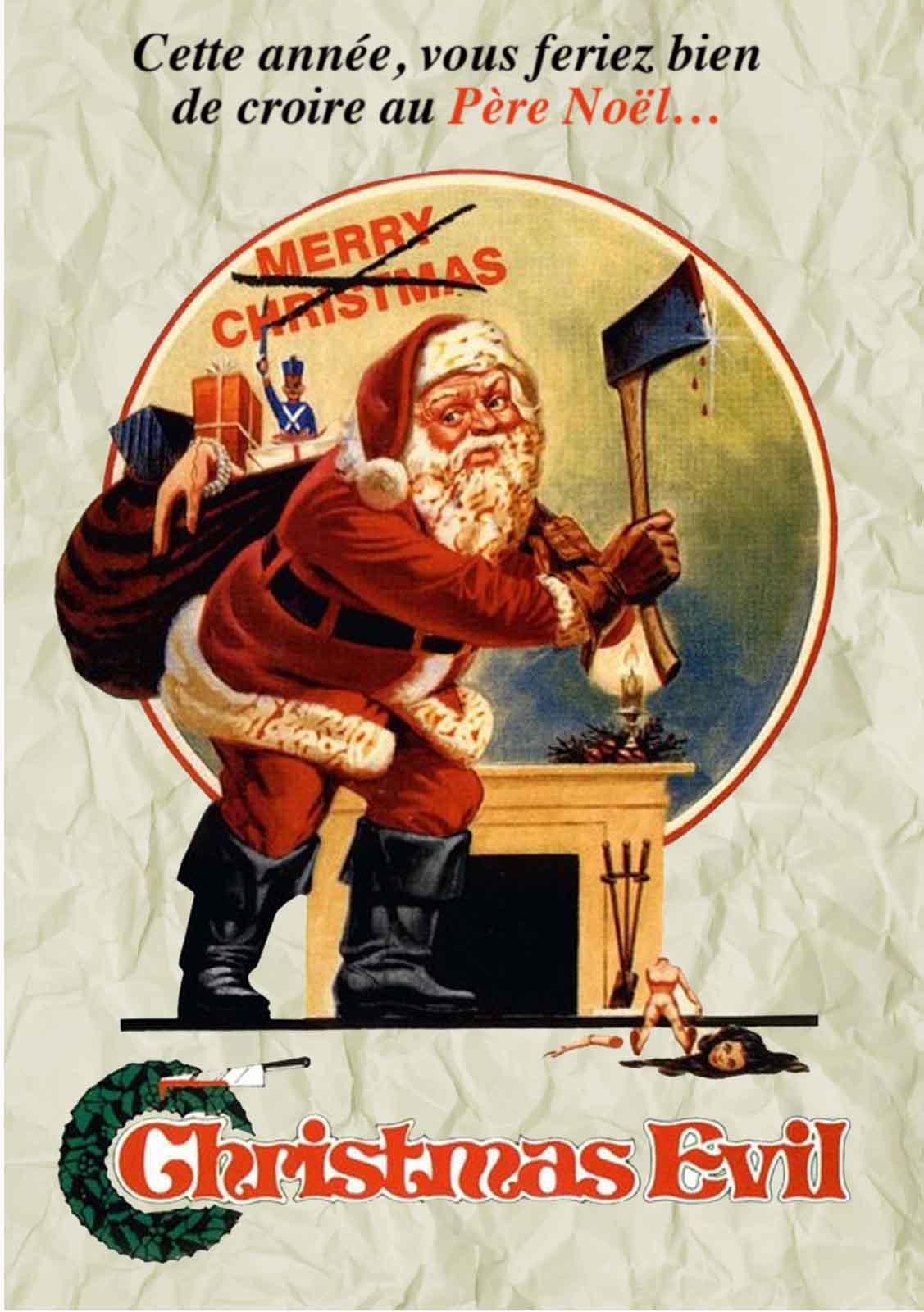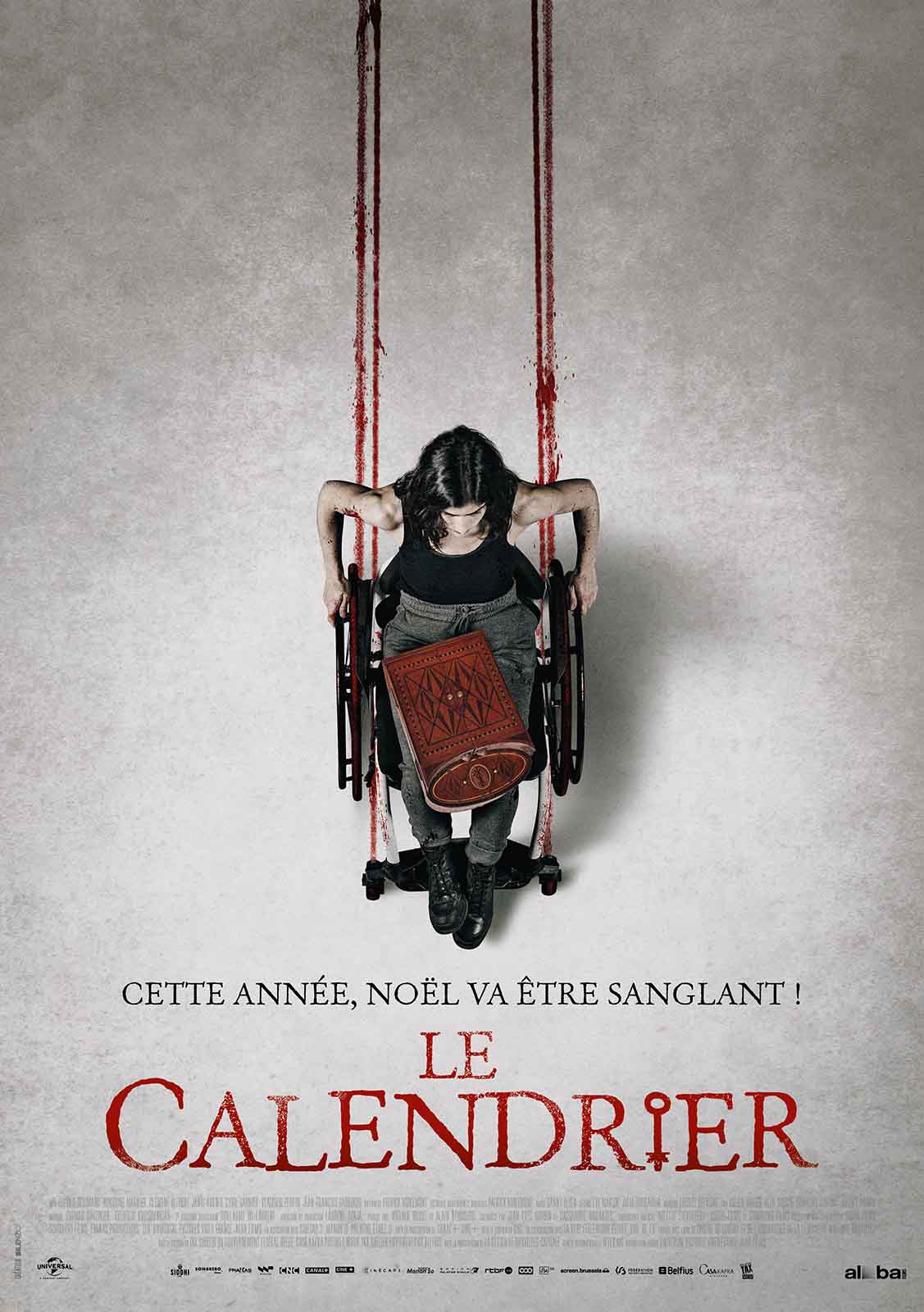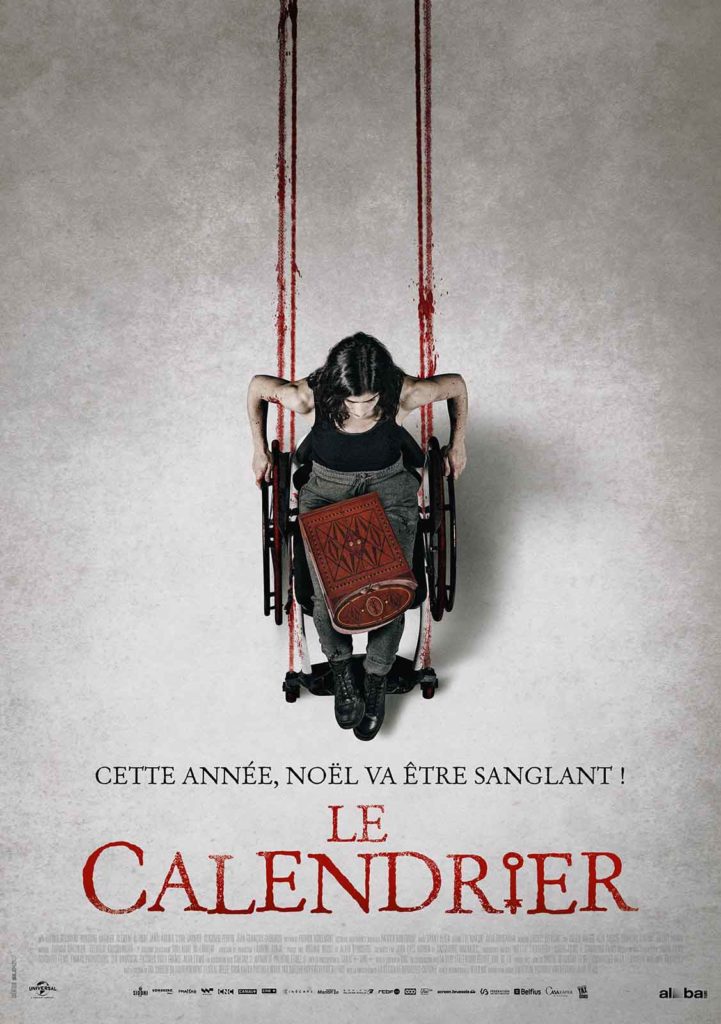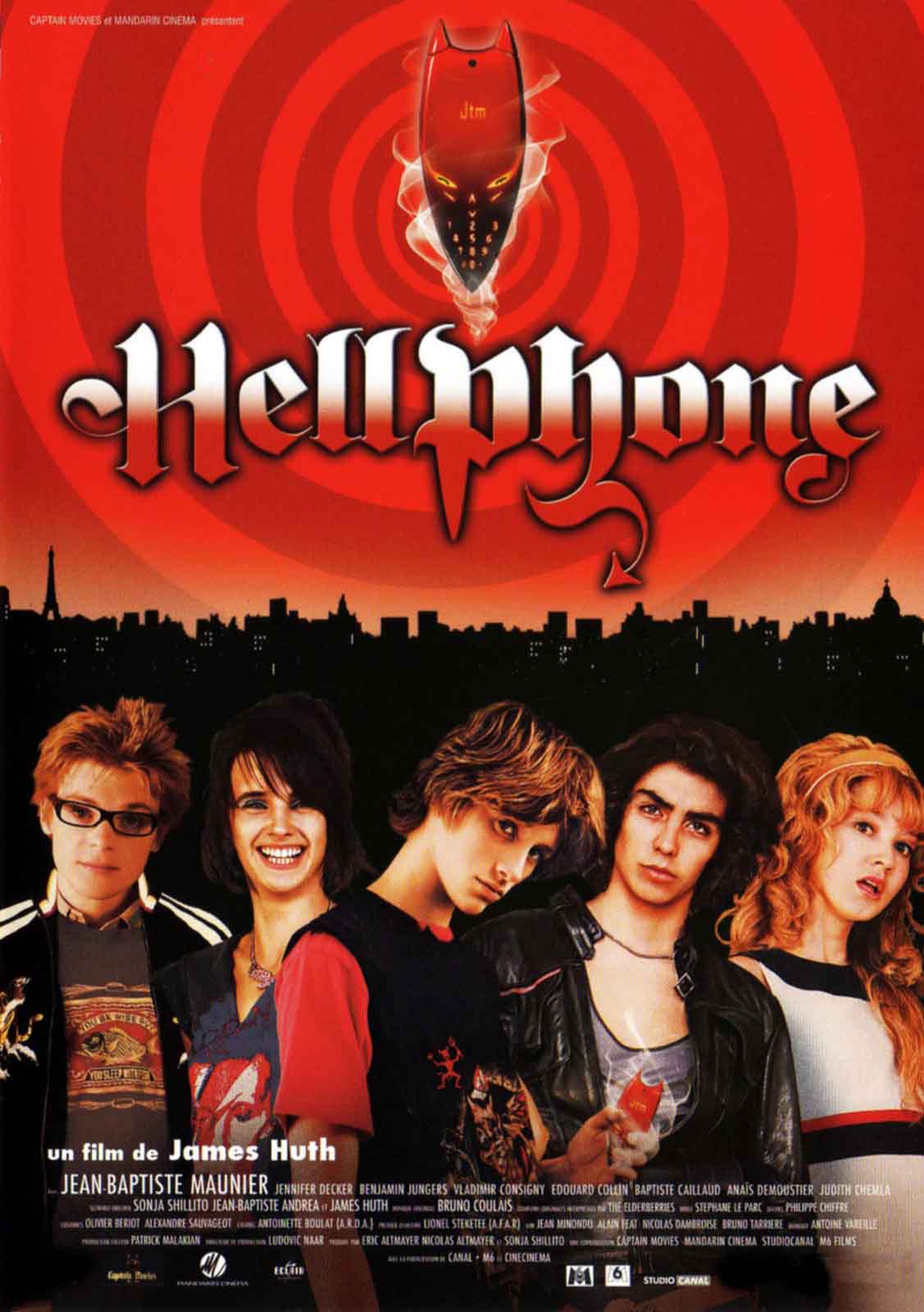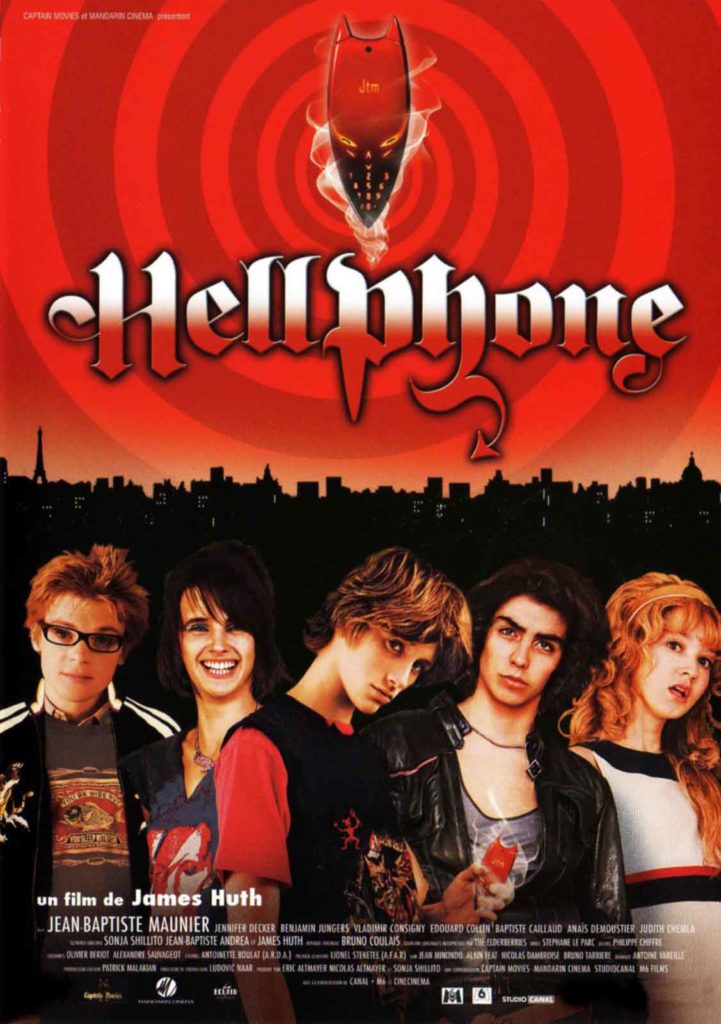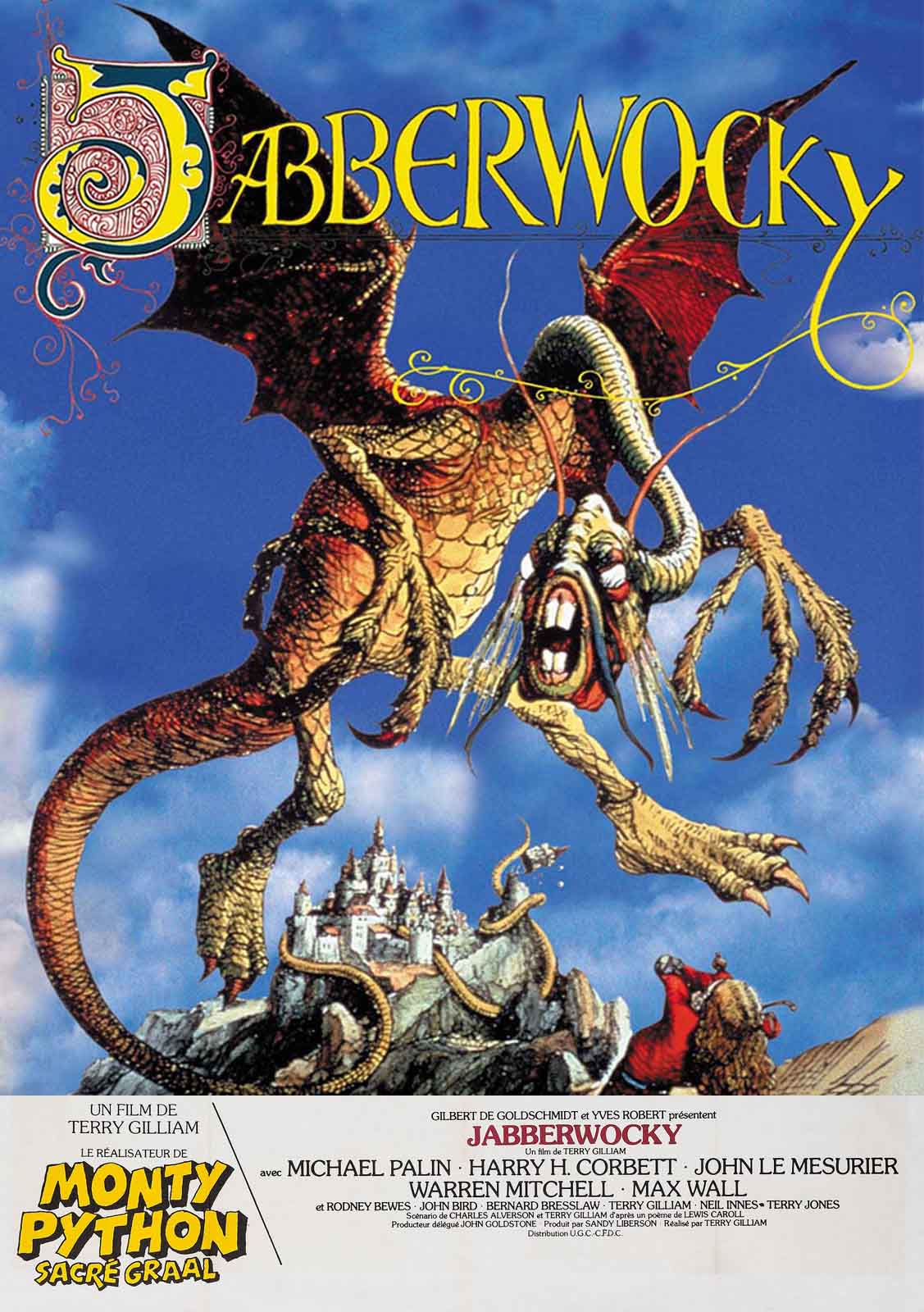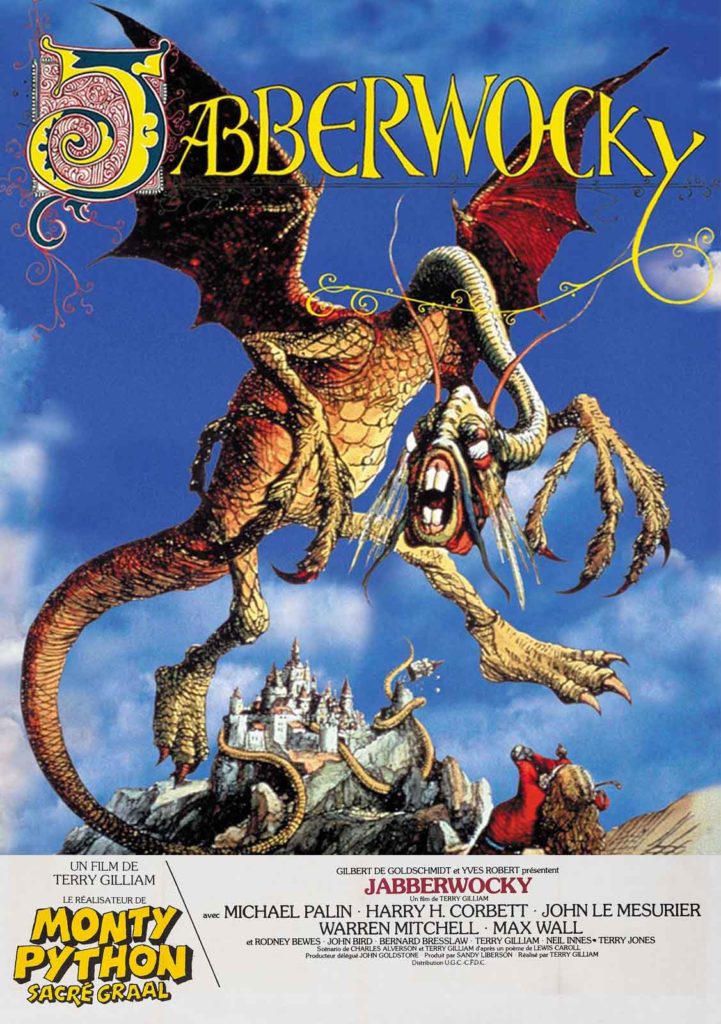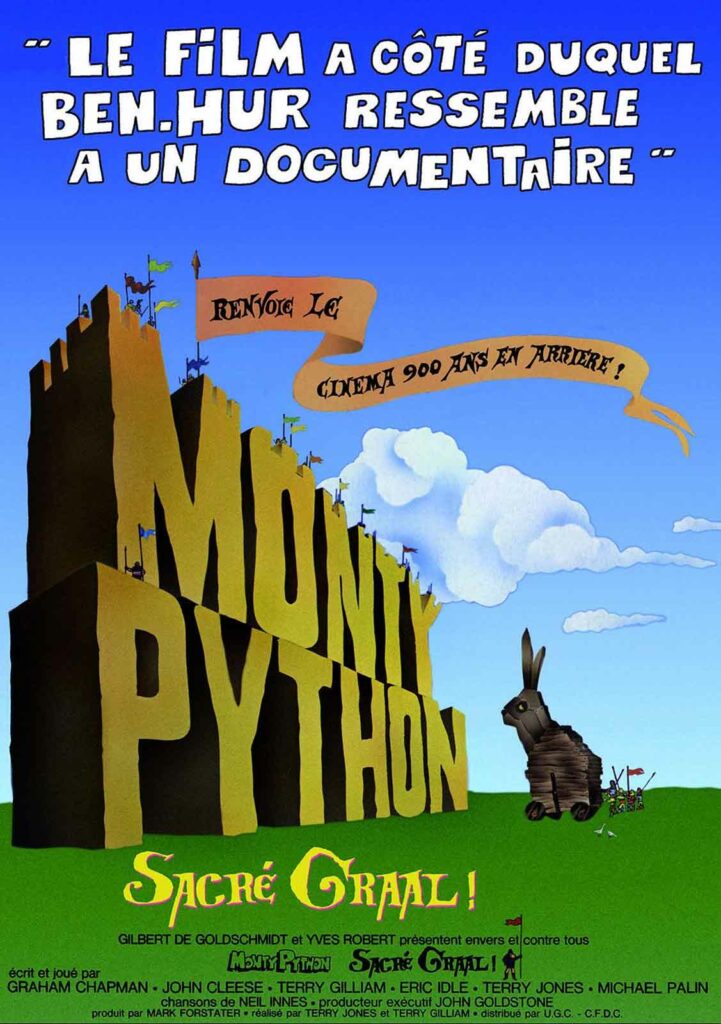Richard Donner et Bill Murray réinventent le classique de Charles Dickens dans ce conte de Noël moderne et satirique…
Richard Donner hésita un moment avant de se lancer dans Scrooged, variante moderne et humoristique du fameux « Christmas Carol » écrit par Charles Dickens en 1843. Après avoir pesé le pour et le contre, le cinéaste décida finalement de s’embarquer dans l’aventure, histoire de varier les plaisirs entre L’Arme fatale et L’Arme fatale 2. Sollicité pour le rôle principal, Bill Murray se laisse lui aussi le temps de la réflexion, pas sûr de vouloir reprendre ses activités d’acteur après les quatre ans de pause qui suivirent S.O.S fantômes. Le scénario co-rédigé par Mitch Glazer et Michael O’Donoghue le séduit, mais il souhaite y ajouter son grain de sel et le fait entièrement retravailler. La présence du comédien dans le film pousse les distributeurs à capitaliser sur sa popularité gigantesque acquise grâce à Ghostbusters. Les posters américains annoncent donc fièrement : « Bill Murray est de retour parmi les fantômes, mais cette fois, c’est trois contre un ! » La France, quant à elle, choisit le titre Fantômes en fête pour évoquer le plus frontalement possible S.O.S. fantômes, quitte à oublier au passage toute référence au célèbre conte de Noël dont s’inspire le scénario.


Tout commence sur des chapeaux de roue. Après un plan aérien soutenu par des chœurs féerique à mi-chemin entre Beetlejuice et L’Étrange Noël de Monsieur Jack, nous assistons à une séquence de fusillade au cours de laquelle le Père Noël et ses lutins prennent les armes face à une armada d’assaillants, jusqu’à ce que Lee Majors (L’Homme qui valait trois milliards lui-même, dans son propre rôle) ne vienne leur prêter main forte. Cette séquence invraisemblable est extraite d’un des nombreux programmes absurdes que s’apprête à diffuser IBC pour la soirée de Noël. A la tête de cette chaîne de télévision, Frank Cross (Murray) est un président odieux, cynique, arriviste et âpre au gain. Pour couronner sa programmation, il décide de produire une version personnelle du « Christmas Carol » de Charles Dickens en y ajoutant tous les ingrédients racoleurs susceptibles d’attirer l’audience. Il ne se doute évidemment pas qu’il s’apprête à vivre lui-même les mésaventures du détestable Scrooge, héros du classique de Dickens. Trois fantômes sont en effet sur le point de lui rendre visite pour ouvrir ses yeux et sa conscience sur ses erreurs passées, présentes et futures…
En roue libre
Habitué jusqu’alors au travail d’équipe (pour le petit et le grand écran), Bill Murray se retrouve ici seul en tête d’affiche, ce qui le pousse à en faire des caisses, à surcharger le tournage d’une énergie dévastatrice, à improviser la majeure partie de ses répliques et finalement à épuiser Richard Donner. Car les deux hommes ont beaucoup de mal à s’accorder pendant le tournage. Le réalisateur n’a aucun contrôle sur sa star, l’acteur essaie sans cesse d’apporter de nouvelles idées pour tenter d’enrichir le scénario, et Fantômes en fêtes finit par ressembler à un produit hybride en quête d’identité. Alternant les passages cyniques et les moments gorgés de bons sentiments, sous-exploitant la présence pourtant toujours réjouissante de Karen Allen, le film cherche la bonne tonalité et finit par ressembler à une fausse bonne idée. Il y a pourtant de belles choses dans Scrooged : une partition lyrique de Danny Elfman, des spectres surprenants (dont l’impressionnant fantôme des Noëls futurs aux allures de grande Camarde dont les entrailles abritent des visages grimaçants et difformes, œuvre du maquilleur Tom Burman) et quelques gags qui font mouche (les sans-abris qui confondent le héros avec Richard Burton). Et puis il y a Bill Murray. Souvent agaçant, cabotin jusqu’au point de non-retour, il sait aussi se montrer irrésistible, drôle et même touchant, comme toujours. Modeste succès au box-office, Fantômes en fête s’est depuis mué en programme incontournable des fêtes de fin d’année, grâce à ses innombrables diffusions sur les chaînes américaines.
© Gilles Penso
Partagez cet article