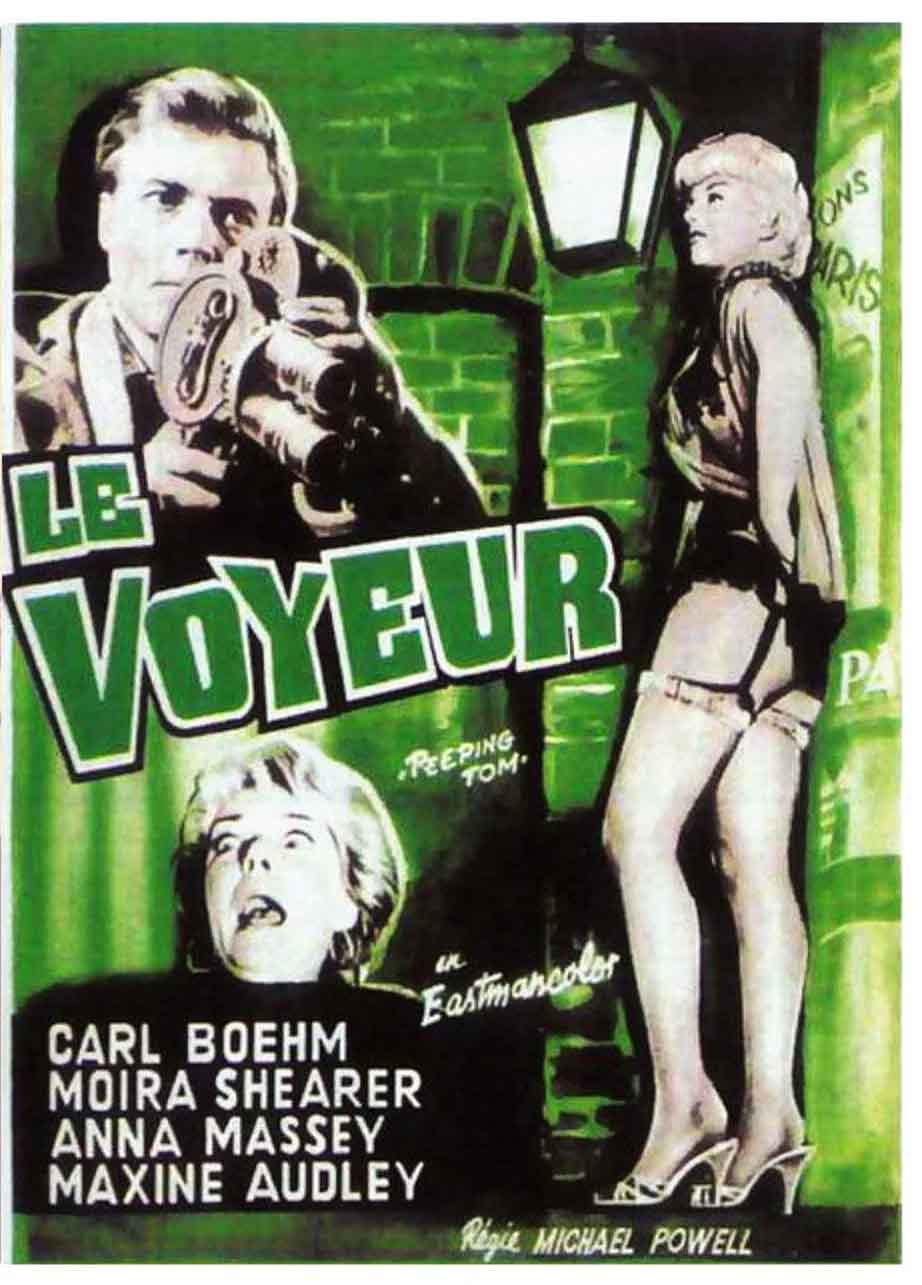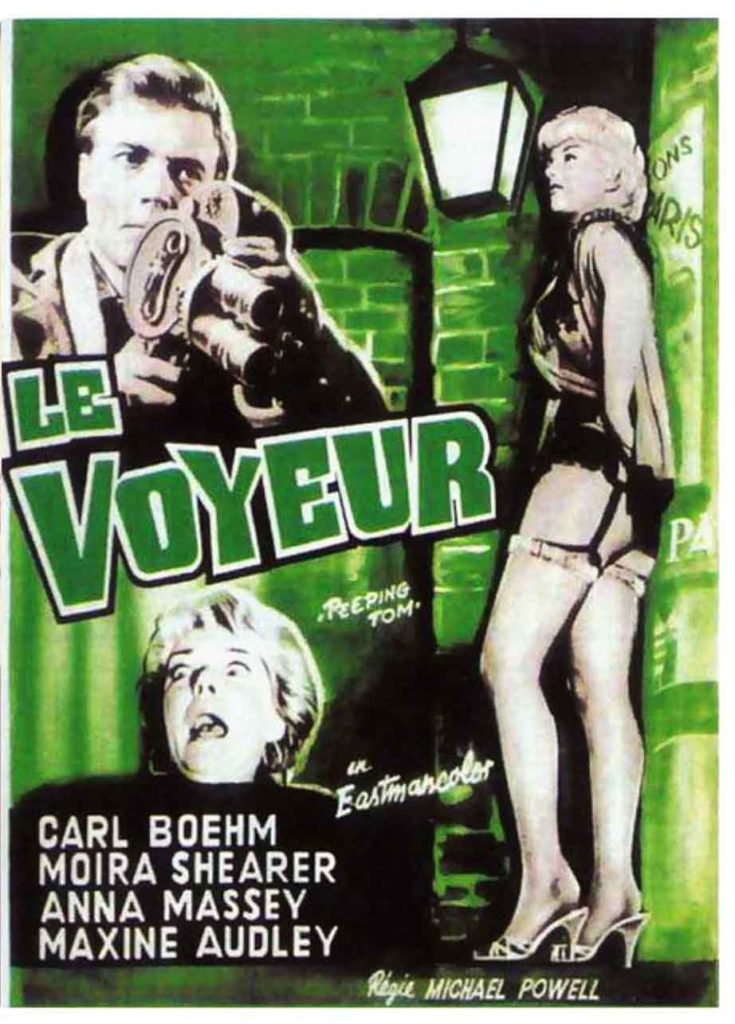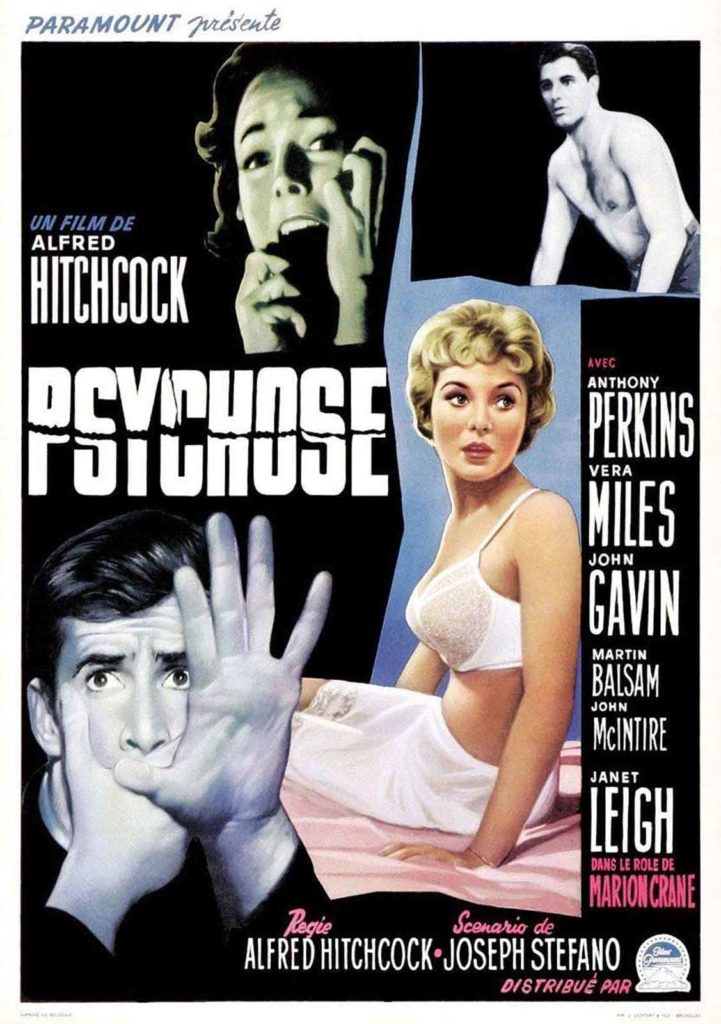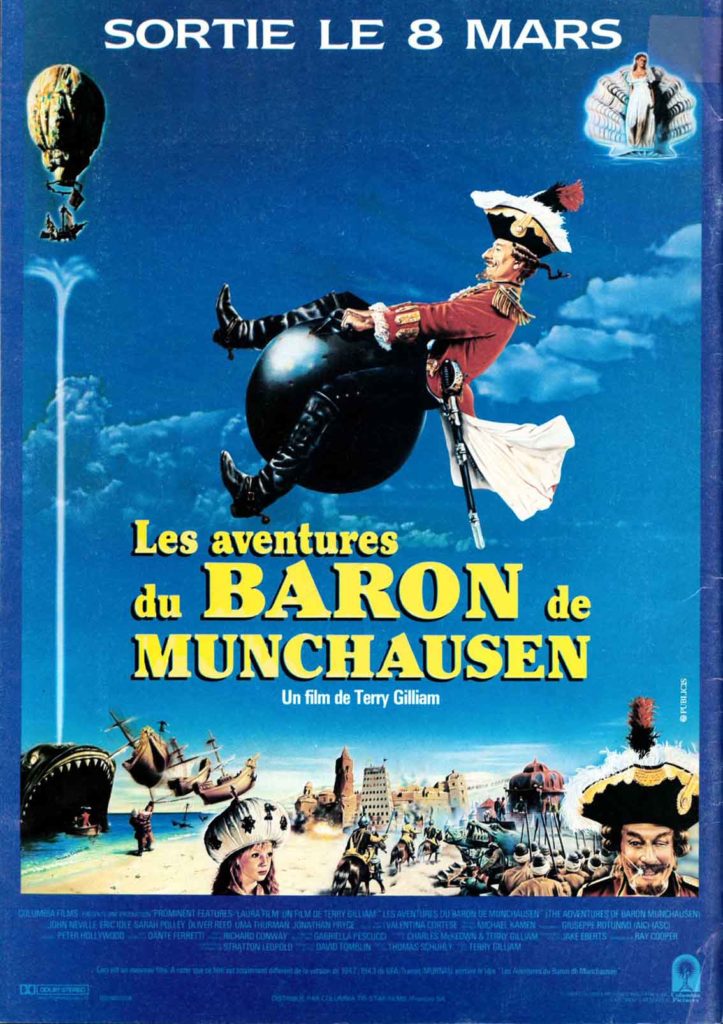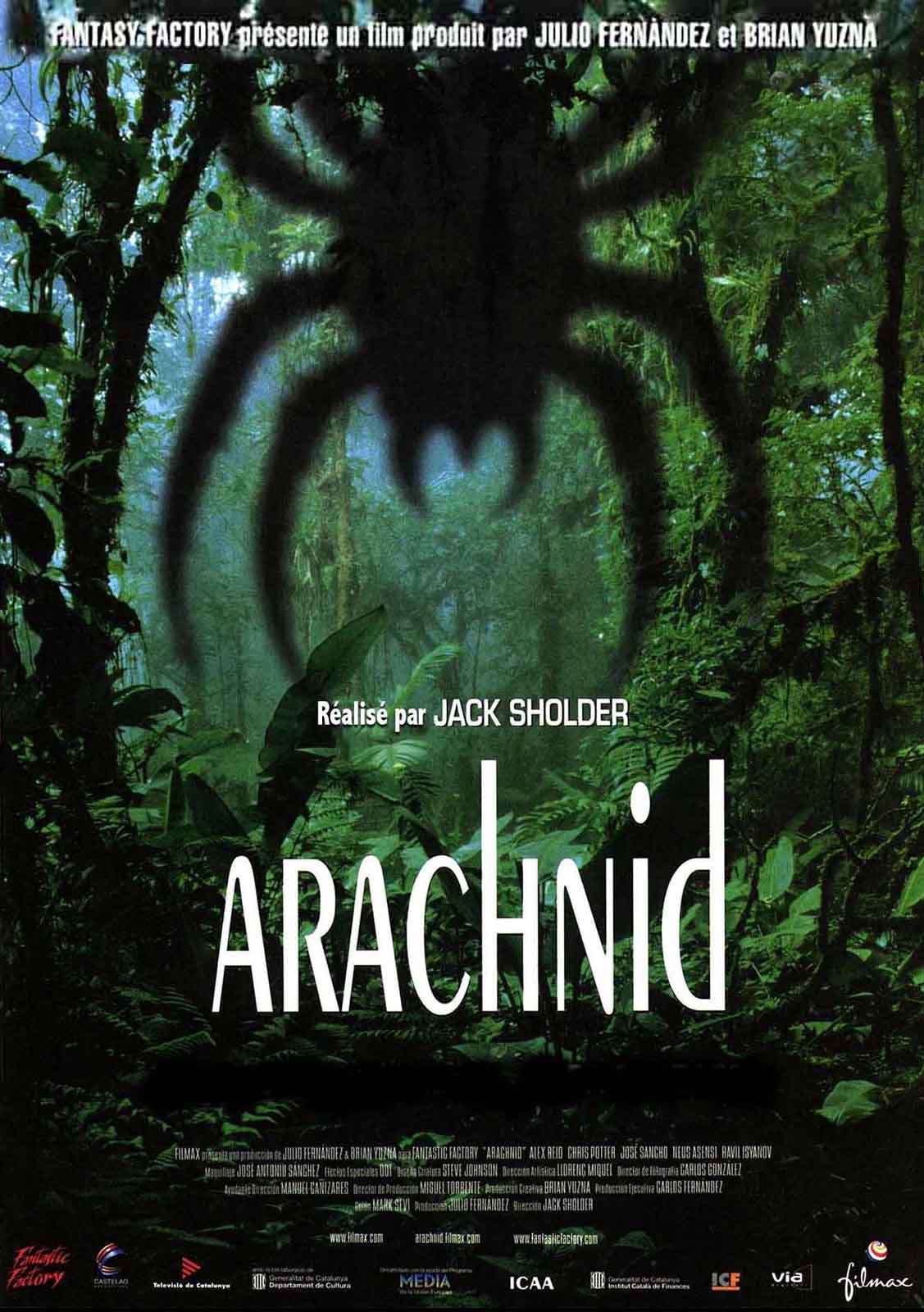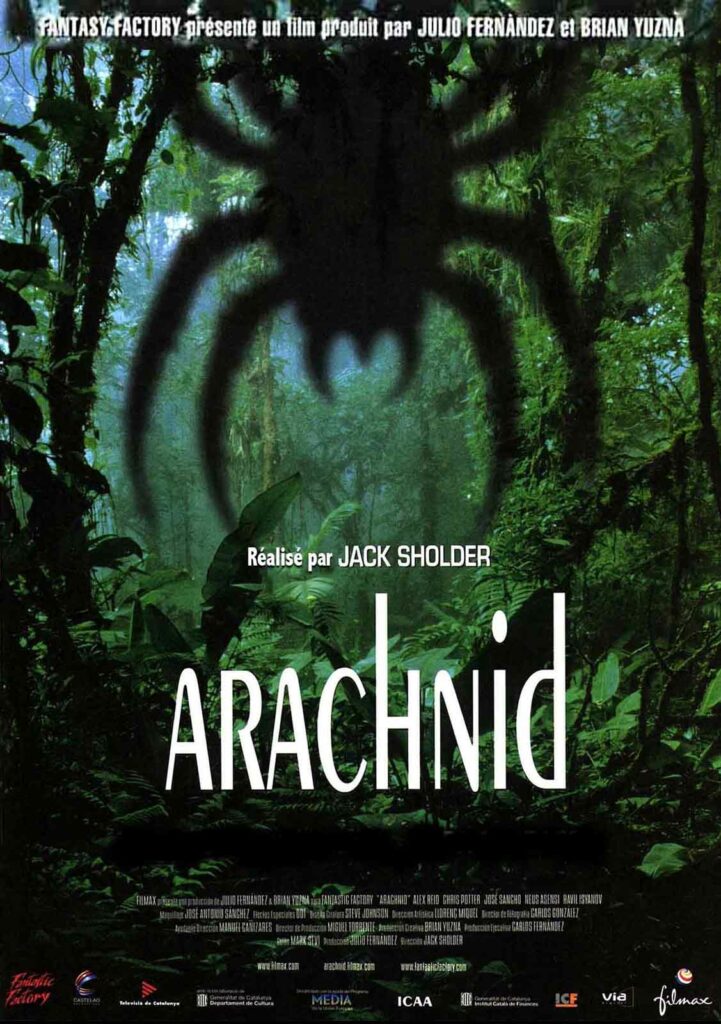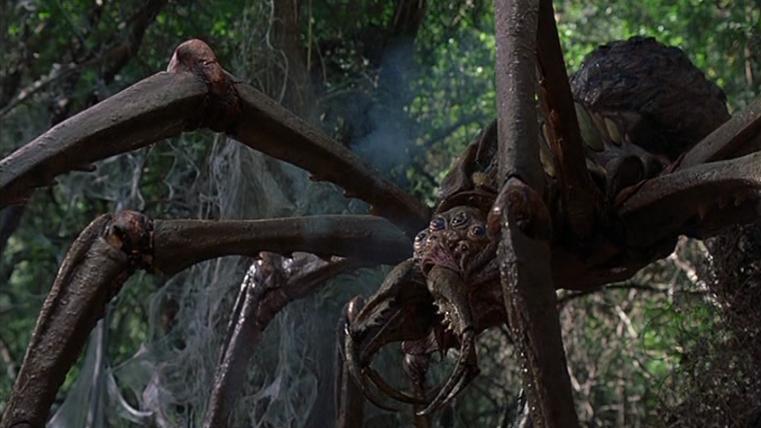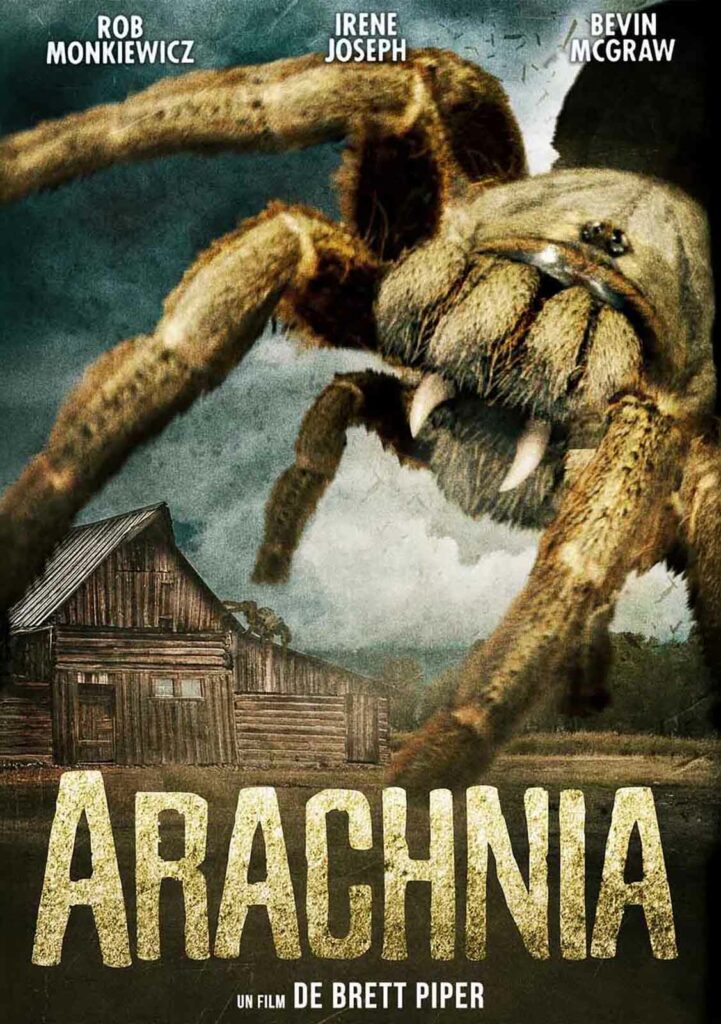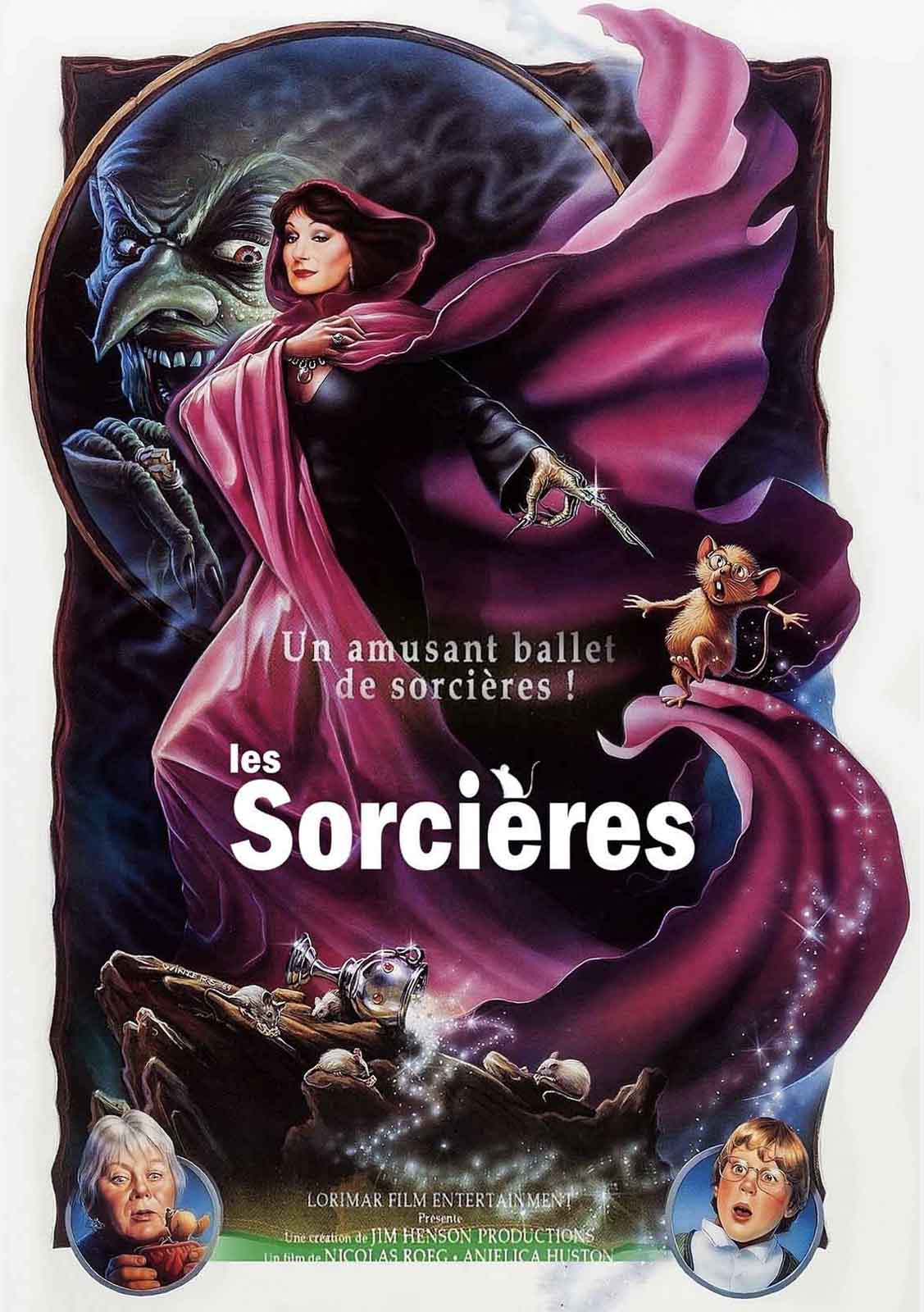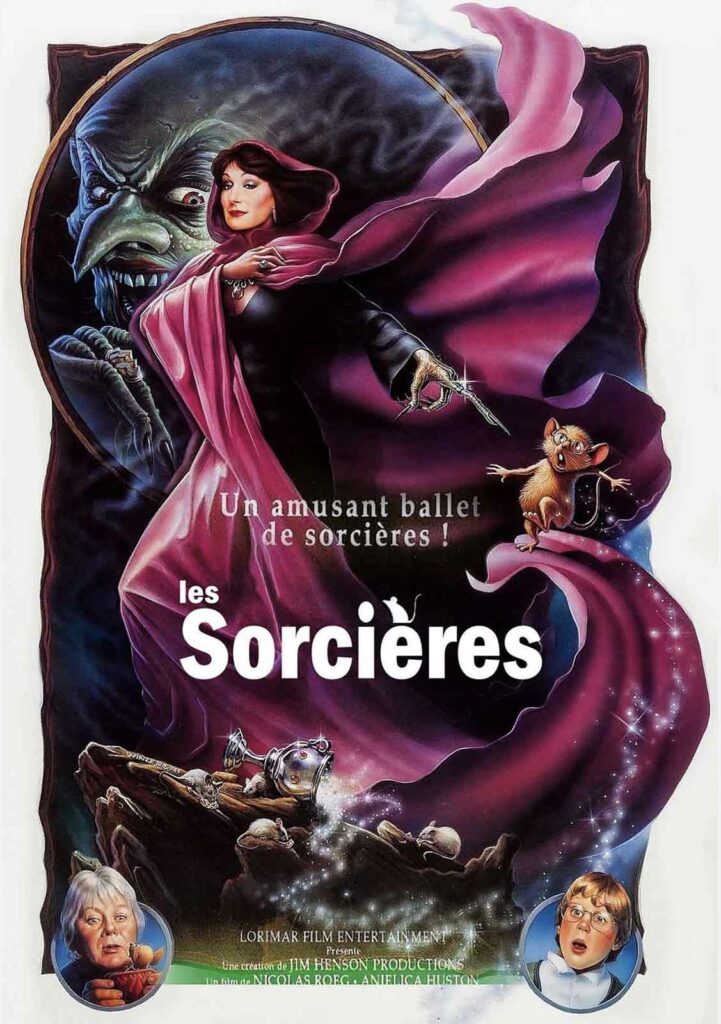Une expérience visant à atteindre le magma du centre de la terre provoque un monstrueux cataclysme
CRACK IN THE WORLD
1965 – USA
Réalisé par Andrew Marton
Avec Dana Andrews, Alexander Knox, Janette Scott, Kieron Moore, Peter Damon, Jim Gillen, Gary Lasdun, Alfred Brown, Mike Steen
THEMA CATASTROPHES
En 1965, Andrew Marton était déjà un vieux de la vieille, un routard ayant réalisé une bonne trentaine de longs-métrages, dont Les Mines du roi Salomon, et ayant participé à bon nombre d’œuvres épiques telles que Ben-Hur, Cléopâtre, Les 55 jours de Pékin ou encore Le Jour le plus long. S’atteler à un film catastrophe n’était donc guère un défi insurmontable pour le cinéaste, lequel eut l’opportunité d’intégrer à son équipe le très talentueux Eugène Lourié, réalisateur du Monstre des temps perdus et officiant ici comme chef décorateur et superviseur des effets spéciaux. Entièrement tourné en Espagne, Quand la Terre s’entrouvrira raconte les expériences pour le moins audacieuses du docteur Stephen Sorenson (Dana Andrews). En quête d’une source d’énergie susceptible d’apporter des ressources inépuisables aux humains et de les mettre à l’abri du besoin, il projette d’utiliser une fusée équipée d’une tête thermonucléaire pour percer la croûte terrestre et atteindre le magma. Le projet n’est pas sans risques, et le principal opposant de Sorenson est Ted Rampion (Kieran Moore), qui conteste sa théorie depuis le début. Démonstration à l’appui, il décrit en miniature les effets dévastateurs que pourrait provoquer une telle explosion.


Il se trouve que Ted est l’ancien élève de Sorenson, mais aussi l’ex-petit ami de sa femme Maggie (Janette Scott). D’où un triangle amoureux conventionnel dont le scénario se serait bien passé, mais qui n’entache guère les qualités générales du film. D’autant que les comédiens sont franchement convaincants. Une fois qu’il a obtenu le feu vert du gouvernement, Sorenson ignore les mises en gardes de son rival et envoie sa fusée dans les entrailles de la terre, déclenchant bientôt une bombe atomique d’une puissance de dix mégatonnes. Comme on pouvait s’y attendre, l’expérience vire rapidement à la catastrophe, creusant une gigantesque fissure à la surface du globe qui n’en finit plus de progresser et de croître, engloutissant tout sur son passage.
L’apocalypse
Pour visualiser le désastre, le film met à contribution quelques images d’archives d’éruptions volcaniques, mais aussi et surtout de très belles maquettes qui rivalisent avec les meilleurs travaux de Derek Meddings (Les Sentinelles de l’air) et Eiji Tsuburaya (Godzilla). Du coup, les destructions, séismes, éboulements et autres coulées de lave prennent une tournure monstrueusement photogénique. Andrew Marton ne ménage d’ailleurs pas ses efforts pour mettre en place d’efficaces séquences de suspense, notamment la descente dans le cratère qui vise à faire exploser une autre bombe sensée stopper la progression de la fissure, ou la course avec le train sur le pont qui menace de s’écrouler. Les dernières images sont apocalyptiques, dans la mesure où la catastrophe, impossible à enrayer, arrache à la croûte terrestre un gigantesque bloc qui se projette dans l’espace et se mue en nouvelle lune. Et lorsque le couple de survivants, blême, contemple le crépuscule de ce nouveau monde comme de nouveaux Adam et Eve, on réalise que cette variante sur le thème classique de l’apprenti-sorcier a pris une dimension littéralement biblique.
© Gilles Penso
Partagez cet article