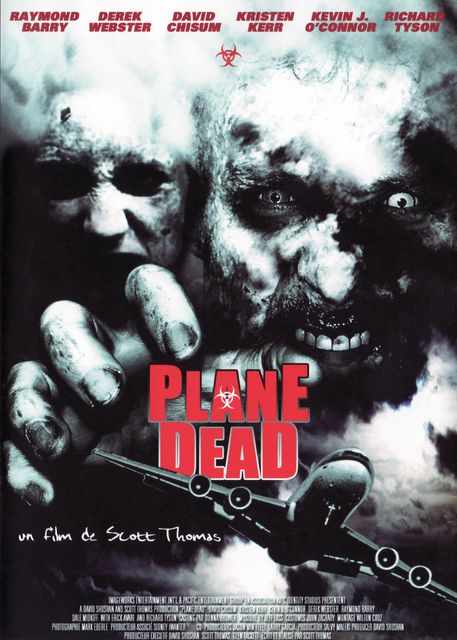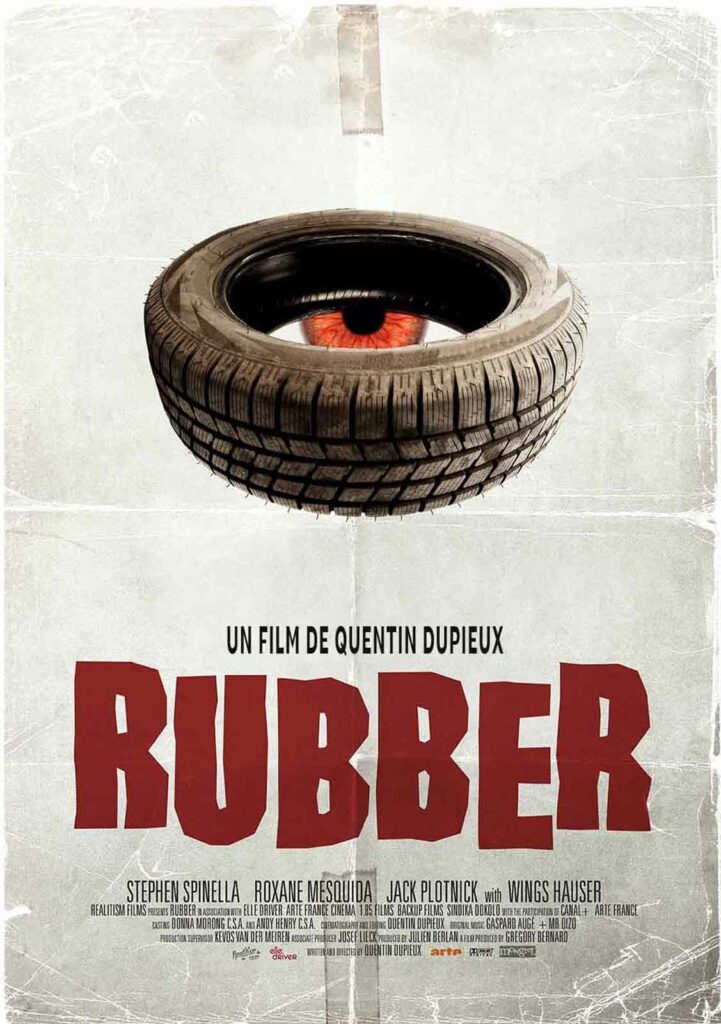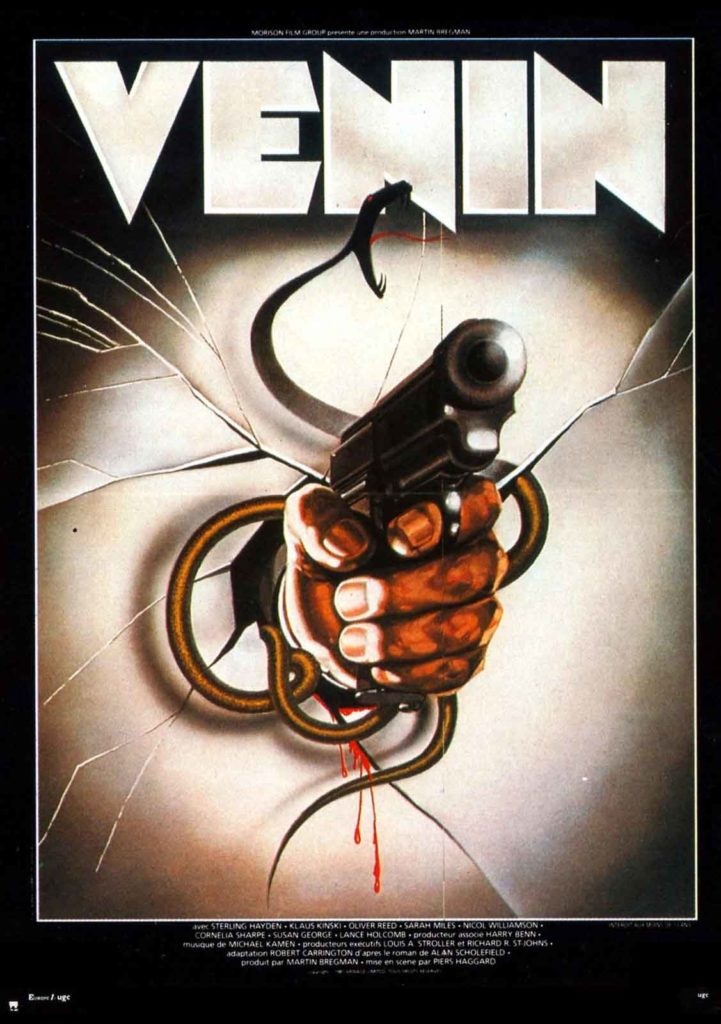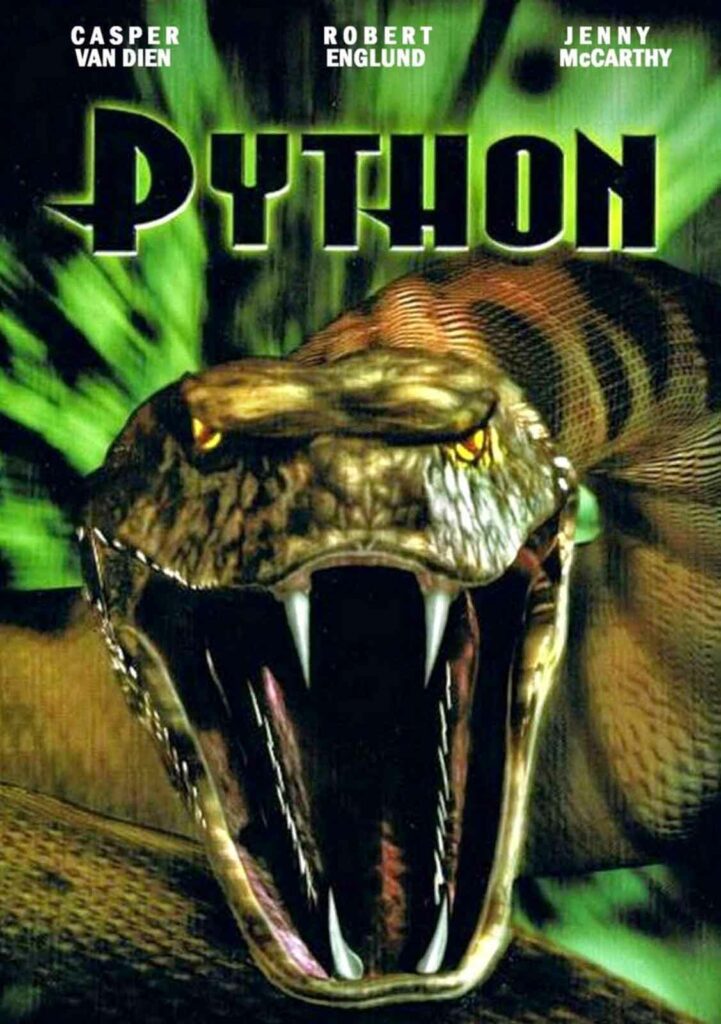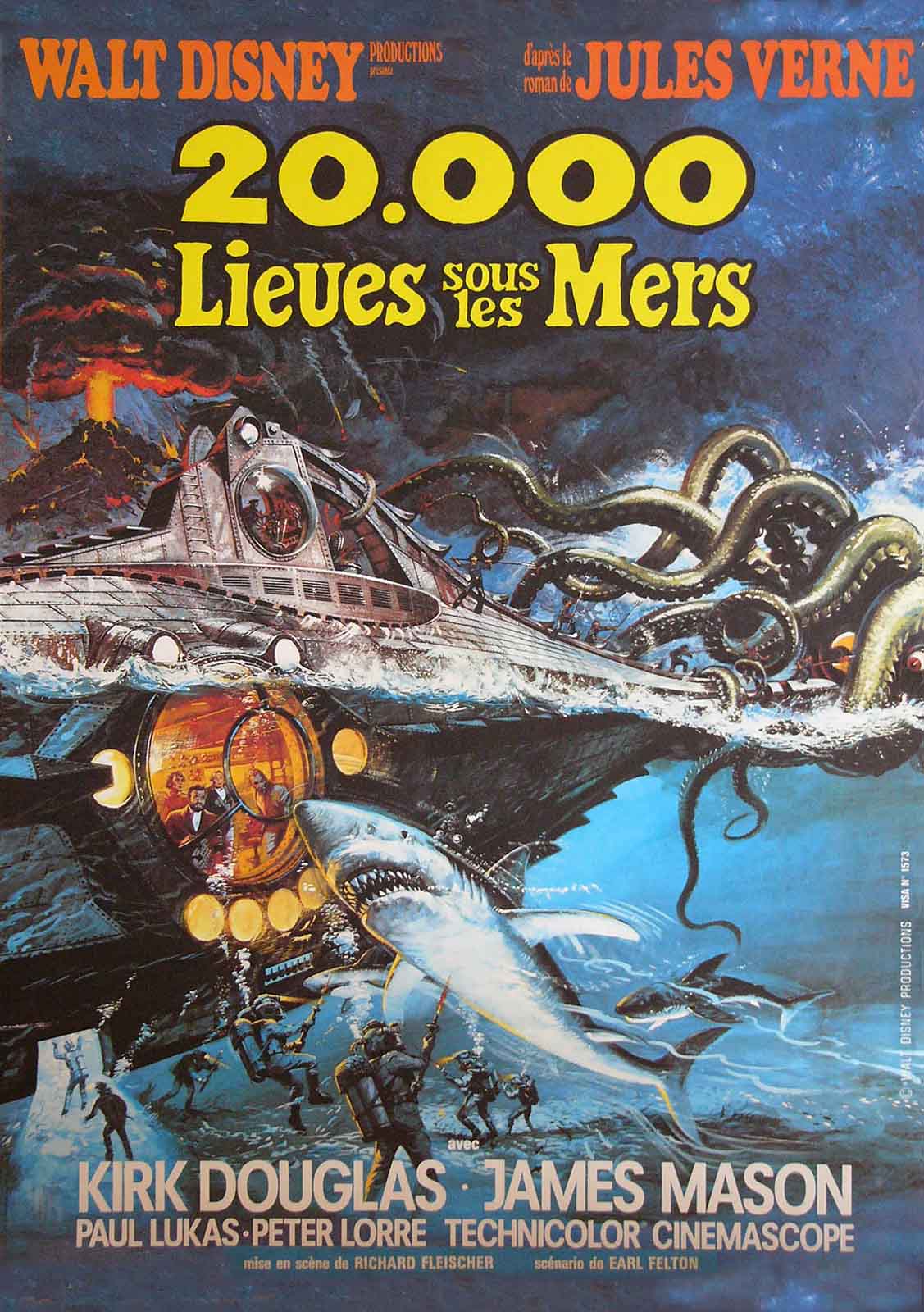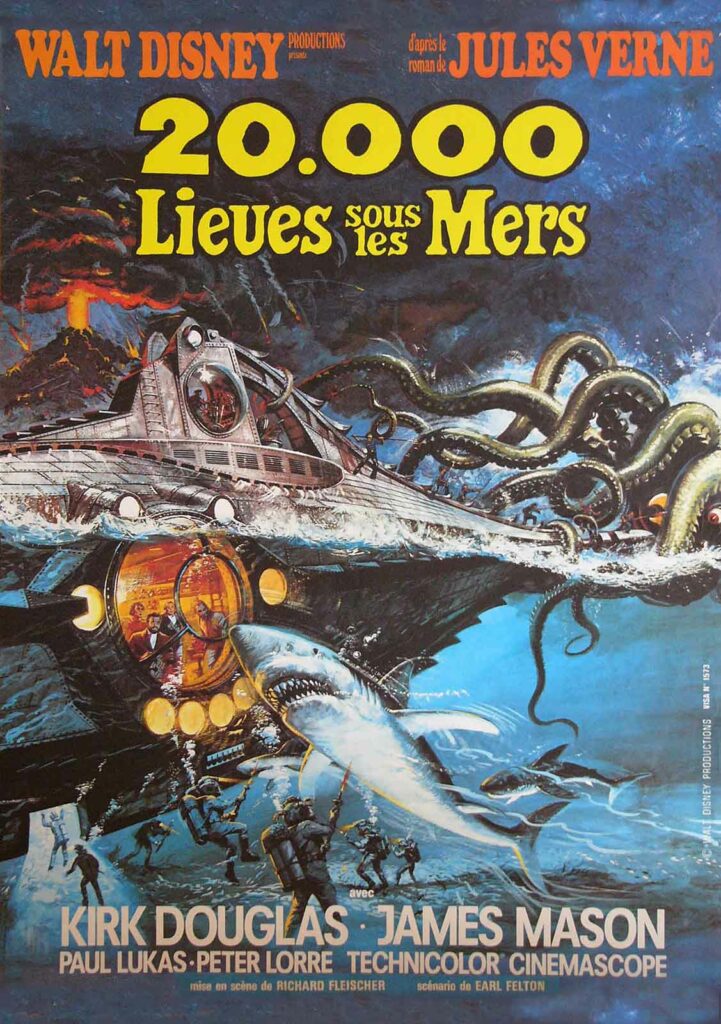L’esthète Mario Bava s’essaie à l’exercice du film à sketches avec trois récits d’épouvante abordant le vampirisme, les fantômes et la mort
En s’attaquant à l’exercice du film à sketches, Mario Bava s’est efforcé d’aborder trois récits aussi différents que possible, leur seul véritable point commun étant l’épouvante, comme le suggère assez bien un titre poétique et évocateur. Tout commence avec Boris Karloff qui, pince sans rire, se présente au spectateur (ce qui n’est pas superflu, vu sa tendance habituelle à recouvrir son visage de latex) et annonce les thématiques du film en évoquant le mythe des vampires, alors brusquement éclairé de rouge. Le spectateur, conditionné, se cale dans son fauteuil, tandis que s’amorce le premier récit, « Le Téléphone », inspiré d’une nouvelle d’Howard Snyder. Son héroïne, Rosy, reçoit des messages téléphoniques menaçants de la part de Frank, qu’elle a trahi et qui vient de s’évader de prison. Elle supplie alors Mary, une ancienne amie délaissée, de lui tenir compagnie. Ce sketch puise surtout son intérêt dans la photogénie de Michèle Mercier et dans les effets de mise en scène de Bava, qui rachètent en partie l’extrême classicisme d’une intrigue un tant soit peu vaudevillesque.


Le second récit, le plus connu du triptyque, se nomme « Les Wurdalaks » et s’inspire du roman « La Famille du Vourdalak » de Tolstoï. Boris Karloff y interprète Gorka, un chasseur balkan qui devient vampire après avoir tué le brigand Alibek. De retour chez les siens, qui le soupçonnent d’être passé du côté des non-morts, il déclare gravement : « Je suis mort… de faim ! » Tolstoï pointait dans son œuvre la terrible spécificité des vampires slaves qui « sucent de préférence le sang de leurs parents les plus proches et de leurs amis les plus intimes qui, une fois morts, deviennent vampires à leur tour, de sorte qu’on prétend avoir vu en Bosnie et en Hongrie des villages entiers transformés en vourdalaks. » La première victime de Gorka est Ivan, son petit-fils, qui revient d’entre les morts et pleure pour attirer les membres de sa famille, y compris la belle Sdenka dont s’est épris le comte Vladimir d’Urfe. Cynique et angoissant, Karloff contrebalance par son charisme la fadeur des deux tourtereaux incarnés par Mark Damon et Suzy Anderson.
« Je suis mort… de faim ! »
Respectant la règle du crescendo, « La Goutte d’eau », dernier sketch de la trilogie, est probablement le plus réussi. Il puise son inspiration chez Tchekov, et raconte la mésaventure d’Hélène Chester, une infirmière qui fait la toilette des morts. Cédant à la tentation, elle dérobe une bague avec un diamant de la main de Miss Perkins, une voyante décédée en pleine séance de spiritisme. De retour chez elle, l’inquiétude commence à la gagner…. Un cadavre terriblement grimaçant, une grosse mouche, et une lancinante goutte d’eau réussissent à provoquer une angoisse terriblement palpable au sein de cet ultime segment, le tout s’achevant sur un savoureux dénouement « gag ». Bava soigne autant l’image de sa trilogie (comme toujours) que la bande son (la sonnerie du téléphone, le vent chez les Wurdalak, l’eau qui tombe goutte à goutte). Dommage en revanche qu’aucun fil conducteur ne relie ces trois épisodes disparates, entraînant un manque d’unité qui nuit quelque peu à la cohésion du film.
© Gilles Penso
Partagez cet article