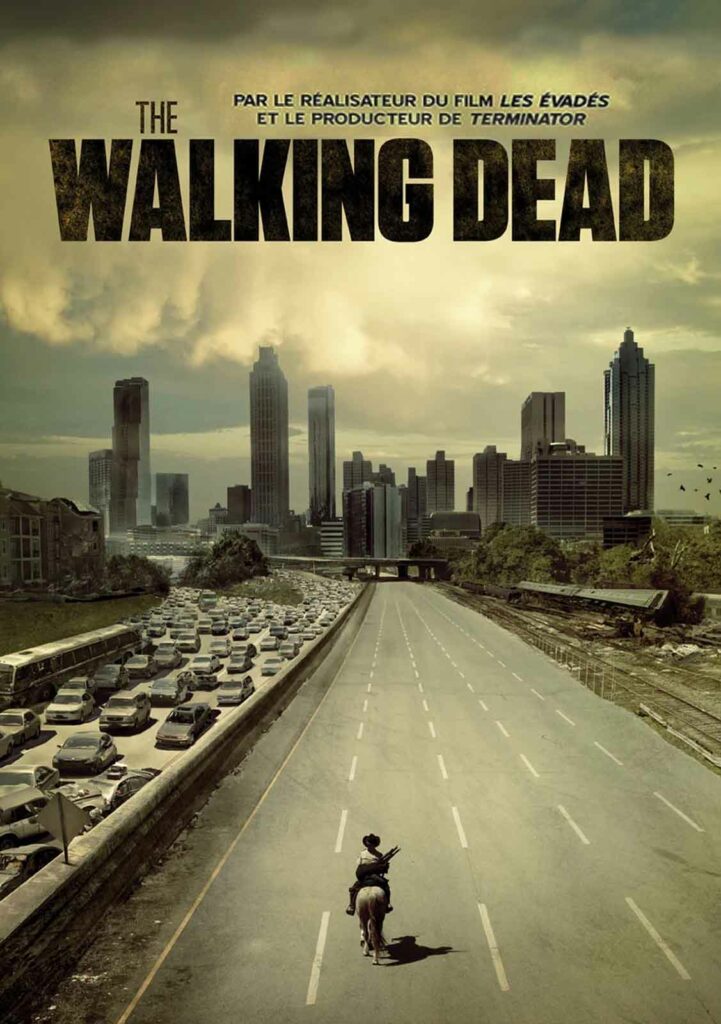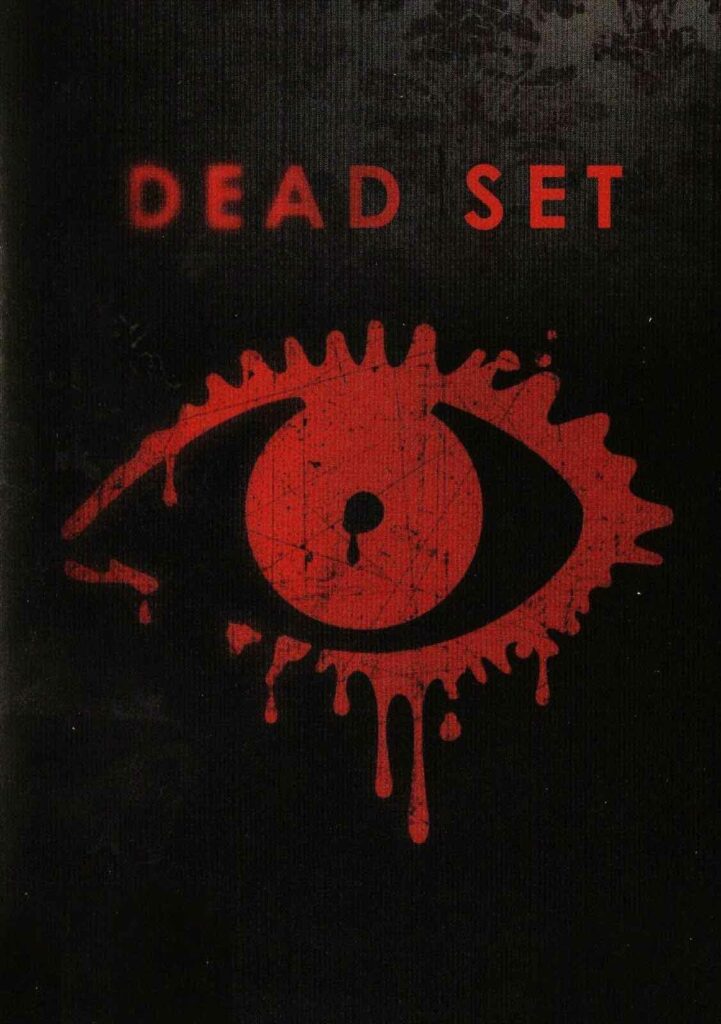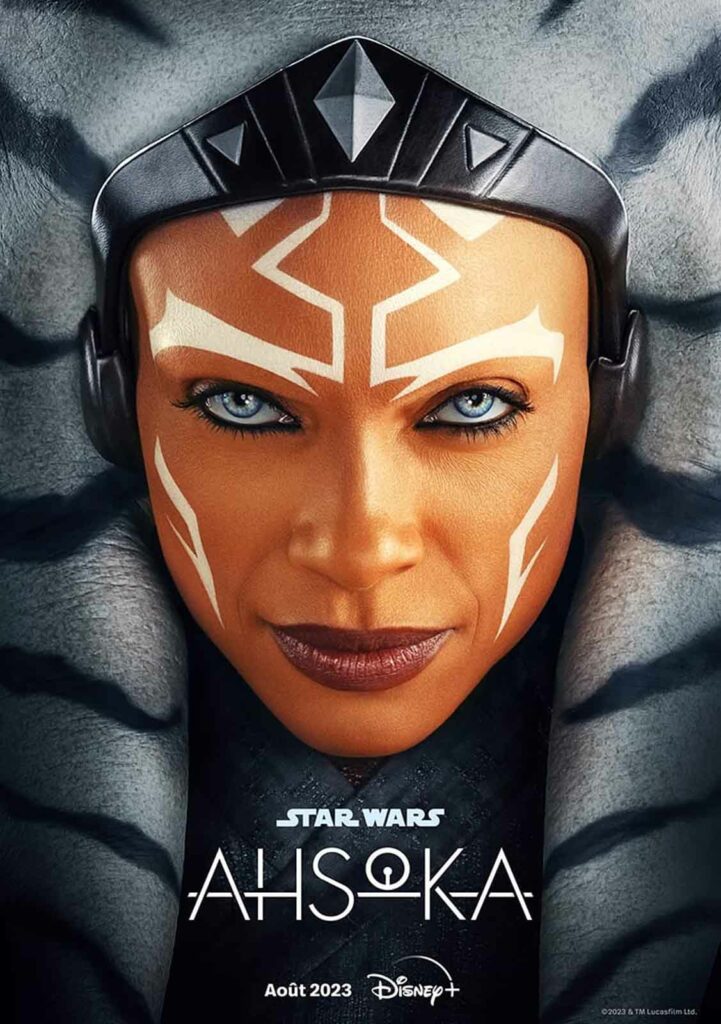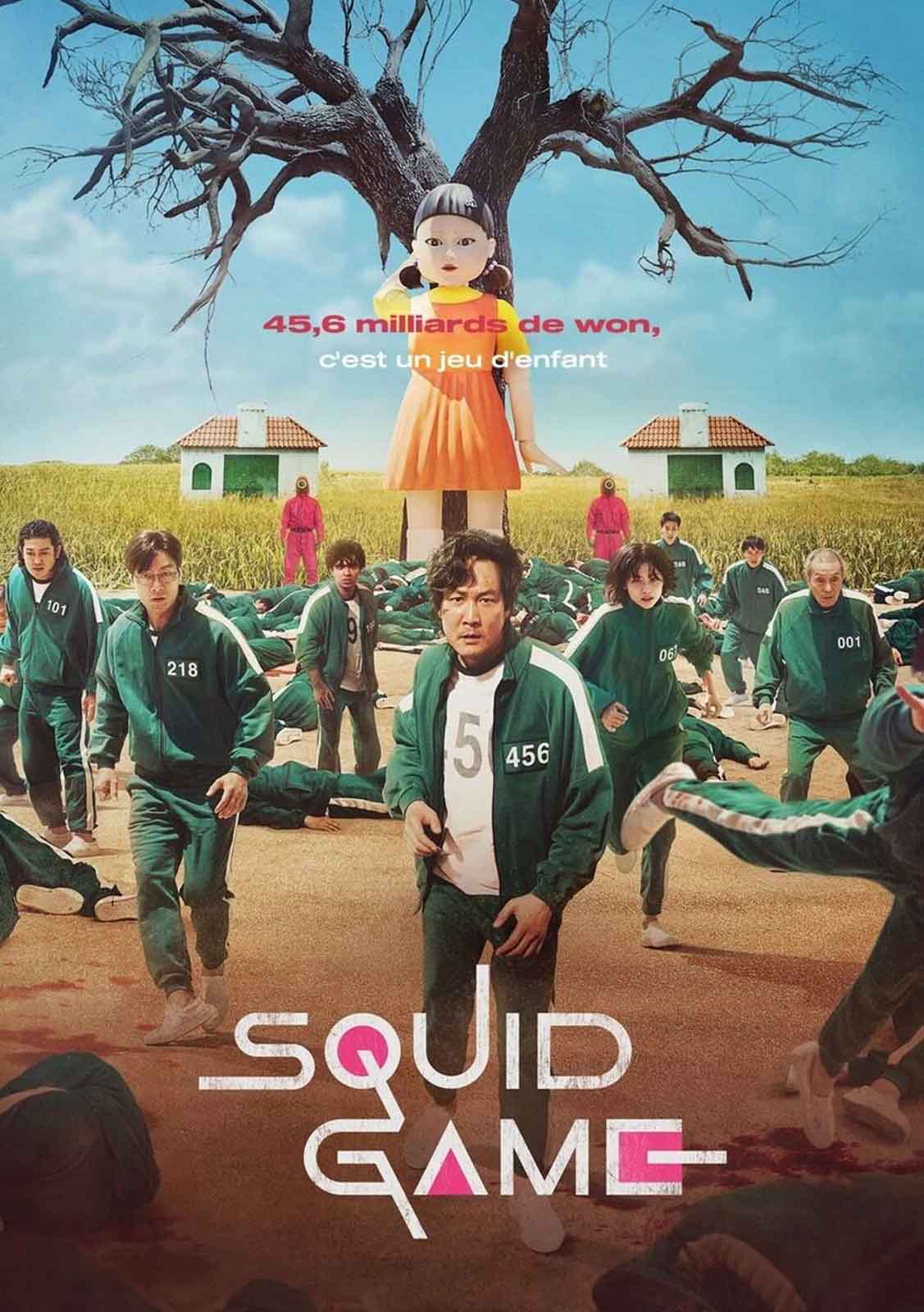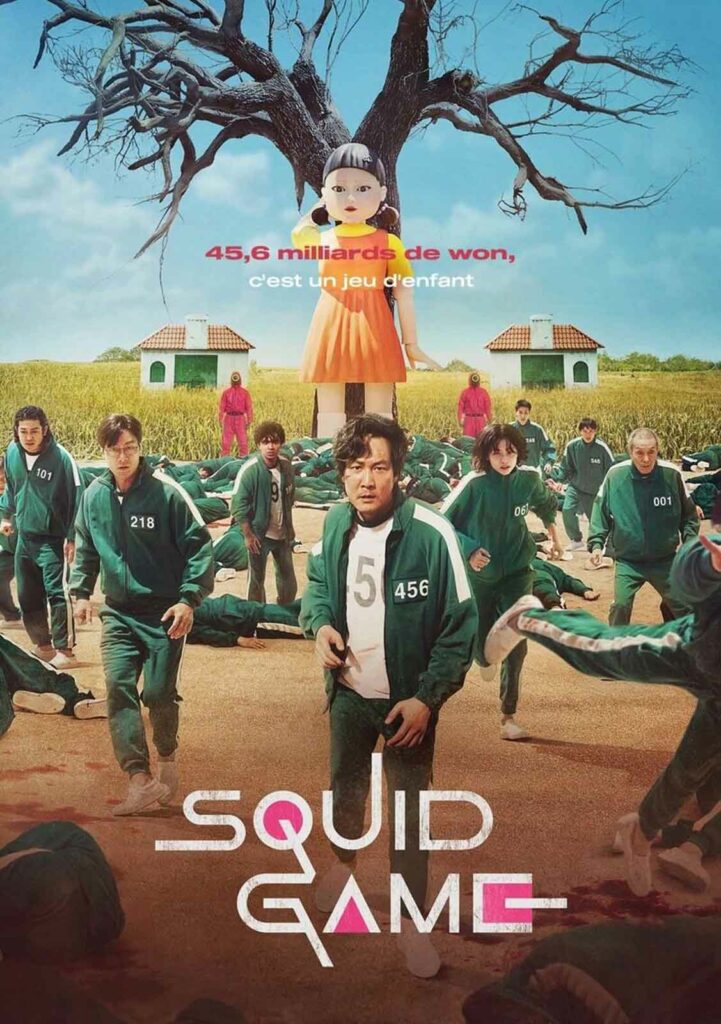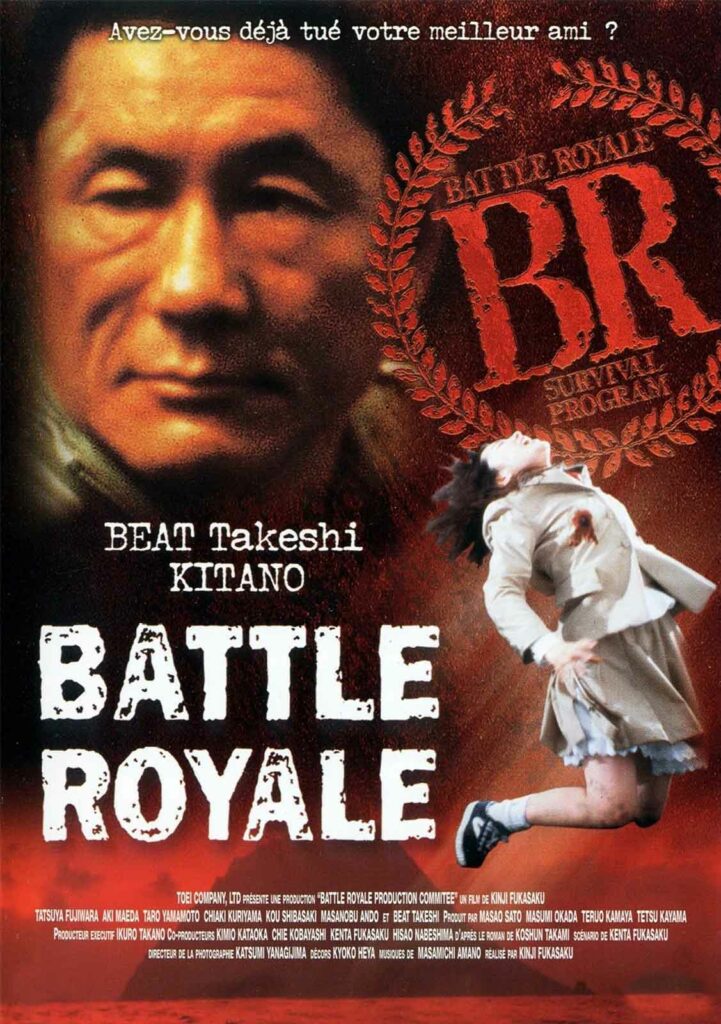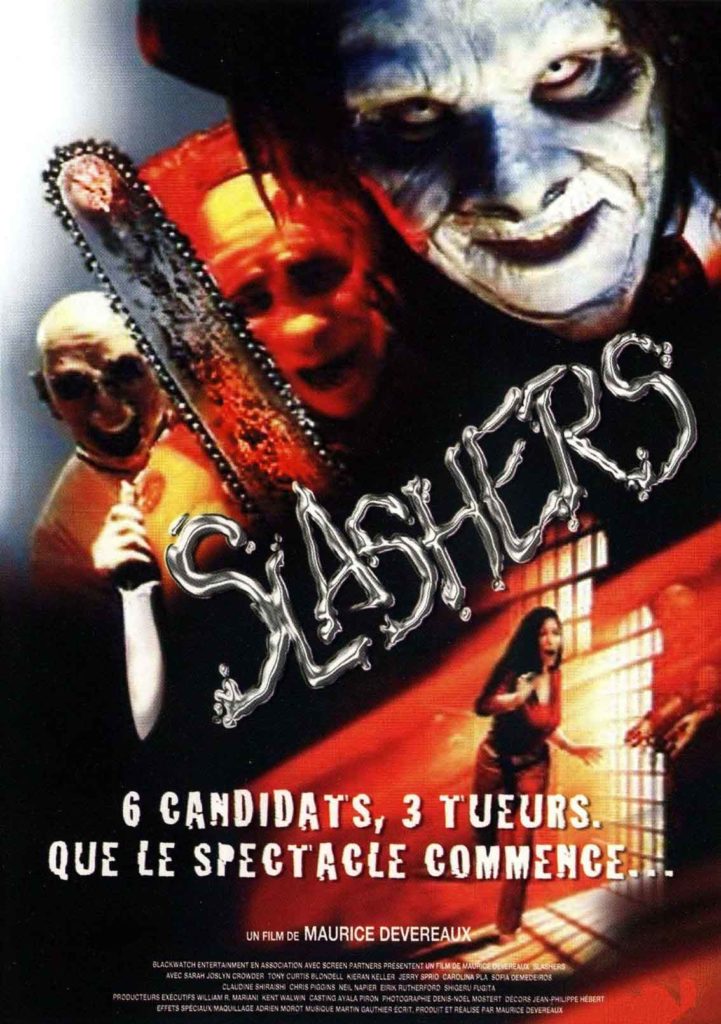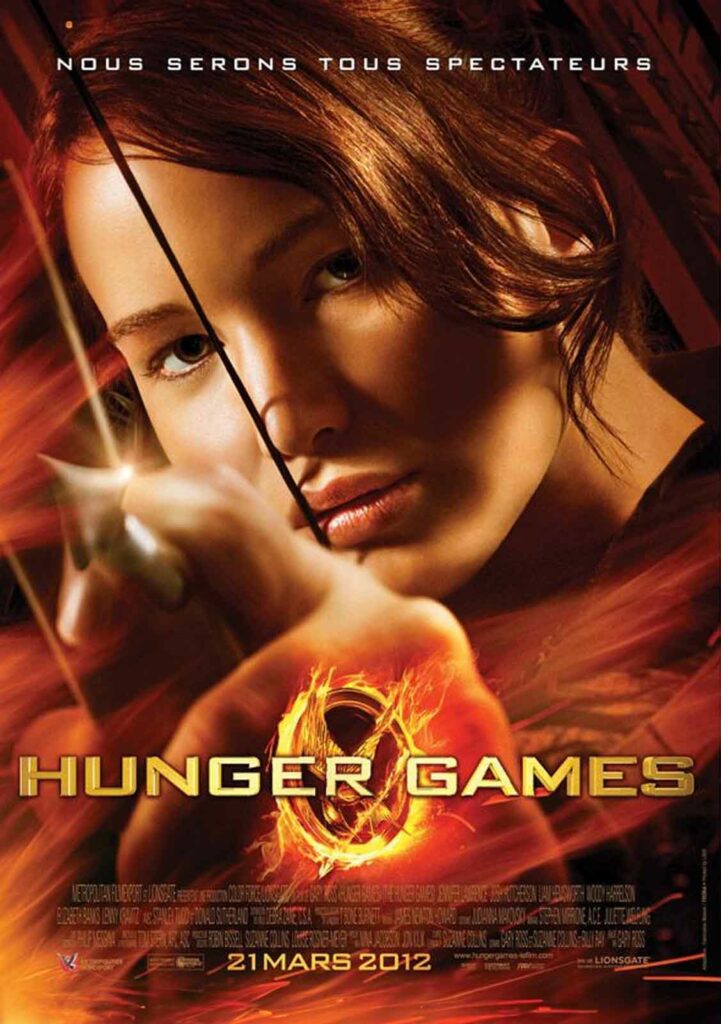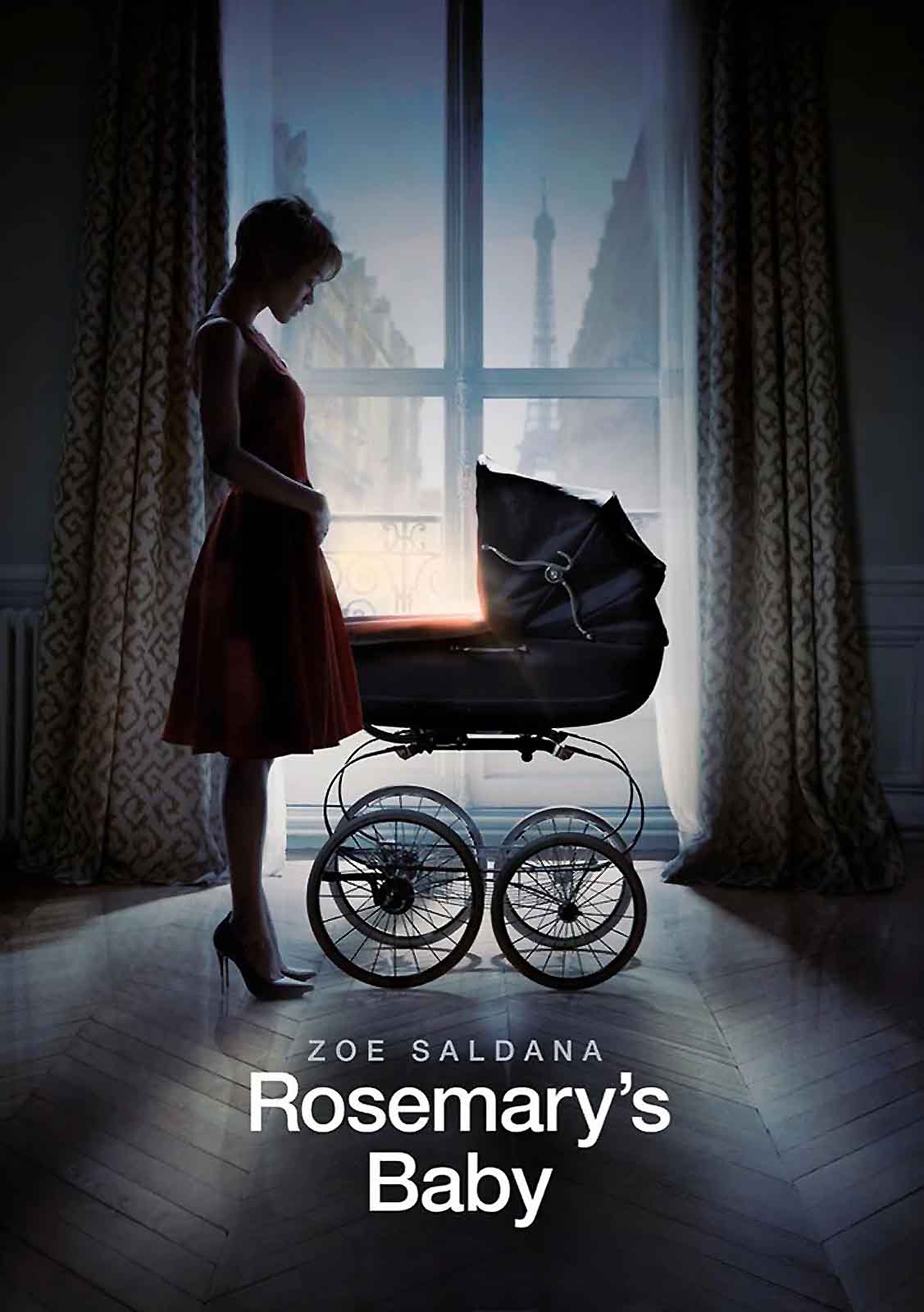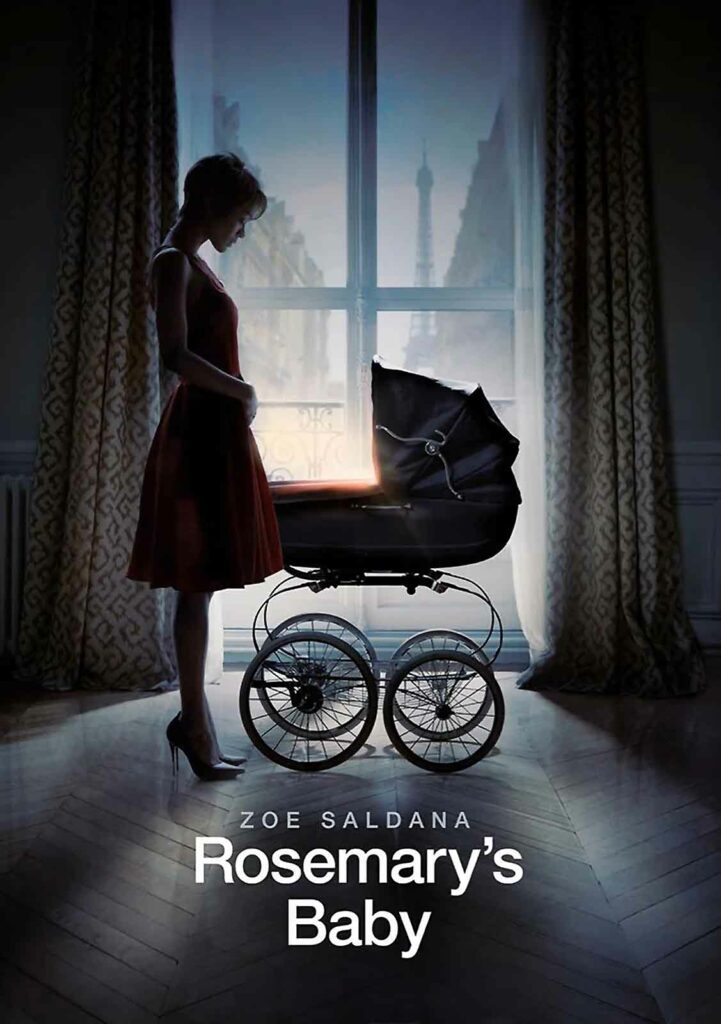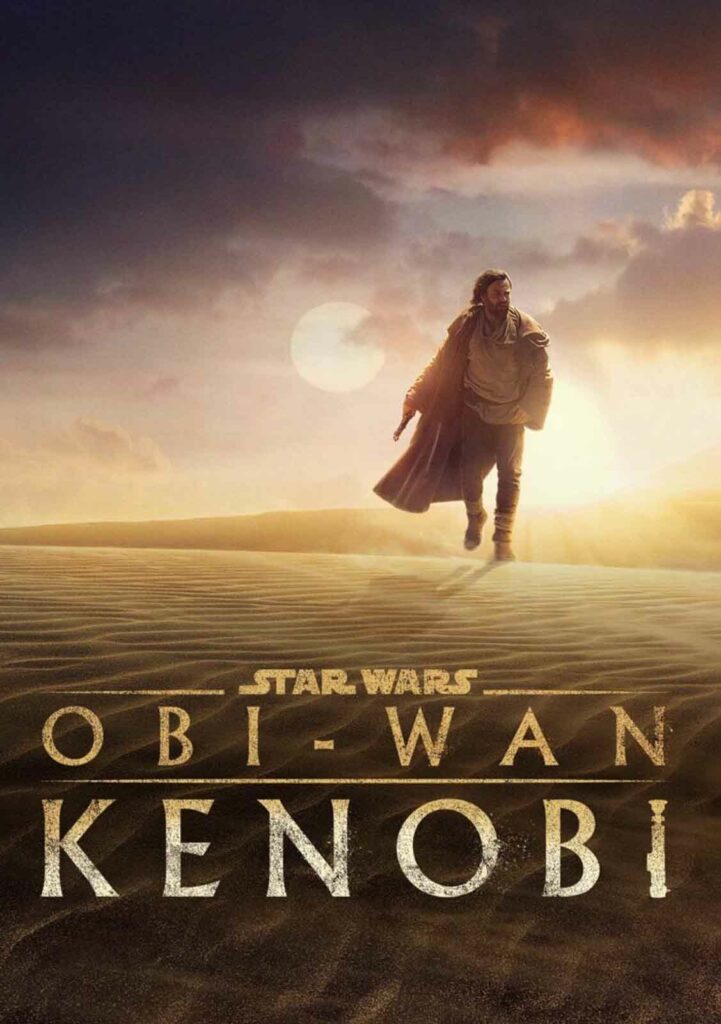La première série dérivée du succès de The Walking Dead tente maladroitement de retrouver les recettes de son modèle…
FEAR THE WALKING DEAD
2015/2023 – USA
Créée par Robert Kirkman et Dave Erickson
Avec Kim Dickens, Cliff Curtis, Frank Dillane, Alycia Debnam-Carey, Elizabeth Rodriguez, Mercedes Mason, Lorenzo James Henrie, Ruben Blades
THEMA ZOMBIES I SAGA WALKING DEAD
En septembre 2013, face au succès colossal de la série The Walking Dead qui attaque alors sa quatrième saison, la chaîne AMC annonce officiellement le développement d’un spin-off, autrement dit un show télévisé parallèle qui se situe dans le même univers mais s’attache à d’autres personnages que ceux créés par Robert Kirkman dans son roman graphique. L’auteur original est cette fois-ci aux commandes, aux côtés du scénariste Dave Erickson (Sons of Anarchy). Ce dernier envisage de revenir aux racines du mal en racontant l’histoire du patient zéro, mais Kirkman n’est pas très chaud à l’idée d’axer la série sur l’origine du virus. Pour lui, mieux vaut garder le mystère à ce sujet. Malgré tout, Fear the Walking Dead (dont le tournage commence avec le titre provisoire de Cobalt) prend place avant les événements racontés dans The Walking Dead. L’idée consiste en effet à raconter l’effondrement de la société depuis les prémices de la catastrophe, un passage qui avait été escamoté dans la série originale, l’invasion des morts-vivants s’étant amorcée pendant le coma du personnage de Rick. Fear The Walking Dead choisit donc un angle narratif différent, tout en s’axant plus sur l’atmosphère que sur l’action.


Les trois premières saisons se déroulent à Los Angeles, puis au Mexique. On y suit une famille recomposée et dysfonctionnelle : Madison Clark (Kim Dickens), conseillère d’éducation dans un lycée, son fiancé Travis Manawa (Cliff Curtis), professeur d’anglais, leurs enfants respectifs – Alicia (Alycia Debnam-Carey), la fille de Madison, Nick (Frank Dillane), son fils toxicomane, et Chris (Lorenzo James Henrie), le fils de Travis issu d’un précédent mariage avec Liza Ortiz (Elizabeth Rodriguez). D’autres personnages rejoignent progressivement leur groupe, alors que débute l’apocalypse zombie. Ensemble, ils doivent se réinventer, apprendre à survivre dans un monde en ruine, et développer des compétences nouvelles pour faire face à la disparition pure et simple de la civilisation. À partir de la quatrième saison, la série opère un virage majeur. Morgan Jones (Lennie James), transfuge de The Walking Dead, devient en effet le nouveau fil rouge de l’intrigue. Installé au Texas, il croise la route des survivants restants et de nouveaux visages, poursuivant la lutte contre les morts… et les vivants.
« Ce n’est pas l’apocalypse, c’est le recommencement ! »
Les problèmes majeurs de Fear the Walking Dead sautent aux yeux dès les premiers épisodes. Ses intrigues peu palpitantes, ses scénarios qui tirent à la ligne, sa mise en scène peu inspirée et sa mise en forme maladroite peinent à nous convaincre. Les choses sont aggravées par le manque d’empathie que génèrent les protagonistes. Aucun d’entre eux n’étant véritablement attachant, comment s’intéresser à leur sort ? Malgré le changement de contexte (la ville, puis la mer, puis une petite ville mexicaine), les situations répètent celles déjà vues dans The Walking Dead, avec moins d’impact dans la mesure où les humains en présence ne nous passionnent pas. On aurait apprécié que les scénarios s’intéressent plus à la redistribution des cartes générée par le virus, dans la mesure où le haut du panier n’est plus lié au statut social ou au compte en banque mais à la capacité de survivre. Quelques idées intéressantes surnagent tout de même, comme cette femme persuadée que les zombies sont une bénédiction (« Ce n’est pas l’apocalypse », dit-elle, « c’est le recommencement, la vie éternelle ! »), proposant une approche mystique du phénomène, ou ces zombies charmés par la musique de Strauss. Il y a fort à parier que la longévité de cette série dérivée soit plus imputable au succès de The Walking Dead qu’à ses qualités propres. D’ailleurs, suite aux chutes d’audience de la saison 3, Morgan ressort des tiroirs pour tenter de relancer l’intérêt des téléspectateurs. Fear the Walking Dead durera tout de même huit saisons, d’autres spin-off se préparant parallèlement pour faire fructifier la vogue manifestement inépuisable des « morts qui marchent ».
© Gilles Penso
À découvrir dans le même genre…
Partagez cet article