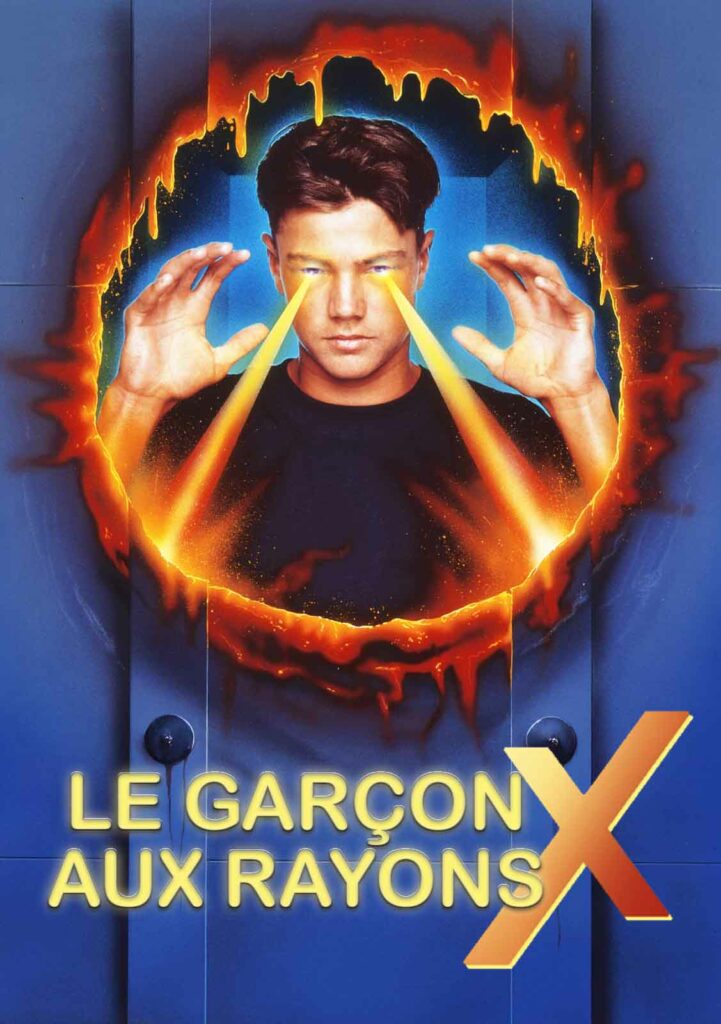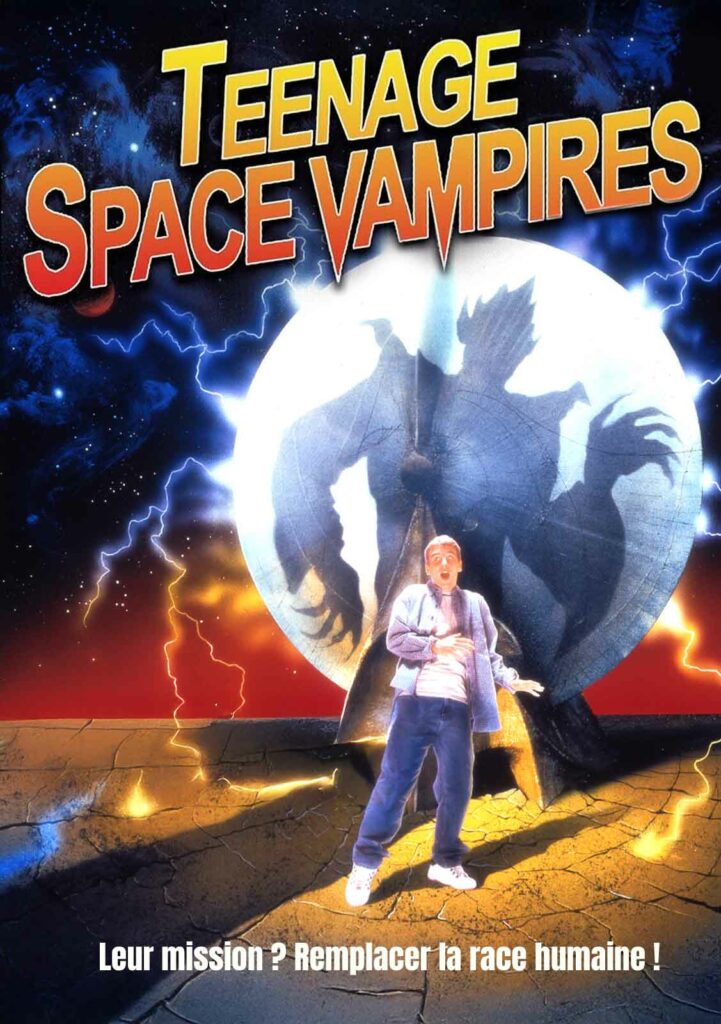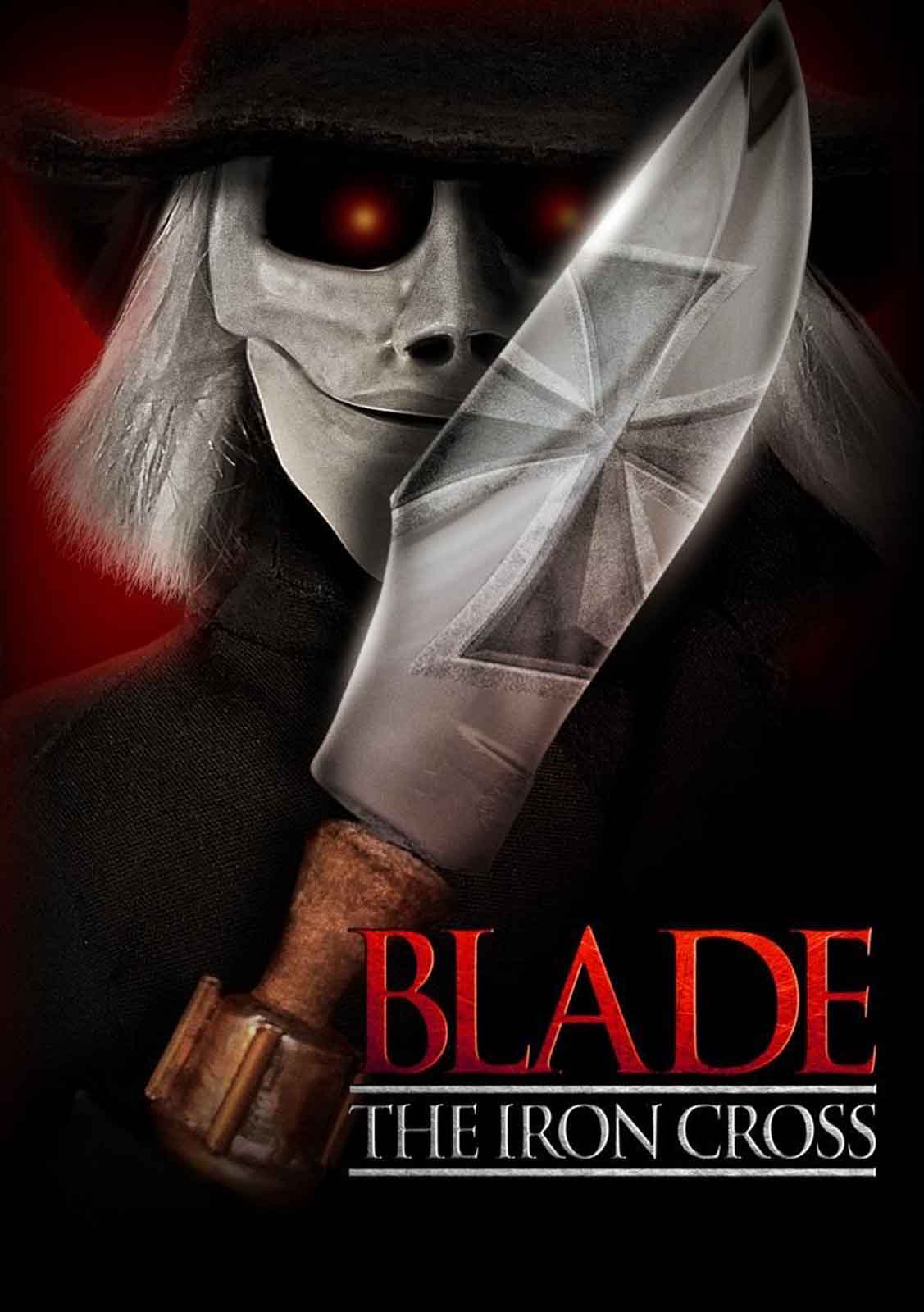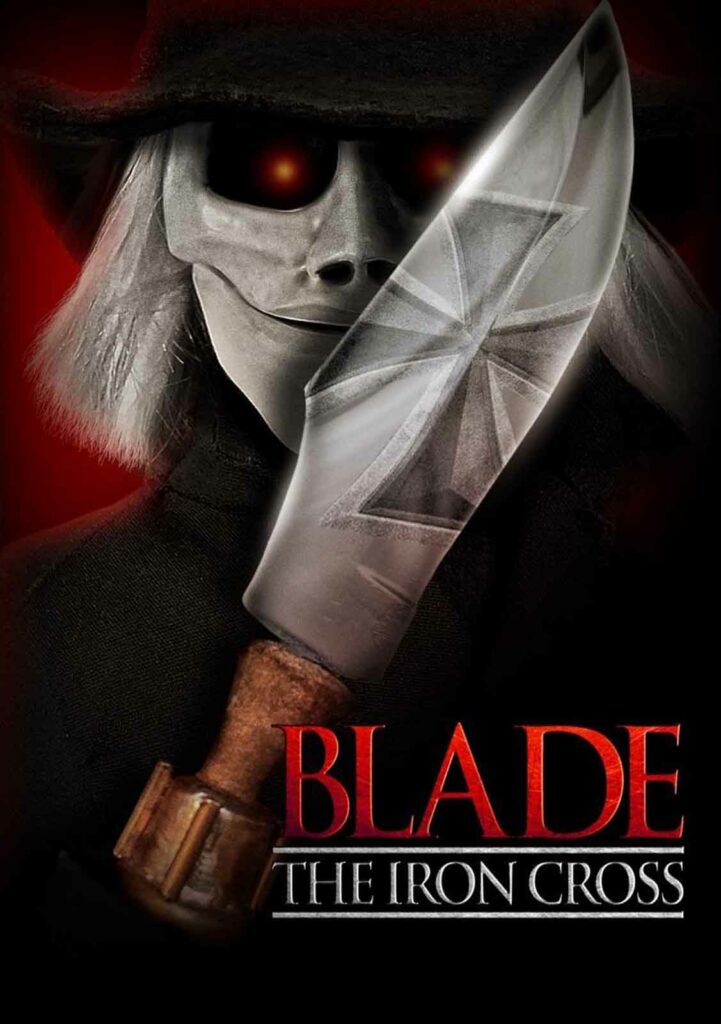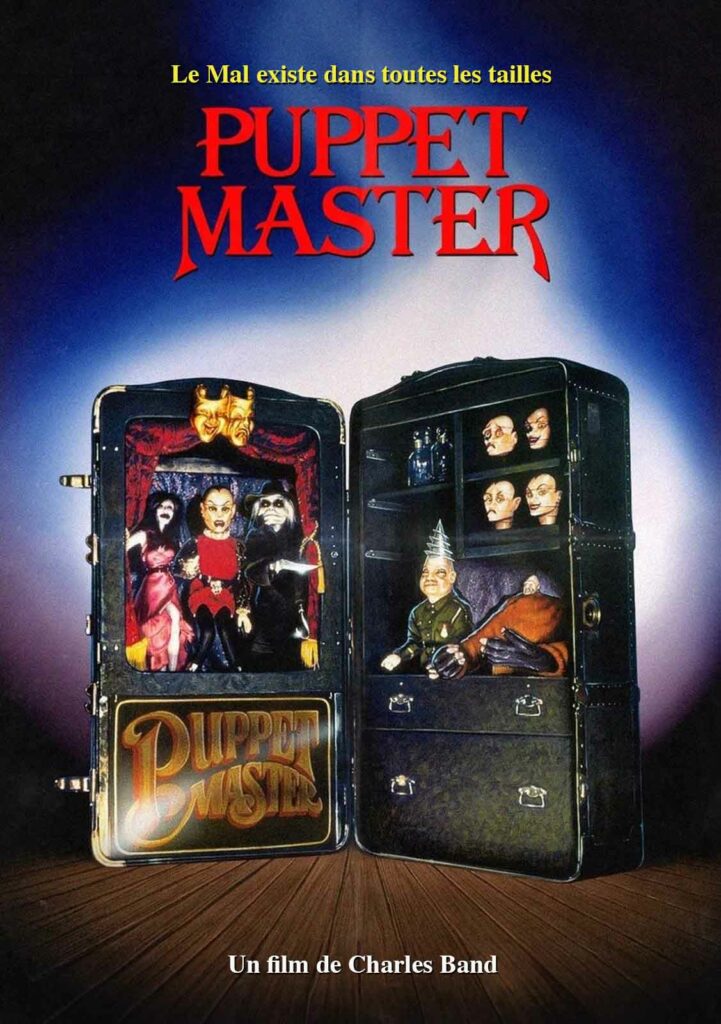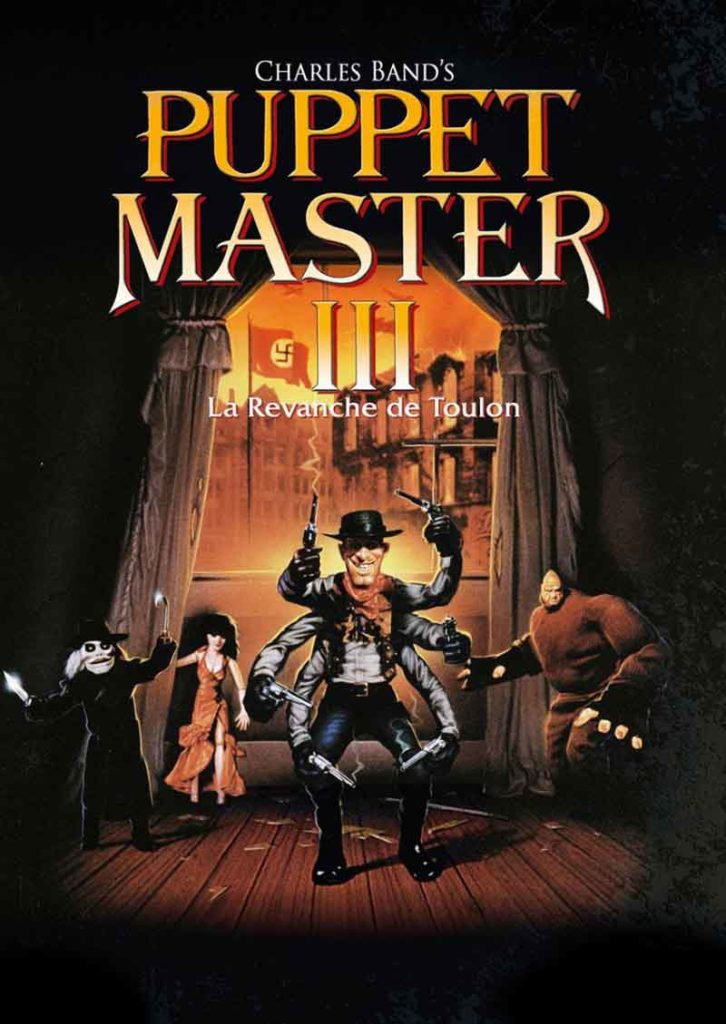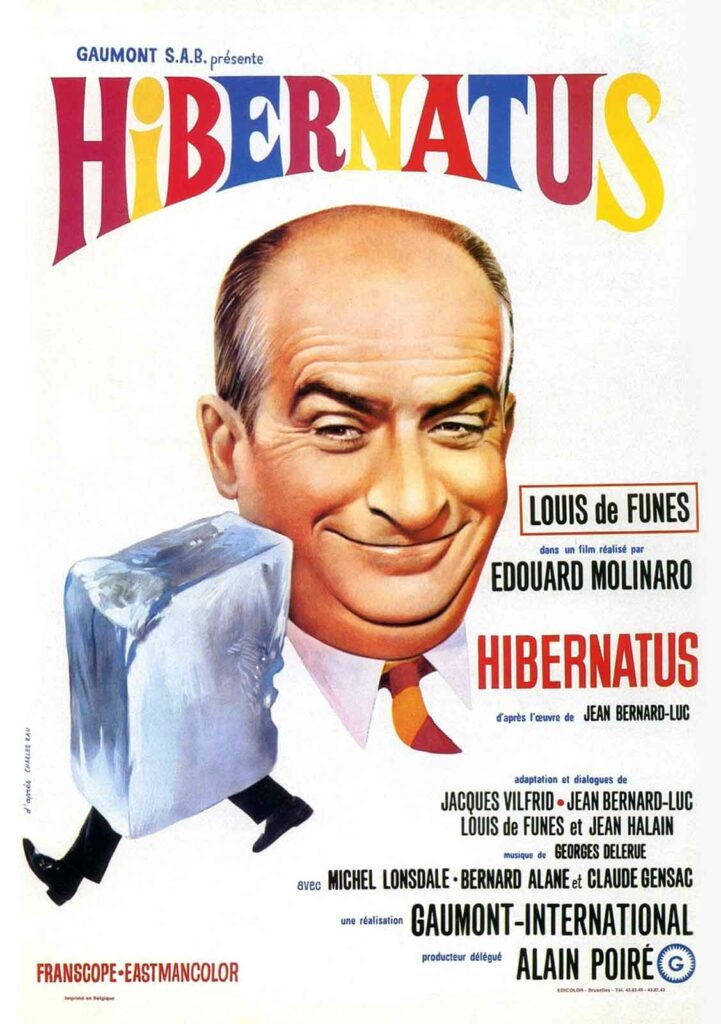Un groupe d’adolescents fait face à un jeu vidéo maléfique qui emprisonne les joueurs dans une inquiétante réalité virtuelle…
ARCADE
1993 – USA
Réalisé par Albert Pyun
Avec Megan Ward, Peter Billingsley, John de Lancie, Sharon Farrell, Seth Green, A.J. Langer, Bryan Dattilo, Brandon Rane, Sean Bagley, B.J. Barrie
THEMA MONDES PARALLÈLES ET MONDES VIRTUELS I SAGA CHARLES BAND
Arcade entre en production fin mars 1991, juste après Dollman. Les deux films sont produits par Charles Band (patron de la compagnie Full Moon), dirigés par Albert Pyun (réalisateur de Cyborg) et écrits par David S. Goyer (futur scénariste de Blade). Mais si Dollman est mis en scène sans accrocs et démarre sa carrière dans les vidéoclubs début 1992, Arcade ne sort qu’en mars 1994, après maintes déconvenues. Le premier problème du film est d’ordre scénaristique. Si Charles Band envisage un simple petit film d’horreur autour d’une salle d’arcades hantée, Goyer voit plus grand. Il souhaite plonger les jeunes héros dans un jeu vidéo en dix niveaux de plus en plus complexes et leur faire vivre des aventures virtuelles épiques. C’est évidemment impensable quand on connait les budgets rachitiques des productions Full Moon. « Le budget d’Arcade était de 750 000 dollars je crois », raconte Albert Pyun. « Je pense que le scénario que David Goyer et moi-même avons élaboré était trop complexe et ambitieux. J’ai proposé l’idée de la réalité virtuelle, au grand regret de tout le monde. C’était trop en avance sur ce qui était économiquement faisable. C’est ma faute. » (1) Paniqué face aux rushes catastrophiques et à un premier montage incompréhensible, Pyun ne sait que faire et doit surtout quitter le navire pour partir réaliser Nemesis. Charles Band et son équipe se retrouvent donc avec un film parfaitement inexploitable sur les bras.


Les premières séquences du film tiennent à peu près la route. Nous y découvrons l’adolescente Alex Manning (Megan Ward), passablement perturbée par le suicide de sa mère. Pour fuir sa vie morose, elle traîne souvent avec sa petite bande de copains (parmi lesquels on reconnaît un tout jeune Seth Green) et avec son petit-ami Greg (Bryan Dattilo). Un jour, ils se retrouvent dans la salle d’arcade de leur quartier, « Dante’s Inferno ». Là, le patron d’une société informatique (John de Lancie) leur fait découvrir un tout nouveau jeu en réalité virtuelle et leur offre même des échantillons gratuits à tester chez eux. Mais ce jeu est maléfique. Les joueurs qui perdent la partie se retrouvent emprisonnés dans un monde virtuel sinistre sans espoir d’en réchapper. Alex va donc devoir y plonger à son tour pour sauver ses amis… Voilà pour le postulat. Pas particulièrement palpitantes, les scènes situées dans le monde réel sont filmées platement et jouées sans beaucoup de conviction. Mais lorsque les héros s’immergent dans le jeu vidéo, c’est bien pire. L’univers digital dans lequel ils évoluent est tellement hideux que le véritable danger de cet univers virtuel semble être une migraine carabinée pour les spectateurs.
La foire du Tron
Même si l’on considère l’année de réalisation du film et son budget, force est de constater que les images de synthèse d’Arcade sont vraiment trop affreuses pour convaincre. Filmés devant un fond bleu, les acteurs s’agitent face à des polygones, des textures dégoulinantes de pixels et une sorte de harpie squelettique à tête de dragon qui les menace avec ses griffes numériques. En charge de la post-production du film après le départ précipité d’Albert Pyun, Daniel Schweiger en garde un souvenir amer. « Nous n’avions pratiquement pas d’argent et l’infographie n’en était qu’à ses balbutiements, à l’époque », raconte-t-il. « Nous avons fait de notre mieux. C’est comme si nous tentions de créer l’homme qui valait trois milliards avec les restes brisés d’un Steve Austin. » (2) Alors qu’Arcade est enfin sur le point de sortir, un autre problème de taille apparaît : Walt Disney menace d’intenter un procès à Full Moon à cause des trop fortes ressemblances avec Tron, notamment une course de motos futuristes sur un sol grillagé. Charles Band s’arrache donc les cheveux, car il est nécessaire de refaire l’intégralité des images de synthèse d’Arcade pour éviter toute ressemblance avec le fameux long-métrage de Steve Lisberger. Aujourd’hui, les fans hardcore s’arrachent des copies en vidéocassette du montage original, avant les ultimes retouches numériques, sous le titre « Original CGI Version ». Mais pour le commun des mortels, Arcade a sombré dans un oubli poli.
(1) et (2) Propos extraits du livre « It Came From the Video Aisle ! » (2017)
© Gilles Penso
À découvrir dans le même genre…
Partagez cet article