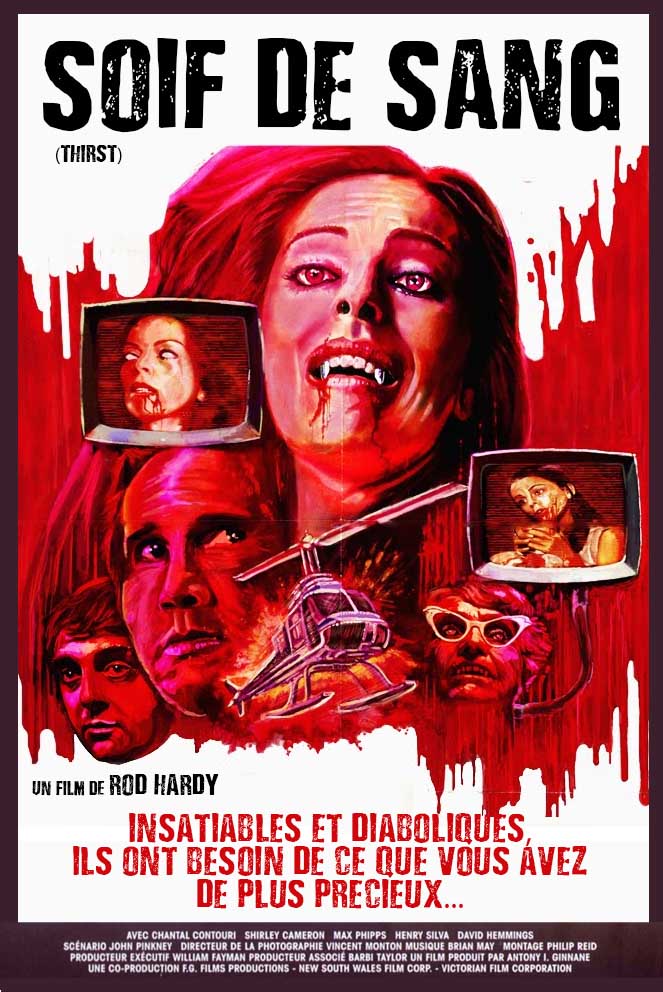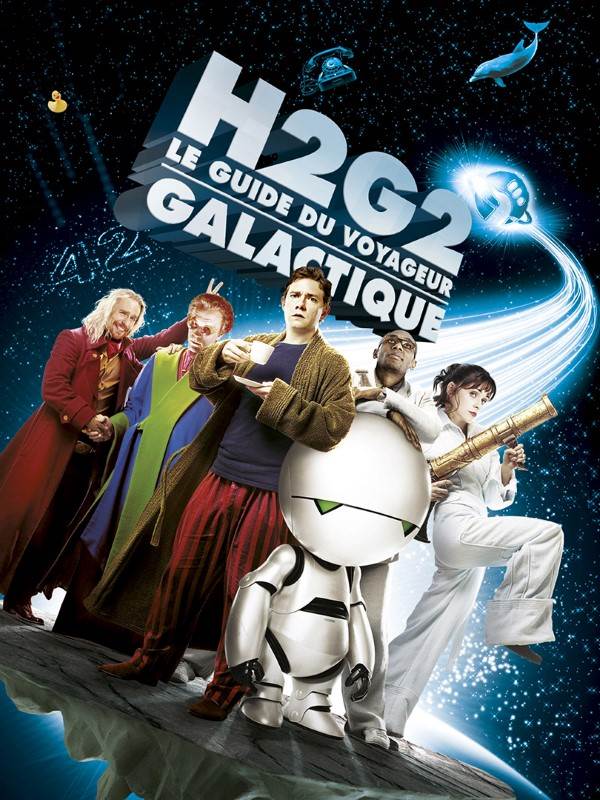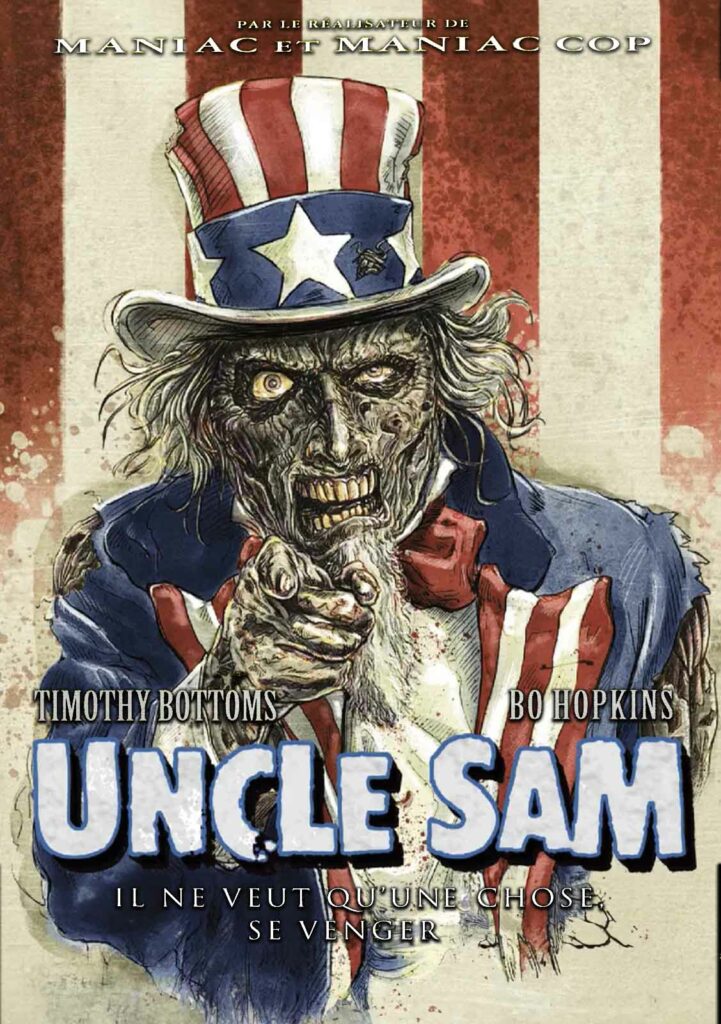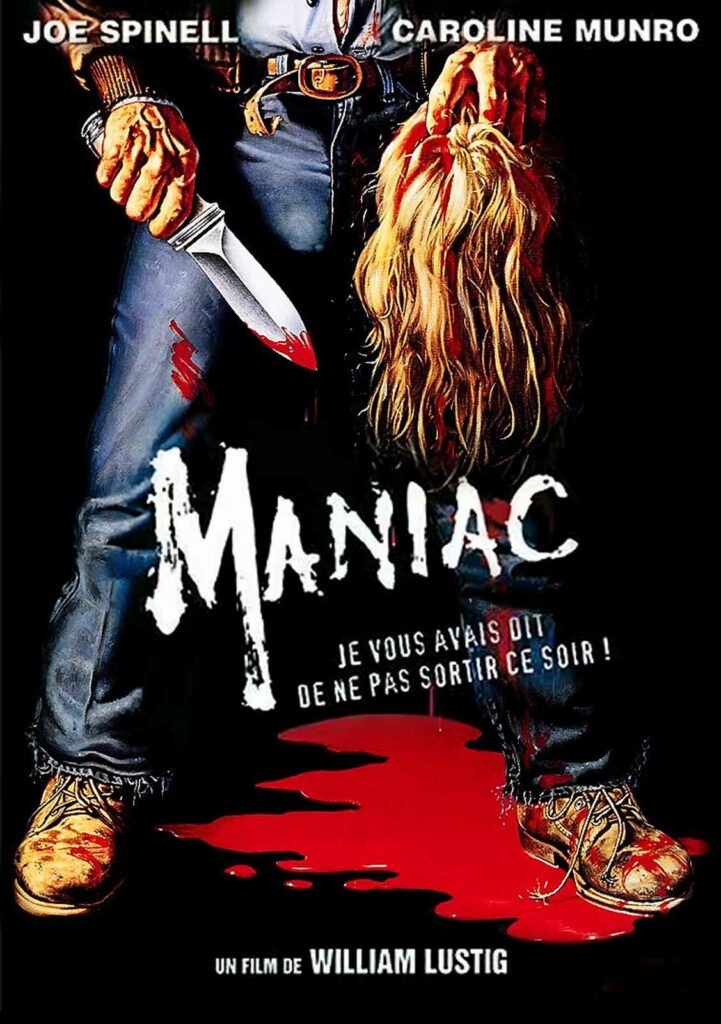Un Viking qui n’aime ni piller ni tuer part à la recherche du Valhalla pour demander aux dieux de changer l’ordre des choses
ERIK THE VIKING
1989 – GB
Réalisé par Terry Jones
Avec Tim Robbins, John Cleese, Mickey Rooney, Samantha Bond, Eartha Kitt, Terry Jones, Imogen Stubbs, Charles McKeown
THEMA EXOTISME FANTASTIQUE I MONSTRES MARINS I HEROIC FANTASY I DRAGONS
La fantaisie, héroïque ou pas, fut un genre plutôt bien servi dans les années 80, relancé en partie grâce à La Guerre des étoiles qui transposait les histoires de chevaliers, de forteresse et de magie dans l’espace. Erik le Viking se place en queue de comète et, pour tout dire, n’a pas généré un enthousiasme délirant à sa sortie. Pourtant, bien que le ton très iconoclaste du scénario et de la mise en scène de l’ex-Monty Python Terry Jones ait rendu le film difficile à catégoriser et donc à promouvoir, les amateurs de « films anguilles » apprécieront surement de se laisser emmener dans cette délirante aventure bon enfant. Car c’est bien d’un divertissement familial dont il s’agit, tiré du livre éponyme écrit par Jones lui-même pour son fils vers la fin des années 70. Une parution qui lui donna l’envie de réitérer l’expérience du récit pour enfants, au cinéma cette fois, et le mènera à rencontrer Jim Henson, pour qui il écrira Labyrinthe. Mais c’est en solo que Terry Jones montera Erik le Viking. Il s’agit d’ailleurs de son véritable premier film, car bien qu’il ait co-signé avec Terry Gilliam la réalisation des longs-métrages des Monty Python (Sacré Graal, La Vie de Brian ou Le Sens de la vie), la personnalité de chaque individu contribuait avant tout à l’identité du groupe. Terry Jones se retrouve ici le seul maitre à bord et, à l’inverse de son compère Terry Gilliam qui utilise le fantastique pour illustrer les versants sombres de l’humanité, il souhaite transposer à l’écran le caractère innocent de ses livres.


Bien qu’amusant de bout en bout, Erik le Viking n’est pas à proprement parler une comédie, encore moins une parodie. La trame de l’histoire peut tout à fait être vue au premier degré : le héros questionne le mode de vie barbare de son époque et emmène son équipage en quête du Valhalla pour implorer les dieux de mettre fin à la violence qui règne dans le monde. C’est plutôt d’une certaine forme de mise en abîme des personnages que nait un humour au second ou troisième degré, comme si Terry Jones demandait à chacun de ses comédiens d’interpréter un acteur jouant lui-même un archétype. Les vikings passent ainsi leur temps à se disputer sur l’honneur d’un ancien qui serait honteusement mort de manière naturelle plutôt qu’à la guerre. Le chef de la tribu ennemie (John Cleese), de son côté, apparait blasé de devoir trouver des châtiments aussi cruels qu’injustes pour ses sujets incapables de payer leurs impôts, l’un d’eux le remerciant même de ne lui couper qu’une main. Erik (Tim Robbins) apparait donc comme un personnage revendiquant le libre-arbitre et souhaitant s’extraire de la dictature de l’histoire. Dans la scène d’introduction qui le voit tenter de se plier à l’exercice du pillage et du viol, sa victime (Samantha Bond, la future Miss Moneypenny de Pierce Brosnan) voit qu’il est mal à l’aise et prend alors les choses en main, arguant en filigrane que les us et coutumes exigent un viol en bonne et due forme. Ce à quoi Erik rétorque qu’il n’en voit pas l’intérêt et que la vie ne peut se limiter à ça. Elle offre alors de pousser au moins quelques cris de détresse afin qu’il puisse garder la face vis-à-vis de ses camarades. Le ton est ainsi donné. Erik traversera tout le film en étant celui par qui le changement arrive.
Une parenthèse enchantée
Tom Hulce avait déjà signé pour le rôle principal, mais lorsque la production put enfin démarrer, il prit congé des plateaux de cinéma pour se focaliser sur le théâtre. Alors que Terry Jones avait toujours envisagé Erik comme un petit personnage au milieu de vikings plus costauds que lui, il engagea néanmoins le jeune Tim Robbins, frais émoulu de Howard : une nouvelle race de héros et Top Gun, qui, du haut de ses presque deux mètres, donne au personnage une allure dégingandée encore plus inadaptée. Le concept de mise en scène initial de Terry Jones consistait à filmer le début de l’histoire en décors naturels en Norvège, puis à évoluer graduellement vers des décors en studio à mesure que les vikings s’aventuraient loin de chez eux, pour conférer à leur quête une dimension plus fantasmagorique. Malheureusement, le village Viking dut finalement être érigé en studio. L’évolution tonale, moins marquée, se ressent néanmoins grâce à une direction artistique soignée que signent notamment Gavin Bocquet, futur directeur artistique des préquelles de La Guerre des étoiles, et Alan Lee, l’incontournable illustrateur du Seigneur des Anneaux. Les effets spéciaux possèdent une facture volontairement rudimentaire et artisanale, l’idée primant sur le réalisme. On retiendra quelques jolies scènes comme l’arrivée du drakkar au bout du monde (puisque la terre est plate évidemment), la découverte du Valhalla où les dieux sont incarnés par des enfants, un combat contre un dragon marin savamment caché dans la brume et la submersion d’une ville entière dont le décor use adroitement de la perspective forcée. Chaque séquence peut être vue comme un chapitre des histoires illustrées dont s’inspire le film, mais certains critiques reprochèrent plutôt à Erik le Viking de ressembler à une succession de sketches, un écueil attribuable aux années passées à travailler dans ce format avec les Monty Python. A vrai dire, Terry Jones semble avoir eu du mal à trouver le bon rythme au montage. En guise d’aveu déguisé, il écourta son film de 17 minutes pour sa sortie en VHS en 1990 (le ramenant à une durée de 89 minutes), puis laissa son fils l’élimer encore un peu en 2006 pour une version « Director’s son’s cut » de 75 minutes en DVD. Mais quelle que soit la version, Terry Jones a atteint son objectif : son film respire l’innocence en évitant toute mièvrerie et offre au spectateur complice une parenthèse enchantée digne du Princess Bride de Rob Reiner.
© Jérôme Muslewski
Partagez cet article