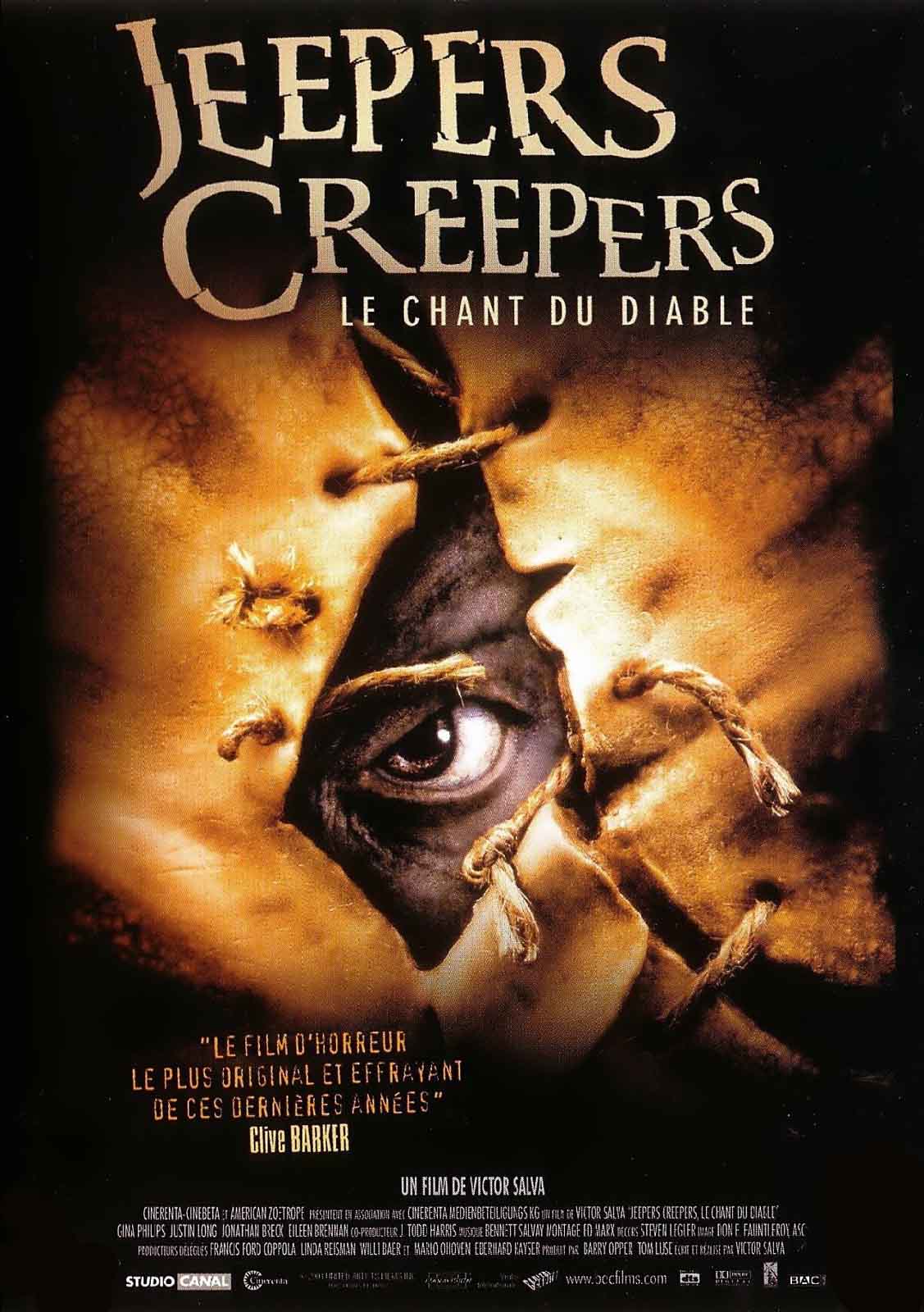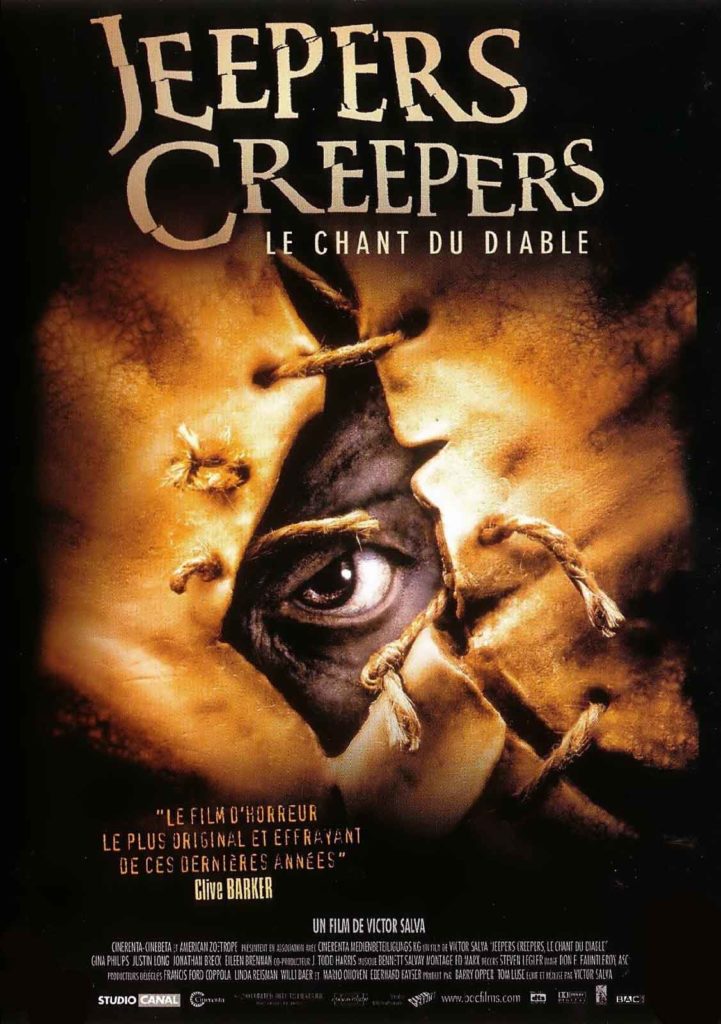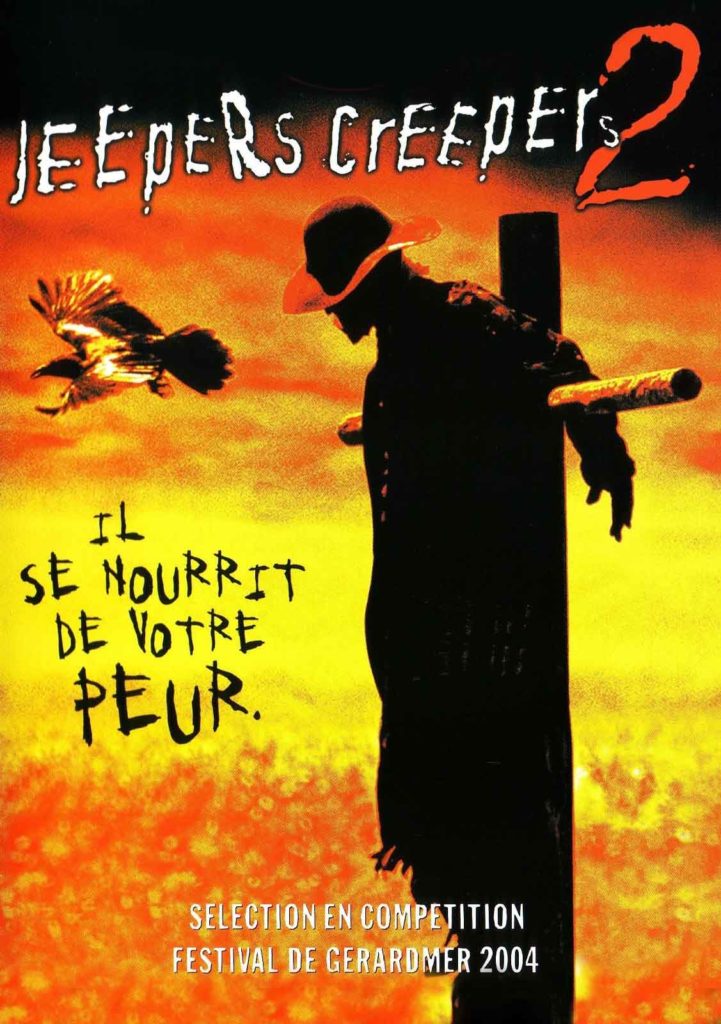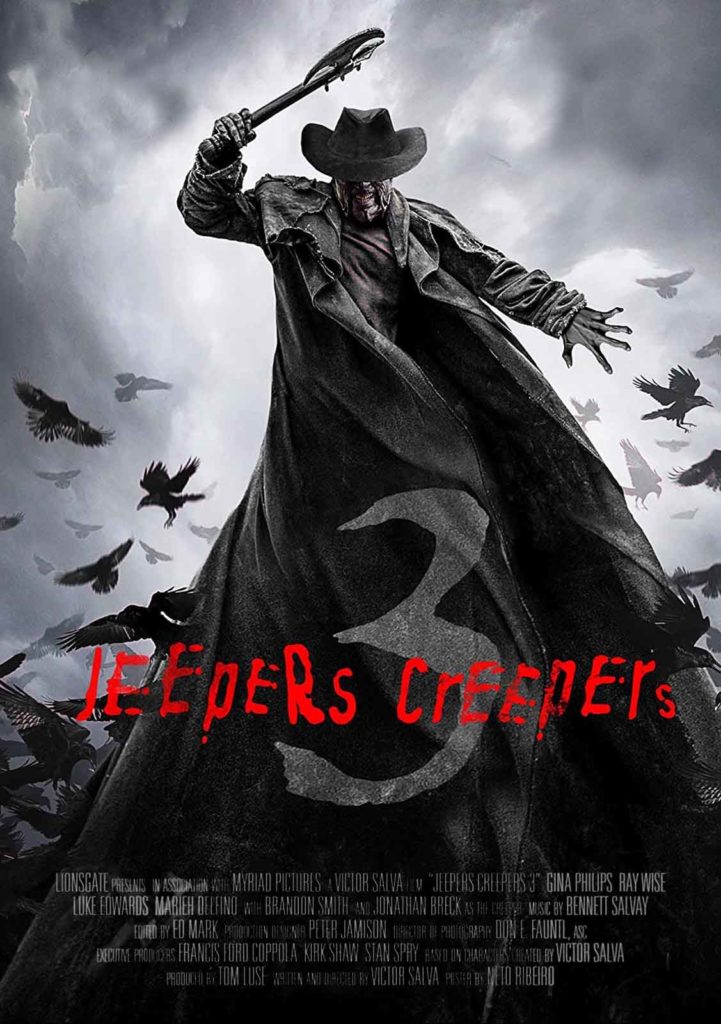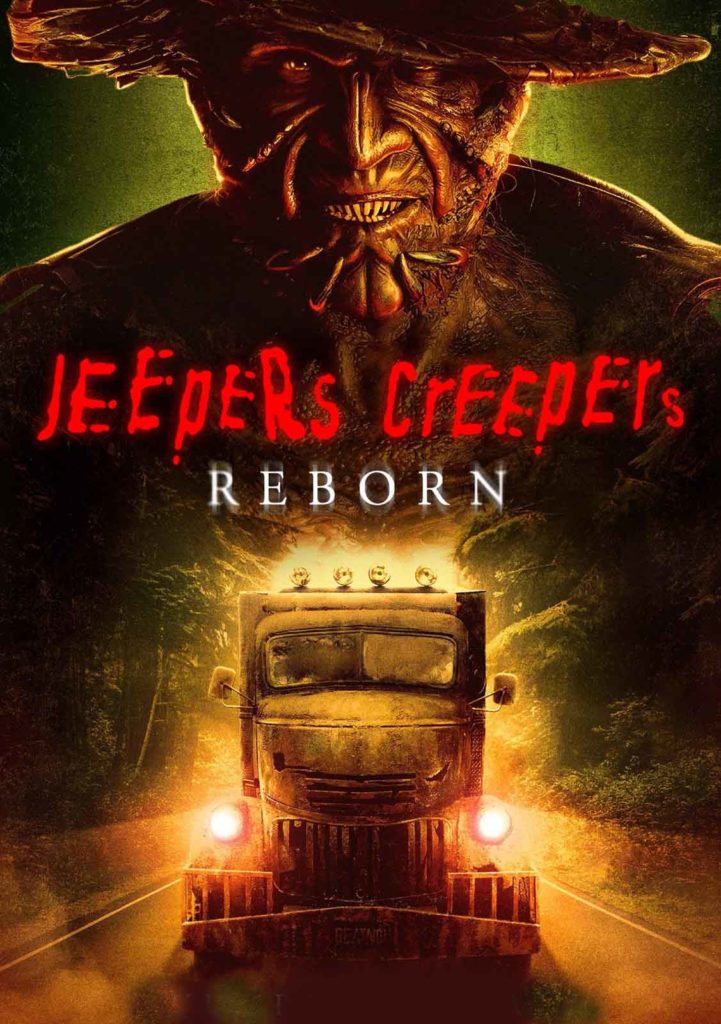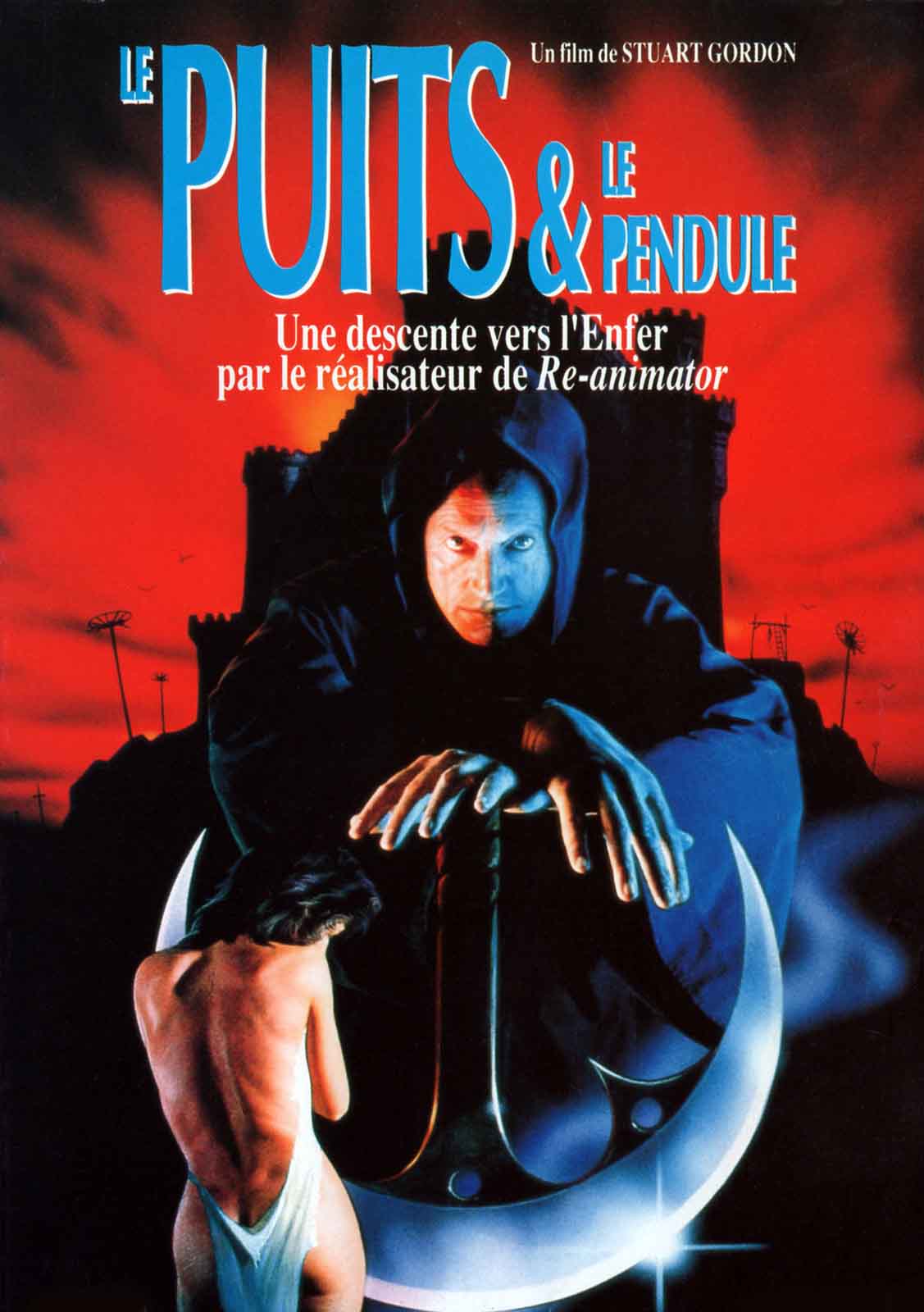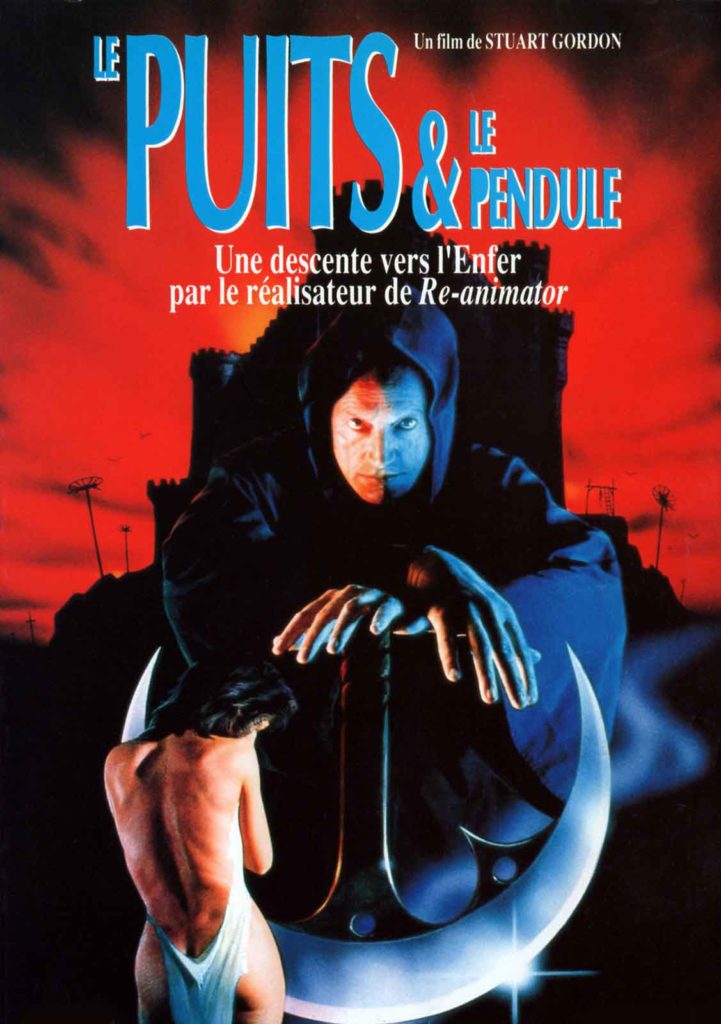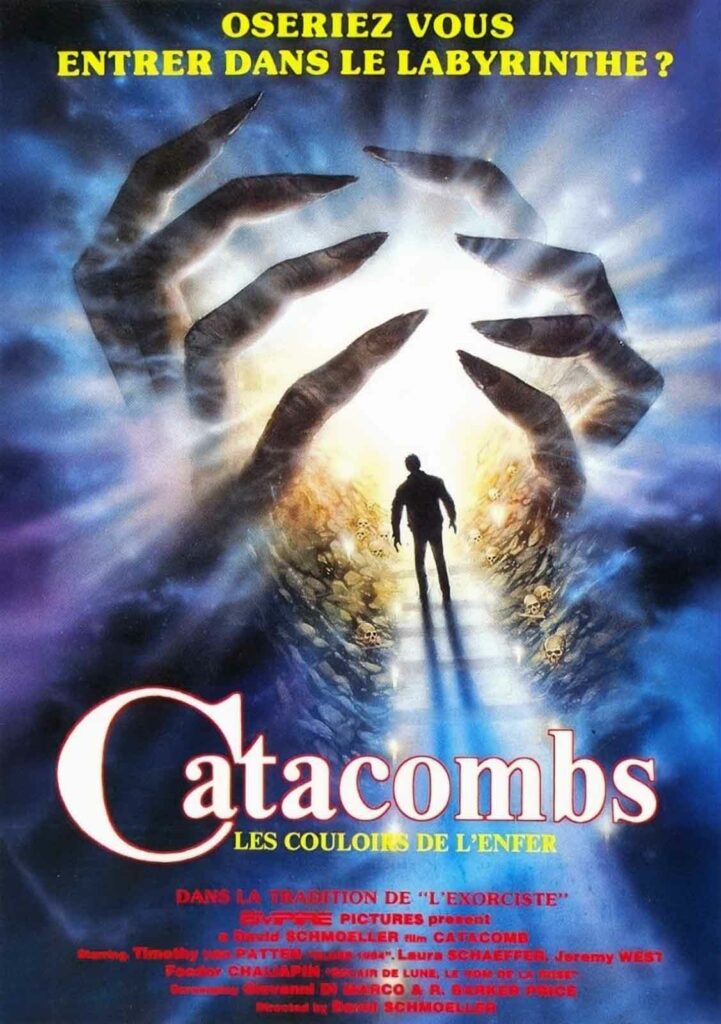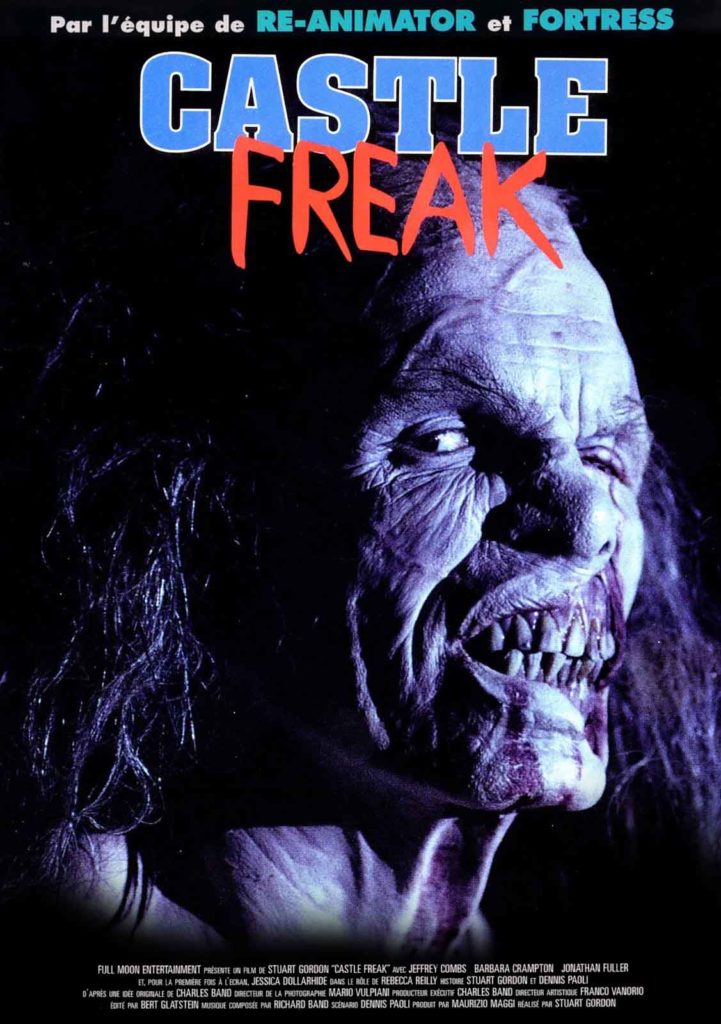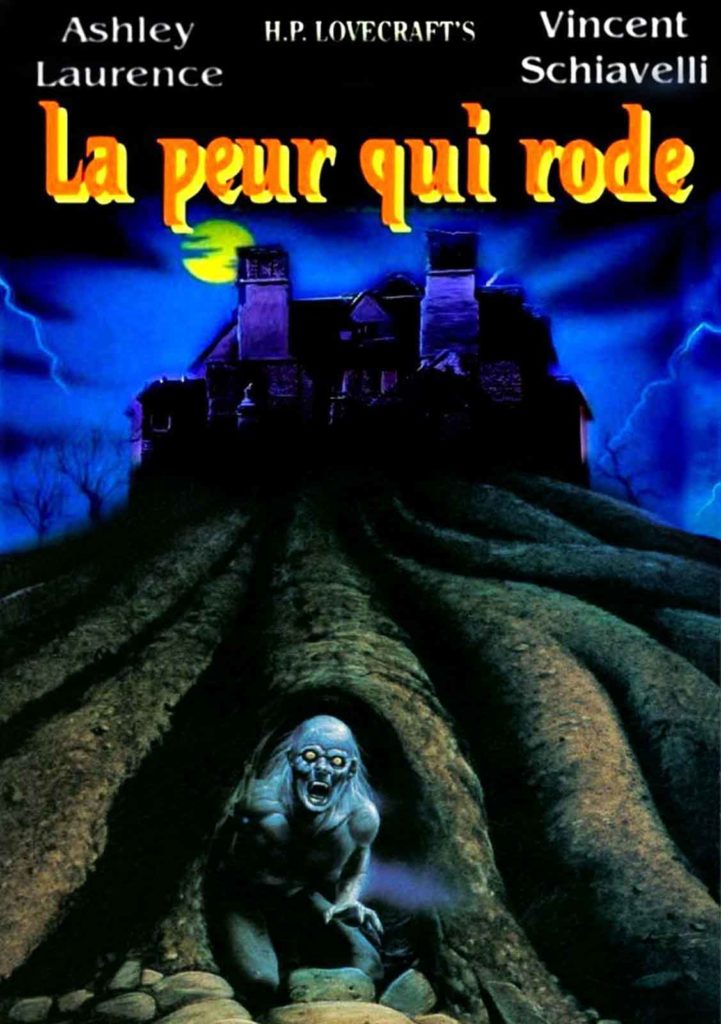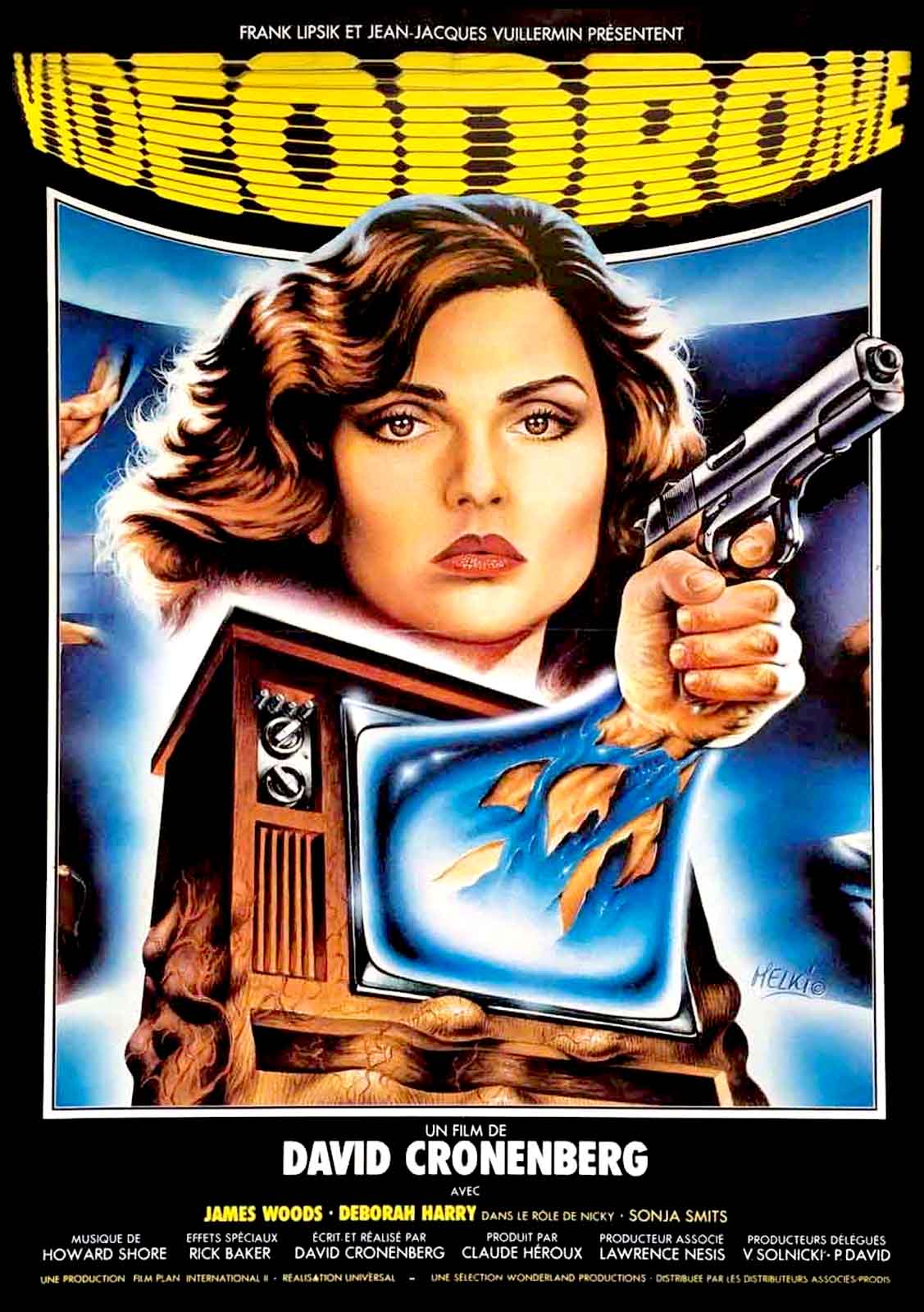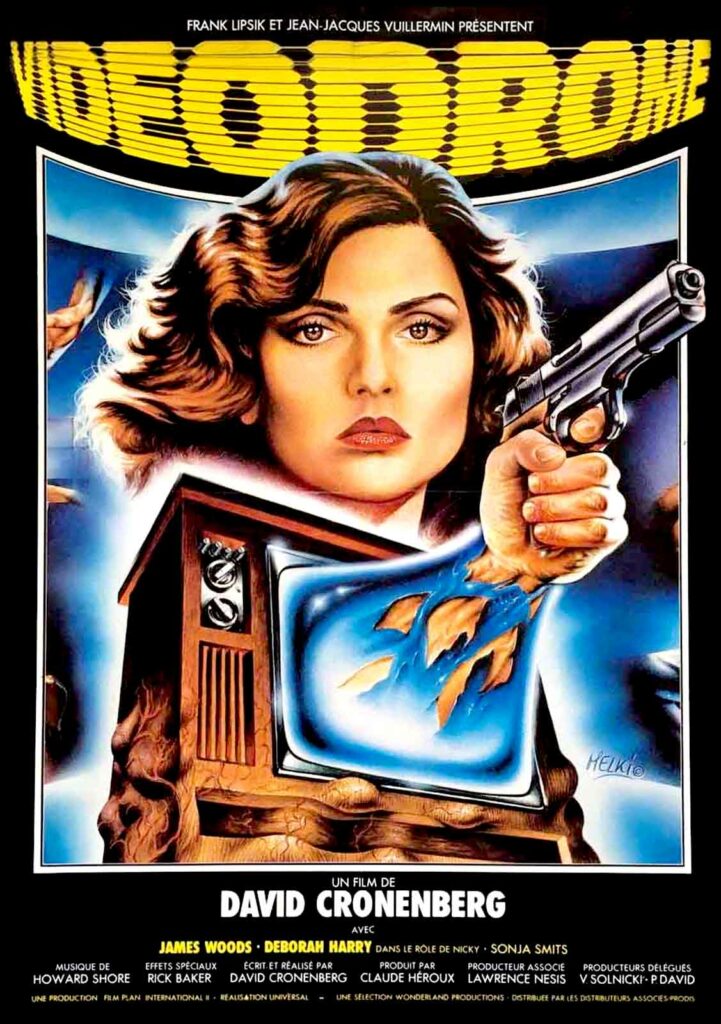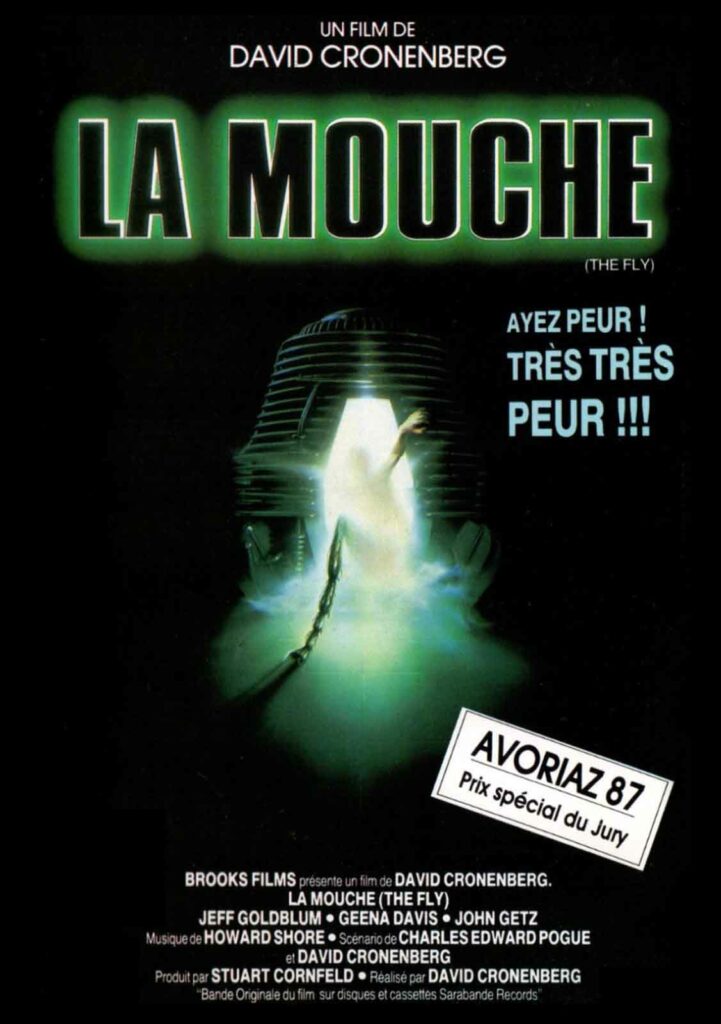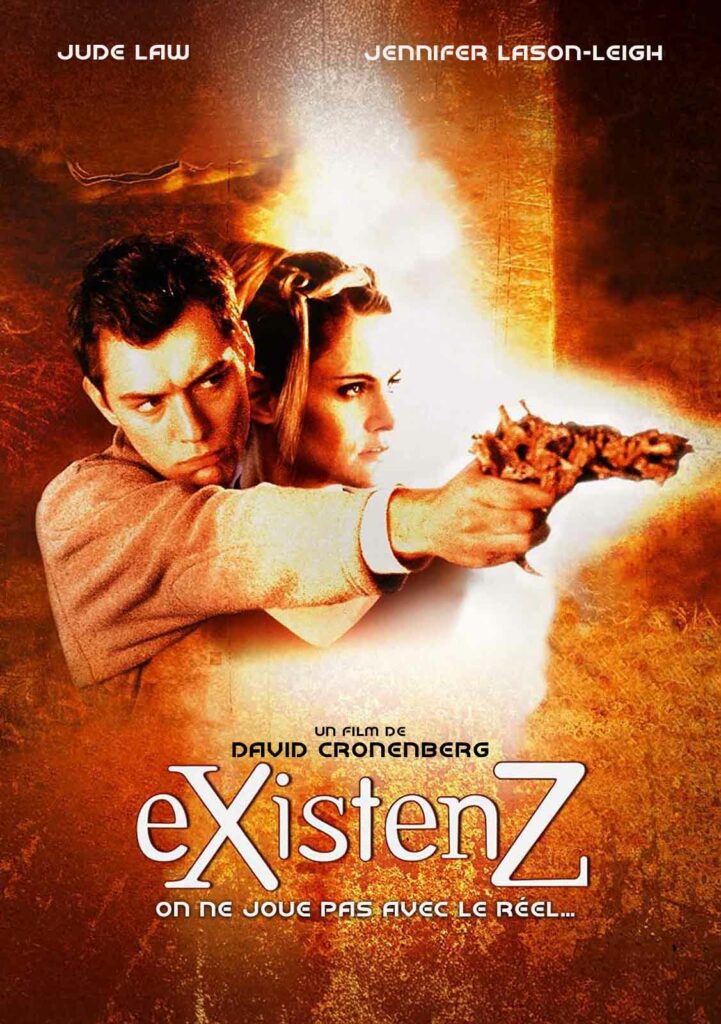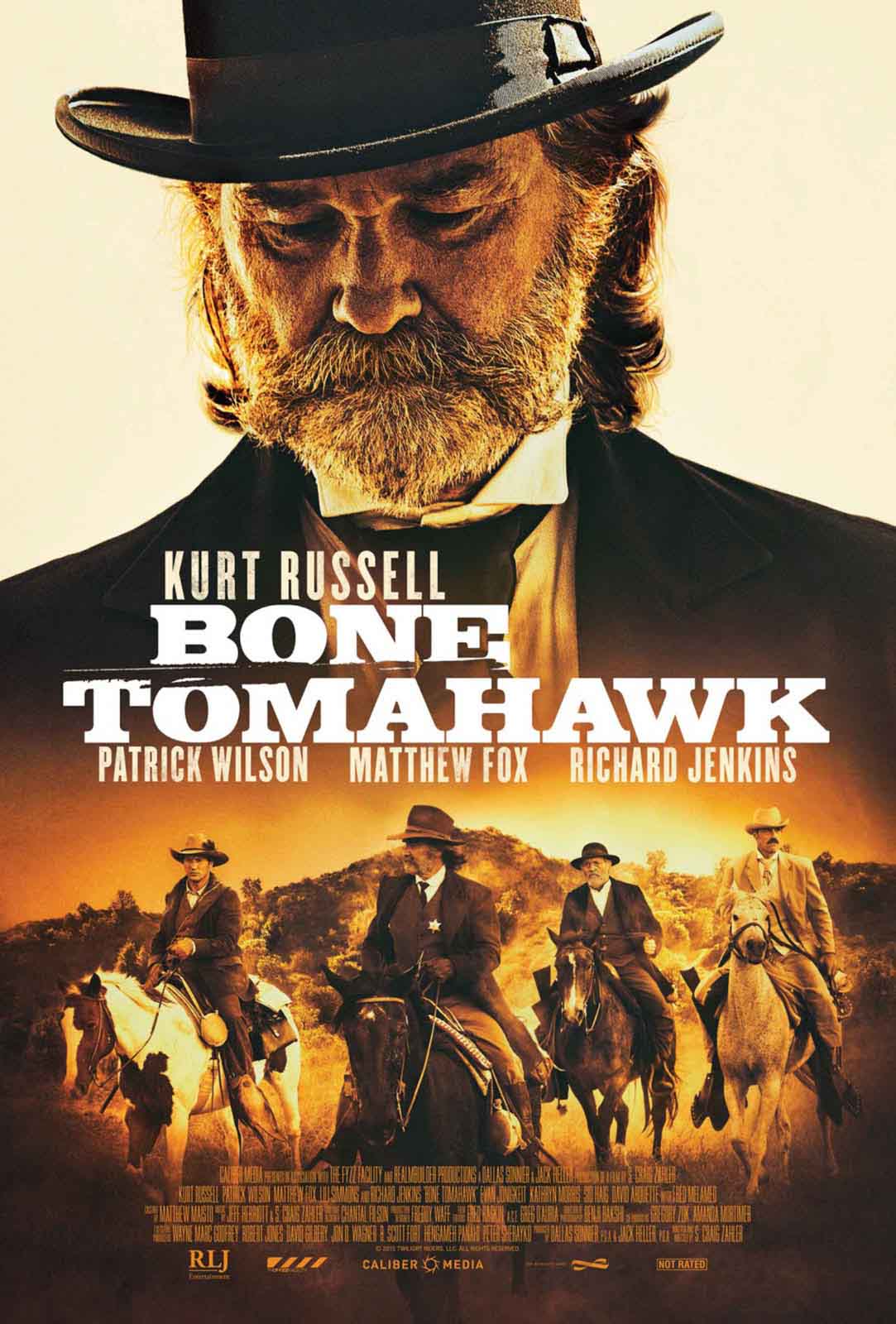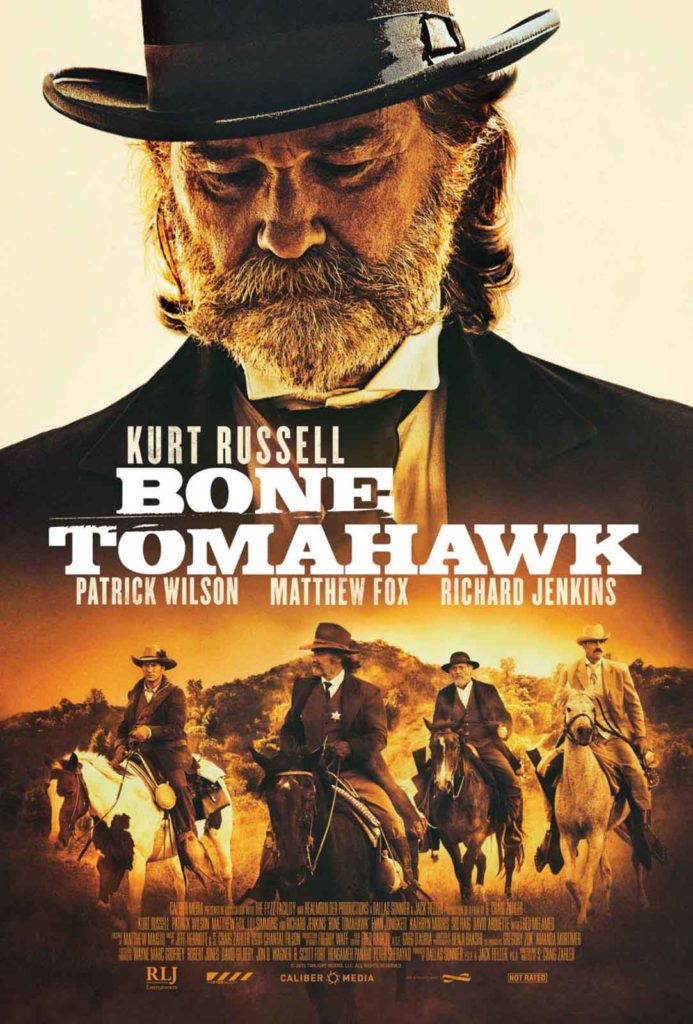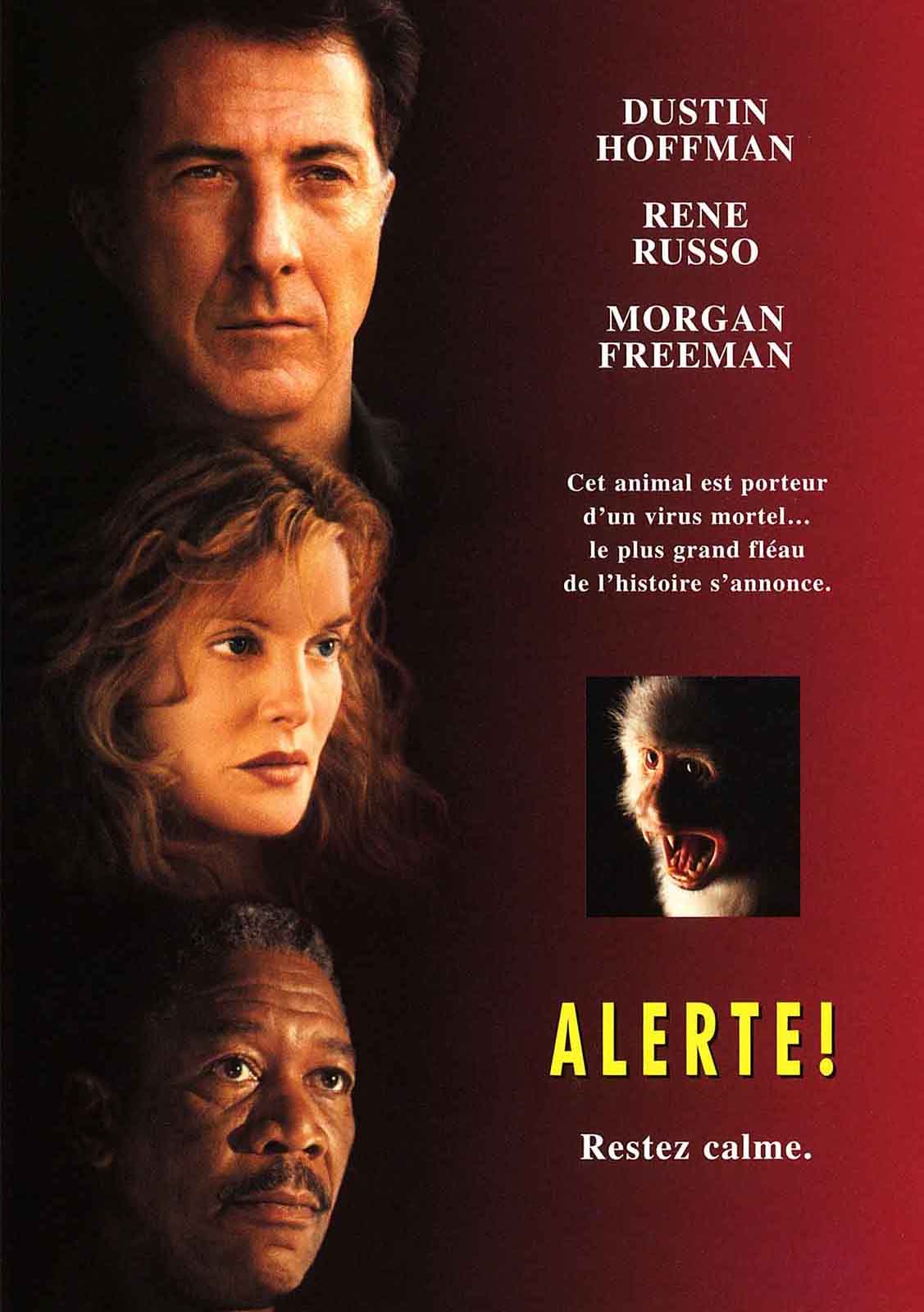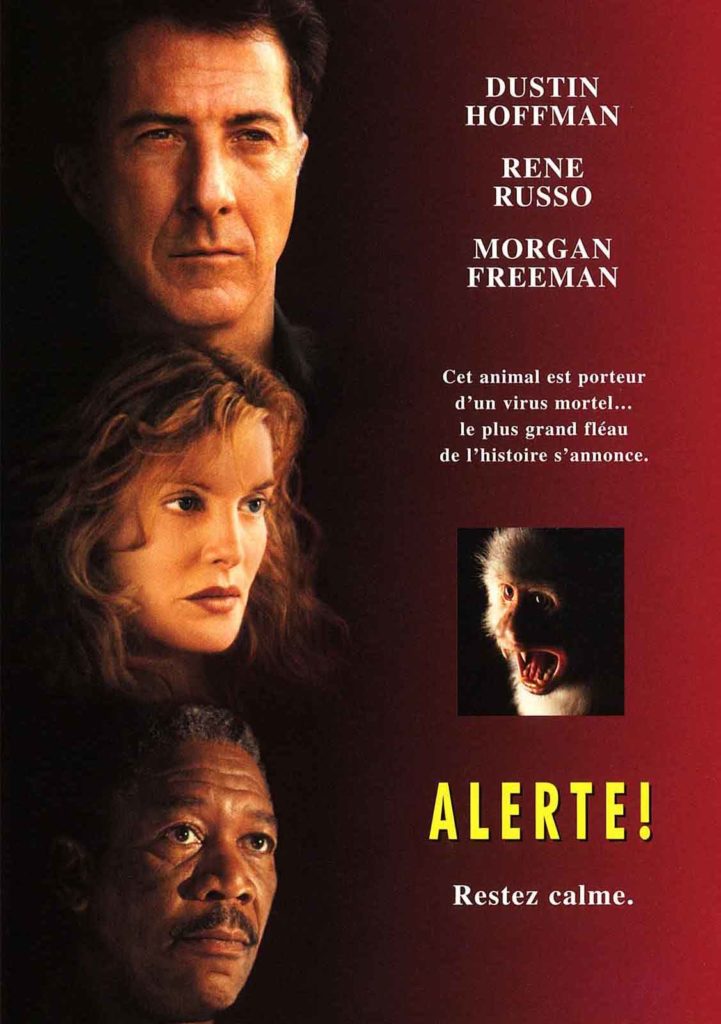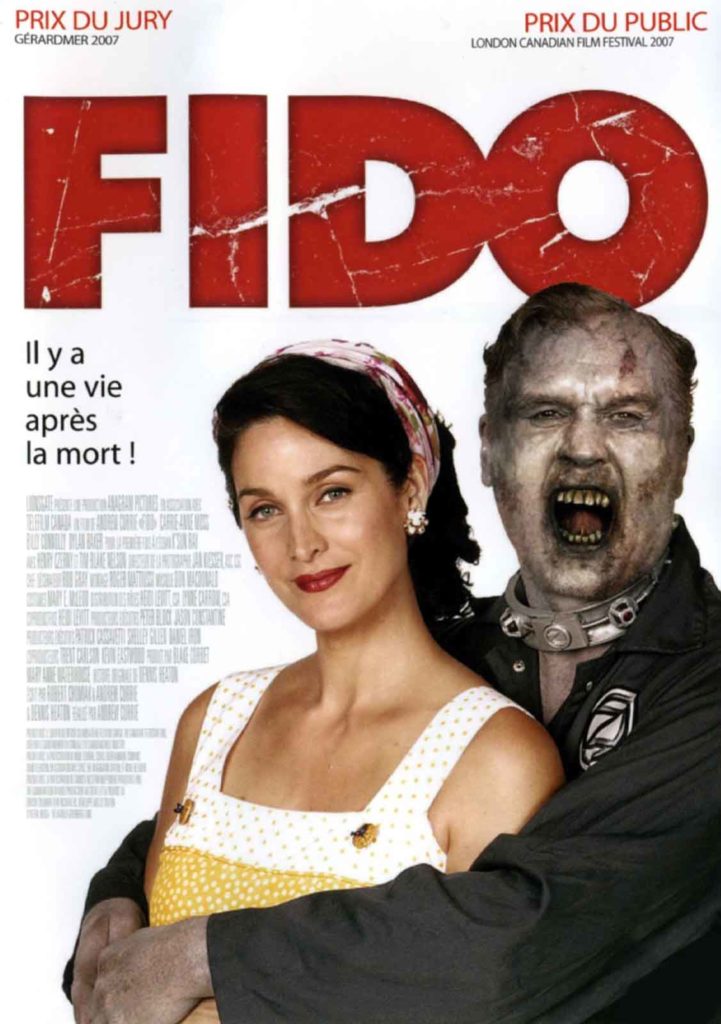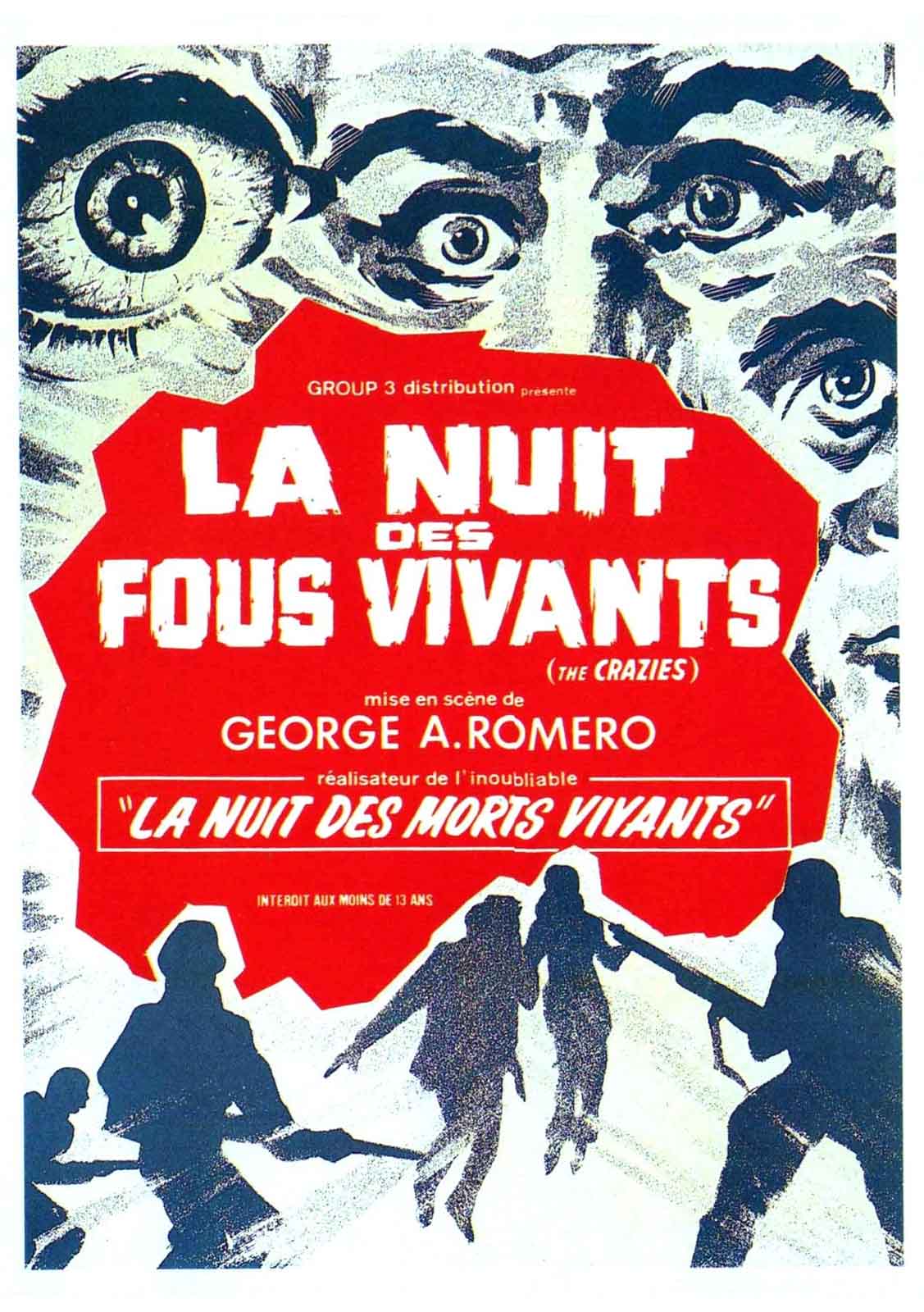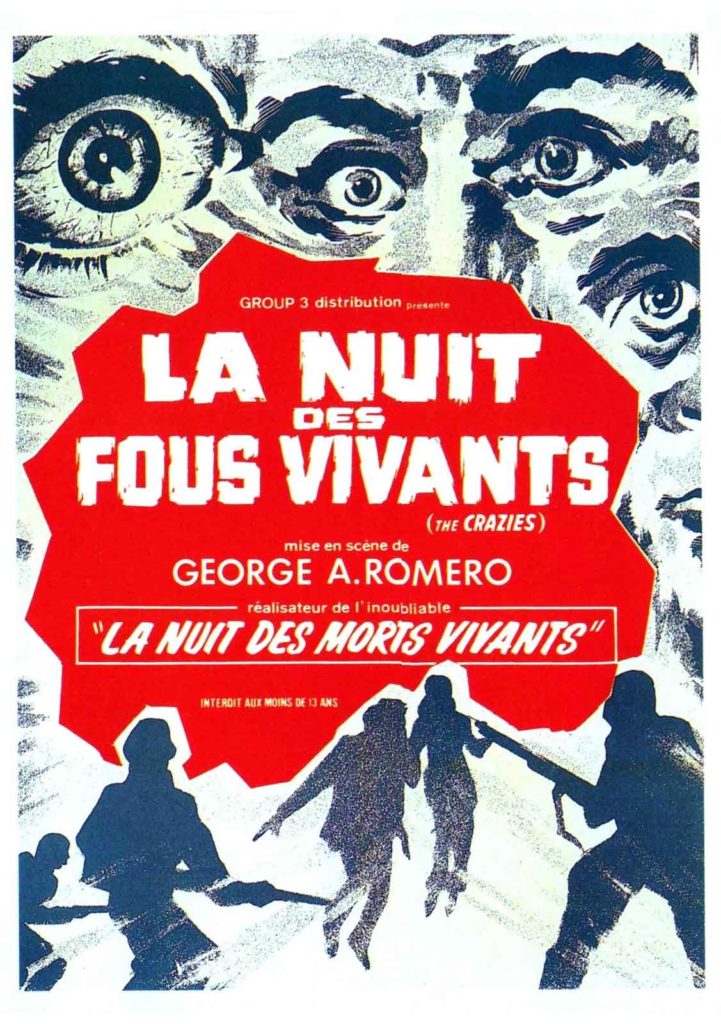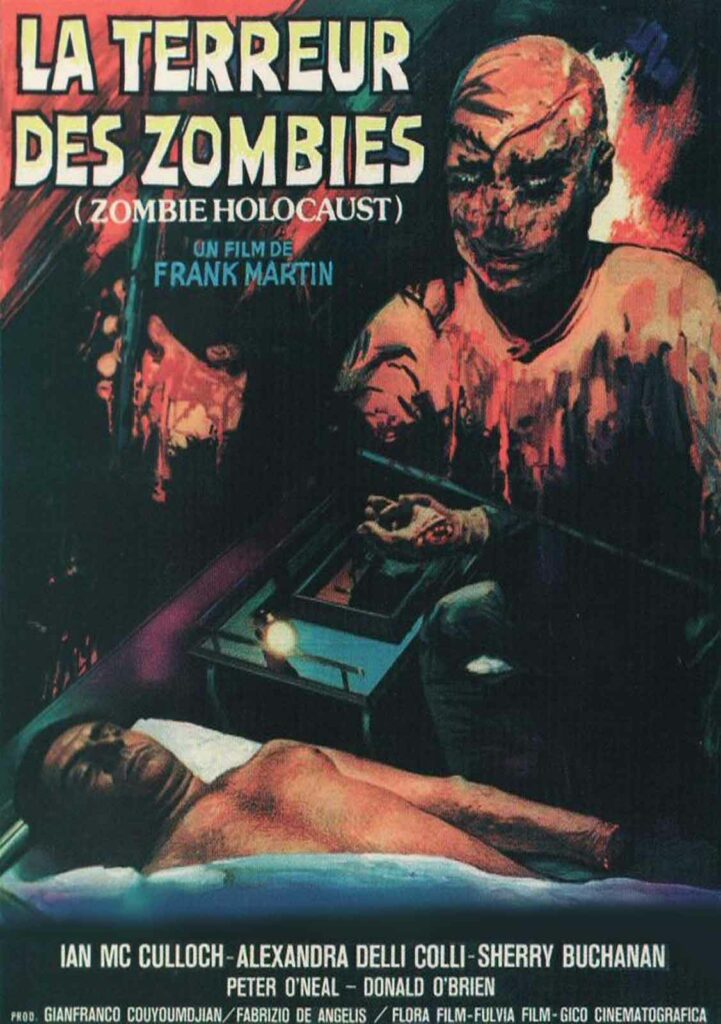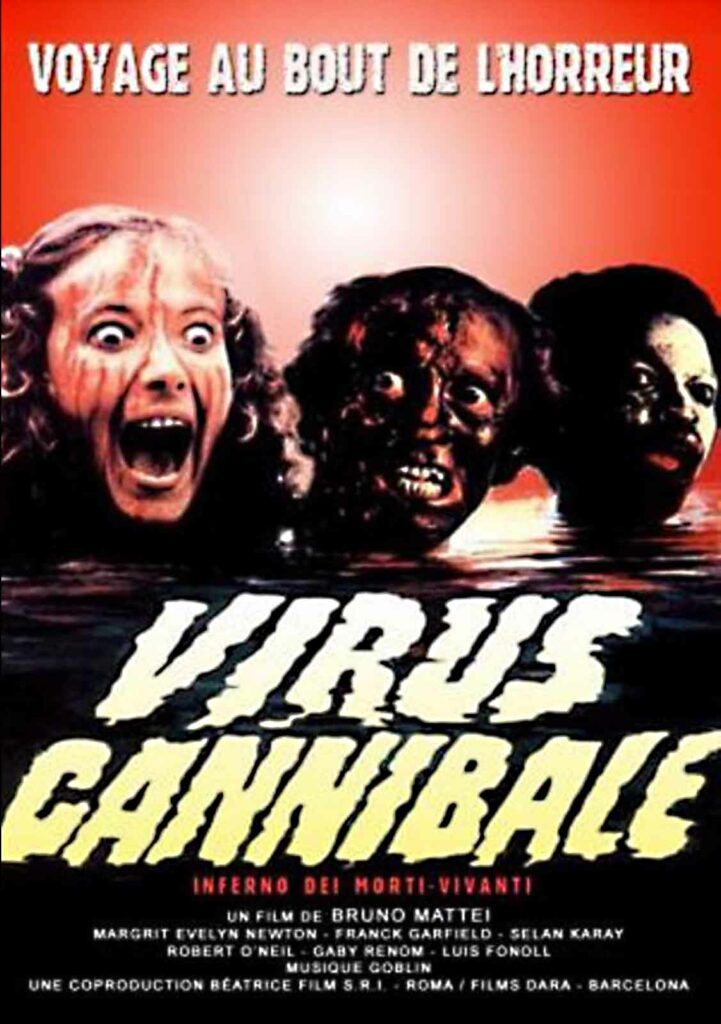Oubliez tout ce que vous pensiez connaître : ce Godzilla redéfinit de fond en comble le mythe le plus célèbre du cinéma japonais
SHIN GOJIRA
2016 – JAPON
Réalisé par Hideaki Anno et Shinji Higuchi
Avec Hiroki Hasagewa, Yutaka Takenouchi, Satomi Ishihara, Ren Osugi, Akira Emoto, Kengo Kôra, Mikako Ichikawa
THEMA DINOSAURES I SAGA GODZILLA
Comme si elle était elle-même en mutation perpétuelle, la saga Godzilla n’en finit plus de se réinventer, comme en témoigne Godzilla Résurgence qui ignore effrontément tous les films précédents, y compris l’œuvre originale d’Inoshiro Honda. Le scénario s’attarde sur les autorités politiques et militaires, montrant leur incapacité à gérer la situation de crise que constitue le surgissement d’un monstre inconnu en plein Tokyo. Les palabres n’en finissent plus, chacun se contredit, les luttes de pouvoir et la quête désespérée d’une bonne image prennent le pas sur le bien-être des citoyens. La mise en scène elle-même cherche une certaine singularité, alternant les plans larges au grand-angle qu’on croirait issus d’un film de Stanley Kubrick et les gros plans insistant sur les regards perplexes, incrédules ou impuissants. Le montage est parfois très nerveux, les angles de vue souvent insolites, et la réalisation emprunte parfois ses effets au « found footage » lorsque les événements sont vus à travers les téléphones portables des passants.


La créature qui surgit initialement ne ressemble que de loin au Godzilla que nous connaissons. C’est un être pataud, aux membres antérieurs atrophiés, qui rampe pathétiquement entre les immeubles en arborant un faciès amphibien affublé de deux énormes yeux immobiles. La bête étant en métamorphose permanente, elle ressurgit plus tard sous forme d’un dinosaure bipède à la mâchoire gigantesque garnie d’une multitude de dents acérées, aux yeux noirs et enfoncés, aux pattes avant rigides, aux membres postérieurs disproportionnés et à la queue immensément longue. Alors que les protagonistes humains nagent en pleine confusion, le scénario révèle que cette créature marine préhistorique a été réveillée et s’est mise à muter à cause d’un stock de produits radioactifs abandonnés au fond des océans.
« C'est vraiment l'incarnation d'un dieu ! »
Partagez cet article