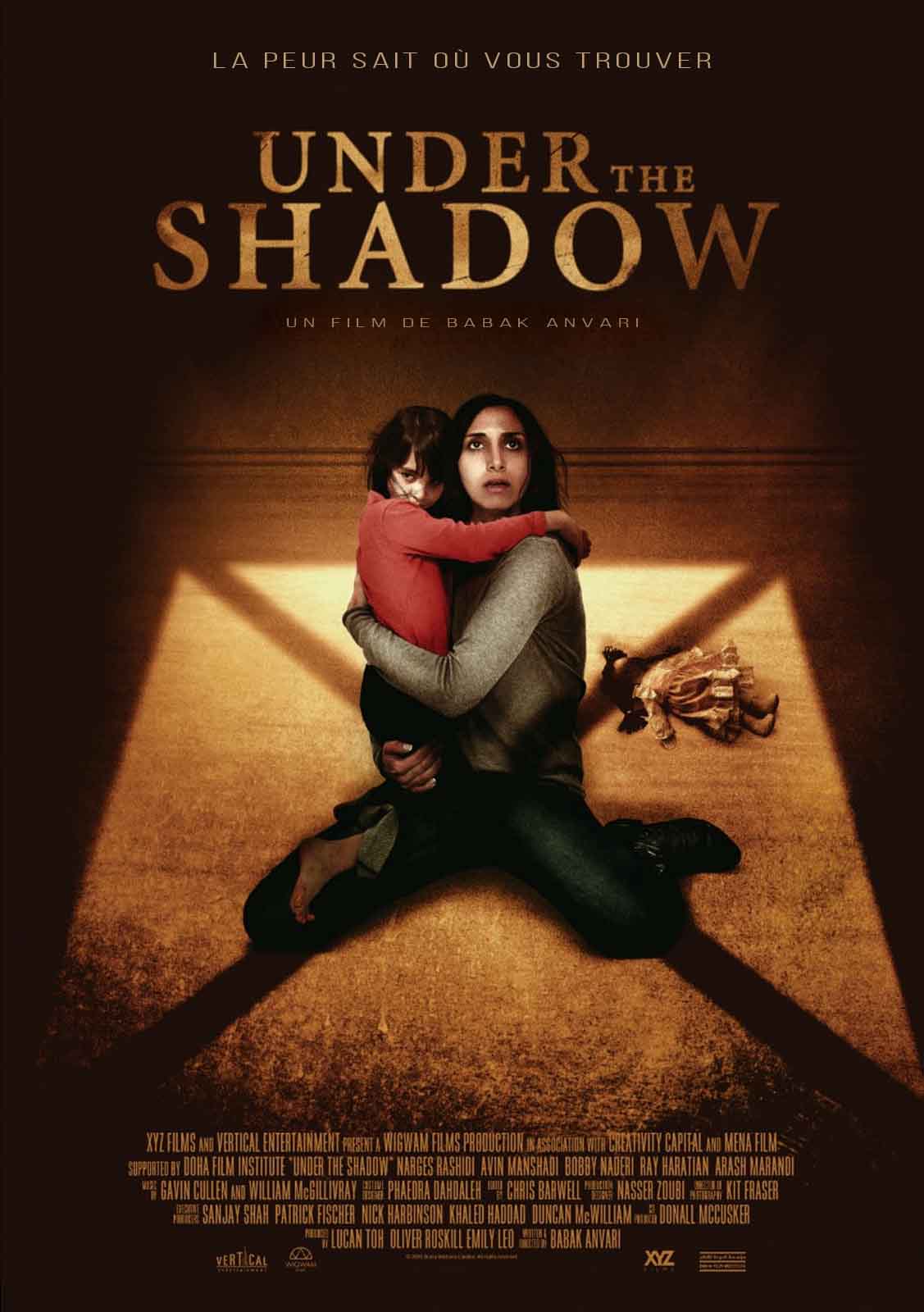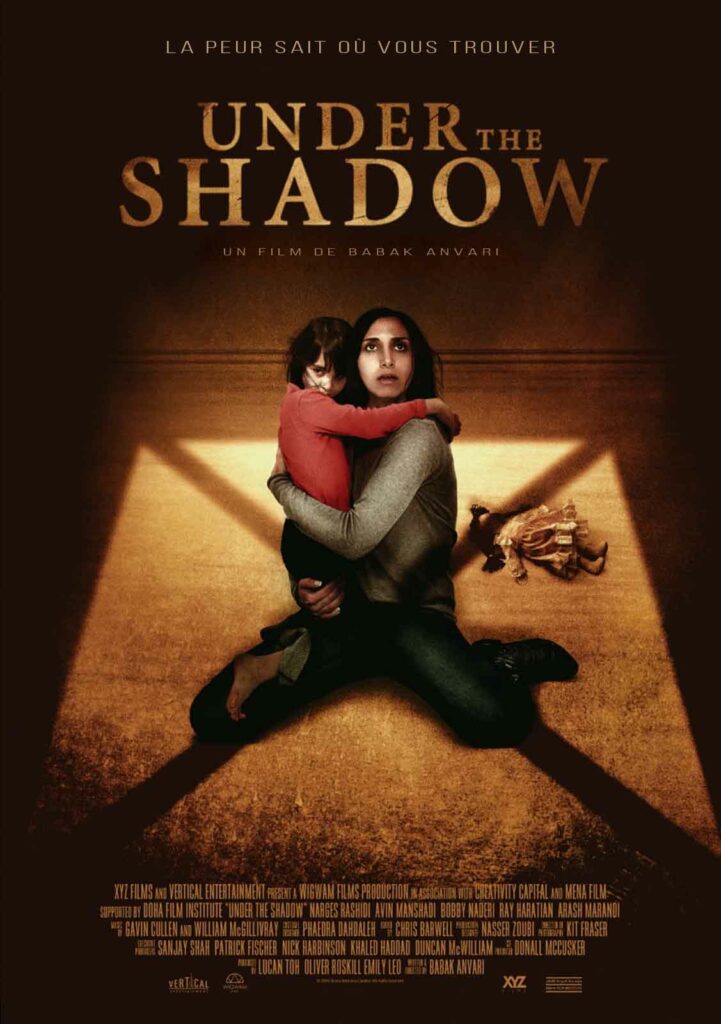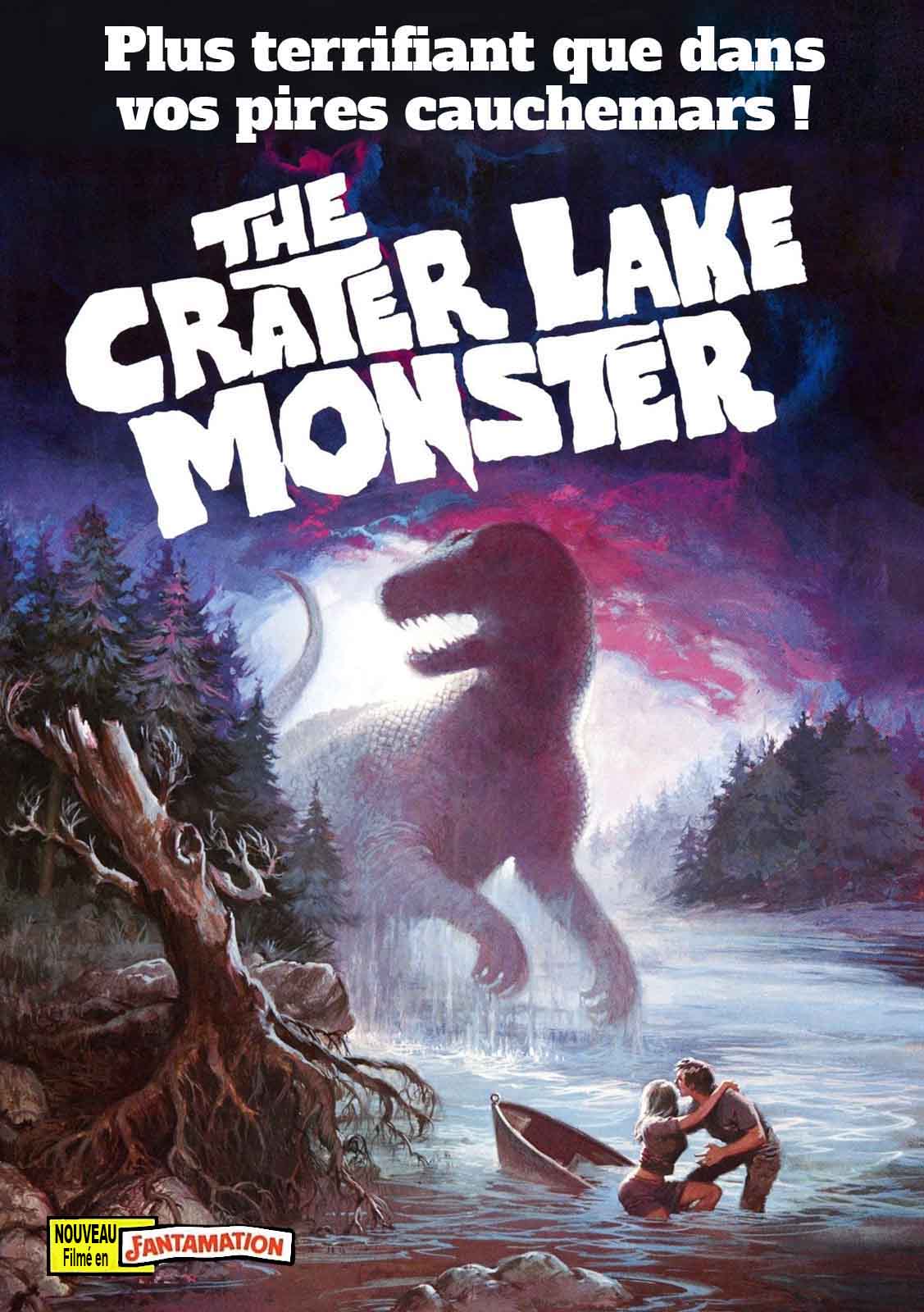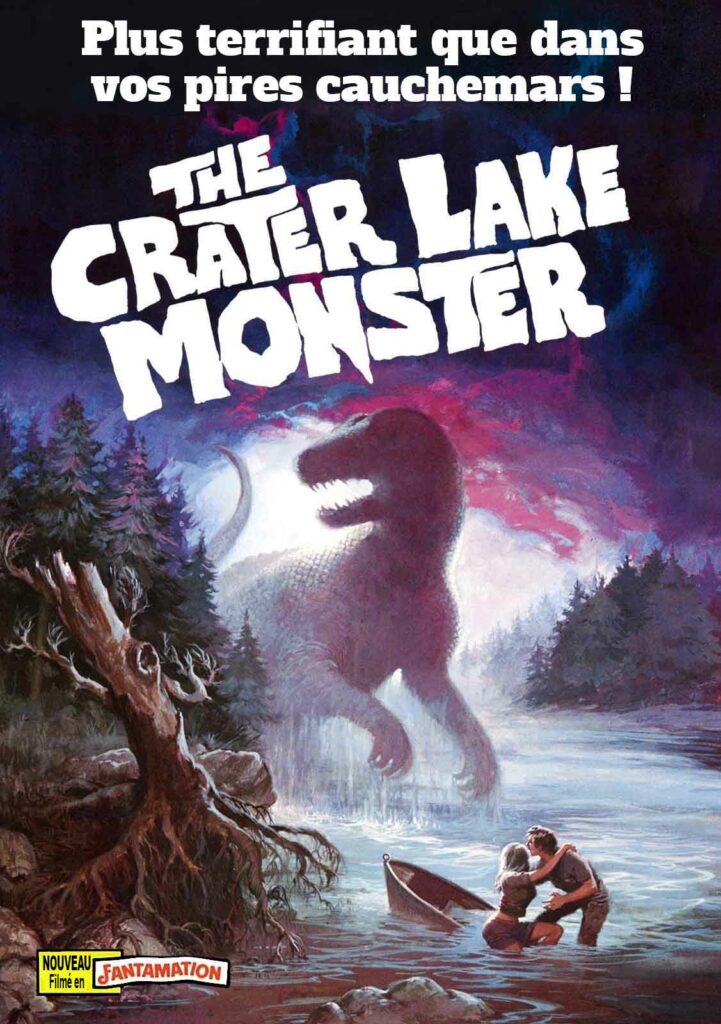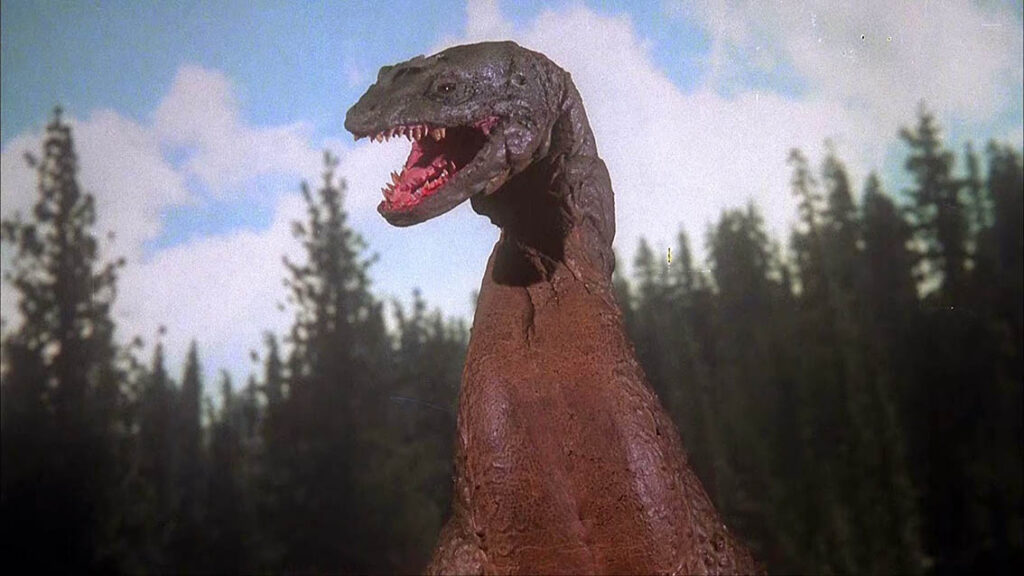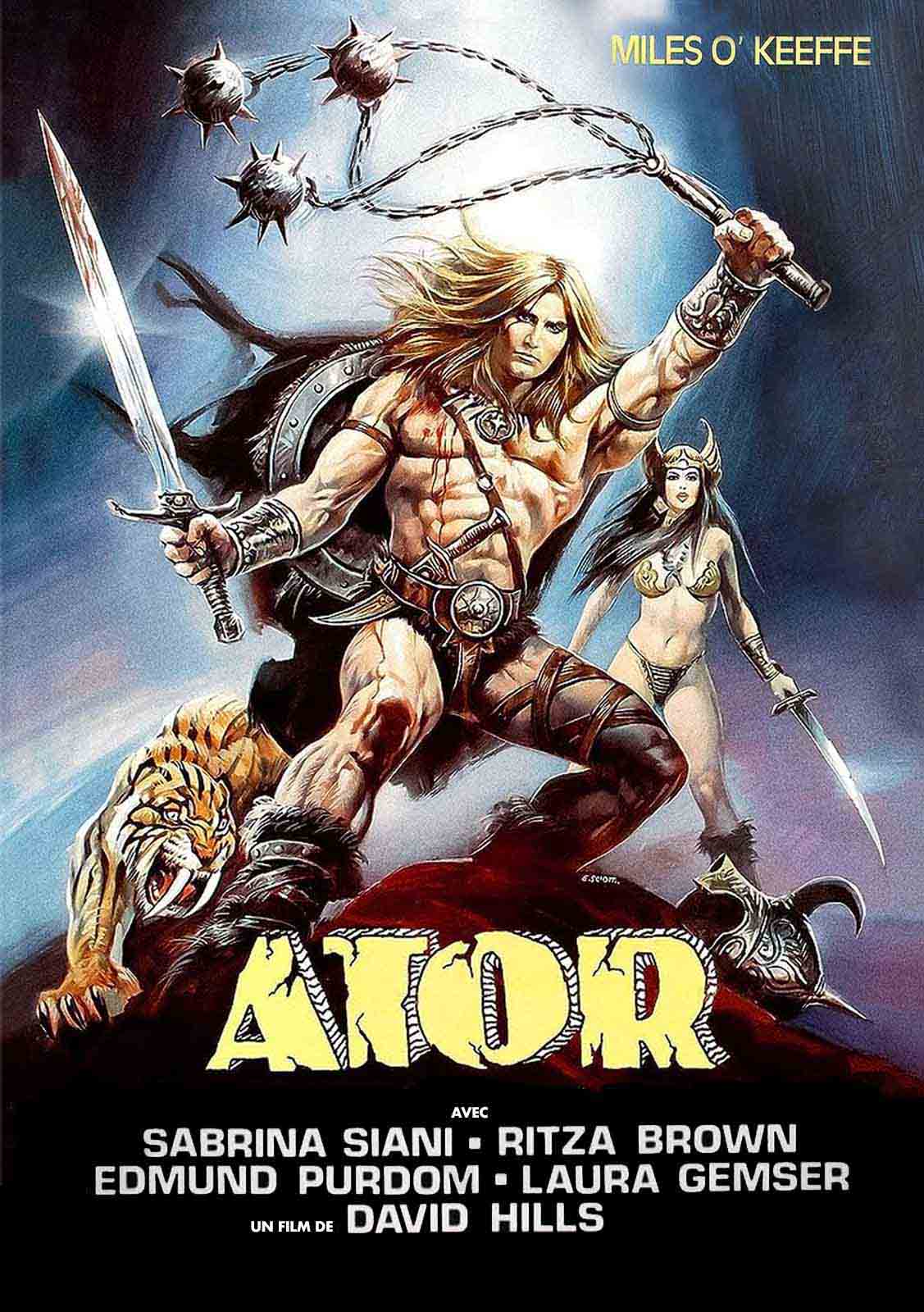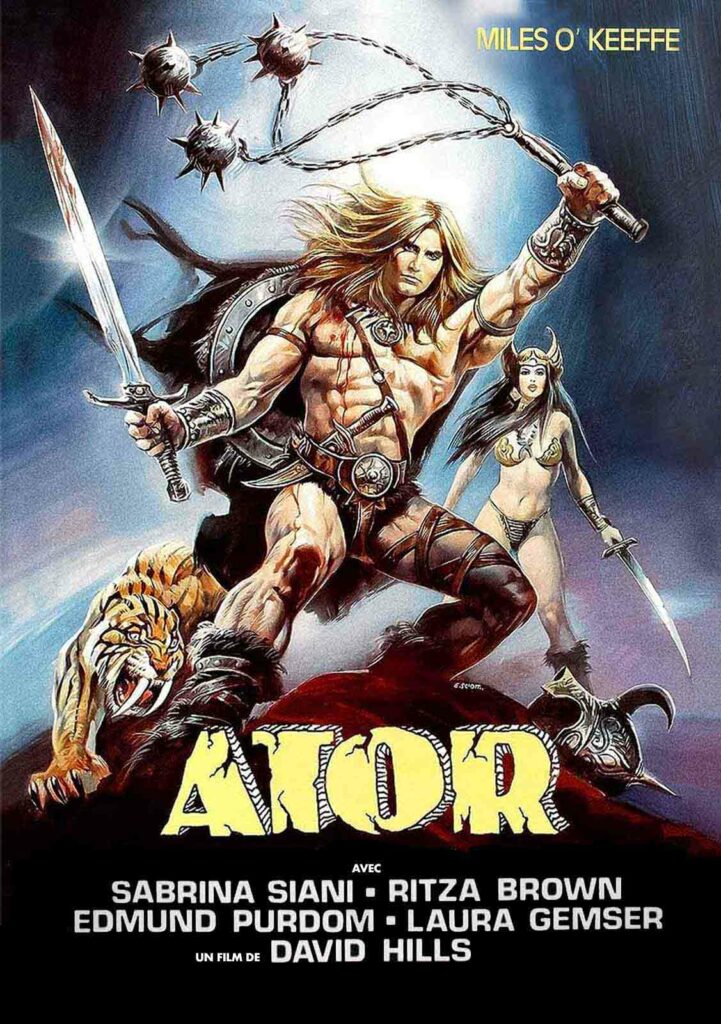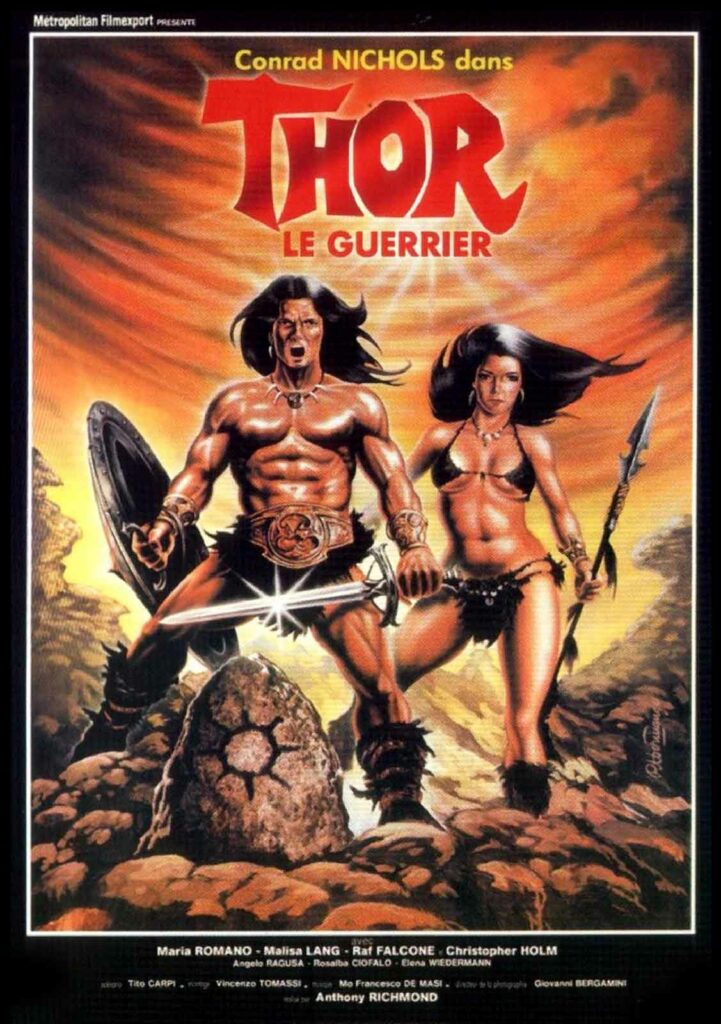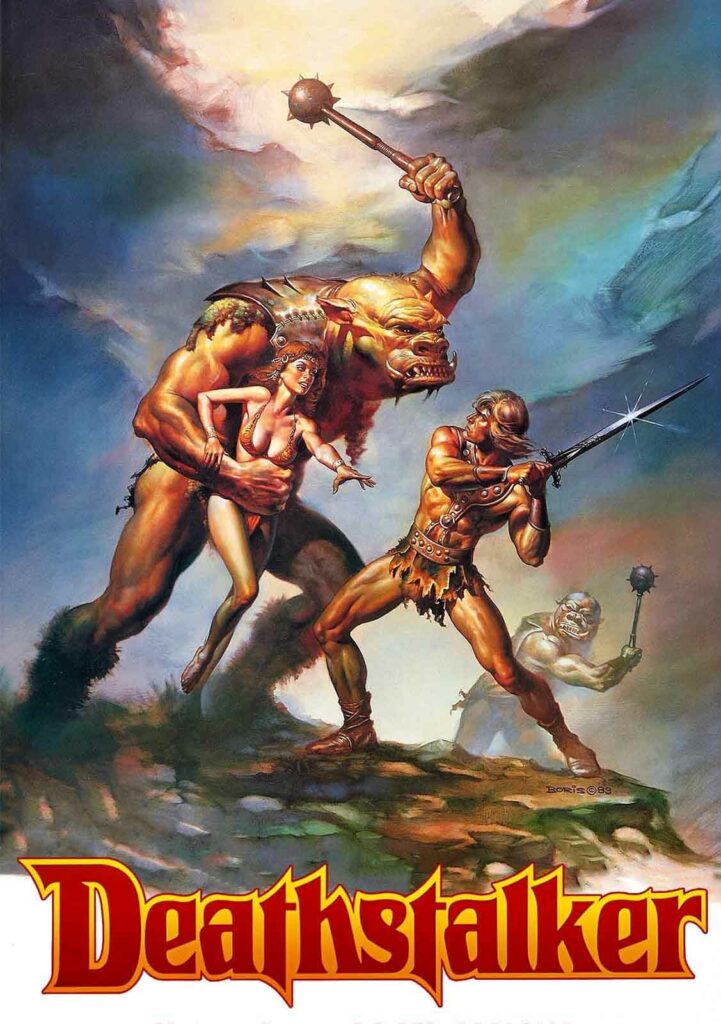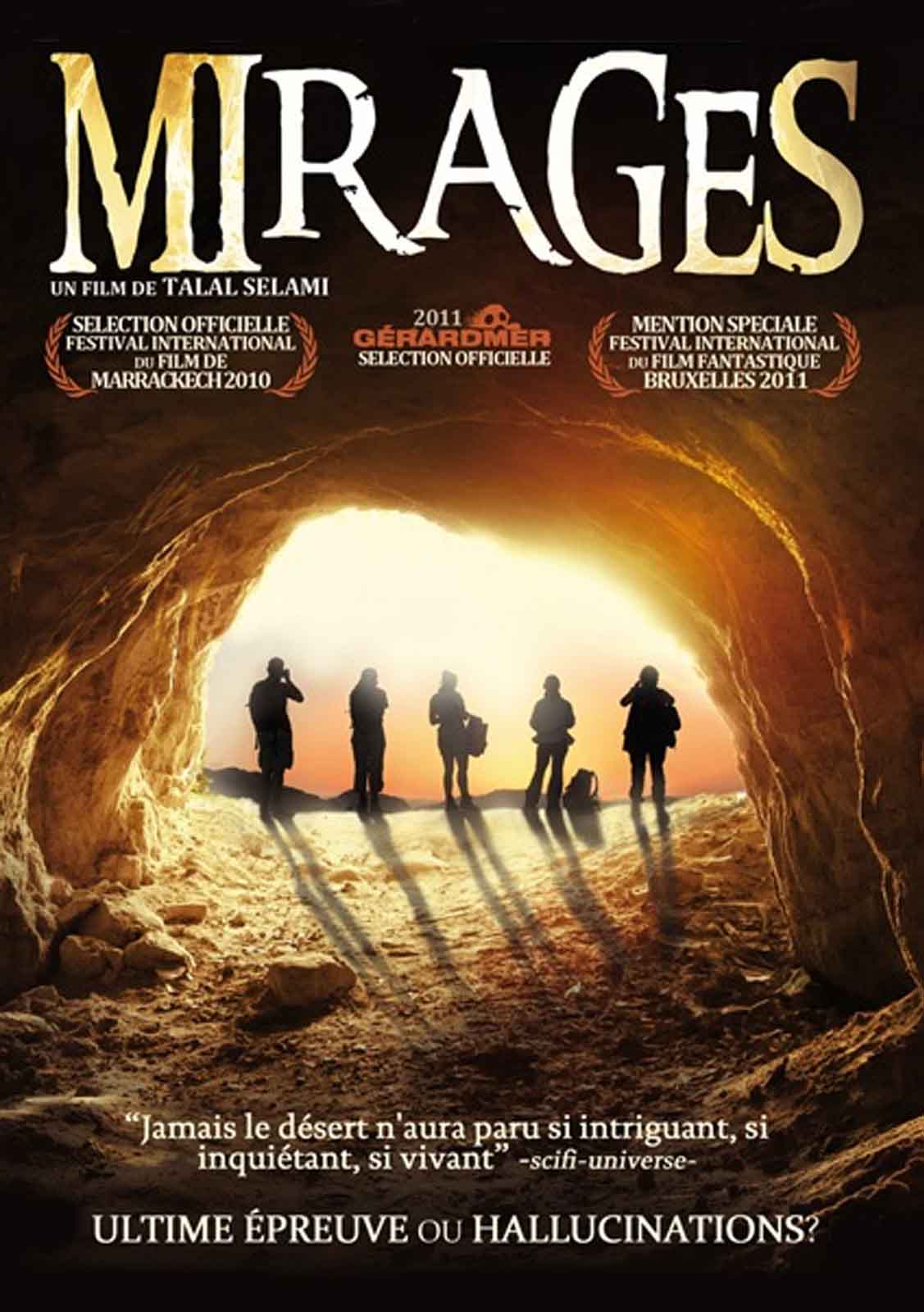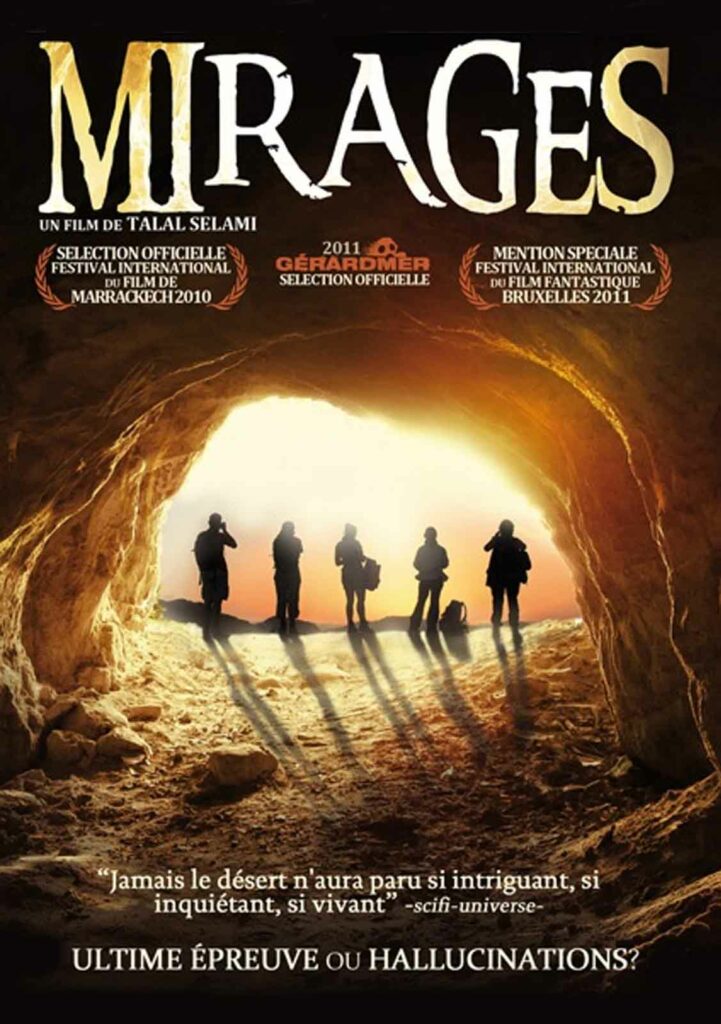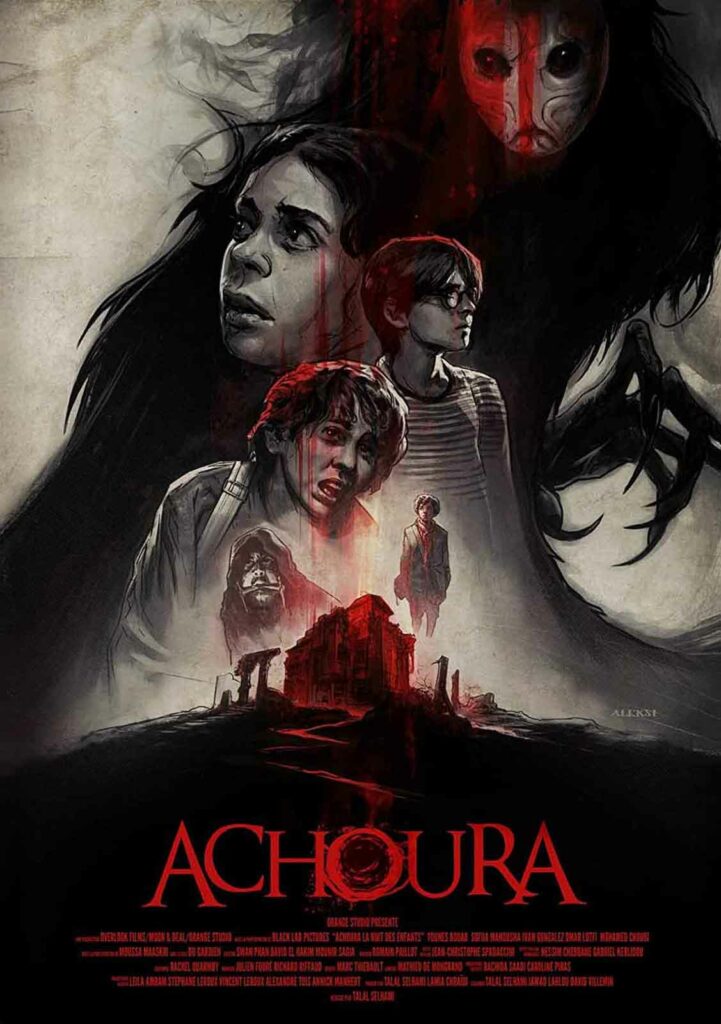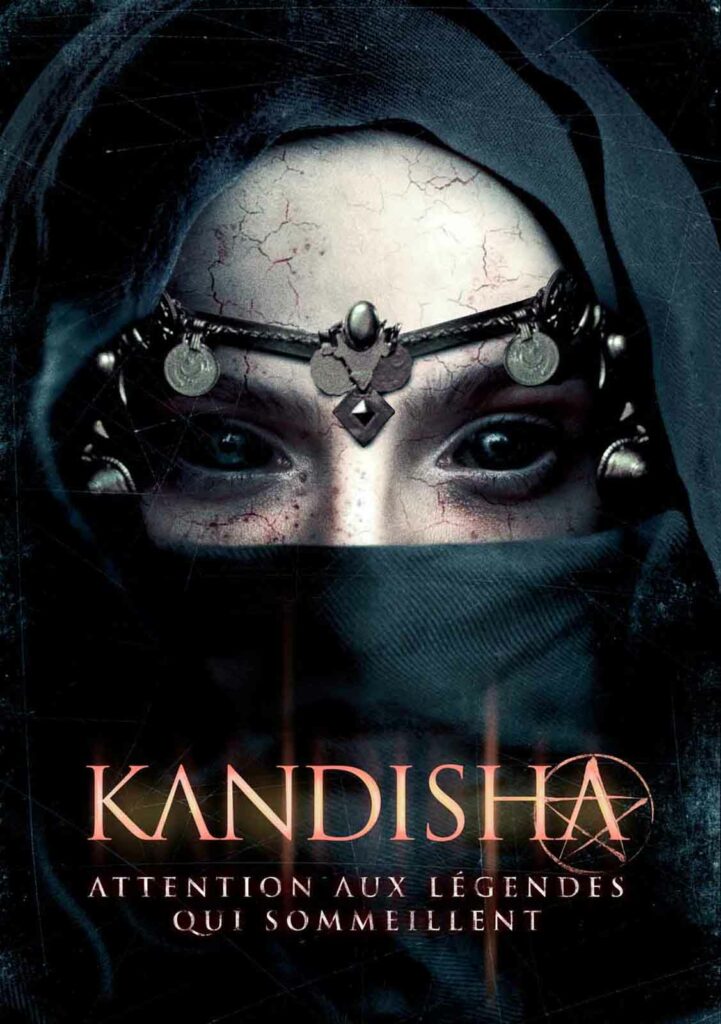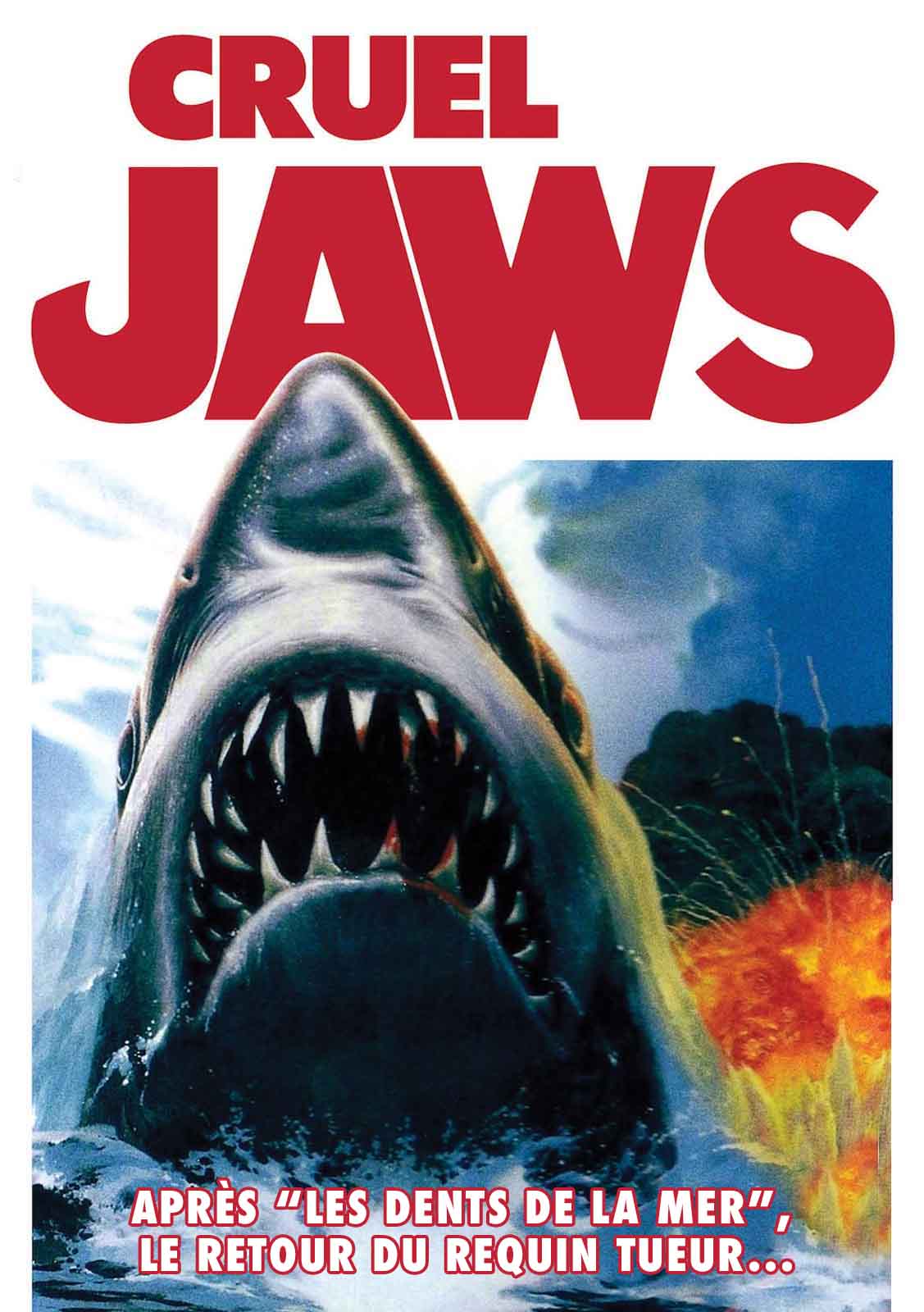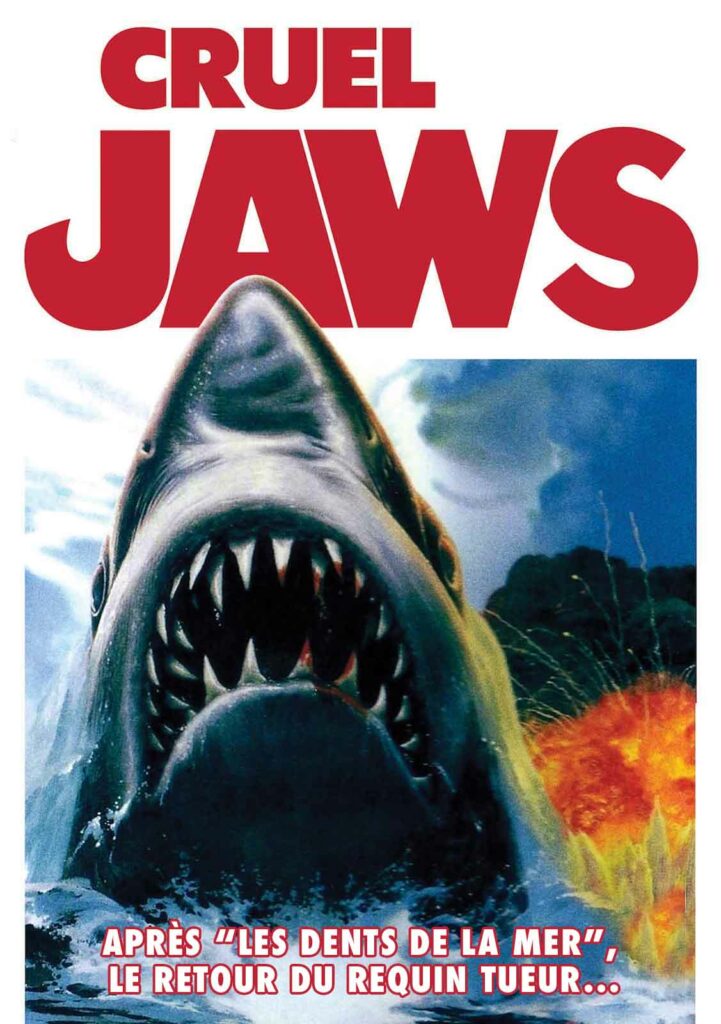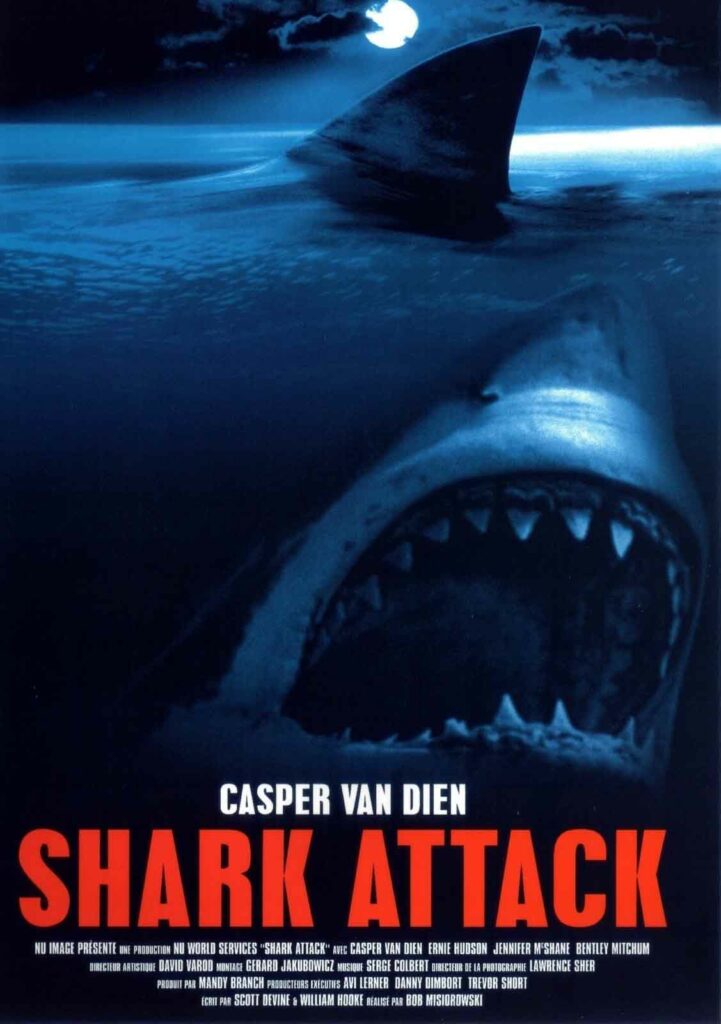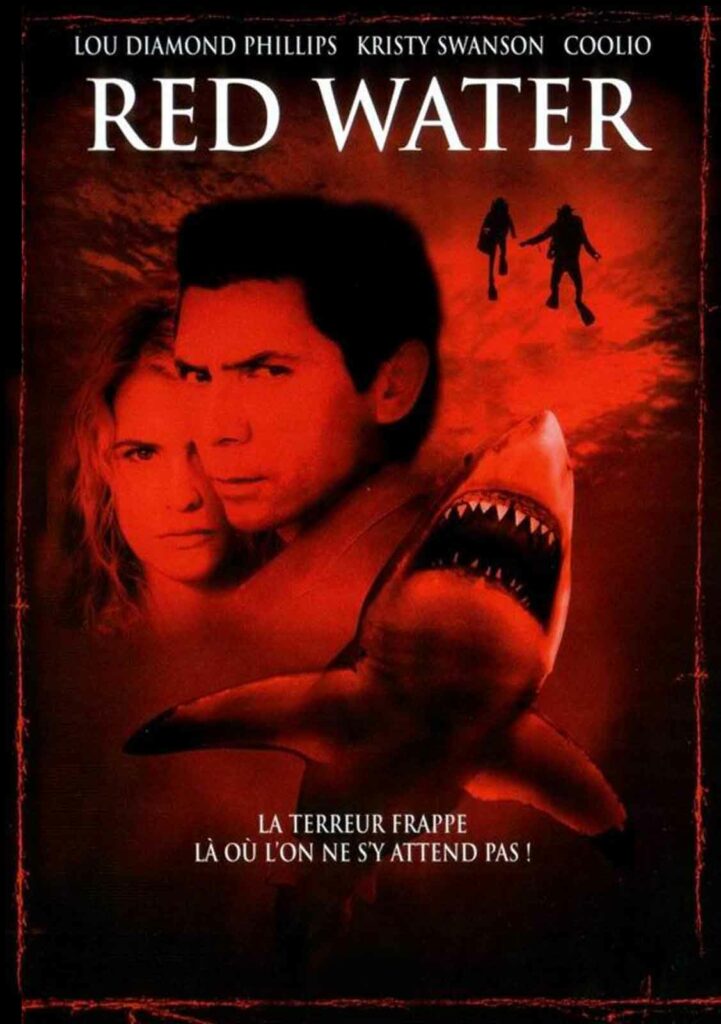Le jeune super-héros latino de l’univers DC fait ses premiers pas au cinéma dans un film sympathique à défaut d’être mémorable…
BLUE BEETLE
2023 – USA
Réalisé par Angel Manuel Soto
Avec Xolo Maridueña, Bruna Marquezine, Adriana Barraza, Damian Alcazar, Raoul Max Trujillo, Susan Sarandon, George Lopez, Belissa Escobedo, Harvey Guilen
THEMA SUPER-HÉROS I SAGA DC COMICS
Le scarabée bleu aura eu plusieurs vies avant de trouver sa forme définitive dans les pages des comics DC. Créé par Charles Nicholas Wojtkowski et Will Eisner, il vit ses premières aventures dans Mystery Men Comics en 1939 sous les traits du policier Dan Garret, se muant en super-justicier grâce à un équipement dernier cri et des vitamines dopantes. Après le dépôt de bilan de l’éditeur Fox Feature Syndicate, Blue Beetle atterrit chez Charlton Comics qui le ressuscite au milieu des années 60 et réinvente ses origines. Dan Garret est désormais un archéologue devenu super-héros grâce à un objet magique d’origine égyptienne en forme de scarabée. Au début des années 80, c’est DC Comics qui récupère les droits du personnage après la fermeture de Charlton, mettant en avant deux autres personnages : l’inventeur Ted Kord, disciple de Dan Garrett, et l’adolescent Jaime Reyes, son successeur. C’est sur cette variante plus récente de l’histoire que s’appuie l’adaptation cinématographique confiée par Warner et le studio DC au cinéaste portoricain Angel Manuel Soto. Le crédo des films DC post-Zack Snyder étant l’humour et la légèreté (comme en témoignent Shazam, The Suicide Squad ou The Flash), c’est cette voie qu’emprunte naturellement Blue Beetle.


Le héros du film est donc Jaime Reyes (Xolo Maridueña), jeune diplômé de l’université de droit de Gotham qui revient dans sa ville natale de Palmera et retrouve sa famille volubile. Malgré la chaleur et la bonne humeur ambiante, les nouvelles ne sont pas bonnes. Le père de Jaime a des problèmes cardiaques et les difficultés financières familiales les menacent d’une expulsion imminente. Acceptant un petit boulot d’agent d’entretien, Jaime fait la rencontre de Jenny Kord (Bruna Marquezine), membre d’une famille d’industriels fortunés dont la dirigeante, la redoutable Victoria Kord (Susan Sarandon), capitalise sur la vente d’armes ultrasophistiquées. Sa dernière trouvaille, un ancien artefact extraterrestre connu sous le nom de Scarab, va lui permettre de mettre au point le projet OMAC (One Man Army Corps), des exosquelettes biomécaniques capables de créer une armée de cyborgs indestructibles. Par un concours de circonstances rocambolesque, Jaime se retrouve en possession du Scarab et subit bientôt malgré lui une étrange mutation…
Beetlemania
L’entame du film nous séduit par sa fraîcheur et sa candeur. Cette famille latino est certes caricaturale et excessive, mais il est difficile de ne pas s’y attacher. On sent bien que cette simplicité ne va pas durer et que tôt ou tard les codes du film de super-héros vont s’inviter dans l’intrigue pour lui ôter tout ce qui pourrait faire son charme et son originalité. Et ça ne loupe pas. Dès que Jaime devient Blue Beetle, nous voilà face à un super-héros à mi-chemin entre Spider-Man et Iron Man qui se lance dans des combats musclés contre un adversaire possédant peu ou prou les mêmes capacités que lui, à grands renforts de doublures numériques en apesanteur et d’images de synthèse tous azimuts. Au-delà de l’inévitable effet de déjà-vu, le spectateur peine à s’impliquer dans les exploits du petit Scarabée dans la mesure où la nature même de ses pouvoirs nous échappe totalement. À la fois combinaison futuriste façon Tony Stark et symbiote extra-terrestre à la Venom, le costume dont il est revêtu semble à peu près capable de tout. Un peu blasés par ces démonstrations infographiques très modérément palpitantes, nous nous rabattons sur la famille Reyes qui reste diablement attachante. Certes, l’oncle complotiste Rudy (George Lopez) en fait des tonnes et se soustrait à toute logique (il devient en un clin d’œil virtuose de l’informatique, ingénieur et pilote de vaisseaux volants). Il n’empêche que c’est lui qui prononce les dialogues clés. Si sa réplique « l’univers t’a fait un don, à toi d’en faire bon usage » nous renvoie au crédo de Spider-Man, celle qui affirme « on va peut-être enfin avoir notre héros à nous » dit bien la volonté de positionner Blue Beetle comme représentant et défenseur d’une des minorités les plus importantes des Etats-Unis. A l’instar de Black Panther, fer de lance super-héroïque de la communauté afro-américaine, le scarabée bleu est donc le super-justicier mexicain que les latino-américains attendaient. C’est sa vocation principale. Mais il eut sans doute fallu un film mieux construit et moins bardé de clichés pour pleinement nous convaincre.
© Gilles Penso
À découvrir dans le même genre…
Partagez cet article