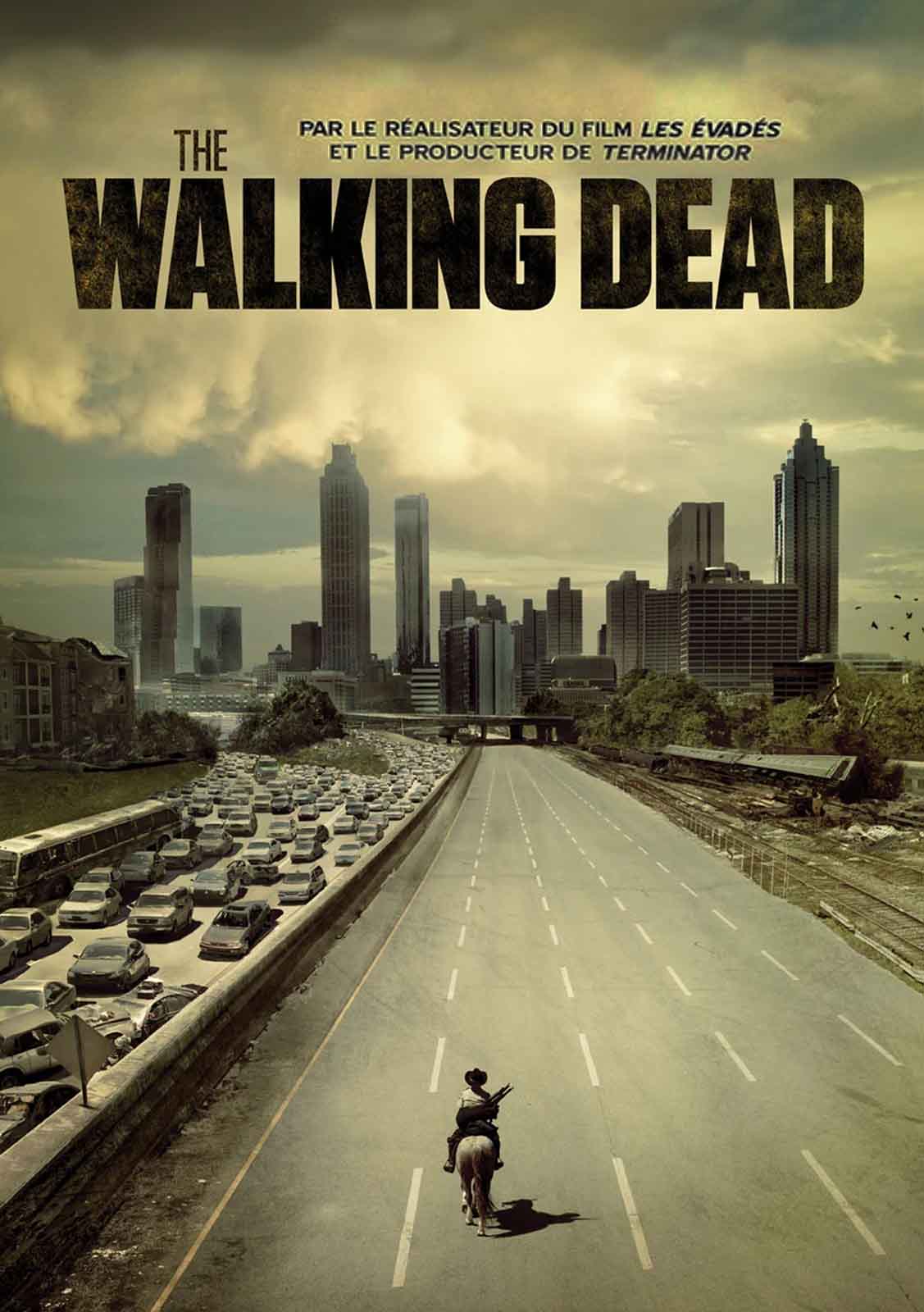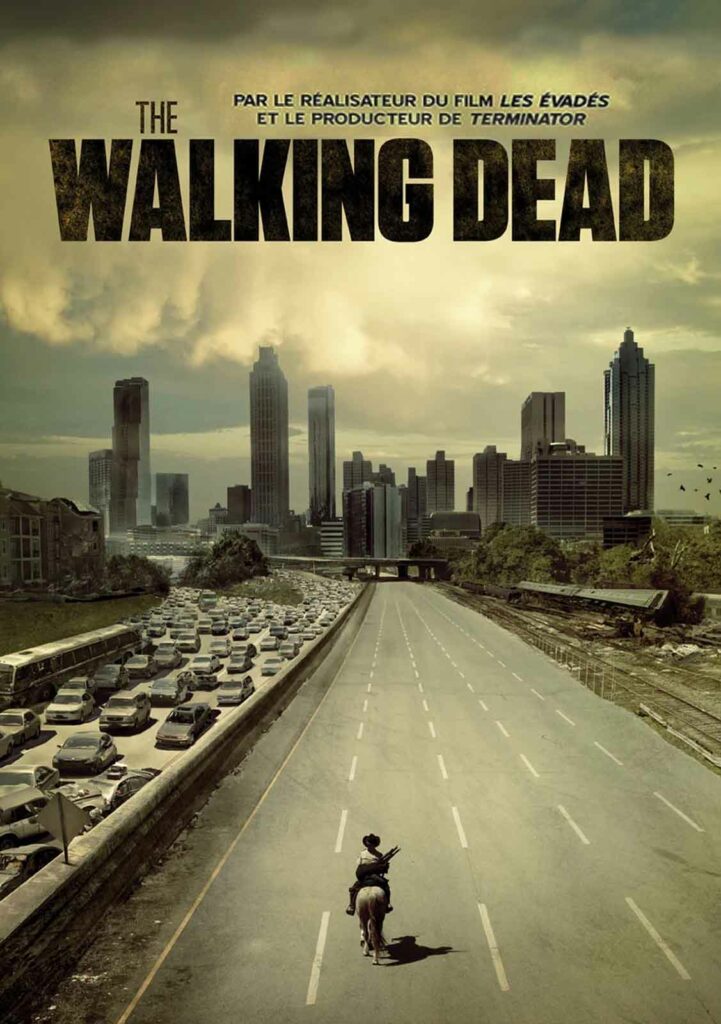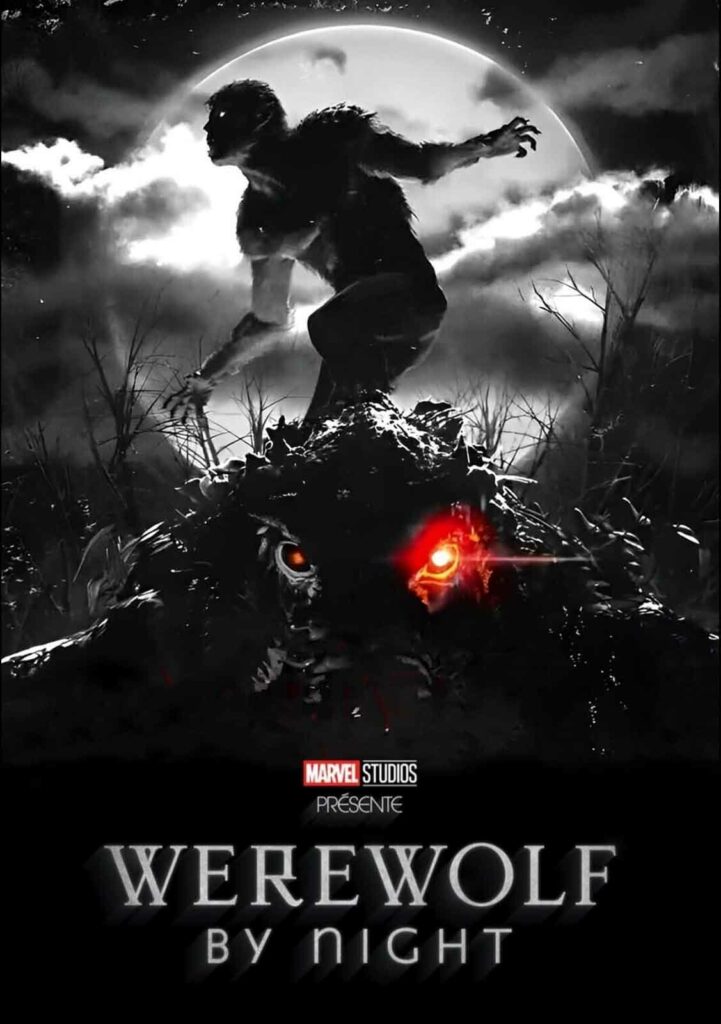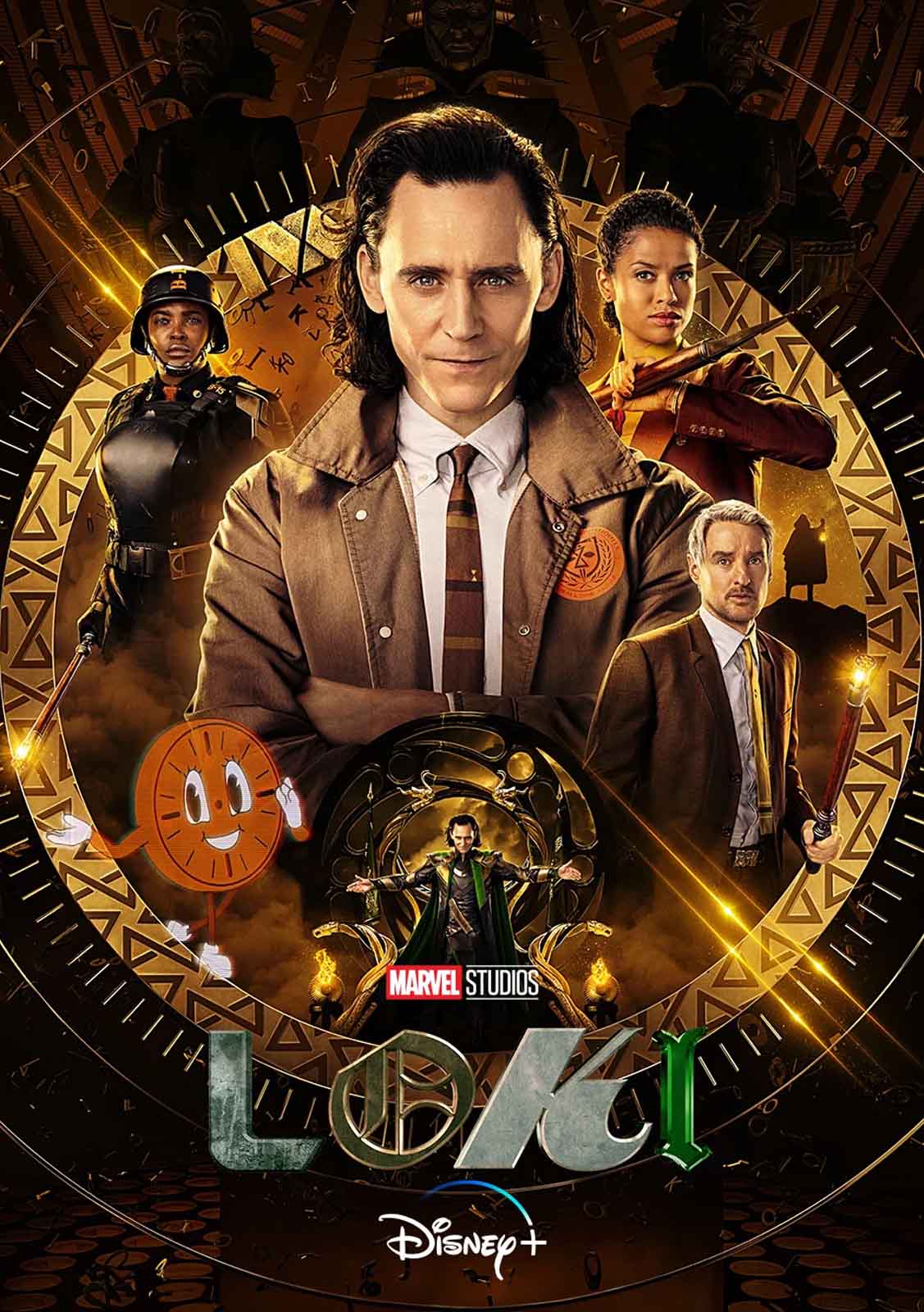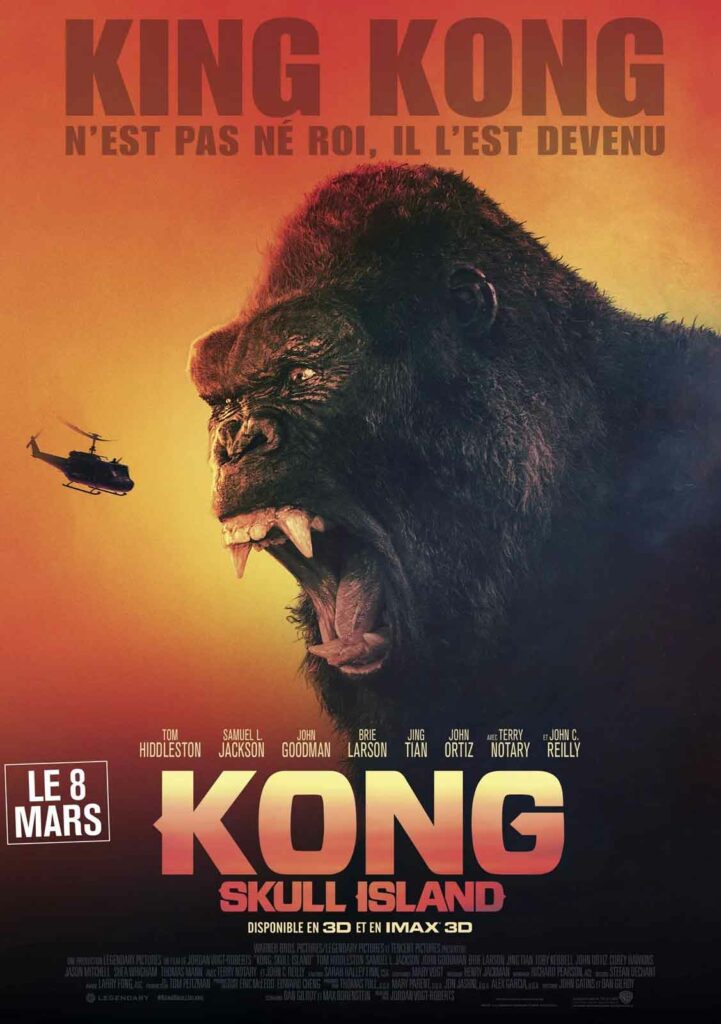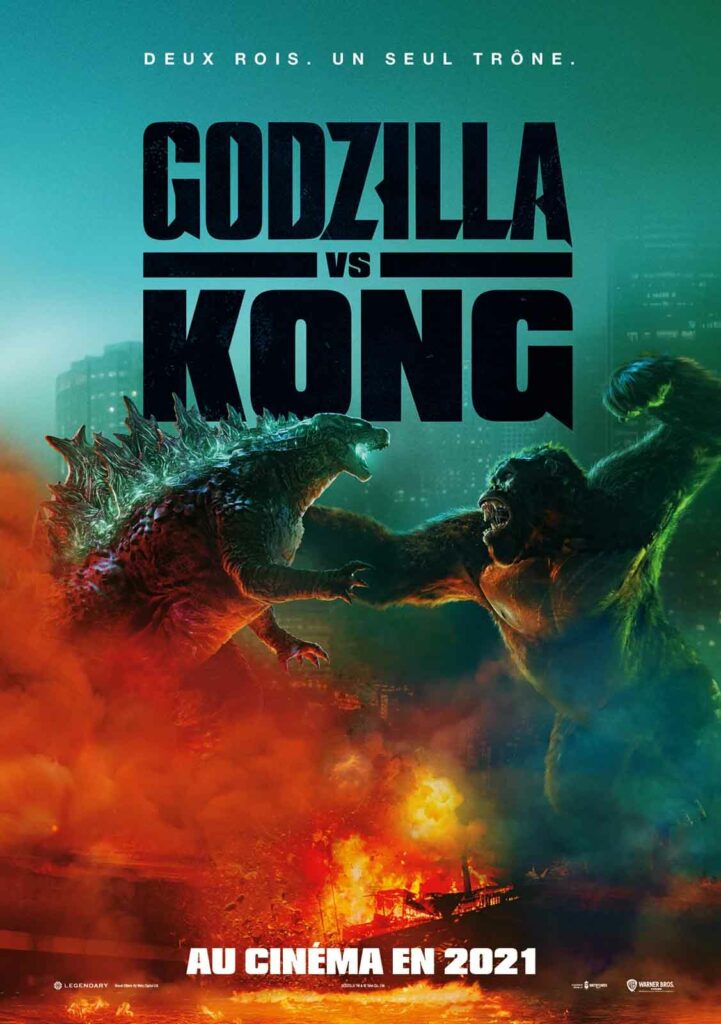L’ex-patron du S.H.I.E.L.D. reprend du service pour tenter d’enrayer une invasion extra-terrestre fomentée par des Skrulls rebelles…
SECRET INVASION
2023 – USA
Créée par Kyle Bradstreet
Avec Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Richard Dormer, Emilia Clarke, Don Cheadle
THEMA EXTRA-TERRESTRES I SAGA MARVEL CINEMATIC UNIVERSE
En 2008, la saga « Secret Invasion » bouleverse l’univers des comics Marvel en sollicitant une grande partie des super-héros maison tout en montrant des répercussions affectant la planète toute entière. Cette série écrite par Brian Michael Bendis et dessinée par Leinil F. Yu attire l’attention d’Anthony et Joe Russo (Captain America : Civil War, Avengers : Endgame) qui envisagent un temps de l’adapter au cinéma. Mais c’est finalement le petit écran qui servira d’écrin à Secret Invasion, sous forme d’une mini-série de six épisodes pour Disney + chapeautée par Kyle Bradstreet (à qui nous devons le show Mr. Robot). Le format choisi impose de revoir considérablement à la baisse le scope des événements. Les scénarios se concentrent donc sur les efforts de Nick Fury pour contrecarrer les plans hégémoniques d’un groupuscule de Skrulls rebelles infiltrés parmi les humains, sans que n’intervienne le moindre super-héros dans le récit. Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn et Don Cheadle reprennent les rôles respectifs de Fury, Talos et du colonel Rhodes qu’ils tenaient déjà au cinéma. Emilia Clarke et Dermot Mulroney se joignent à la fête, la première sous les traits d’une agent double Skrull, le second dans le costume du président des États-Unis.


Après une absence prolongée loin de la planète Terre suite aux événements survenus dans Avengers Endgame, l’ex-patron du S.H.I.E.L.D., toujours aussi borgne et intraitable mais moins fringuant qu’autrefois, redescend parmi les siens pour régler une question grave qui pourrait mettre en péril l’humanité toute entière. Les Skrulls, cette fameuse race extra-terrestre capable d’imiter n’importe qui avec un réalisme confondant, sont parmi nous, et l’un d’entre eux, le renégat Gravik (Kingsley Ben-Adir) a décidé de renverser les forces terriennes pour imposer le règne de son espèce. Dans ce but, il projette une série d’attentats qui, à terme, devraient mener à une troisième guerre mondiale. Comme James Caan dans Futur immédiat, Fury va devoir travailler main dans la main avec un coéquipier alien, en l’occurrence Talos, pour tenter d’enrayer ce plan machiavélique. Mais comment lutter contre des terroristes capables de s’infiltrer partout en passant inaperçus, y compris au sein même de la Maison Blanche ?
Fury rôde
C’est donc sous les atours d’un thriller d’espionnage que Secret Invasion se révèle auprès des téléspectateurs, Kyle Bradstreet et son équipe citant parmi leurs sources d’inspiration Le Troisième homme de Carol Reed, les romans de John le Carré et les séries Homeland et The Americans. Une telle approche dicte un certain nombre de figures imposées (scènes de filatures, de poursuites, d’écoutes) mais aussi une poignée de séquences d’action très ambitieuses qui n’auraient pas surpris sur un grand écran (notamment l’impressionnante attaque du convoi présidentiel par des hélicoptères). La tonalité choisie pour cette série autorise également une violence réaliste et crue qui surprend chez Marvel. Les fusillades meurtrières, les assassinats de sang-froid, les scènes de torture et les milliers de victimes décimées par un attentat ne font pas peur à Disney qui cherche visiblement à toucher un public plus adulte, après les dérives adolescentes de Ms Marvel et She Hulk. A l’avenant, les scripts fouillent un peu plus qu’à l’accoutumée la psychologie des personnages, nous présentant un Nick Fury vieilli, fatigué et au bout du rouleau qui n’est que « l’ombre de lui-même » selon Gravik, un vilain que Kingsley Ben-Adir campe avec beaucoup de charisme. Certes, Secret Invasion n’a rien d’inoubliable – c’est le lot de la grande majorité des shows Disney + – mais se distingue tout de même par ses prises de risque, son audace et une noirceur inattendue.
© Gilles Penso
Partagez cet article