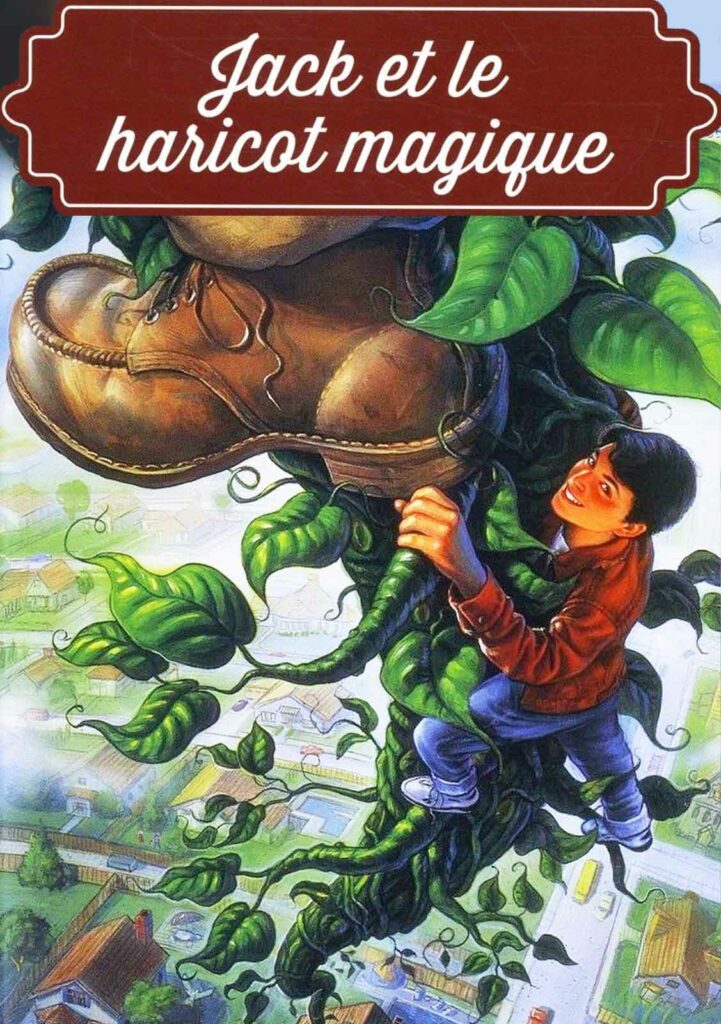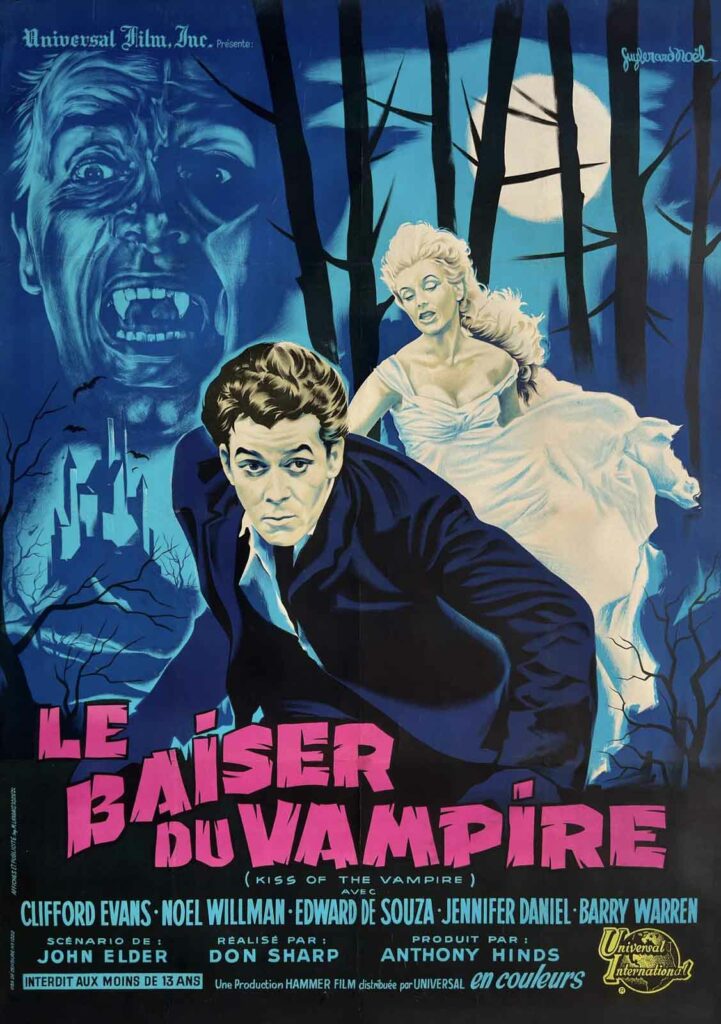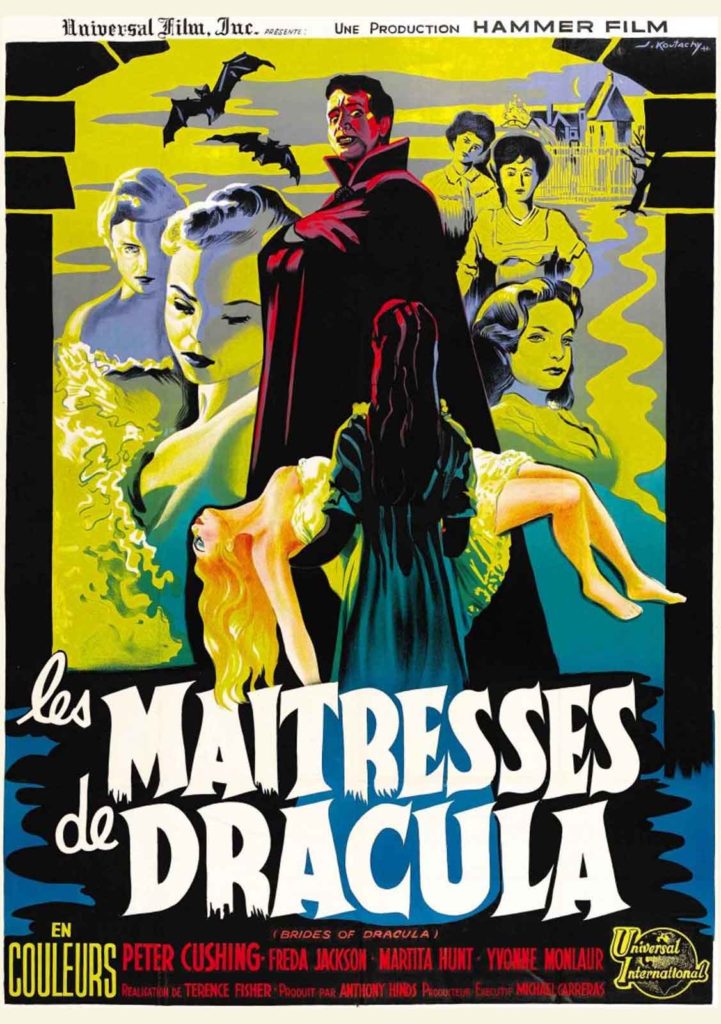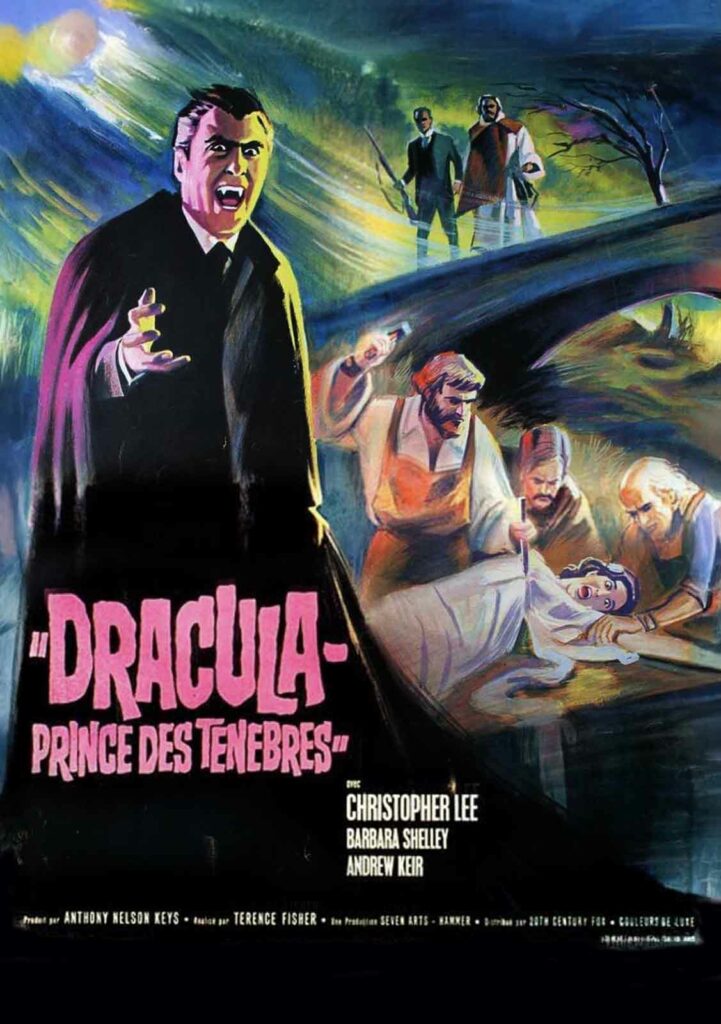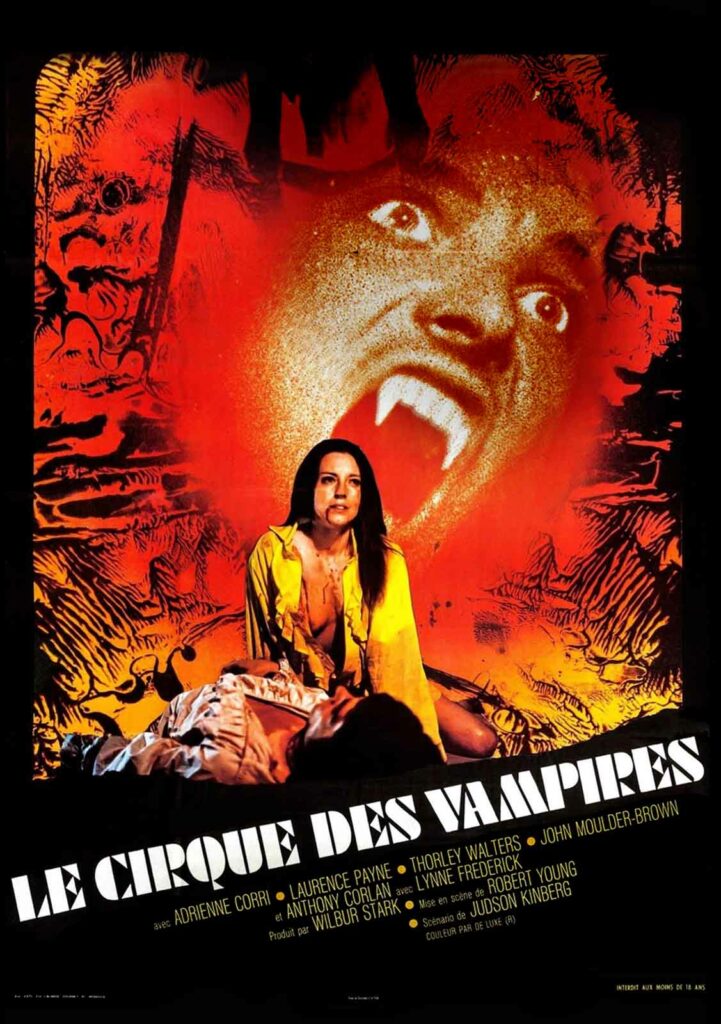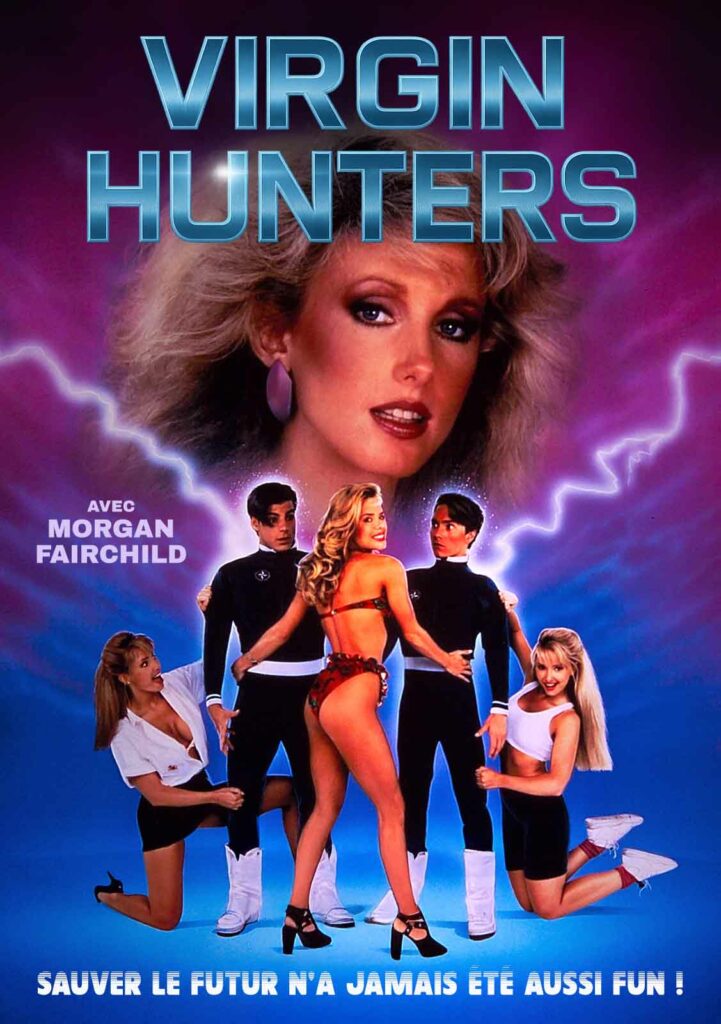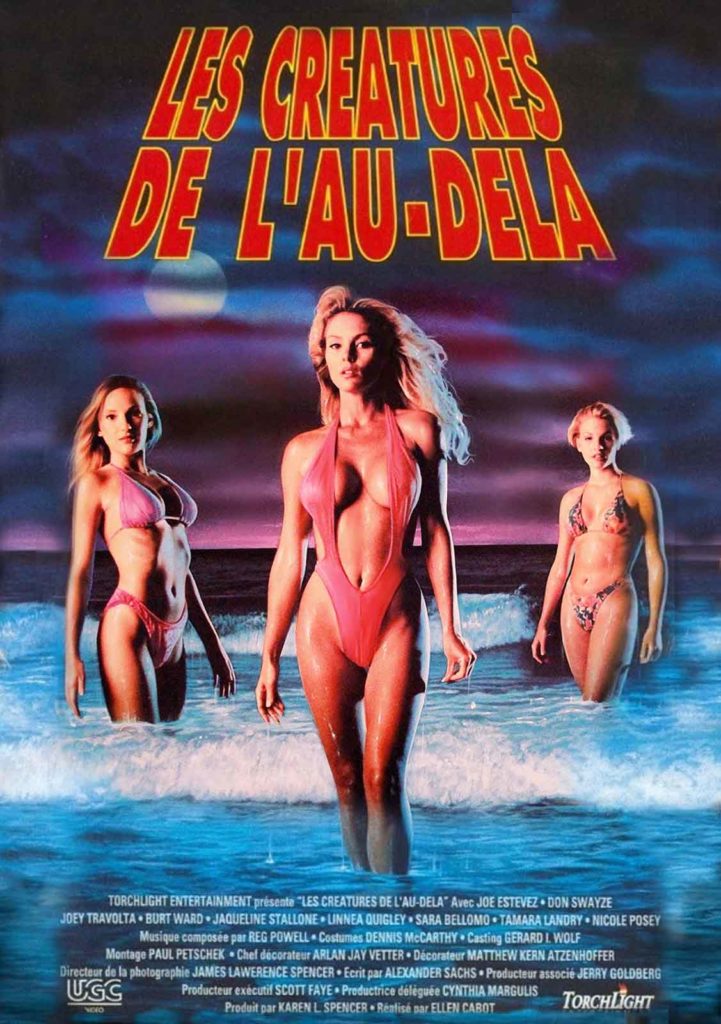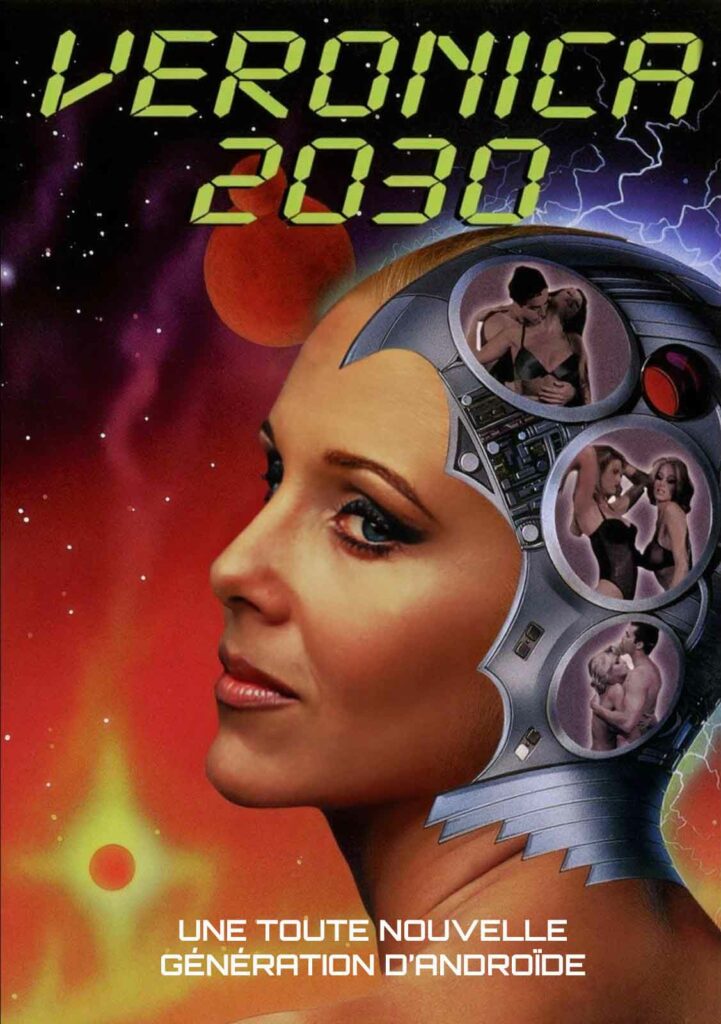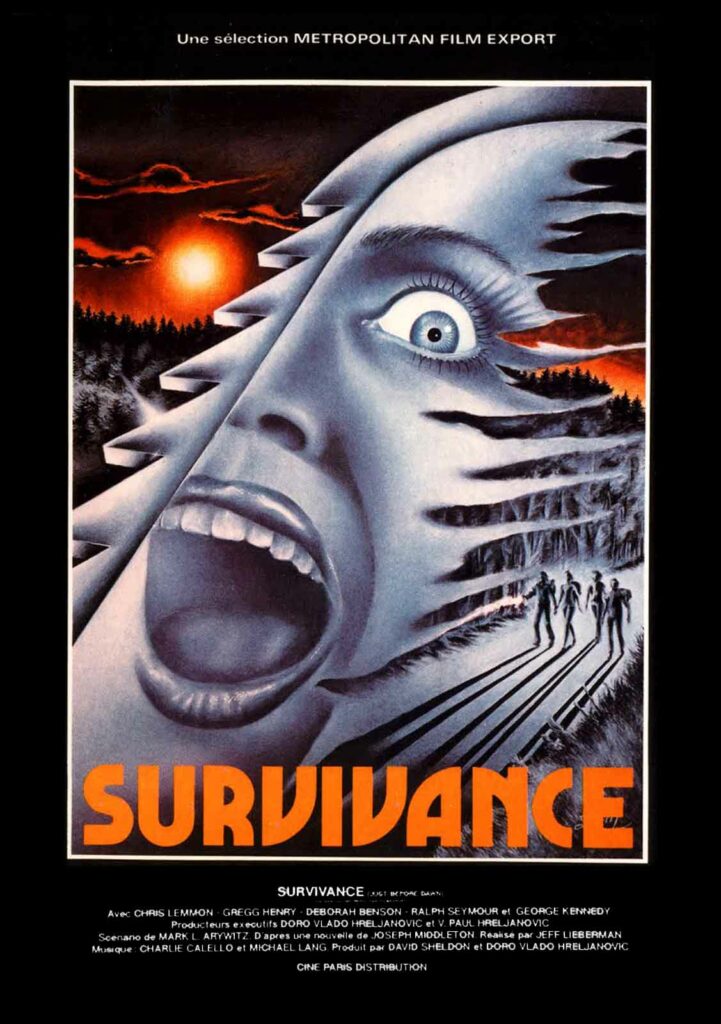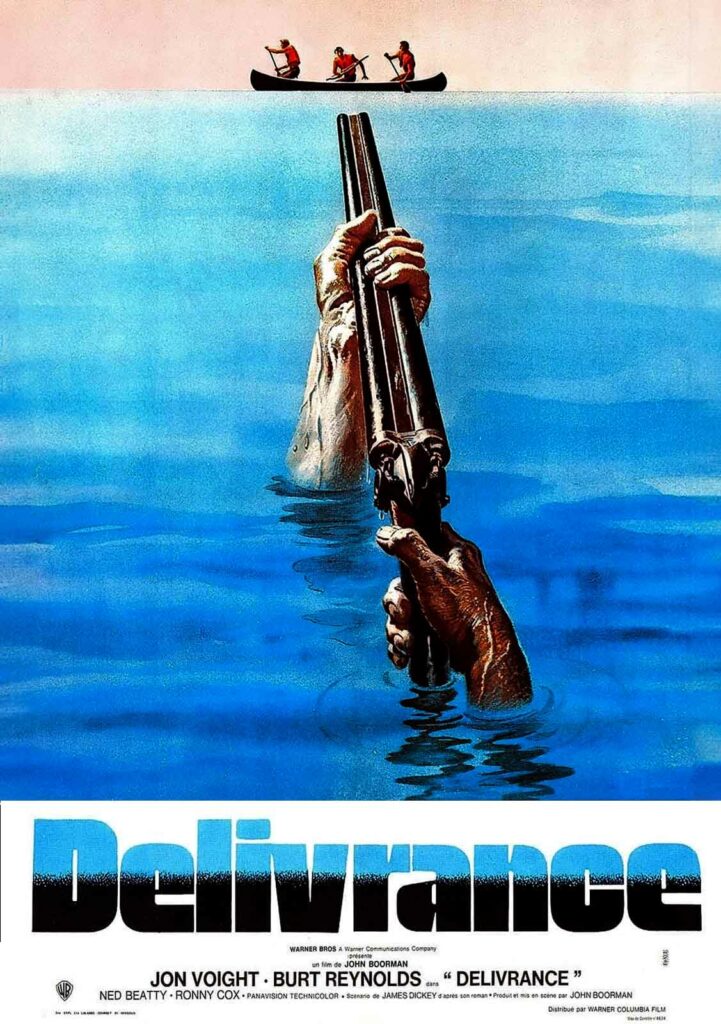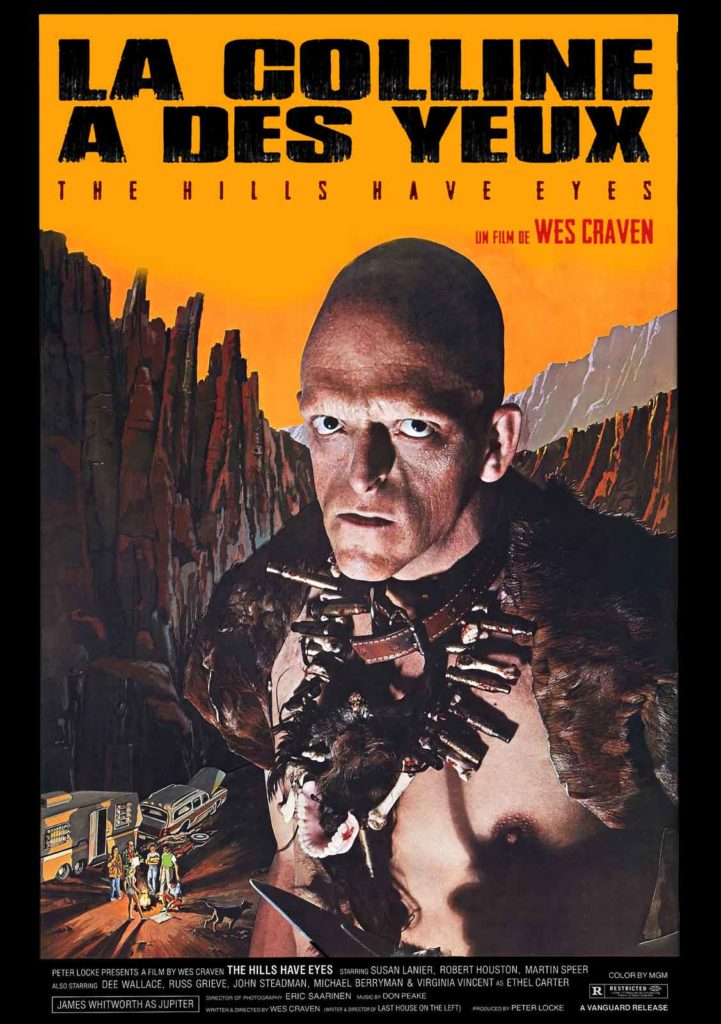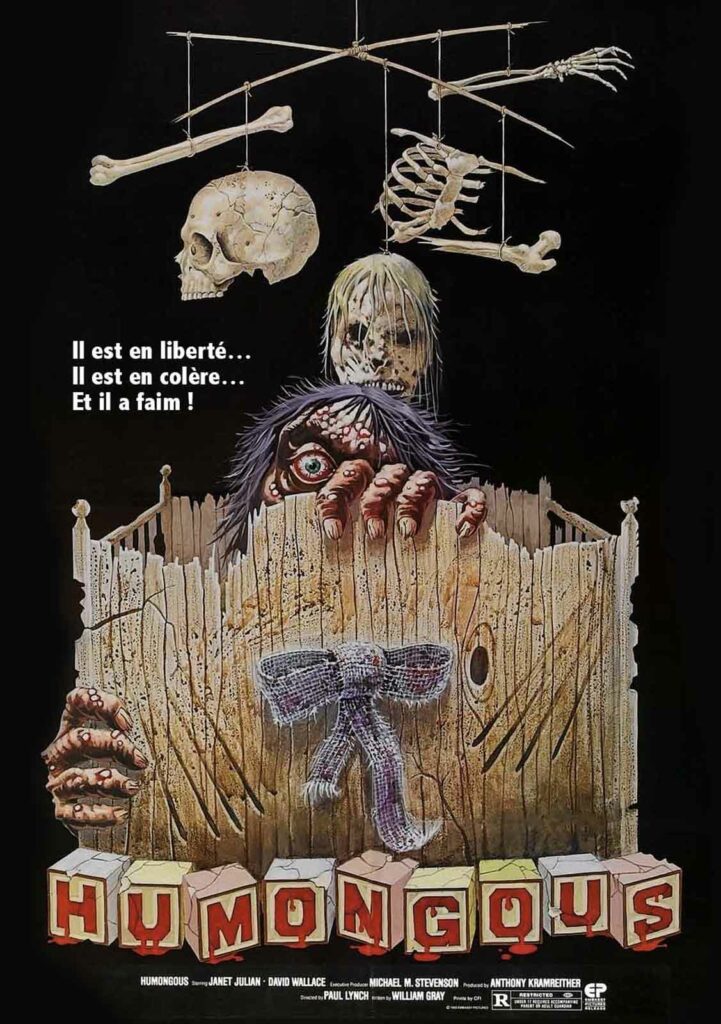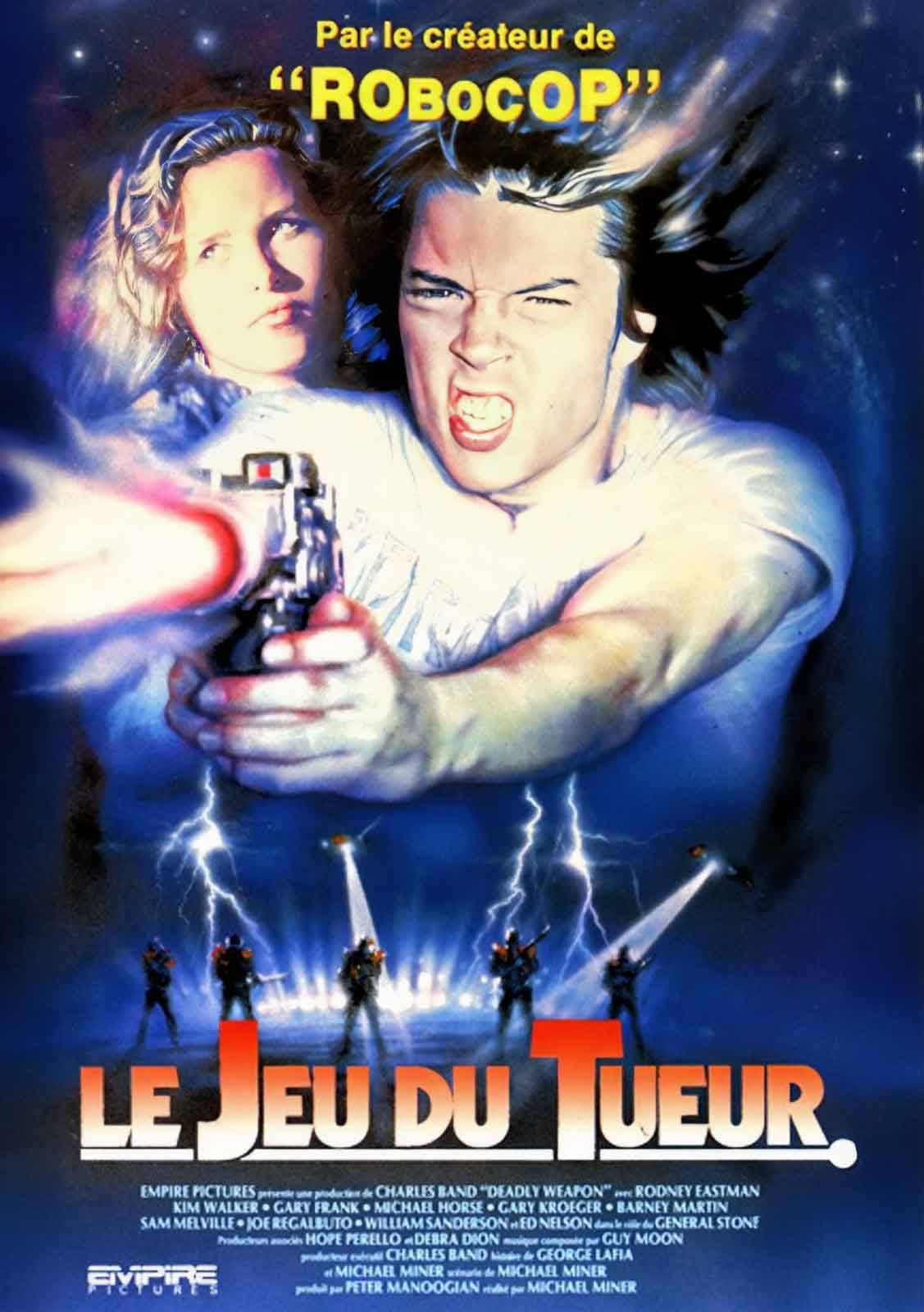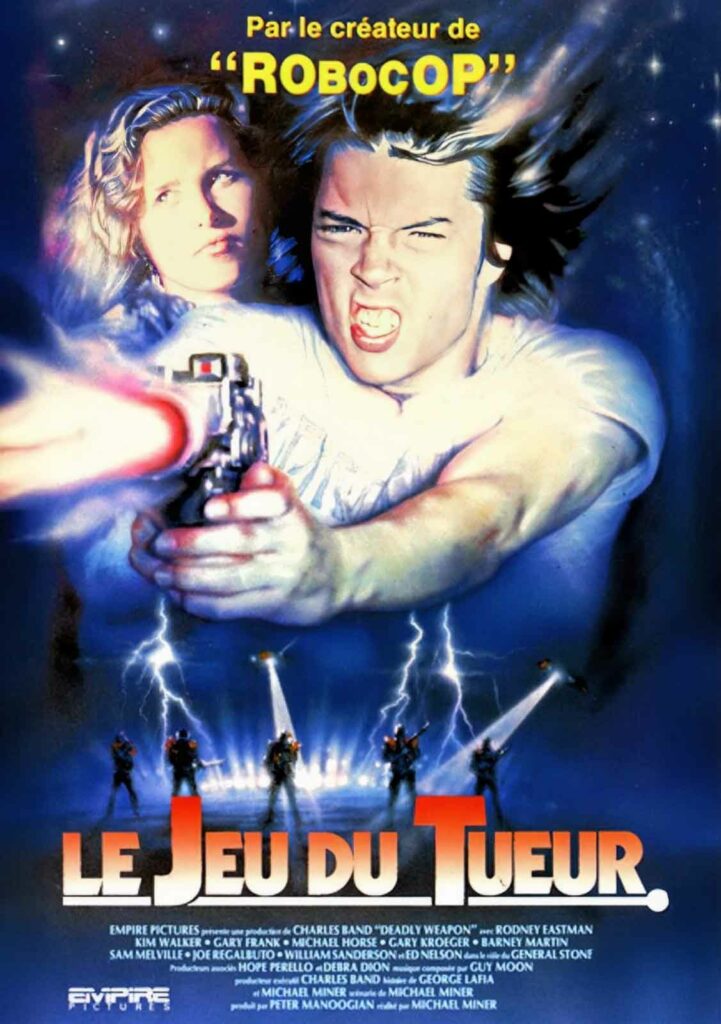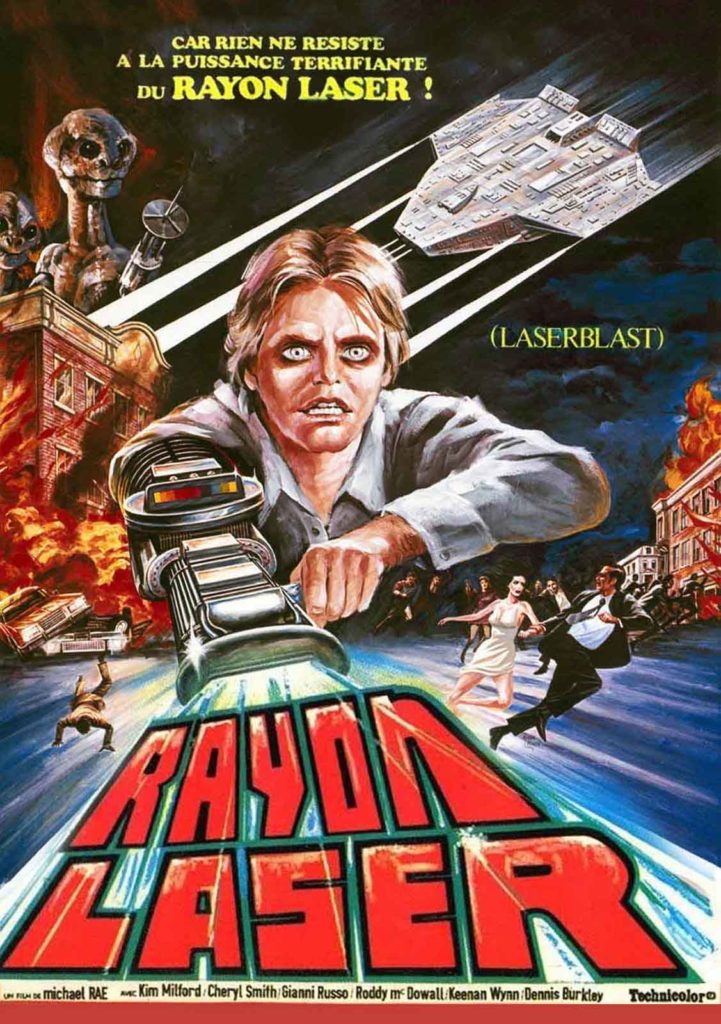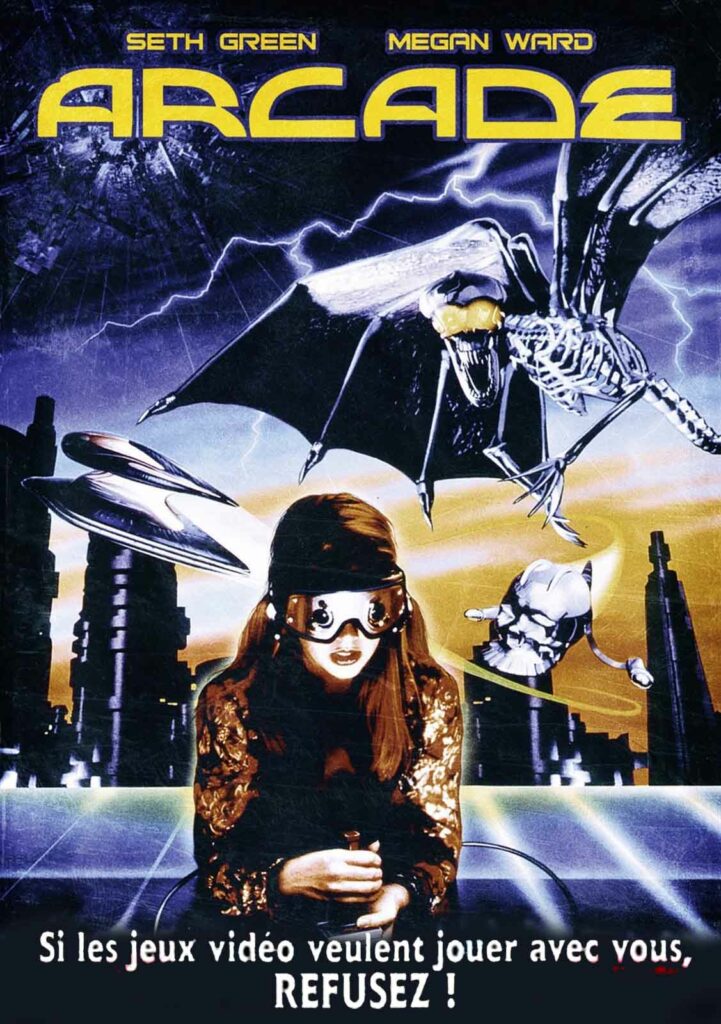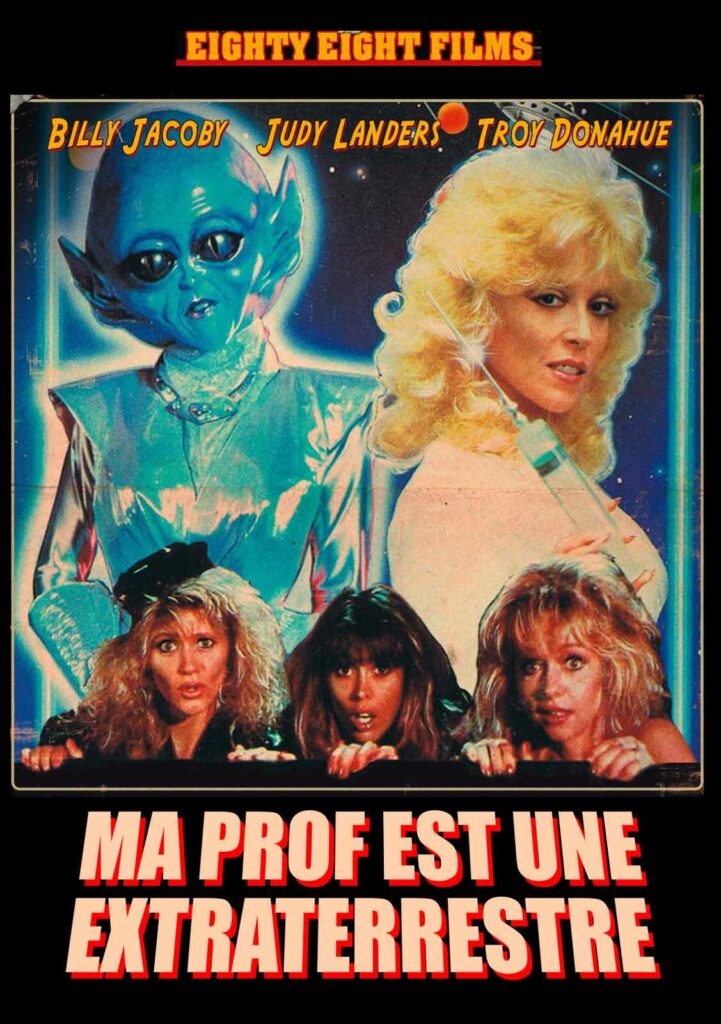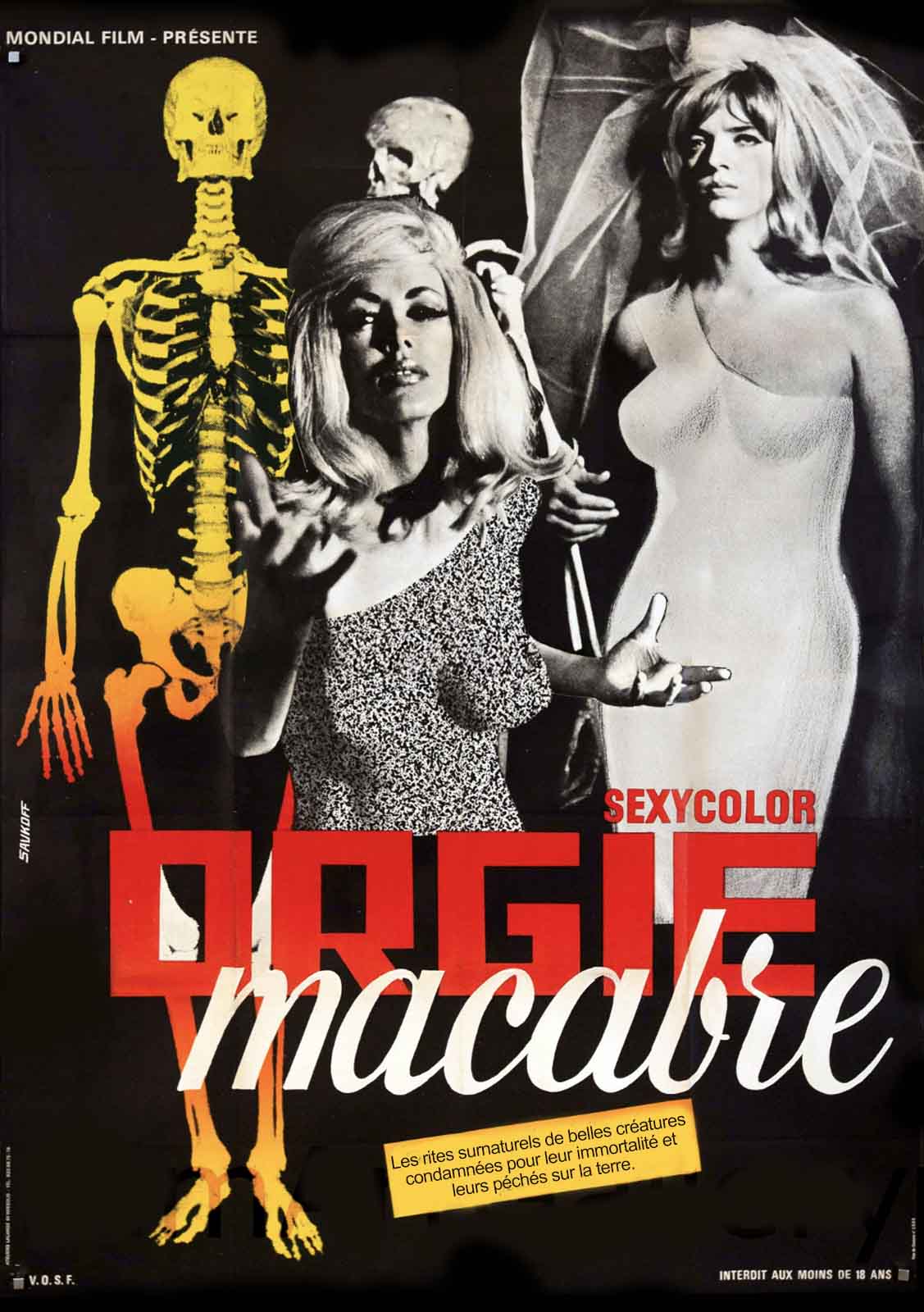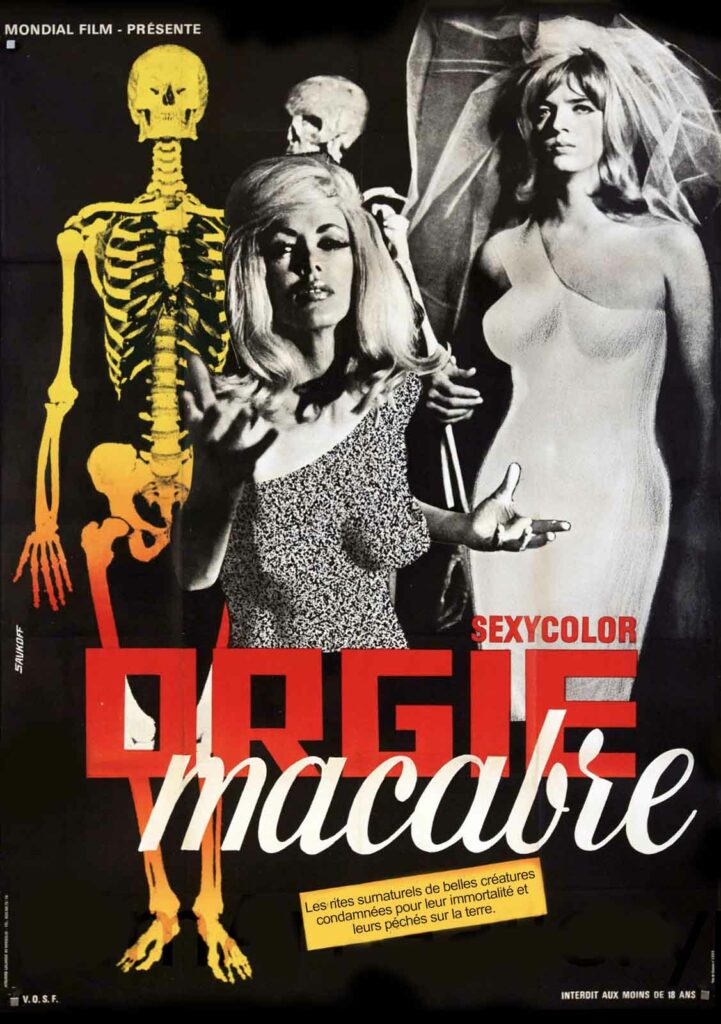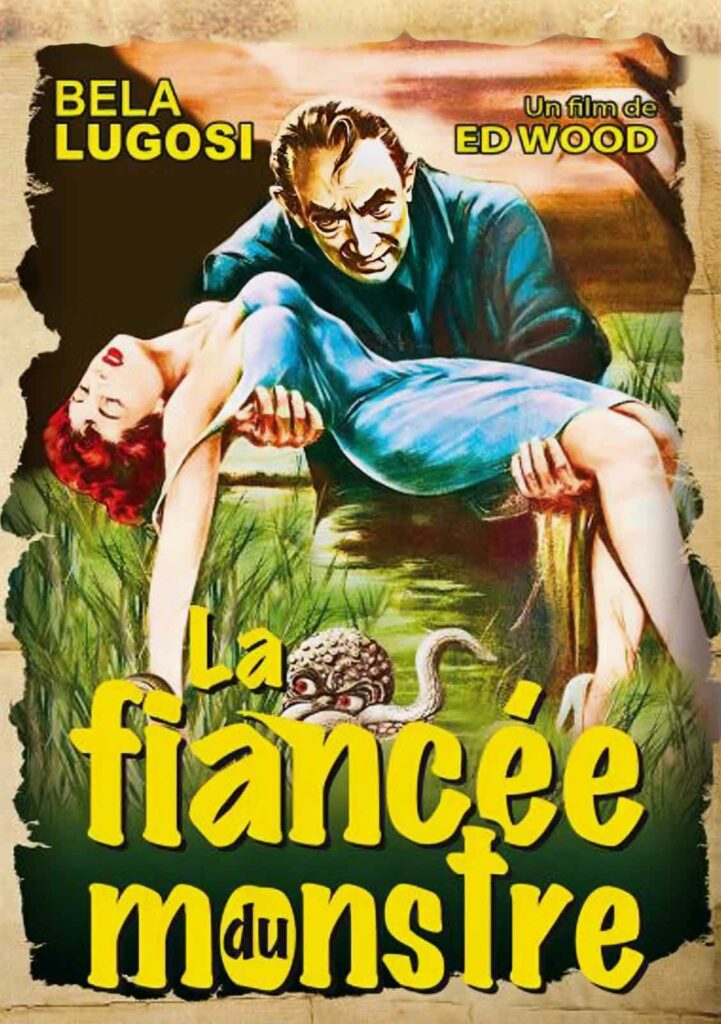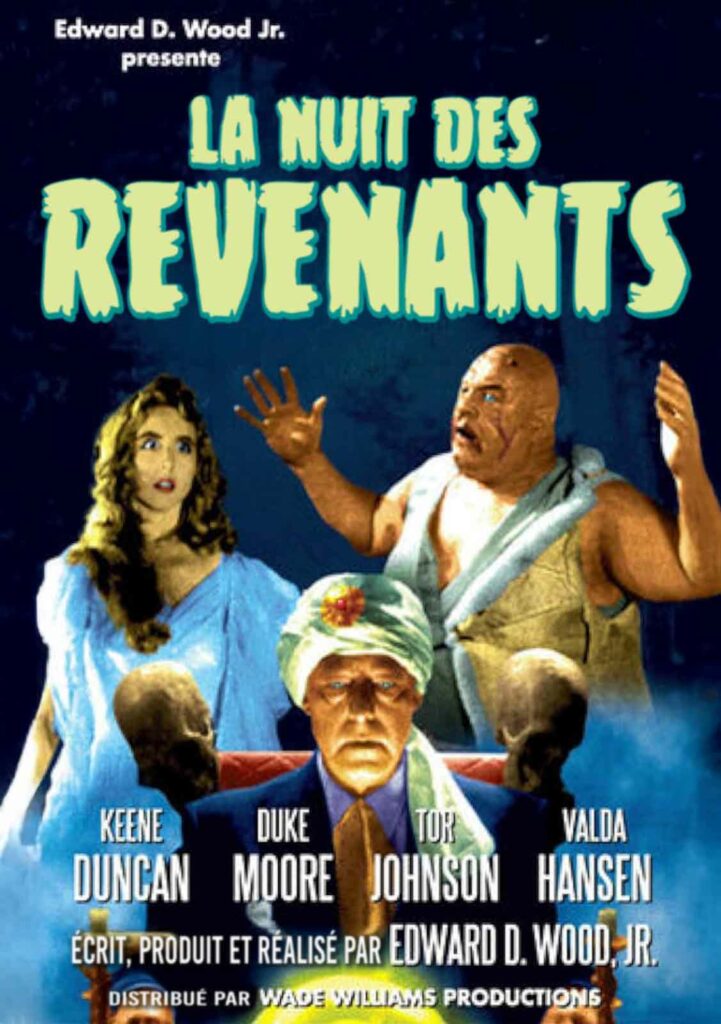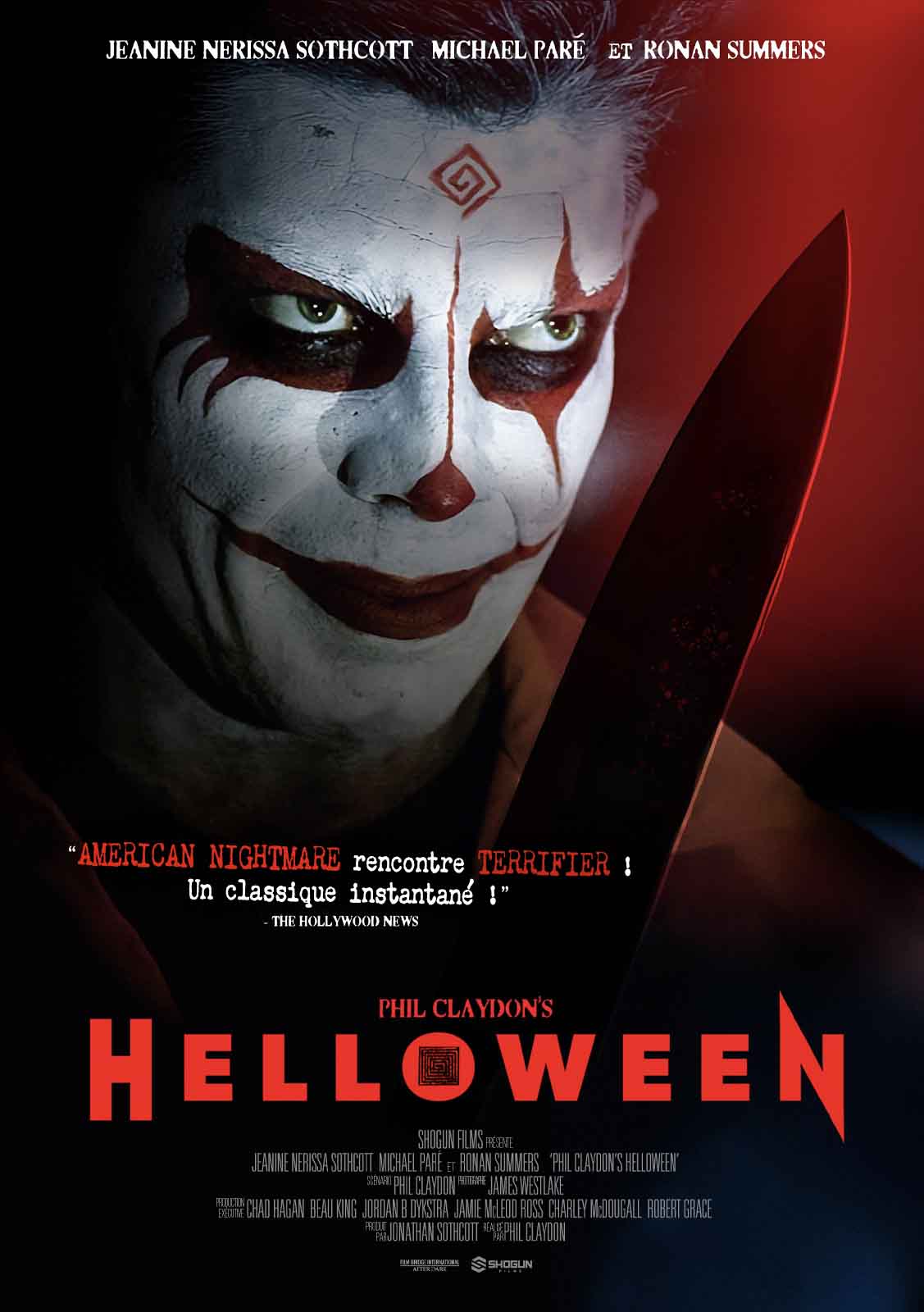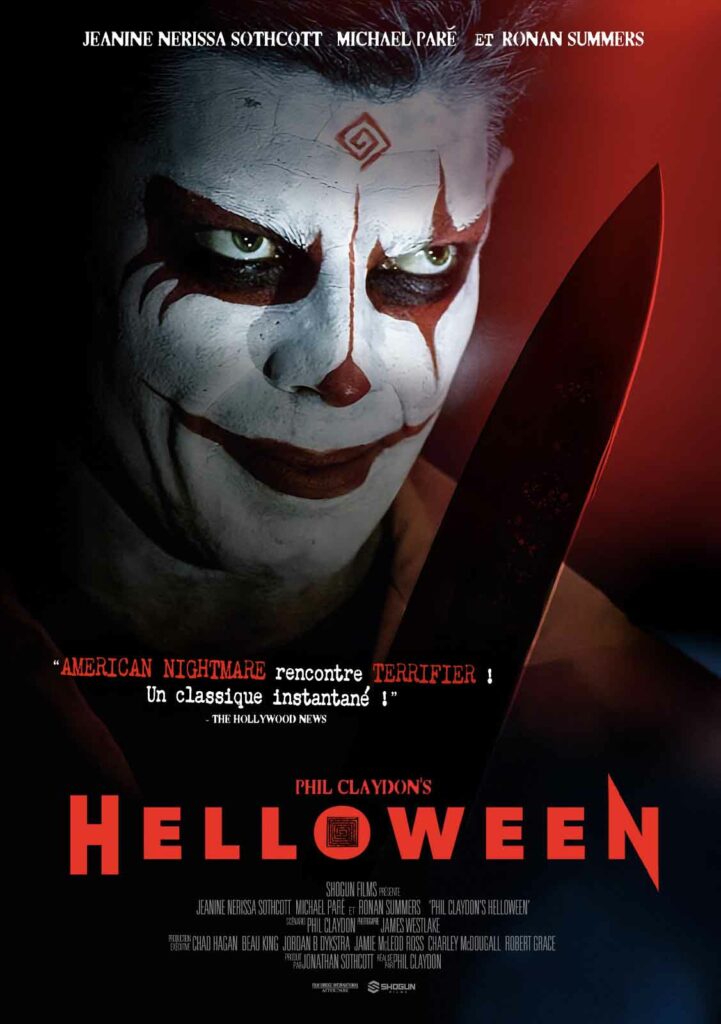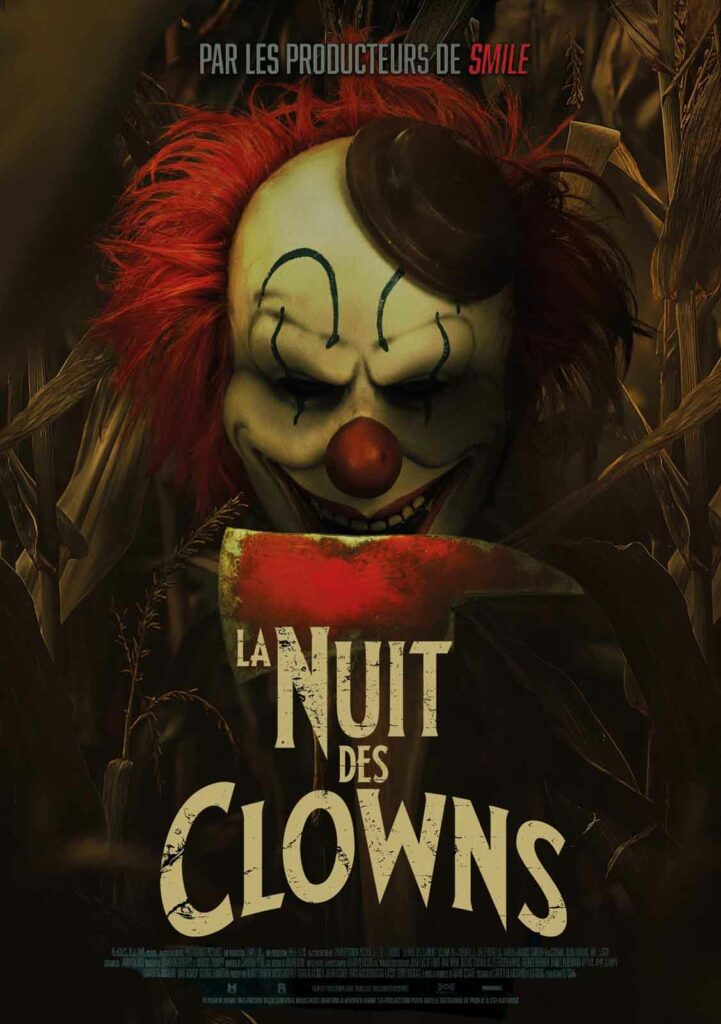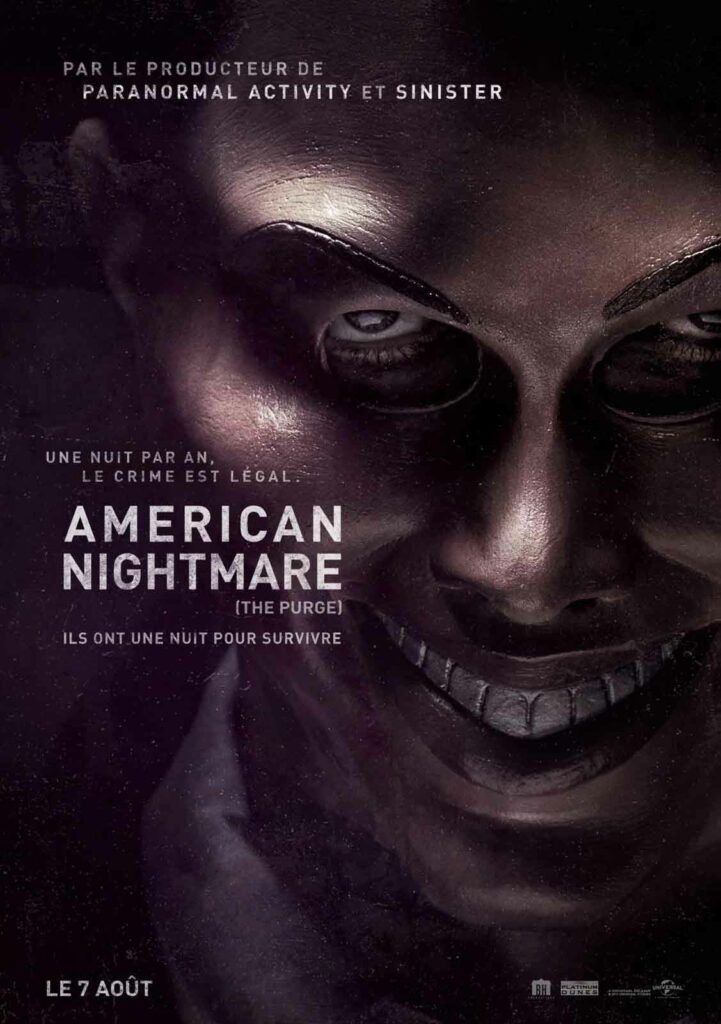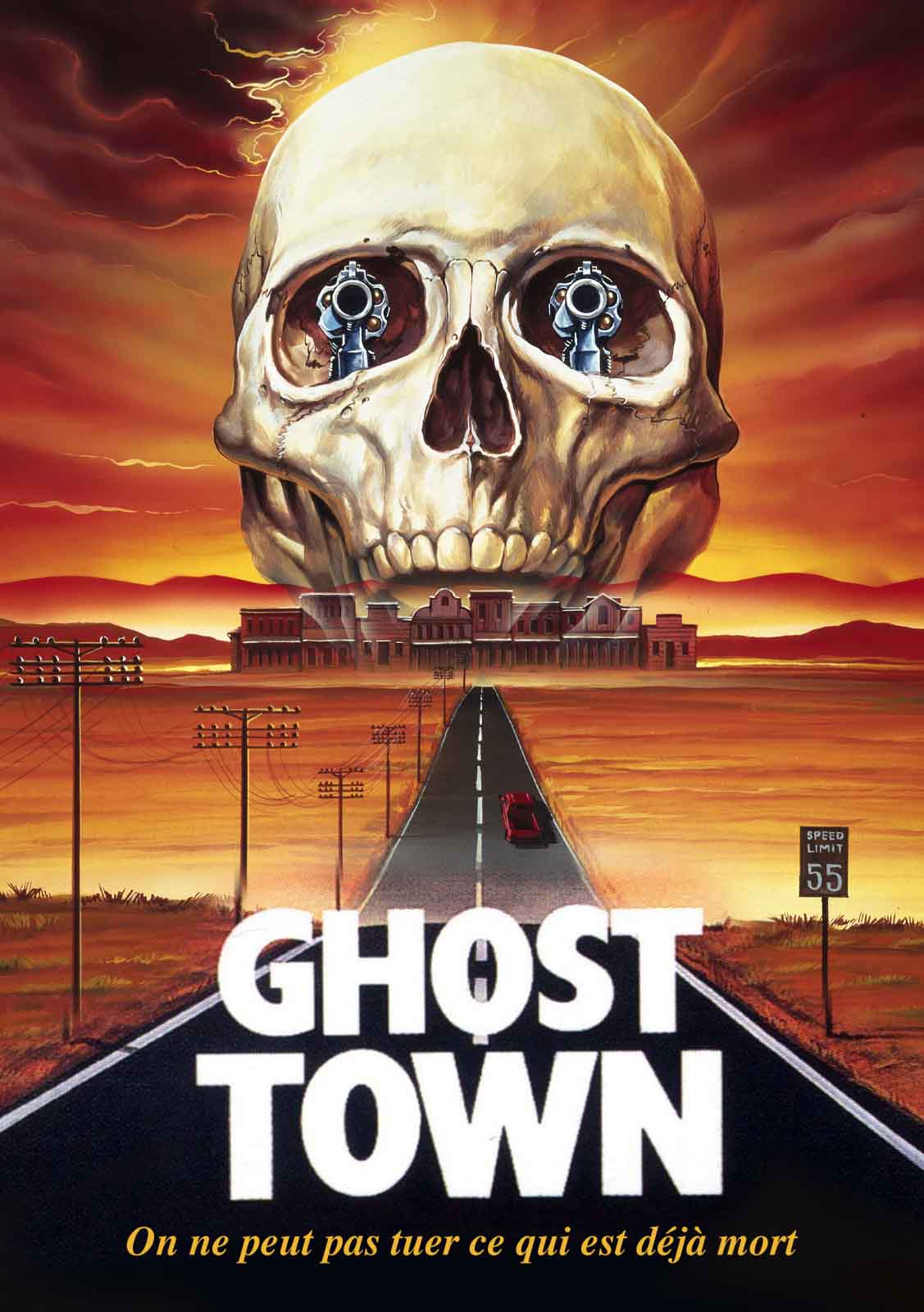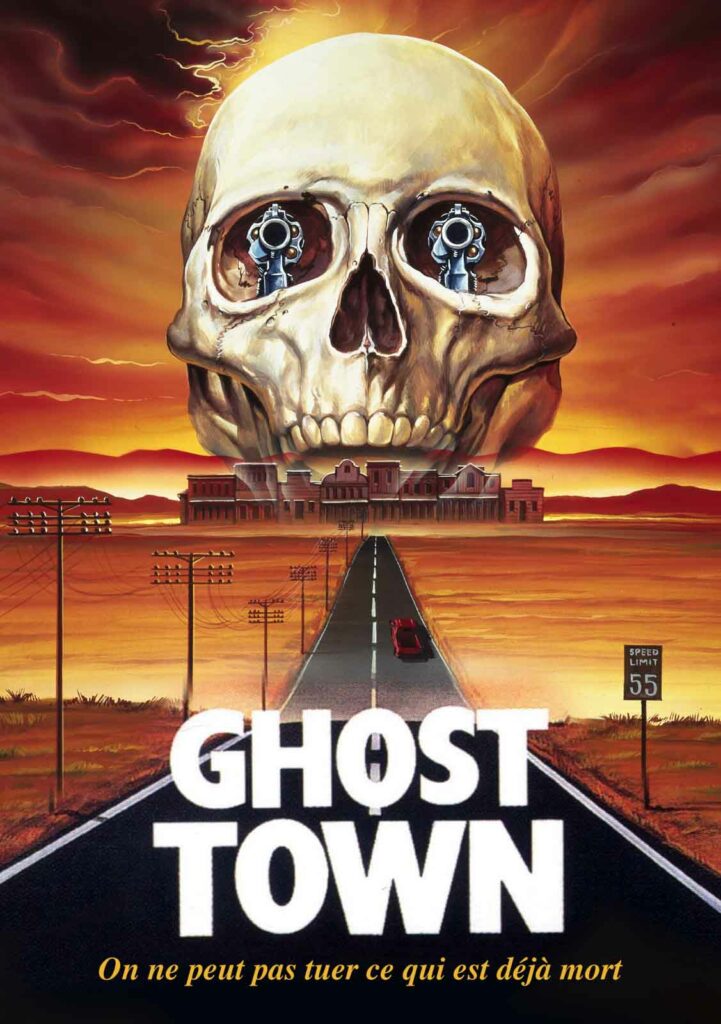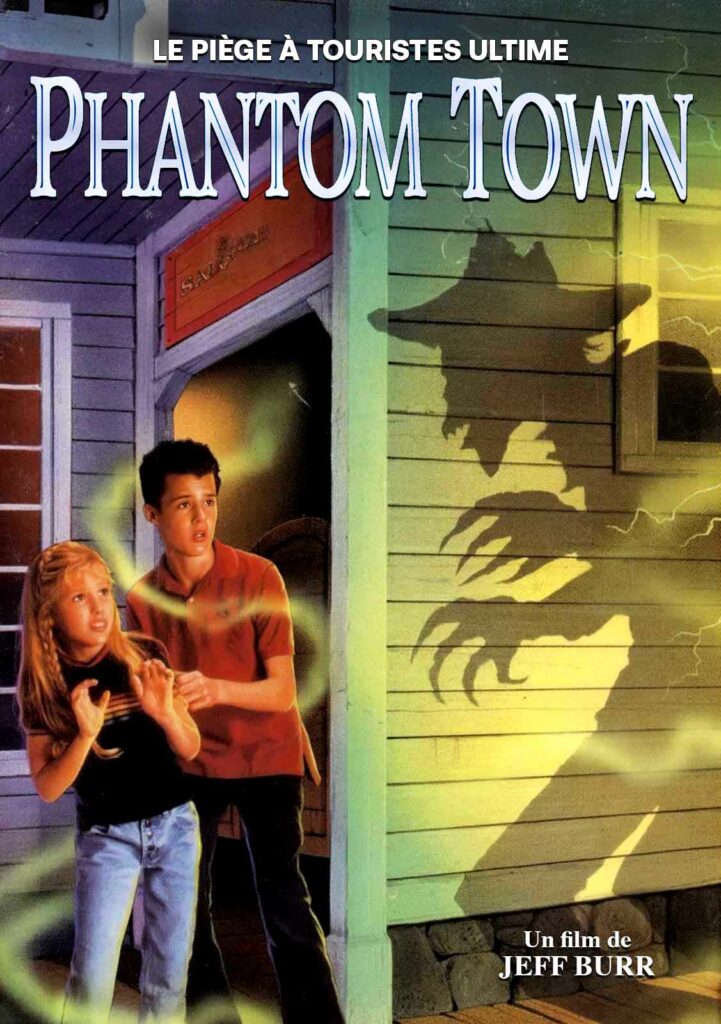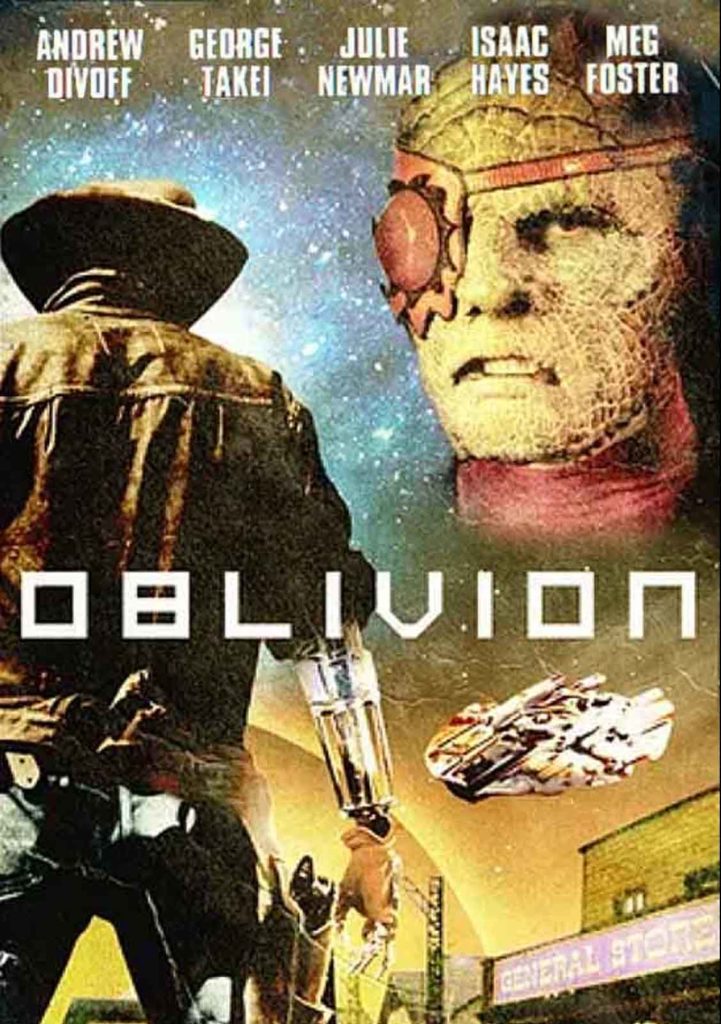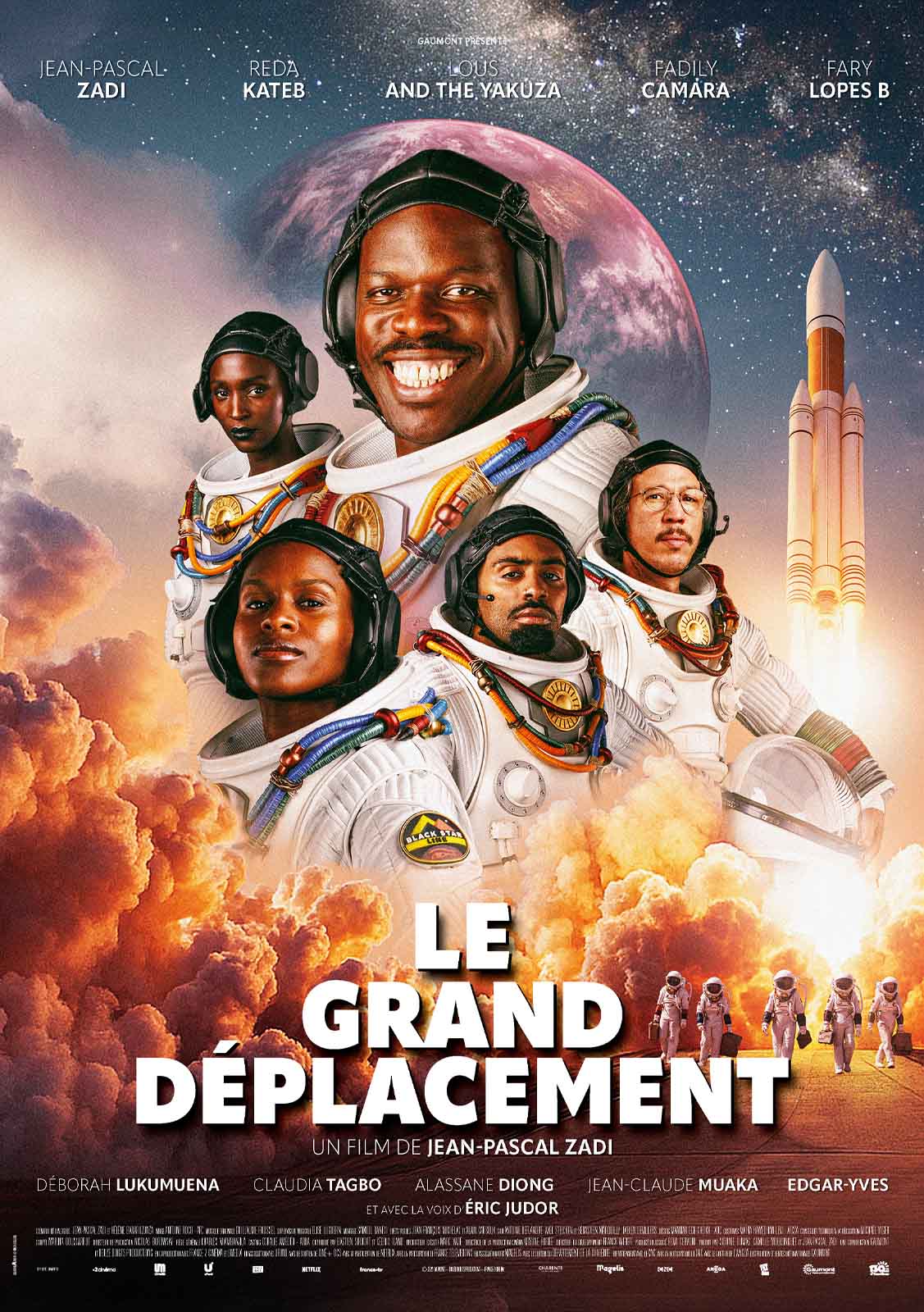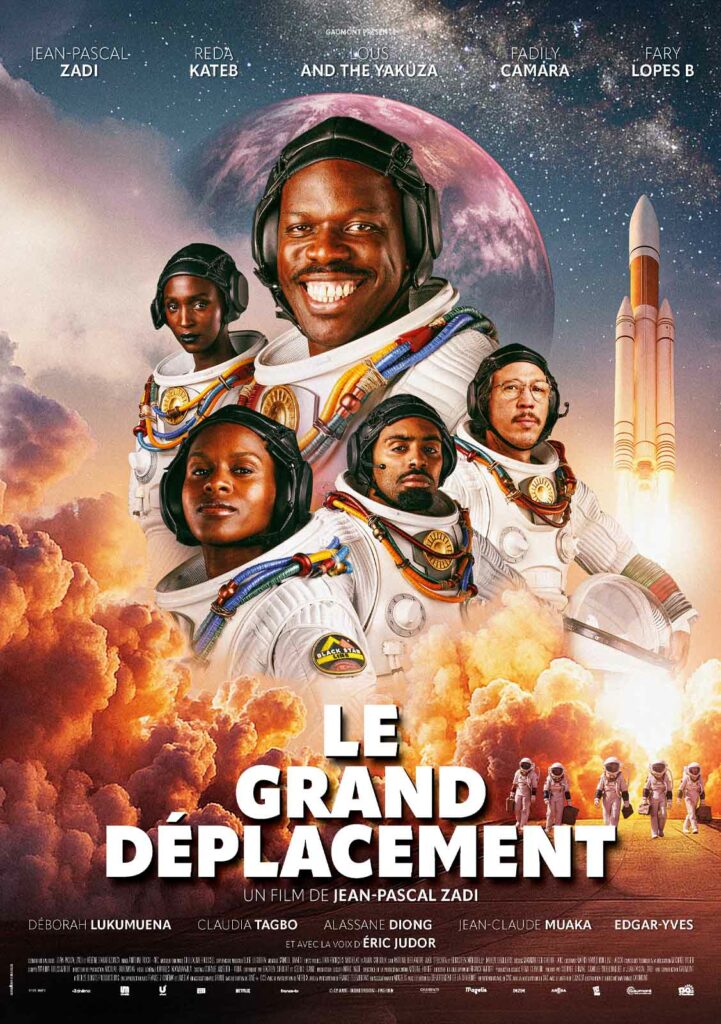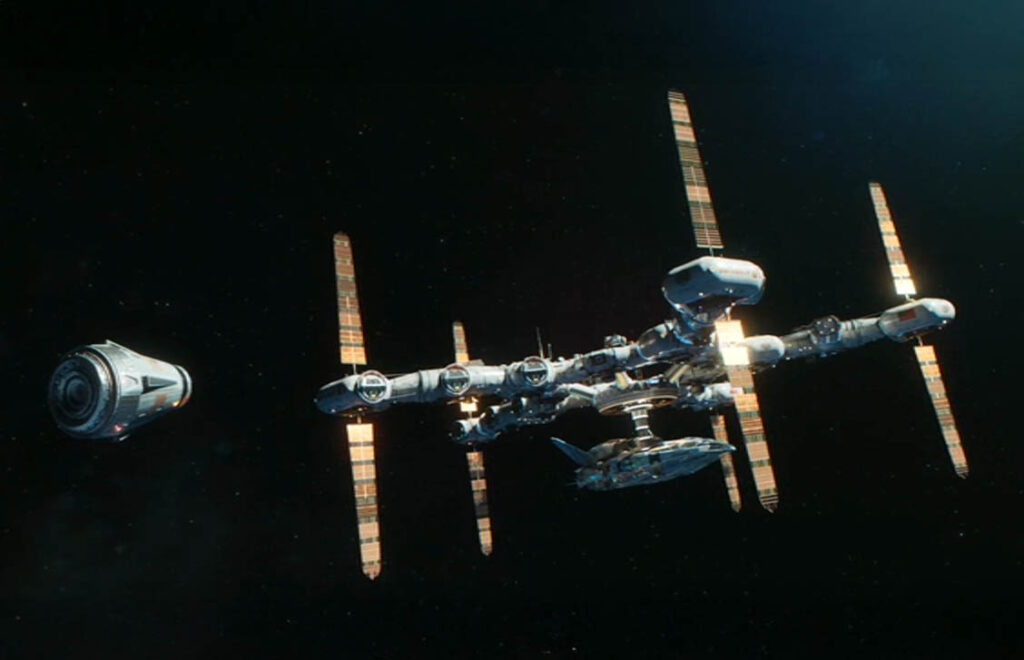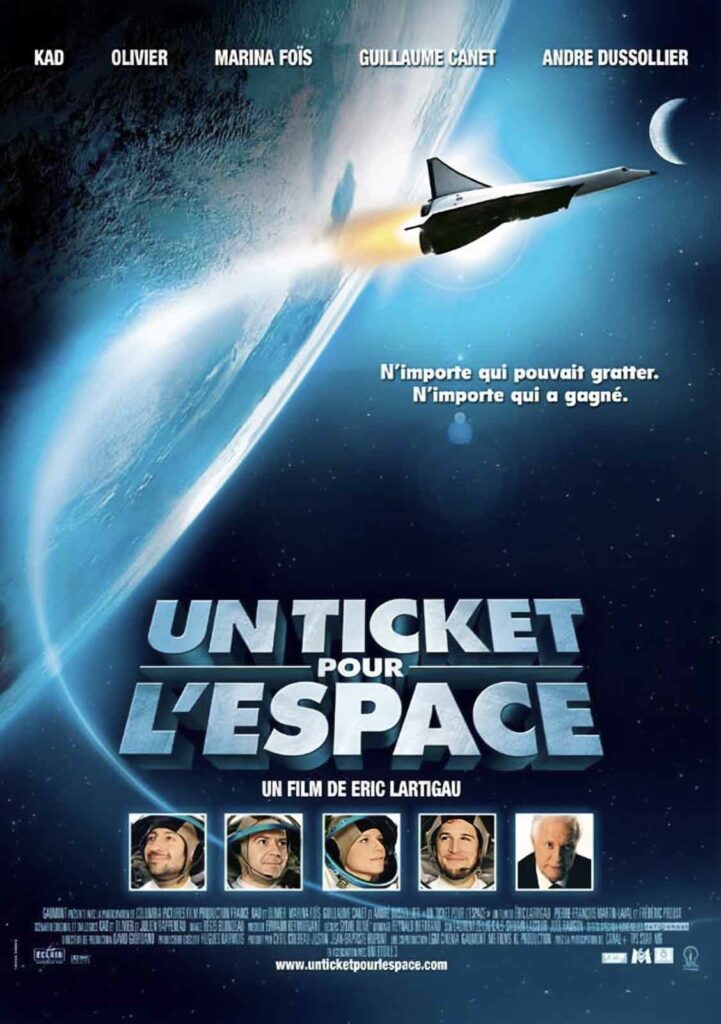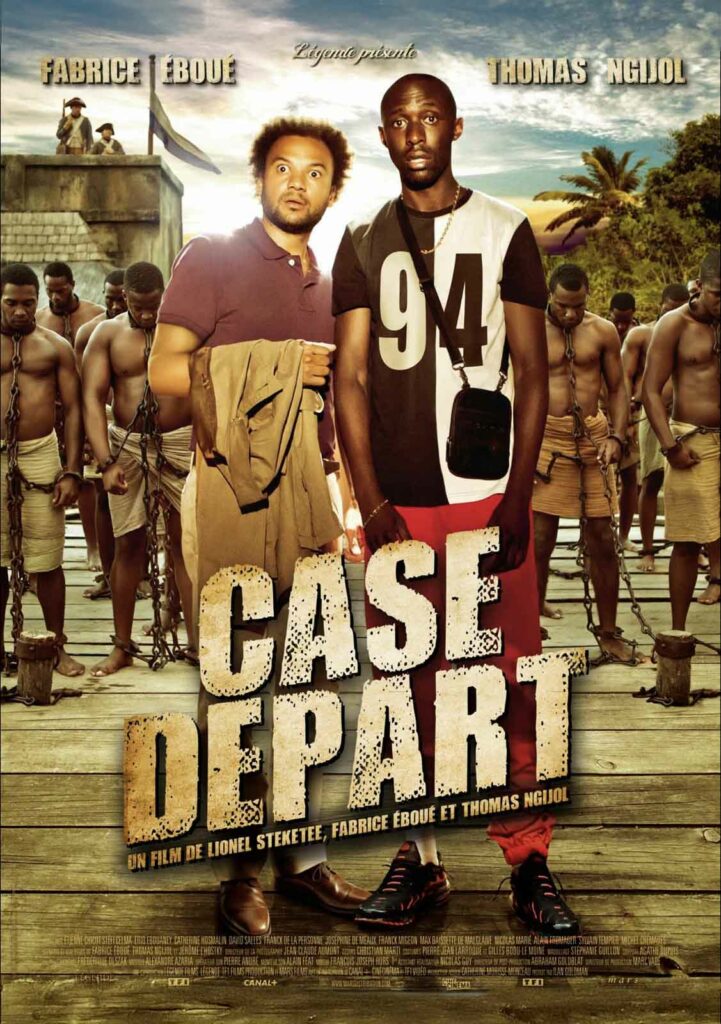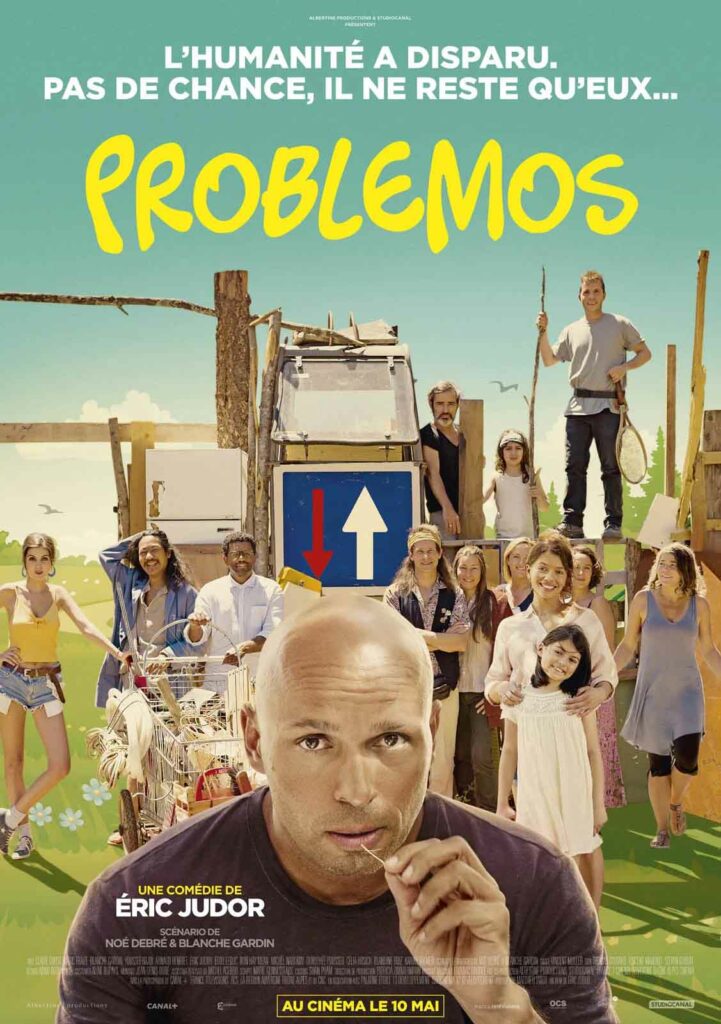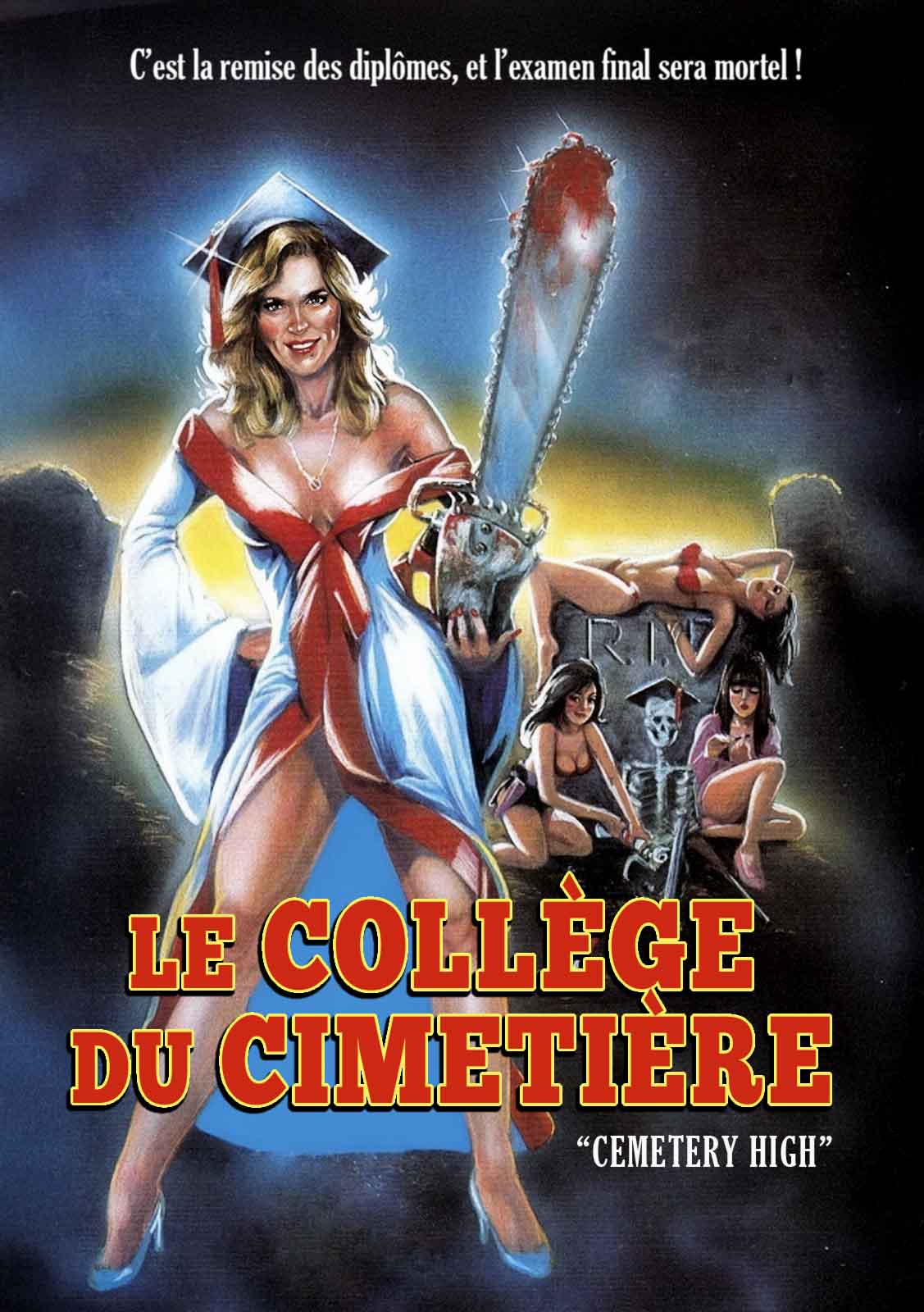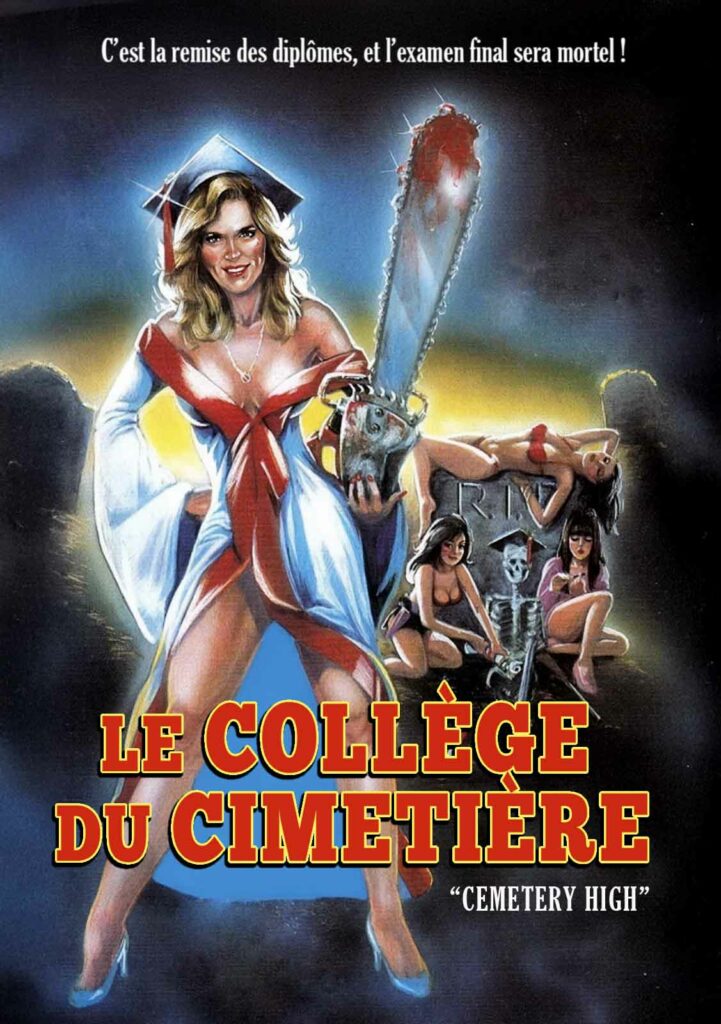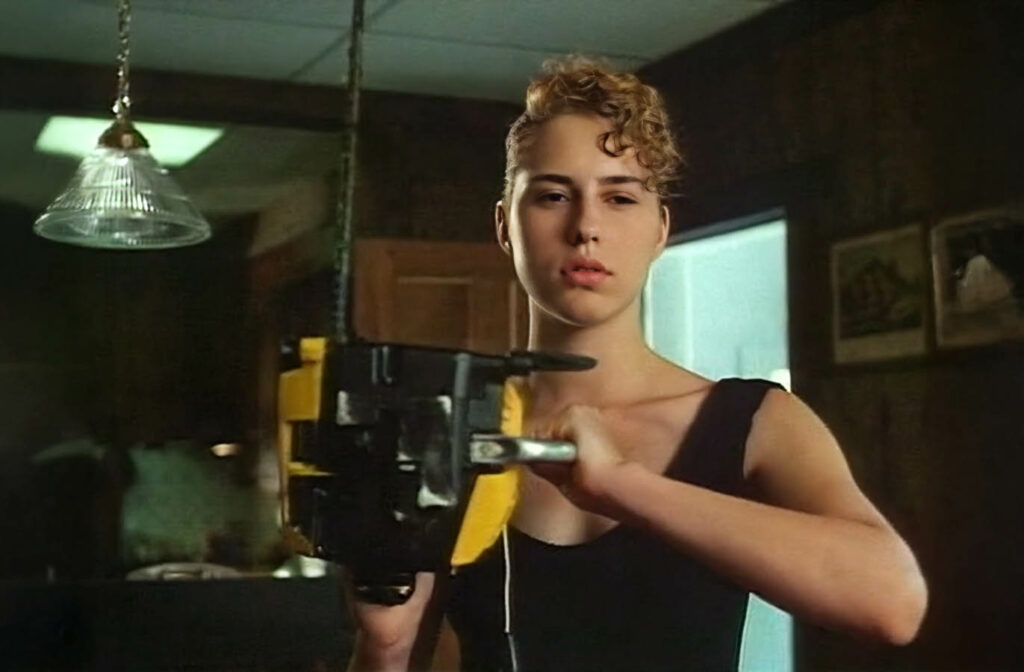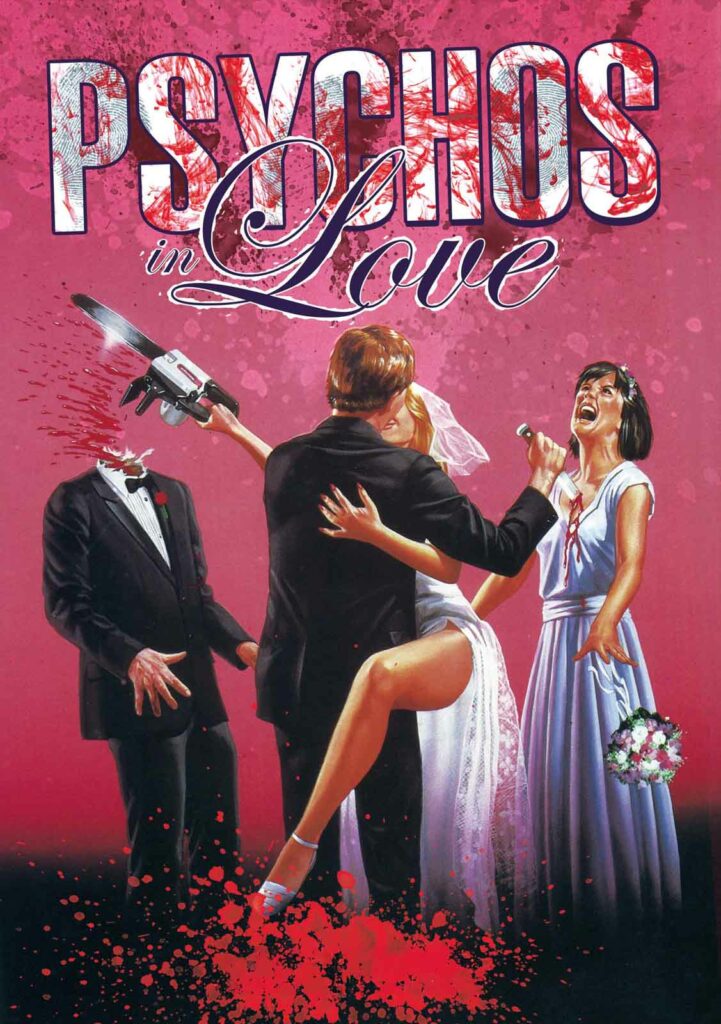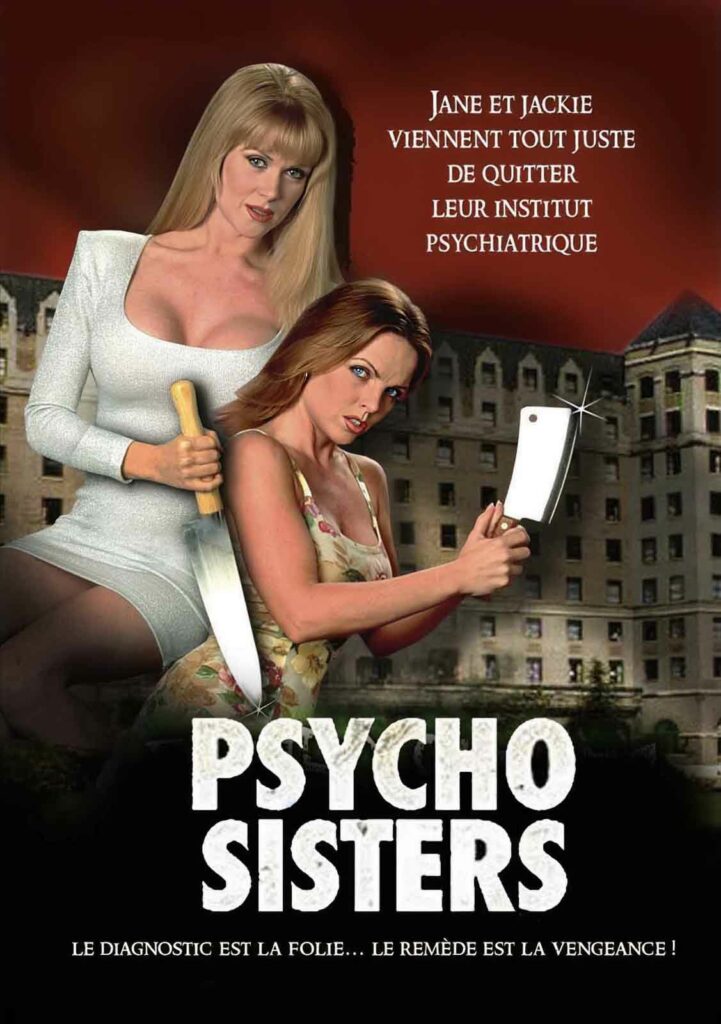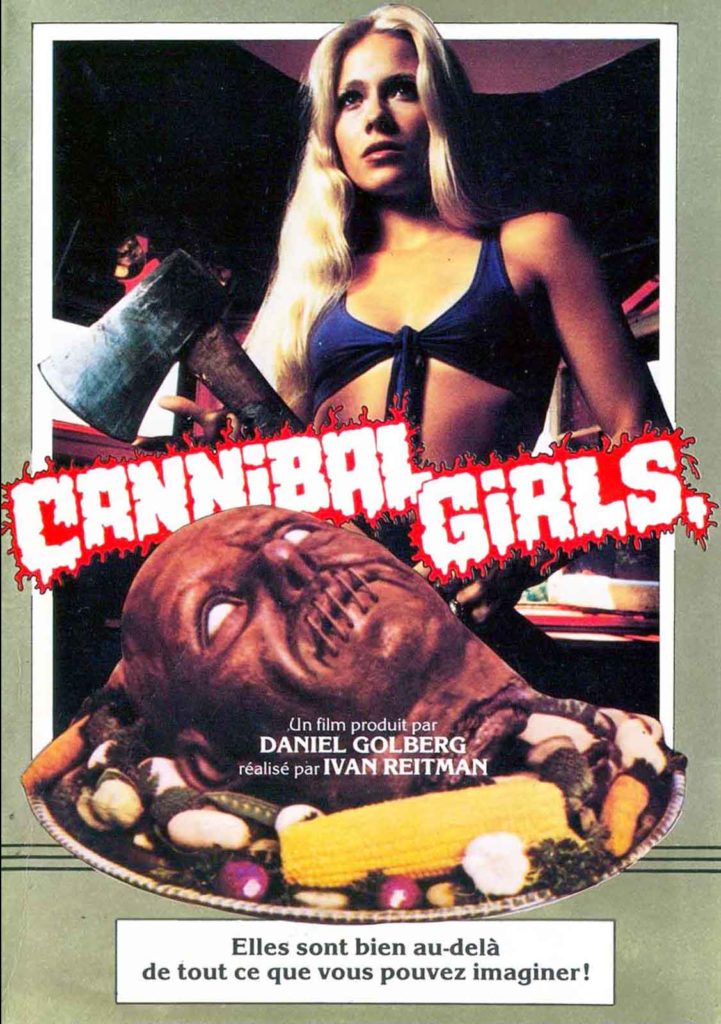Trois lutins et une fée, venus d’une forêt irlandaise, provoquent la zizanie dans une famille américaine pour protéger leur royaume…
LEAPIN’ LEPRECHAUNS !
1995 – USA
Réalisé par Ted Nicolaou
Avec Andrew Smith, John Bluthal, Ray Bright, Jeremy Levine, Mike Higgins, James Ellis, Sylvester McCoy, Godfrey James, Ion Haiduc, Tina Martin, Grant Cramer
THEMA CONTES I NAINS ET GÉANTS I SAGA CHARLES BAND
Les premiers titres de la collection « Moonbeam » initiée par Charles Band ayant bien marché dans les vidéoclubs – Prehysteria, Le Château du petit dragon, Jack et le haricot magique, La Boutique fantastique -, le rythme s’accélère et finit par s’appuyer sur une sorte de « template » scénaristique presque interchangeable. Les Lutins sauteurs repose ainsi sur un principe narratif qui évoque beaucoup Le Château du petit dragon dont il recycle de nombreux ingrédients. Après un premier jet proposé par Ed Naha (Chérie j’ai rétréci les gosses), le scénario des Lutins sauteurs est finalisé par Michael McGann et par le réalisateur Ted Nicolaou (tous deux déjà à l’œuvre sur Le Château du petit dragon, justement), qui seront finalement les seuls auteurs crédités au générique, aux côtés de Charles Band qui se voit attribuer l’idée originale. Comme la grande majorité des productions de Band à l’époque, Les Lutins sauteurs est tourné en Roumanie. La forêt locale figure donc les collines irlandaises (ce qui fonctionne plutôt bien si l’on n’est pas trop regardant) et le décor de rue américaine construit sur le site de la compagnie Castel Film se fait passer pour un quartier du Colorado.


Lorsque le film commence, un groupe de touristes américains, accompagné de leurs enfants, débarque en Irlande pour un séjour pittoresque. Sur place, ils sont accueillis par Michael Dennehy (John Bluthal), propriétaire d’un vaste domaine médiéval, qui leur fait découvrir les lieux tout en évoquant les vieilles légendes celtiques. Ce que personne ne soupçonne, c’est que les fameux leprechauns dont il parle existent bel et bien : ils vivent dissimulés sous une pierre ancestrale – le « portique royal » – nichée au cœur de la « colline enchantée ». Une fois les visiteurs repartis, trois de ces petites créatures sortent de leur cachette et rendent visite à Michael. Leur roi, Kevin (Godfrey James), apprend que le fils de leur ami humain, John (Grant Cramer), installé aux États-Unis, projette de transformer le terrain familial en parc d’attractions baptisé « Ireland Land ». Inquiet pour son royaume secret, Kevin décide d’accompagner Michael en Amérique, flanqué de deux joyeux compagnons, Patrick (James Ellis) et Flynn (Sylvester McCoy). Malgré leurs protestations, la reine des fées (Tina Martin) choisit de se joindre elle aussi au voyage. Mais le redoutable Finvarra et son armée des ombres ont vent du projet eux aussi.
Les facéties du « petit peuple »
Les Lutins sauteurs est une fable classique sur l’opposition entre l’imagination enfantine et le cartésianisme cynique. Les confrontations entre ce vieil homme fantasque et son fils terre-à-terre enfoncent donc gentiment les portes ouvertes et manquent un peu de sel, même si John Bluthal livre ici une prestation à la fois exubérante et émouvante. S’ils versent volontiers dans la caricature, les membres du « petit peuple » sont bien sûr les éléments les plus attractifs du film : des leprechauns tour à tour grognons et farceurs, adeptes de blagues à base de déplacements d’objets à distance, ainsi qu’une fée volubile à la tête d’une petite troupe de charmantes créatures en tutu et ballerines. Supervisés par le vétéran Jim Aupperle (The Thing, Robocop 2), les effets visuels sont très soignés malgré les contraintes budgétaires inhérentes aux productions Full Moon. Quelques plans composites, des éléments de décor surdimensionnés, des perspectives forcées et une poignée de marionnettes miniatures permettent d’amusantes interactions entre les humains et les êtres féeriques. Le climax, lui, plonge dans une certaine noirceur avec l’apparition du sinistre Finvarra, aux allures de faucheuse à tête de mort. Pas franchement inoubliable mais épisodiquement drôle (la scène du dîner avec le couple de psychiatres est l’un des moments savoureux du film), Les Lutins sauteurs aura droit à une suite tournée dans la foulée et distribuée l’année suivante.
© Gilles Penso
À découvrir dans le même genre…
Partagez cet article