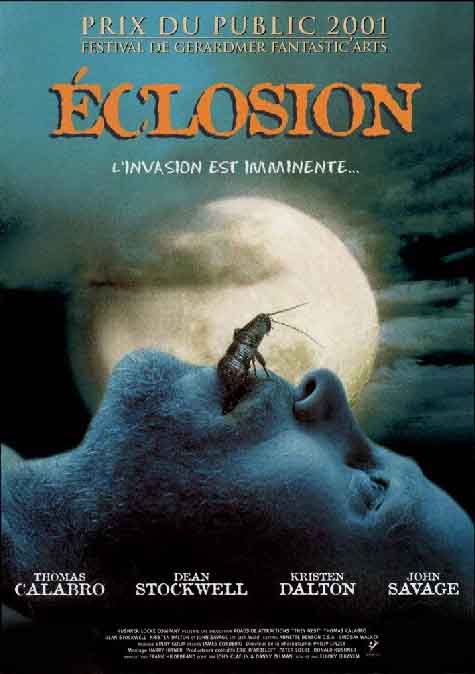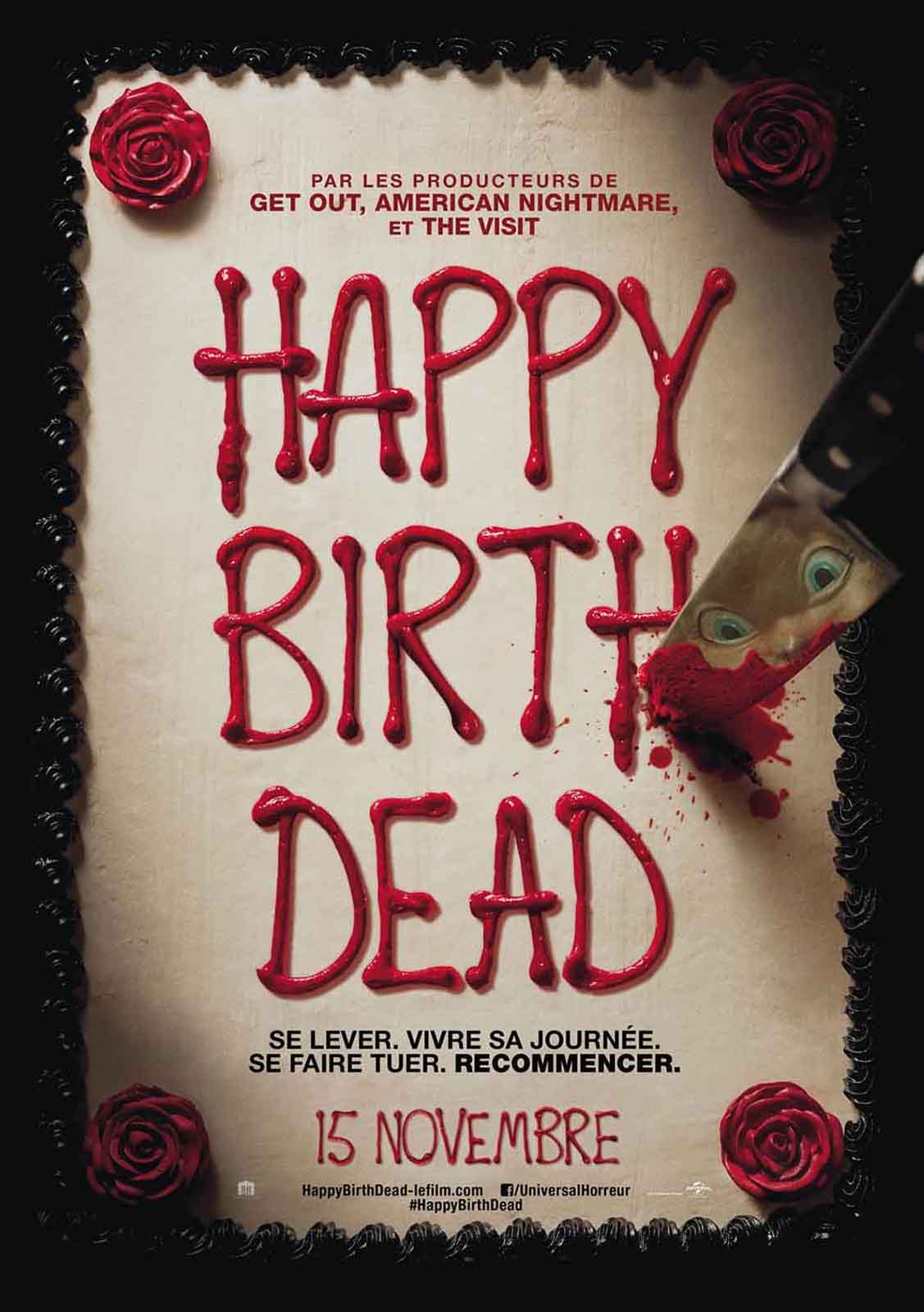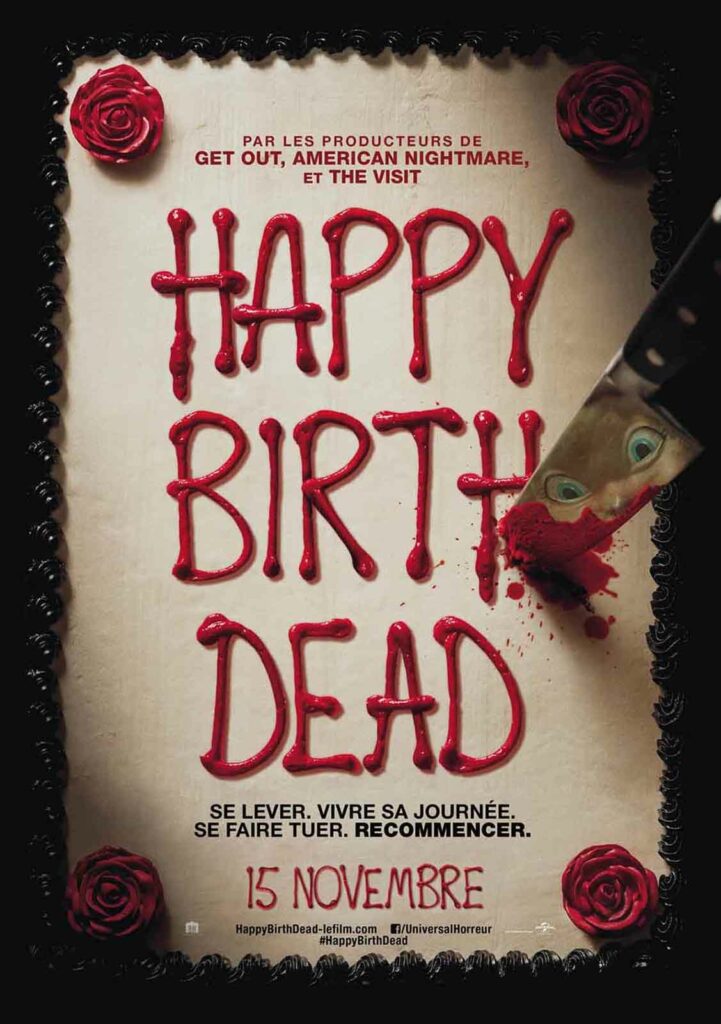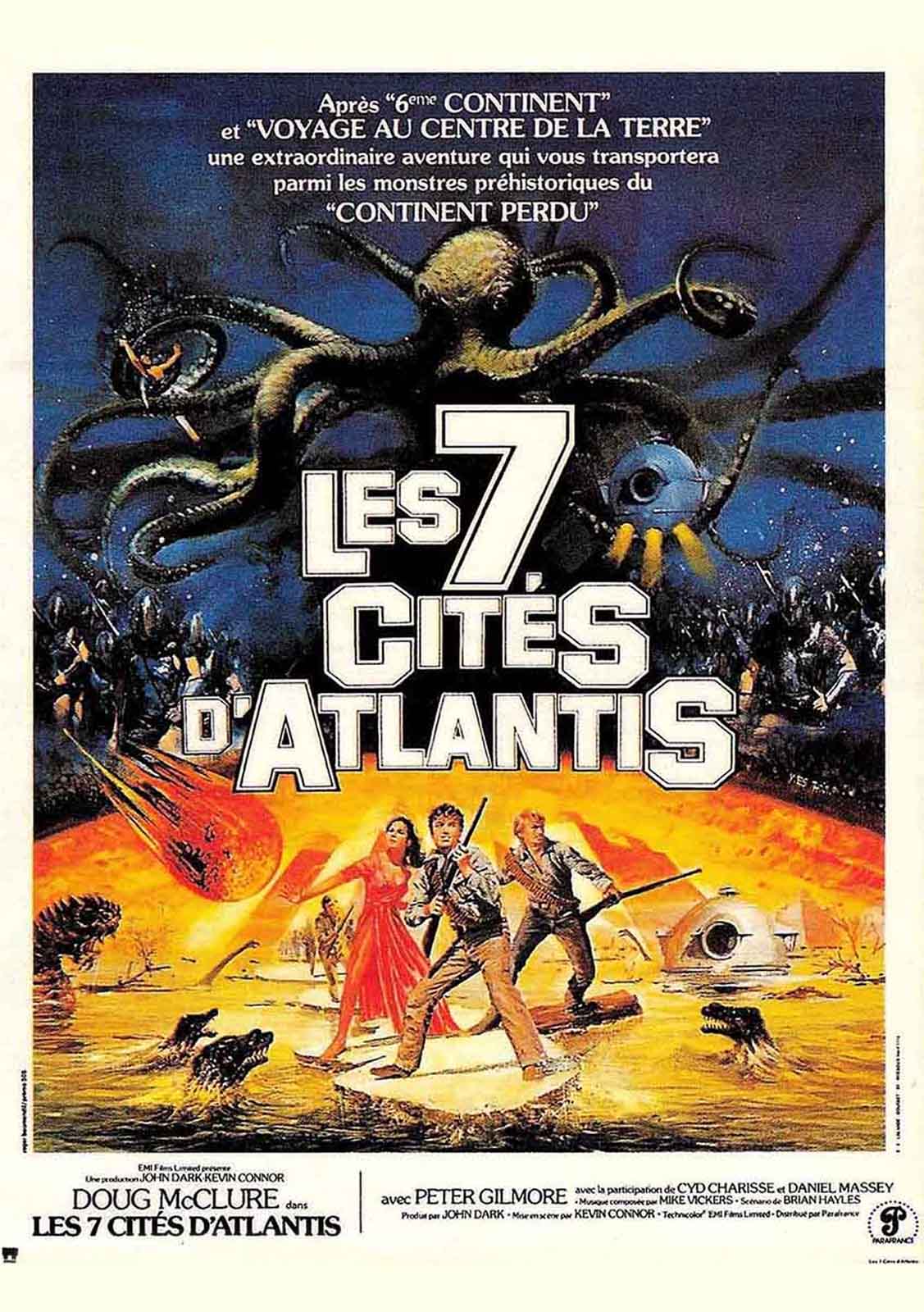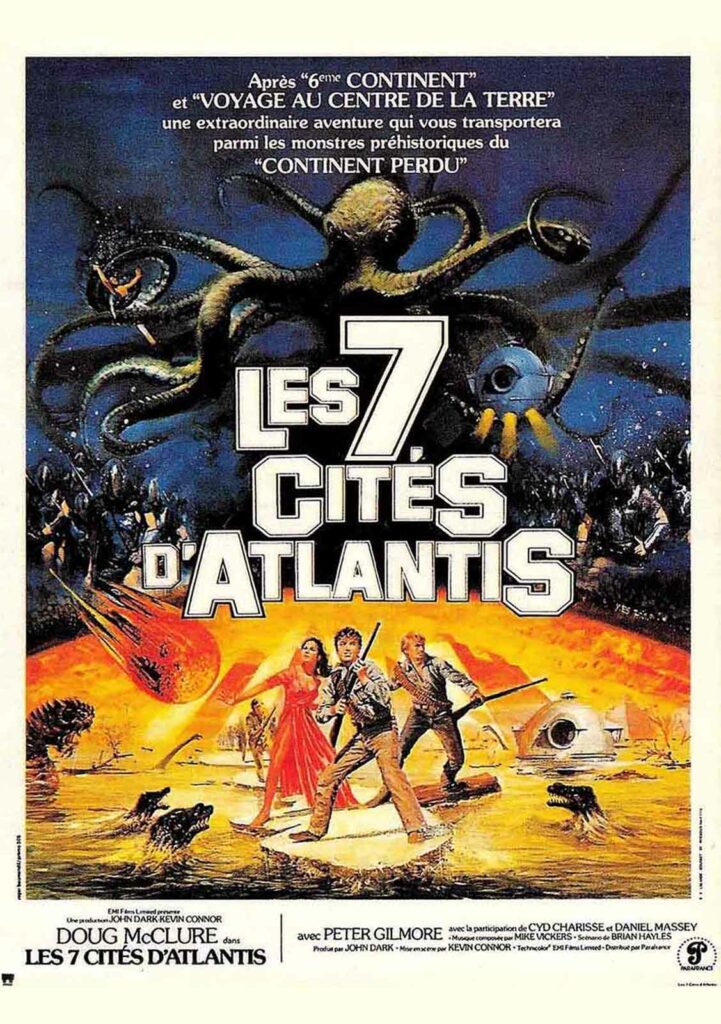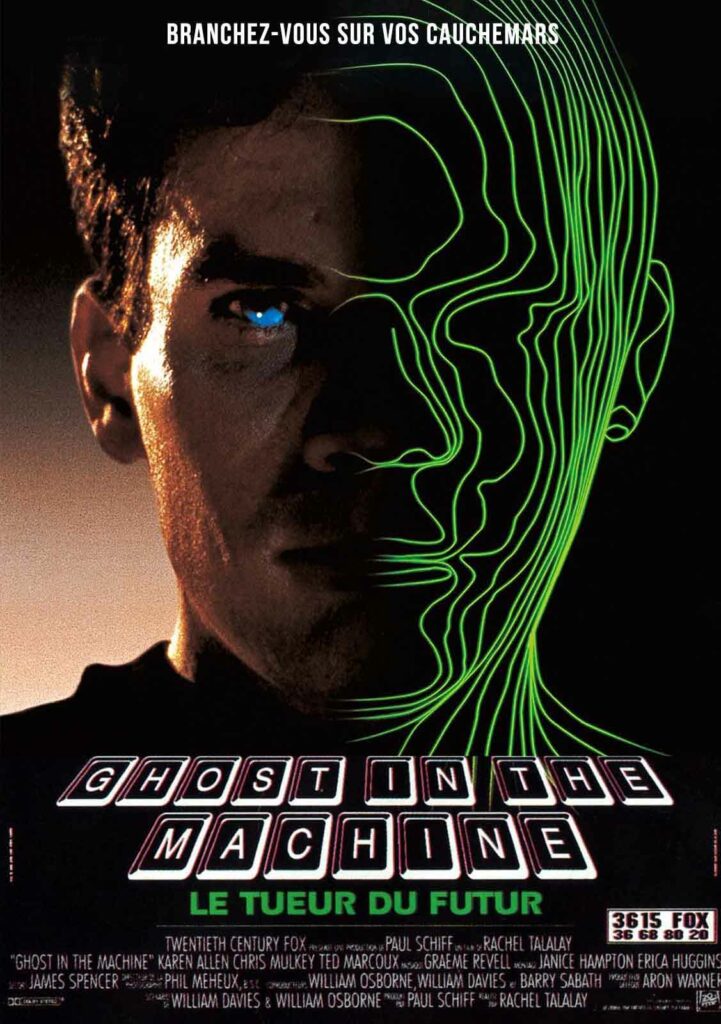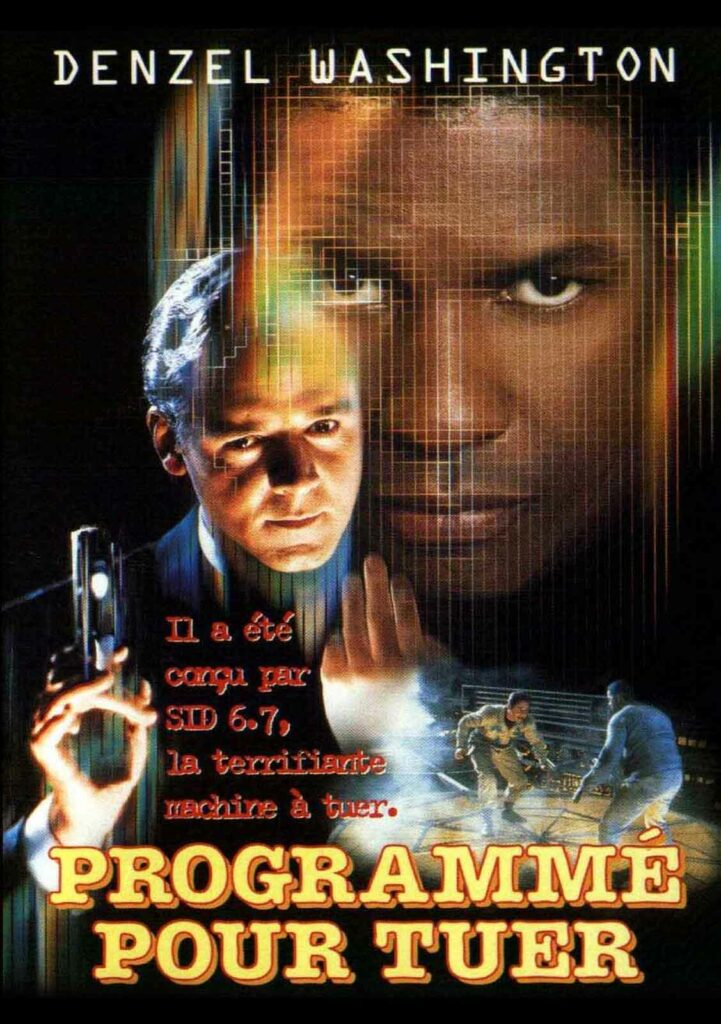M. Night Shyamalan filme les mésaventures d’une nymphe aquatique égarée dans un immeuble résidentiel où rôde une bête féroce surnaturelle…
LADY IN THE WATER
2006 – USA
Réalisé par M. Night Shyamalan
Avec Paul Giamatti, Bryce Dallas Howard, Jeffrey Wright, M. Night Shyamalan, Sarita Choudhury, Freddy Rodriguez, Bob Balaban
THEMA CONTES I SAGA M. NIGHT SHYAMALAN
Si Le Village était un récit noir et désabusé, La Jeune fille de l’eau ramène M. Night Shyamalan sur un terrain plus enfantin et plus optimiste. Pour rédiger son scénario, le cinéaste s’inspire d’ailleurs d’un conte qu’il avait imaginé pour ses propres enfants. Peu convaincus, les studios Disney, pourtant « mariés » avec Shyamalan depuis Sixième sens, ne se lancent pas dans l’aventure. Pour concrétiser ce film qui, visiblement, lui tient particulièrement à cœur, le réalisateur d’Incassable dénonce donc son contrat avec la compagnie aux grandes oreilles et confie La Jeune fille de l’eau à un studio concurrent, en l’occurrence Warner Bros. Paul Giamatti tient le haut de l’affiche dans le rôle de Cleveland Heep, modeste gardien d’un vieil immeuble résidentiel qui s’efforce d’oublier le drame qui frappa jadis sa famille en s’astreignant à des tâches quotidiennes et monotones. Une nuit, la routine est brisée par la présence d’une jeune fille dans la piscine de la résidence. En cherchant à l’atteindre, Cleveland manque de se noyer et c’est elle qui le sauve. D’une étrange pâleur, la demoiselle, qui répond au nom de Story, prétend être une « Narf », autrement dit une nymphe des eaux. Sa mission consiste à trouver un écrivain dans la résidence avant que le « Scrunt », une bête féroce dont le pelage vert se confond avec la végétation, ne s’en prenne à elle. Le récit semble incohérent et absurde, mais Cleveland a très envie d’y croire et de prêter main forte à la mystérieuse jeune fille de l’eau…


La beauté envoûtante de Bryce Dallas Howard (qui jouait déjà dans Le Village) se prête à merveille à ce personnage mythique. Shyamalan, visiblement sous le charme, la filme amoureusement, attardant sa caméra sur son regard mélancolique, sa peau nacrée et ses longues jambes de nymphe. Ironiquement, le père de la comédienne mit lui-même en scène une inoubliable « jeune fille de l’eau » deux décennies plus tôt dans Splash. Le casting de La Jeune fille de l’eau s’avère pertinent jusqu’aux personnages secondaires et le réalisateur lui-même, dans un rôle plus étoffé qu’à l’accoutumée, joue avec justesse et retenue. Mais le film souffre de l’extrême légèreté de son scénario. Sans compter cette incroyable paresse narrative consistant à mettre en scène une vieille locataire chinoise qui, comme par hasard, connaît la légende des « Narfs » sur le bout des doigts et nous en livre tous les tenants et aboutissants. N’eut-il pas été plus intéressant que Cleveland soit obligé de tout comprendre au fur et à mesure ?
La semence du changement
L’idée d’une muse préparant la « semence du changement » auprès des hommes, par le truchement d’un écrivain dont le roman sera lu par un petit garçon appelé à devenir un des dirigeants du pays dans le futur, était pourtant très belle. « Pour moi, le Fantastique est le meilleur moyen d’aborder des sujets liés à la spiritualité d’une manière qui ne soit pas trop frontale, trop directe », nous explique le cinéaste. « Ça permet de traiter ces thèmes en se déconnectant de la religion. On peut parler de la foi sans pour autant aborder les croyances “traditionnelles“. Dans mes films, il ne s’agit pas de croire à Dieu, au diable ou aux anges, mais aux extra-terrestres, aux fantômes ou aux créatures. Ce qui revient au même, finalement. La foi est un sujet fascinant. Sommes-nous capables de croire à des choses que nous ne pouvons pas prouver ? C’est une question qui m’intéresse, et le Fantastique est un vecteur idéal pour tenter d’y répondre. » (1) Les intentions sont assez limpides mais l’effet escompté n’est pas atteint, tout comme les tentatives d’humour qui tombent souvent à plat (par exemple lorsque le critique de cinéma, face au « Scrunt », analyse ce qui se passerait normalement dans un film d’horreur). Nous sommes les premiers à vouloir défendre un film dénonçant le cynisme et plaidant pour la quête du regard d’enfant perdu. Mais lorsque la démonstration est trop appuyée et les effets trop grossiers, comme c’est ici le cas, l’adhésion du spectateur est loin d’être garantie.
(1) Propos recueillis par votre serviteur en septembre 2015
© Gilles Penso
Partagez cet article