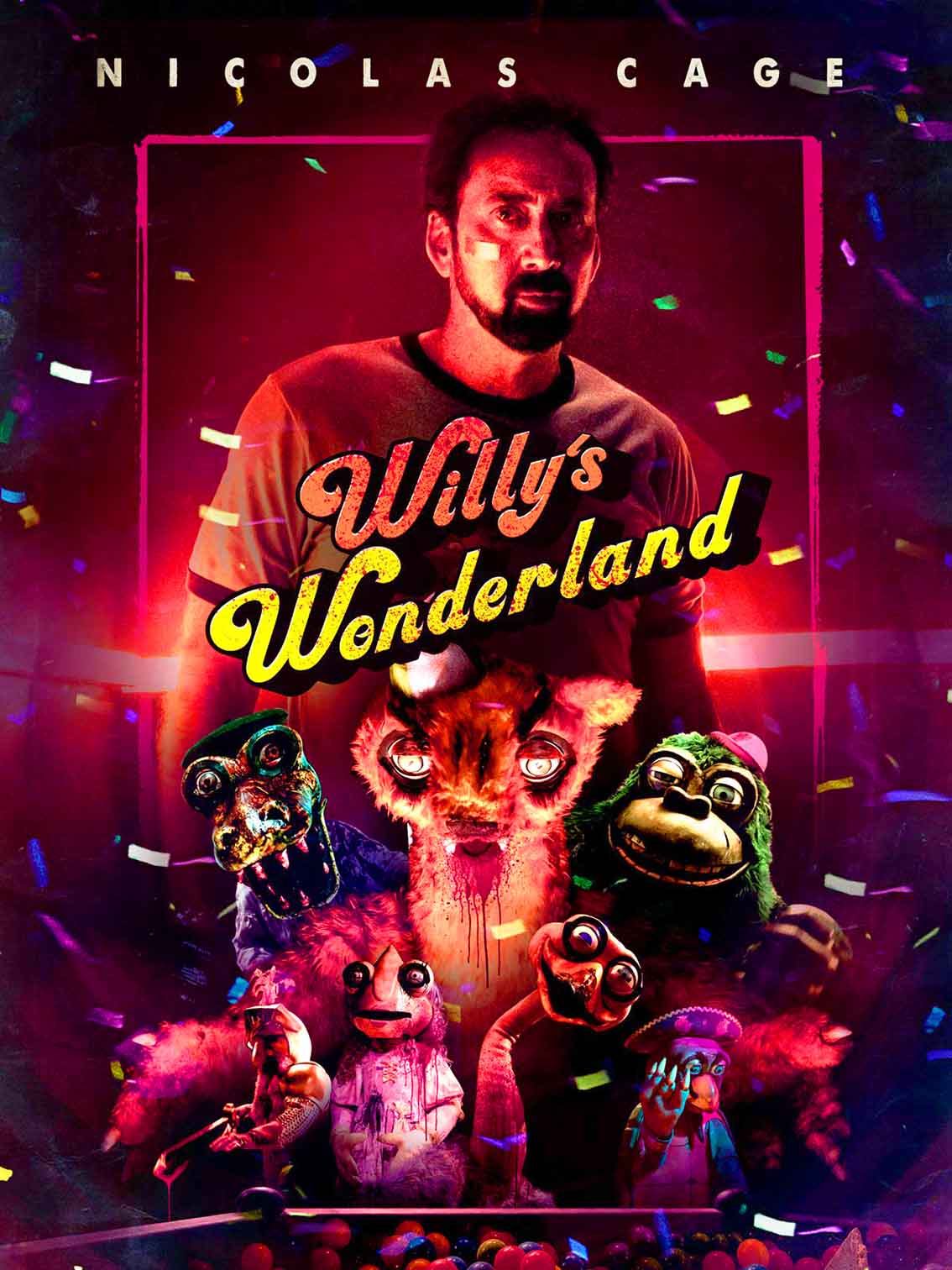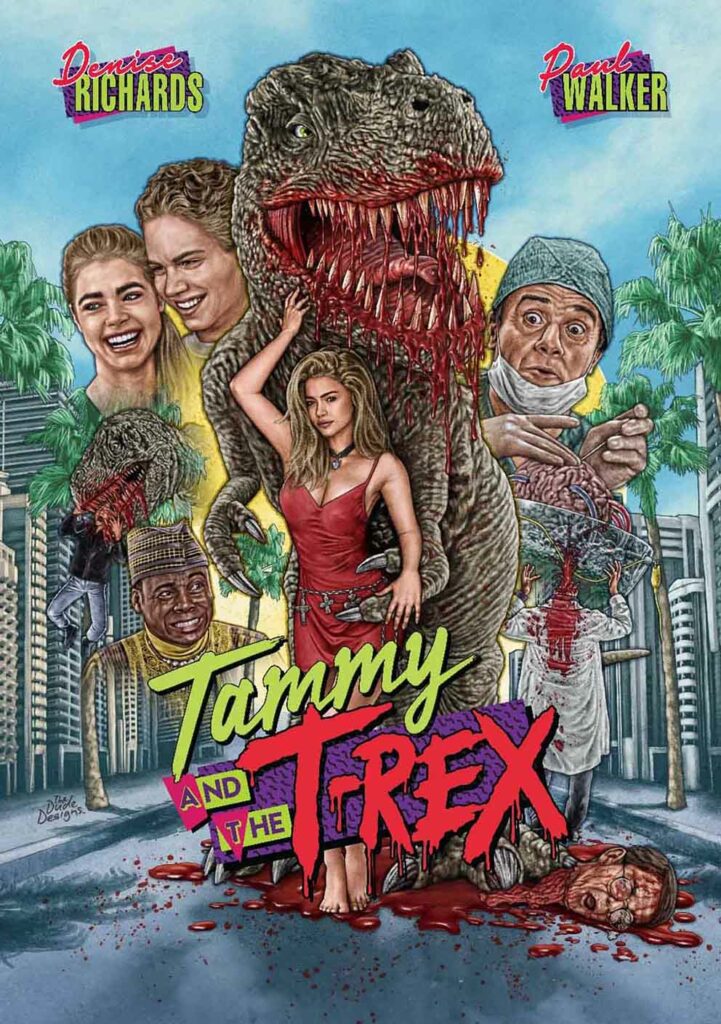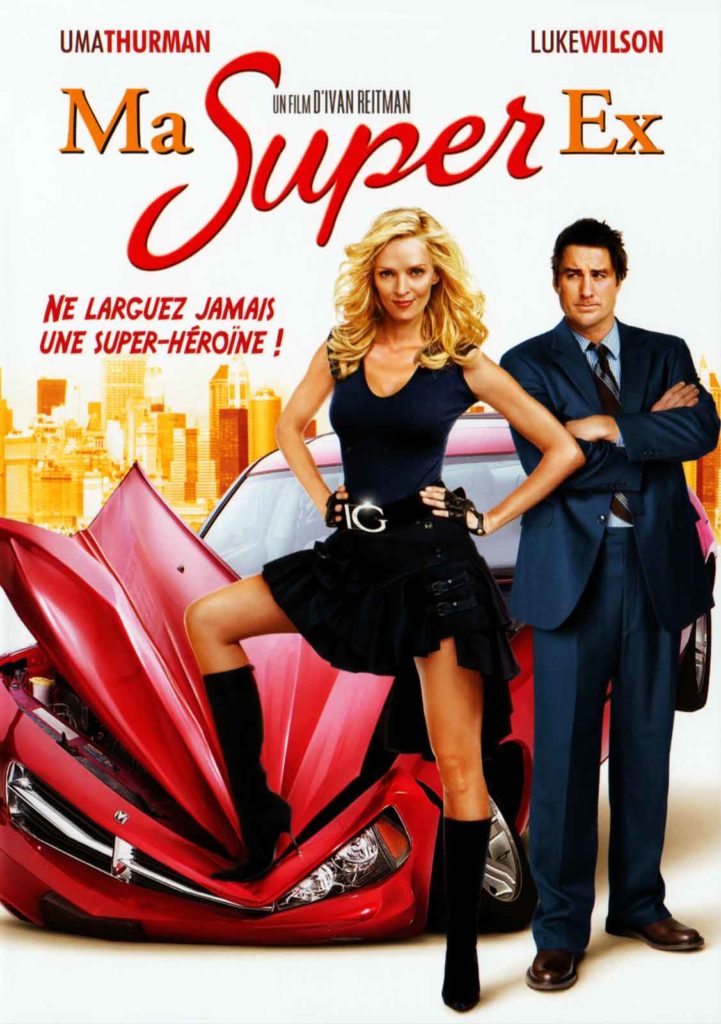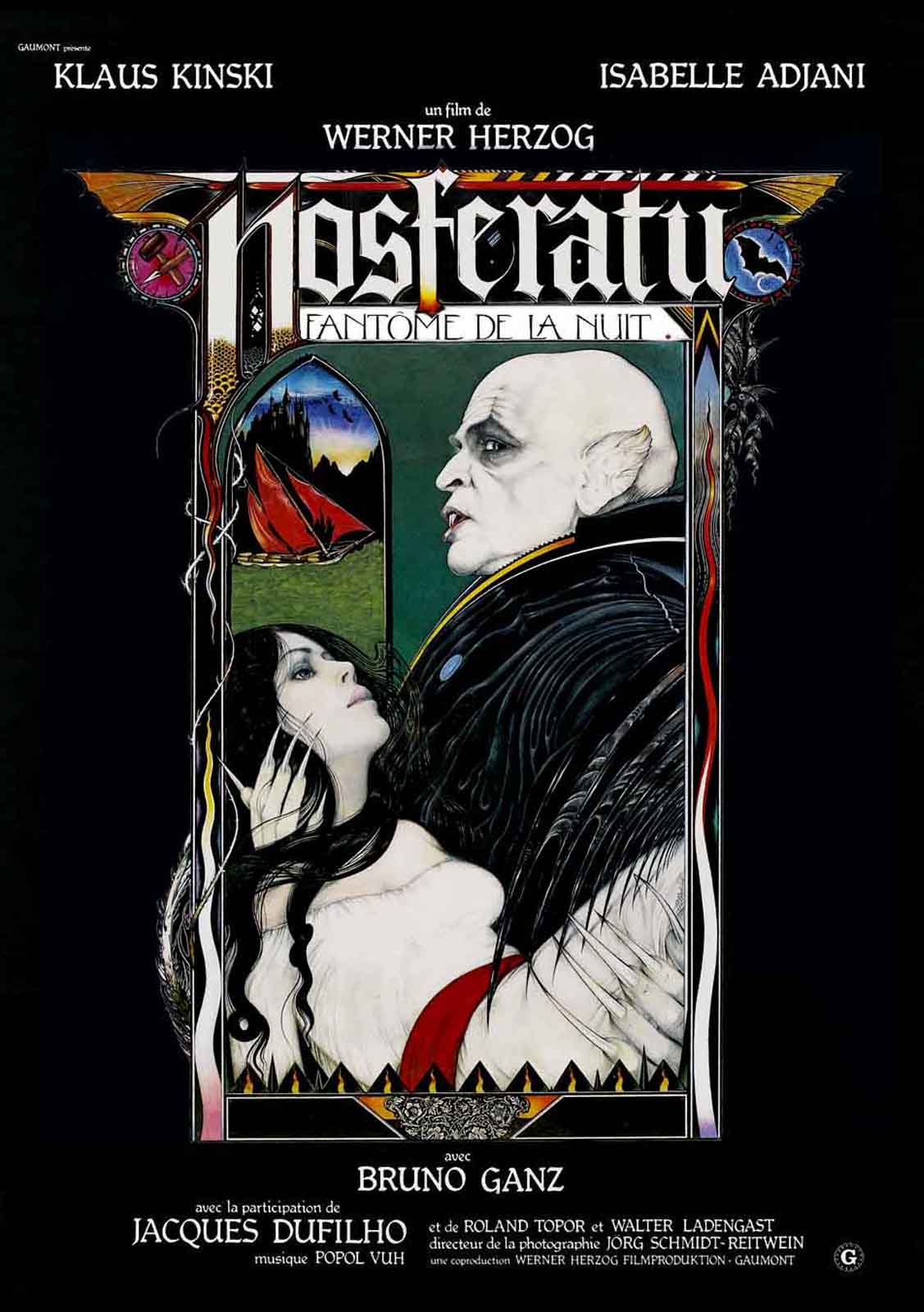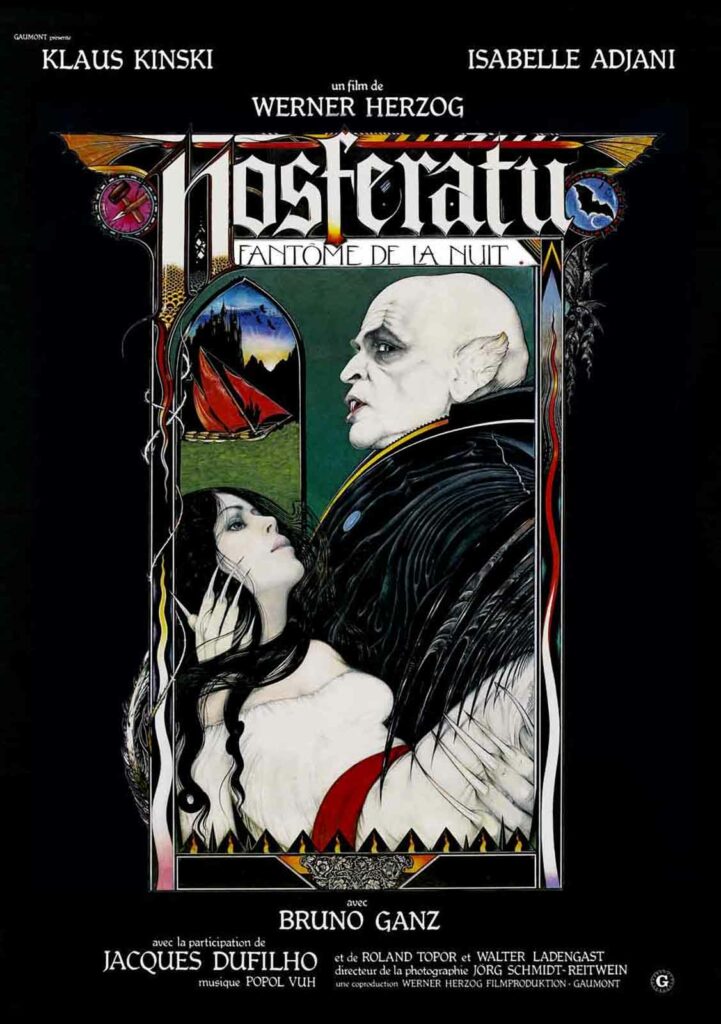Un film de monstres au budget minuscule initié par l’un des futurs plus grands créateurs d’effets spéciaux du monde
EQUINOX
1970 – USA
Réalisé par Jack Woods (et Dennis Muren non crédité)
Avec Edward Connell, Barbara Hewitt, Frank Bonner, Robin Christopher, Jack Woods, James Philips
THEMA SORCELLERIE ET MAGIE
Fou de cinéma et d’effets spéciaux depuis son enfance, Dennis Muren décide à la fin des années 60 de s’attaquer à un long-métrage fantastique. Mark McGee, David Allen et Jim Danforth acceptent de s’embarquer avec lui dans l’aventure. Le premier s’attèle au scénario, le second prend en charge la création des monstres, le troisième participe aux effets visuels et Muren lui-même occupe le poste de réalisateur. « Vers l’âge de douze ans, Le 7ème voyage de Sinbad m’a tellement impressionné que je l’ai vu huit fois la même semaine au cinéma ! », raconte Dennis Muren « C’est pour rendre hommage à ce film et aux autres travaux de Ray Harryhausen que j’ai réalisé Equinox. Il comporte donc trois grandes séquences avec des créatures animées image par image. C’était un long-métrage produit comme un film amateur, tourné entre amis avec un tout petit budget, mais qui a finalement été distribué dans le monde entier. » (1) L’intrigue, assez sommaire, lorgne vaguement du côté de H.P. Lovecraft. Deux couples de jeunes gens y partent à la recherche du docteur Waterman, un scientifique égaré. Au cours de leur voyage, ils découvrent un château étrange, des empreintes de pas gigantesques, une caverne mystérieuse, ainsi qu’un livre ancien et magique mentionnant une malédiction terrifiante. Ils finissent par se retrouver nez à nez avec une série de monstres et leur maître, ayant traversé une barrière dimensionnelle pour retrouver le livre magique.


Malgré son intrigue simpliste et le jeu très approximatif de ses acteurs, le film distille un certain charme, surtout grâce aux créatures qu’il met en scène, toutes inspirées par Ray Harryhausen. « Je dois bien avouer que c’était notre influence principale », avoue David Allen, qui signa le design de toutes ces créatures (2). La pieuvre géante, qui intervient furtivement dans un flash-back en détruisant une cabane, évoque Le Monstre vient de la mer et la maléfique divinité aquatique Cthulhu chère à Lovecraft. La gargouille volante est quant à elle un démarquage très réussi des harpies de Jason et les Argonautes. Les autres monstres du film sont un démon simiesque aux pattes de bouc surnommé Taurus, plus ou moins inspiré du cyclope du 7ème voyage de Sinbad, et un gigantesque troglodyte, cousin de celui de Sinbad et l’œil du tigre, mais ici interprété par un acteur costumé.
Evil Dead avant l’heure
Bien qu’ils soient traités très différemment et plus maladroitement, les thèmes d’Equinox (les jeunes couples dans la forêt, le vieux grimoire qui réveille les démons, les filles possédées l’une après l’autre, la gargouille maléfique, la forteresse moyenâgeuse, le témoignage enregistré sur un magnétophone à bande, les inspirations lovecraftiennes) annoncent ceux de la trilogie Evil Dead, qui commencera elle aussi en 16 mm avec un groupe de cinéastes amateurs. Le producteur Jack Harris (Danger planétaire, Dinosaurus) s’intéresse au film deux ans après la fin de son tournage et propose de le distribuer moyennant quelques modifications, ce que Muren accepte sans hésiter. Le monteur Jack Woods est donc embauché pour superviser cette nouvelle version, et c’est finalement lui qui est crédité comme réalisateur du film. « Le film a un peu changé lorsque Jack Harris a décidé de le sortir en salles », explique David Allen « Les acteurs ont été rappelés quelques trois ans après le début du tournage pour jouer dans des scènes additionnelles » (3). Equinox sort brièvement sur les écrans en 1971 et passe un peu inaperçu. Mais cette expérience aura permis à Dennis Muren de découvrir son penchant définitif pour les effets visuels, et de devenir progressivement l’une des plus grandes pointures en la matière.
(1) Propos recueillis par votre serviteur en mars 2014
(2) et (3) Propos recueillis par votre serviteur en avril 1998
© Gilles Penso
Partagez cet article