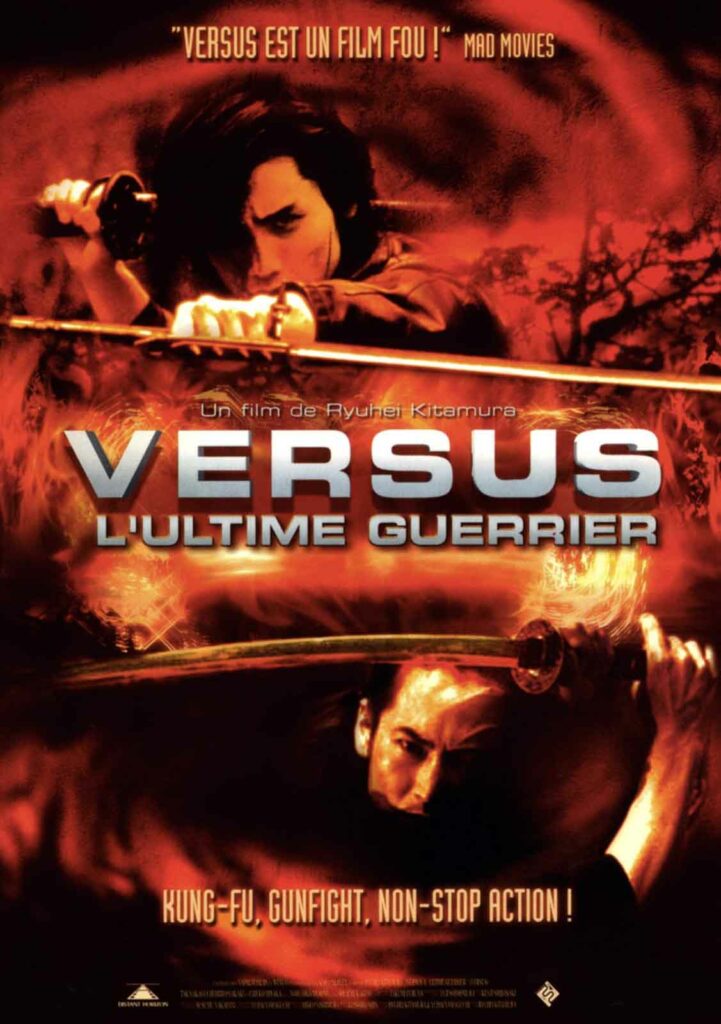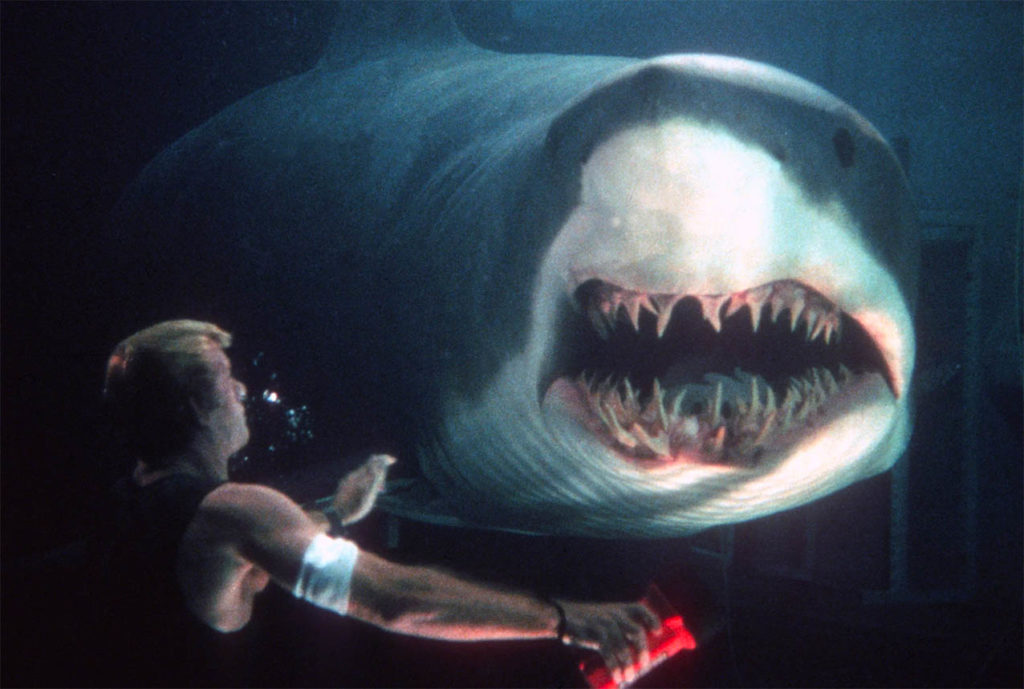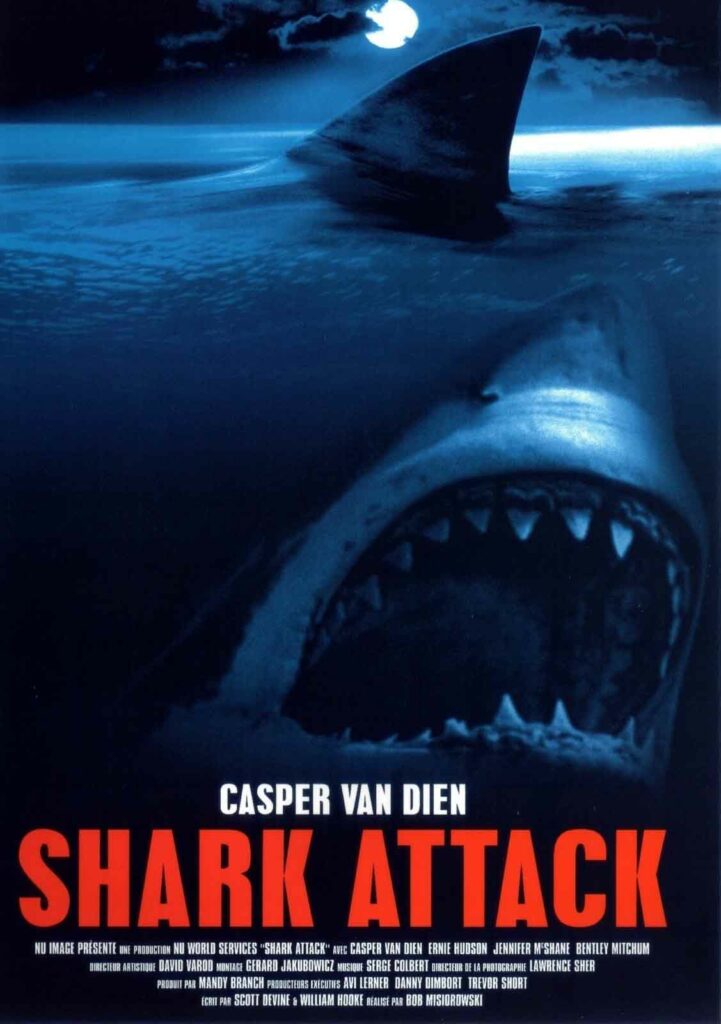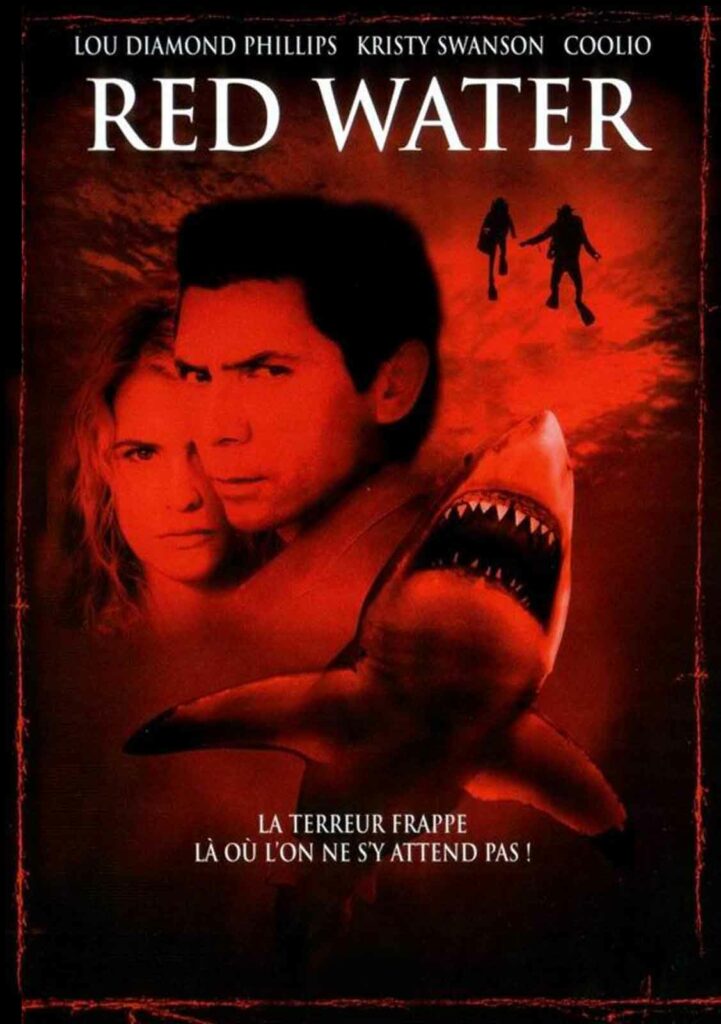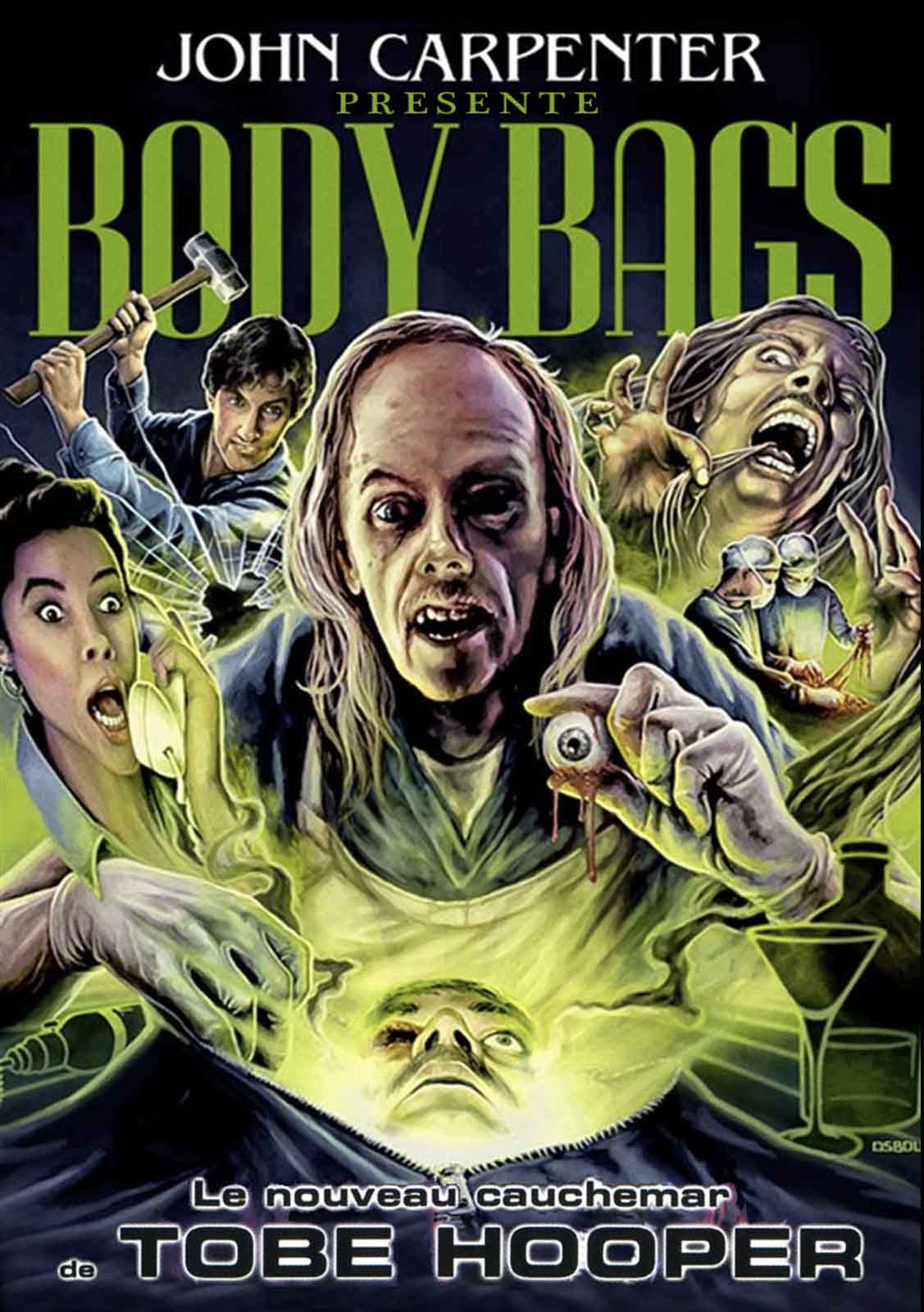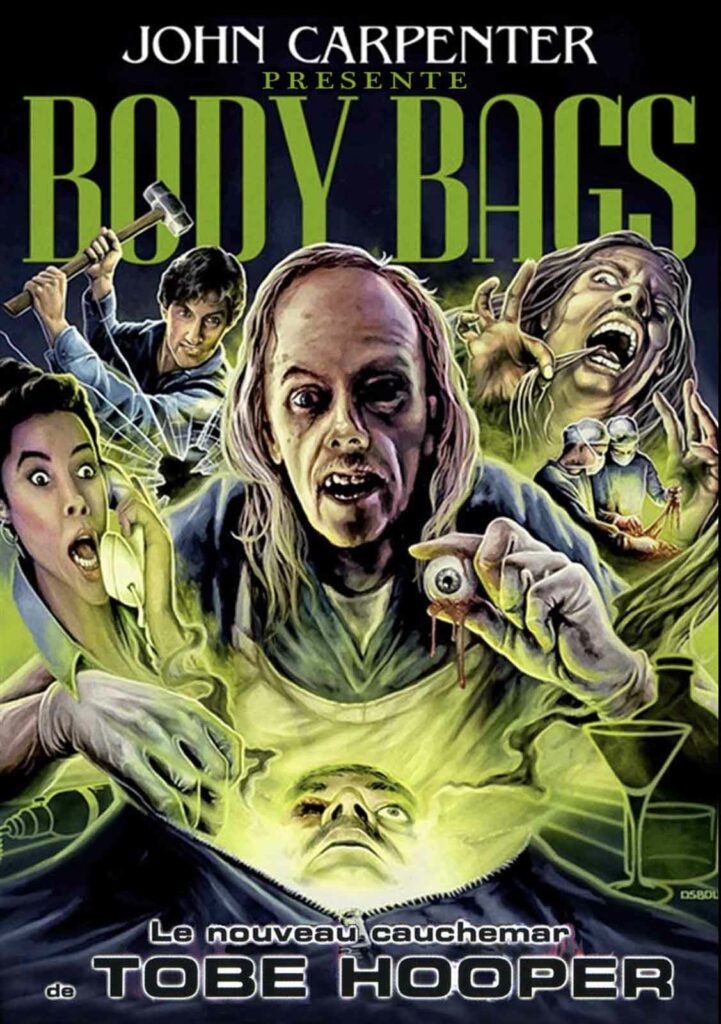Huit ans après son éprouvant survival sauvage, Wes Craven en signe une séquelle ratée et poussive
THE HILLS HAVE EYES PART 2
1985 – USA
Réalisé par Wes Craven
Avec Tamara Stafford, Kevin Spirtas, John Bloom, Colleen Riley, Michael Berryman, Penny Johnson, Janus Blythe, Robert Houston
THEMA TUEURS I CANNIBALES I SAGA LA COLLINE A DES YEUX I WES CRAVEN
Wes Craven est capable du meilleur (Les Griffes de la nuit) comme du pire (La Créature du marais). Jamais cet axiome ne fut mieux illustré que par La Colline a des yeux et sa séquelle ici présente. Après avoir montré quelques larges extraits du premier film, histoire de remettre tout le monde dans le bain, de gagner un peu de temps et d’économiser sur le budget, cette suite parfaitement injustifiée et truffée d’invraisemblances s’empêtre ainsi dans une routine similaire à celle des pires épisodes de la franchise Vendredi 13, empruntant au passage quelques idées visuelles à Massacre à la tronçonneuse, ce qui ne peut pas faire de mal. Le protagoniste semble à priori être Bobby Carter (Robert Houston), survivant des événements effroyables survenus huit années auparavant. Suivi par un psychiatre, il s’est désormais marié à Ruby (Janus Blythe), la jeune fille vivant dans la colline qui a quitté définitivement sa famille de cannibales psychopathes, l’a aidé à sauver sa peau et se nomme désormais Rachel Carter.


Comme tous deux sont jeunes et dynamiques, ils dirigent une équipe de motocross. Quand celle-ci décide de disputer une compétition dans le désert, Bobby ne se sent pas capable de les accompagner, malgré son envie de tester un nouveau carburant de son invention. Accablé par des souvenirs traumatisants, il a le sentiment que ses amis non plus ne devraient sans doute pas partir. Rachel s’y rend tout de même, prenant le relais de Bobby qui, désormais est exclu du reste de l’intrigue. C’est donc elle qui mène toute l’équipe à bord d’un bus. En retard, le petit groupe décide d’emprunter un raccourci, et ce qui devait arriver arrive : le bus s’abîme sur la route accidentée, et se retrouve en panne à deux pas du drame narré dans La Colline a des yeux premier du nom. Les motocyclistes se mettent en quête d’un secours providentiel et trouvent refuge dans ce qui ressemble à une ancienne mine abandonnée. Bientôt, Pluton (Michael Berryman) et le Moissonneur (John Bloom), les redoutables anthropophages survivants du massacre, les traquent sans répit, bien décidés à les afficher à leur prochain menu.
Clichés en série
Au survival éprouvant et malsain succède ainsi le psycho-killer archi-classique avec la bande de jeunes / victimes qui passent leur temps à se chercher les uns les autres, la vieille maison abandonnée, un timide soupçon d’érotisme et tout l’arsenal des clichés habituels. La musique de Harry Manfredini, pesante, appuie lourdement chaque effet. Craven parvient malgré tout à ménager quelques séquences de suspense efficaces, notamment celles mettant en scène la jeune aveugle Cassandra (Tamara Stafford), mais ces passages miraculés ne sauvent en rien l’entreprise d’un inévitable naufrage. L’épilogue nous montre le jeune couple et le chien s’en aller gaiement, bras dessus bras dessous, souriants, après le massacre de leurs six amis. On se croirait dans La Cité de la peur ! Mais qu’est-il arrivé à Wes Craven en 1985 pour qu’il signe une telle ineptie et entache ainsi la réputation d’un de ses chefs d’œuvre ? La Colline a des yeux 2 est généralement oublié dans ses filmographies officielles, et franchement on comprend pourquoi.
© Gilles Penso
Partagez cet article