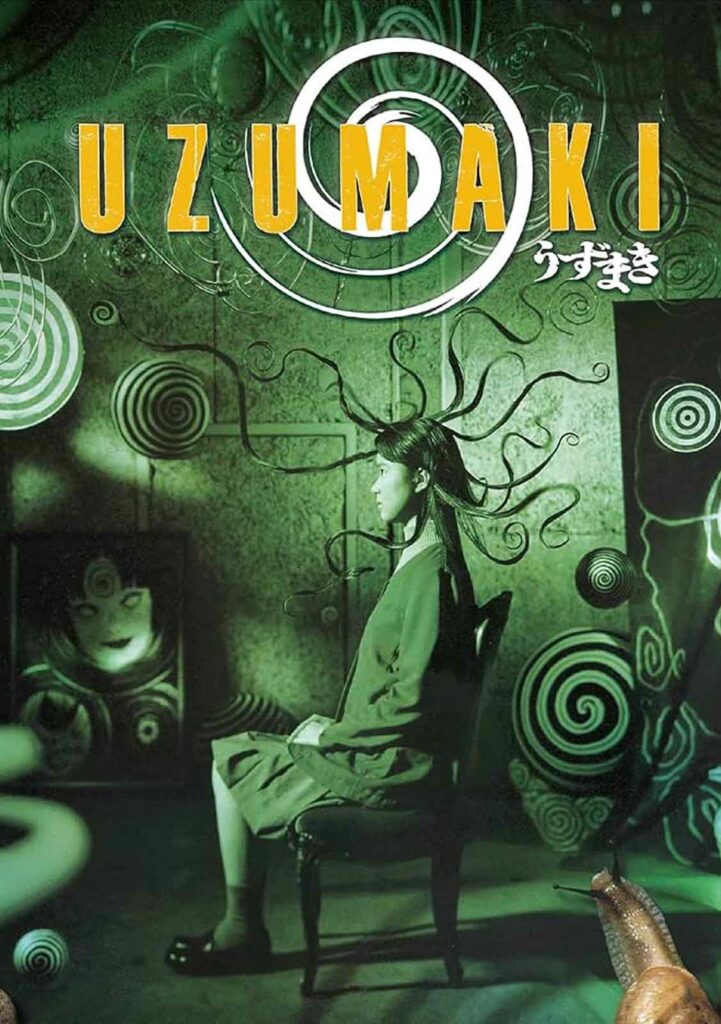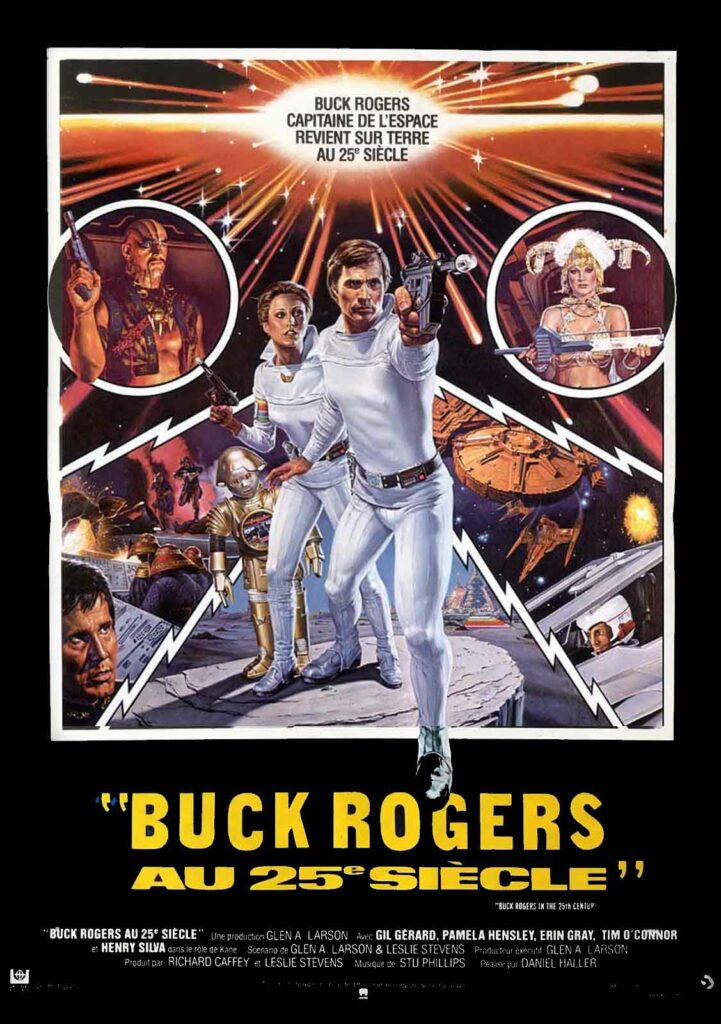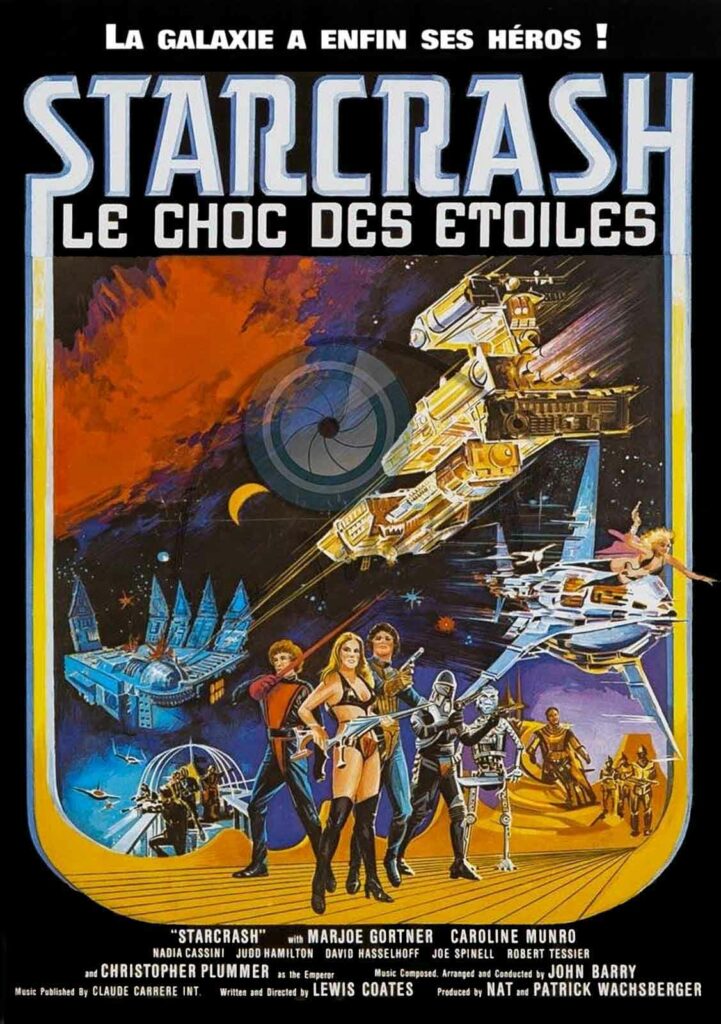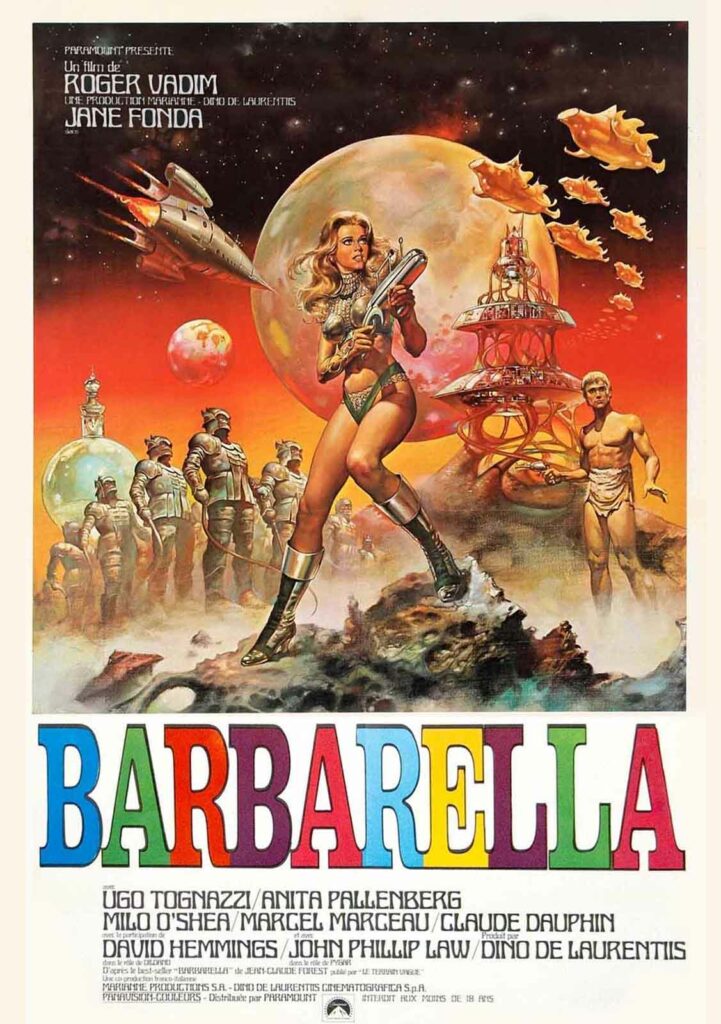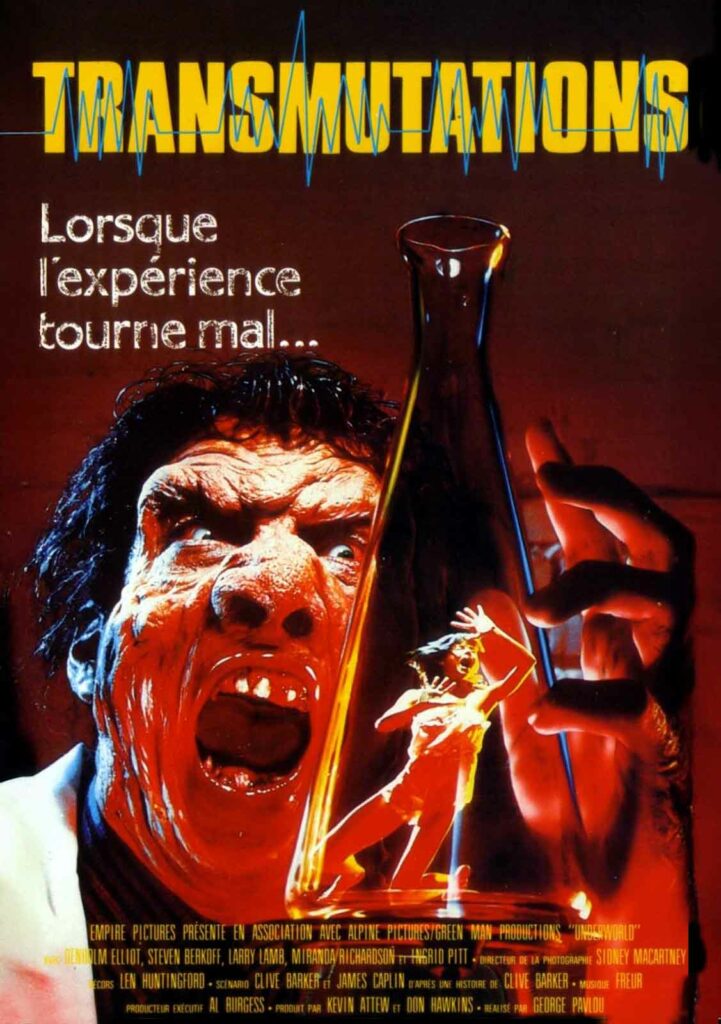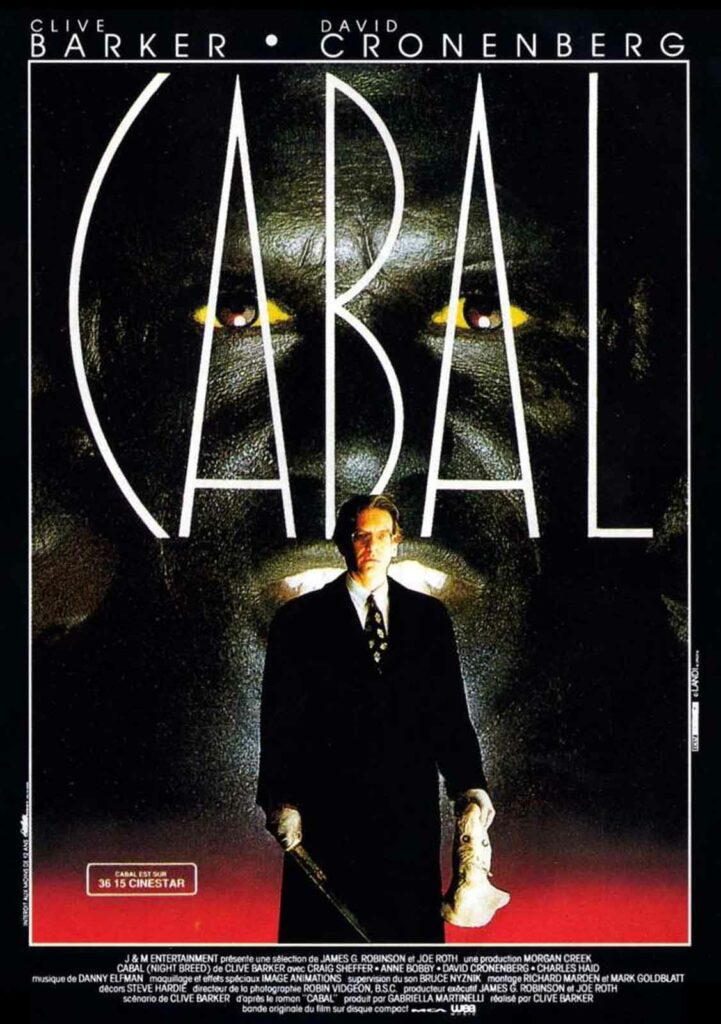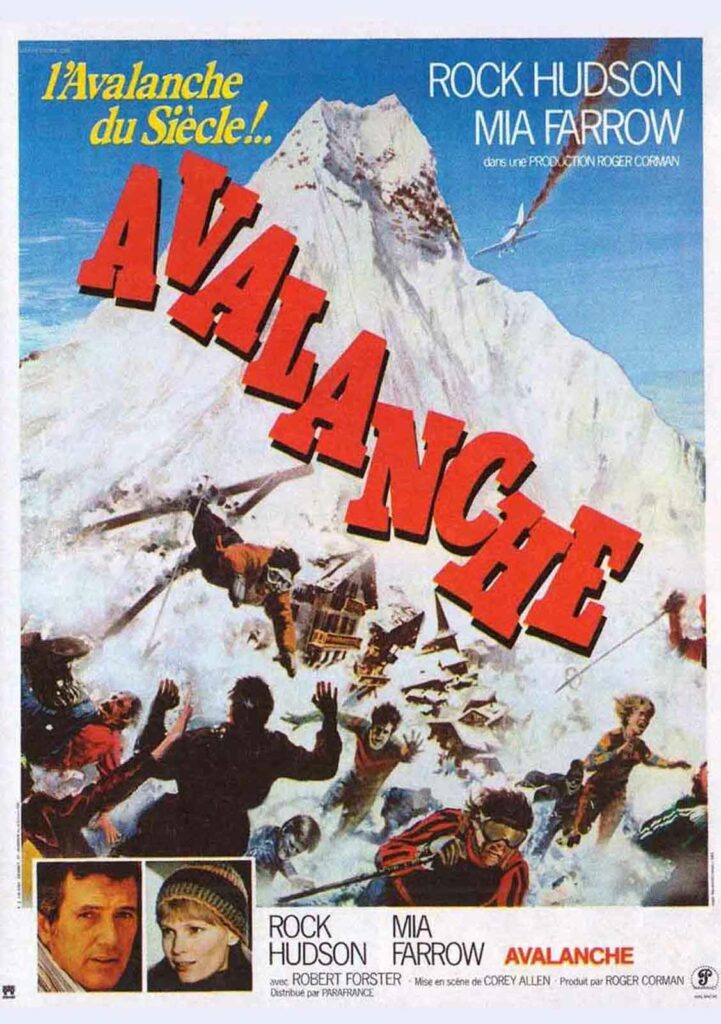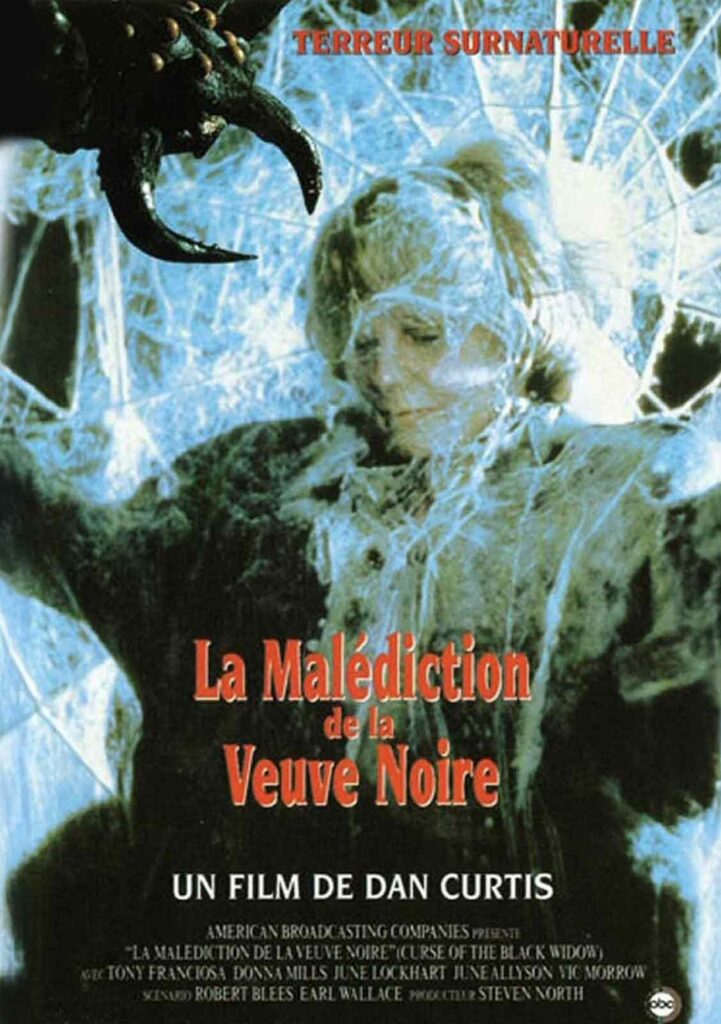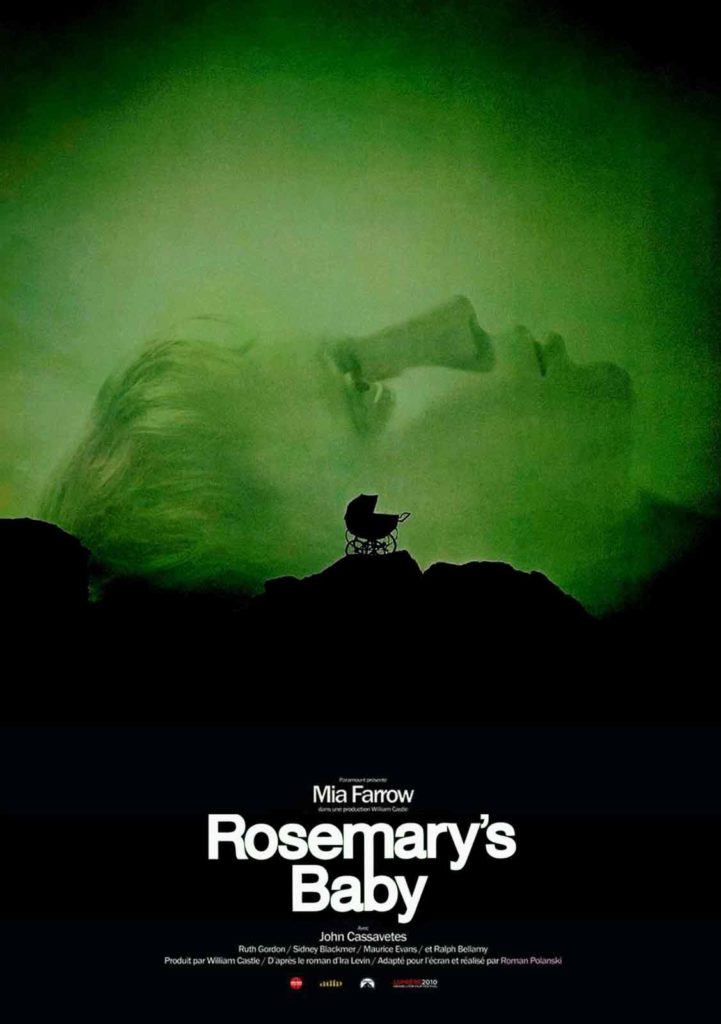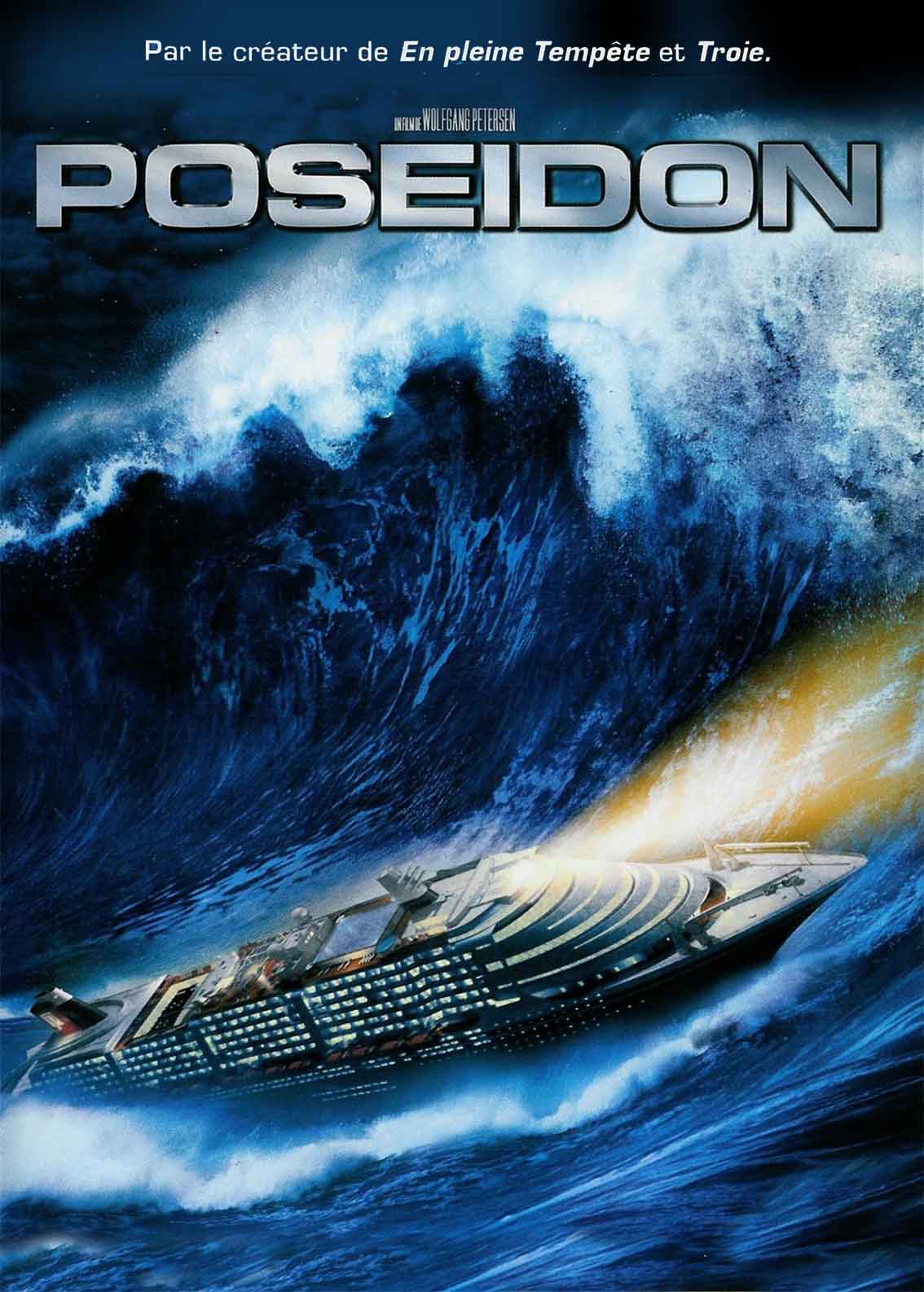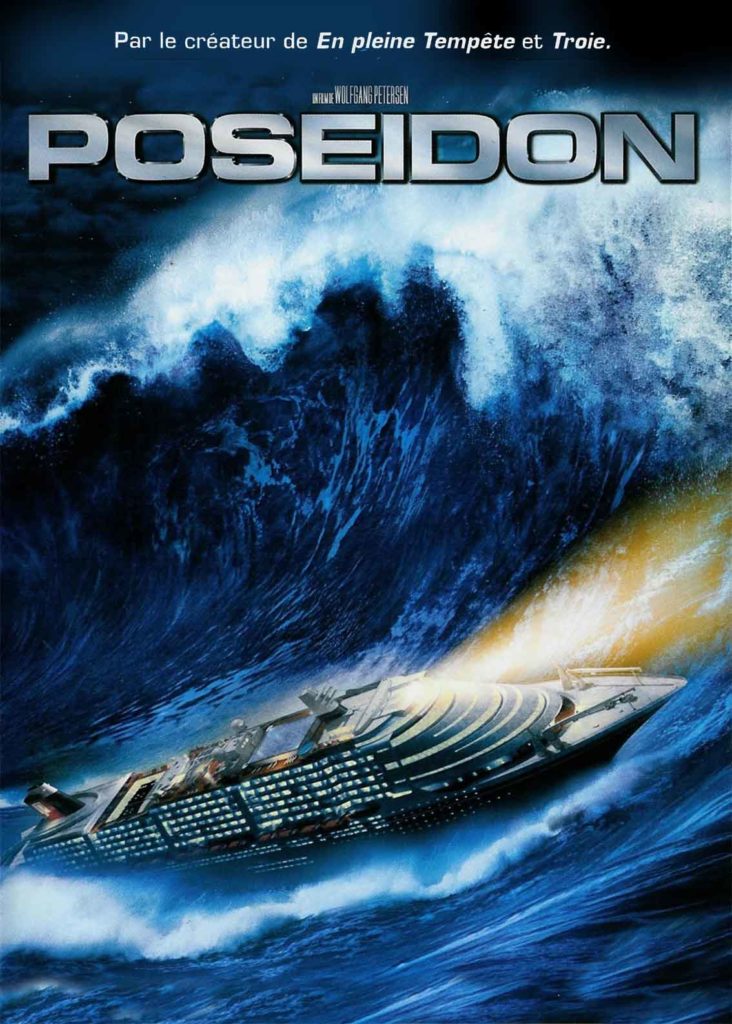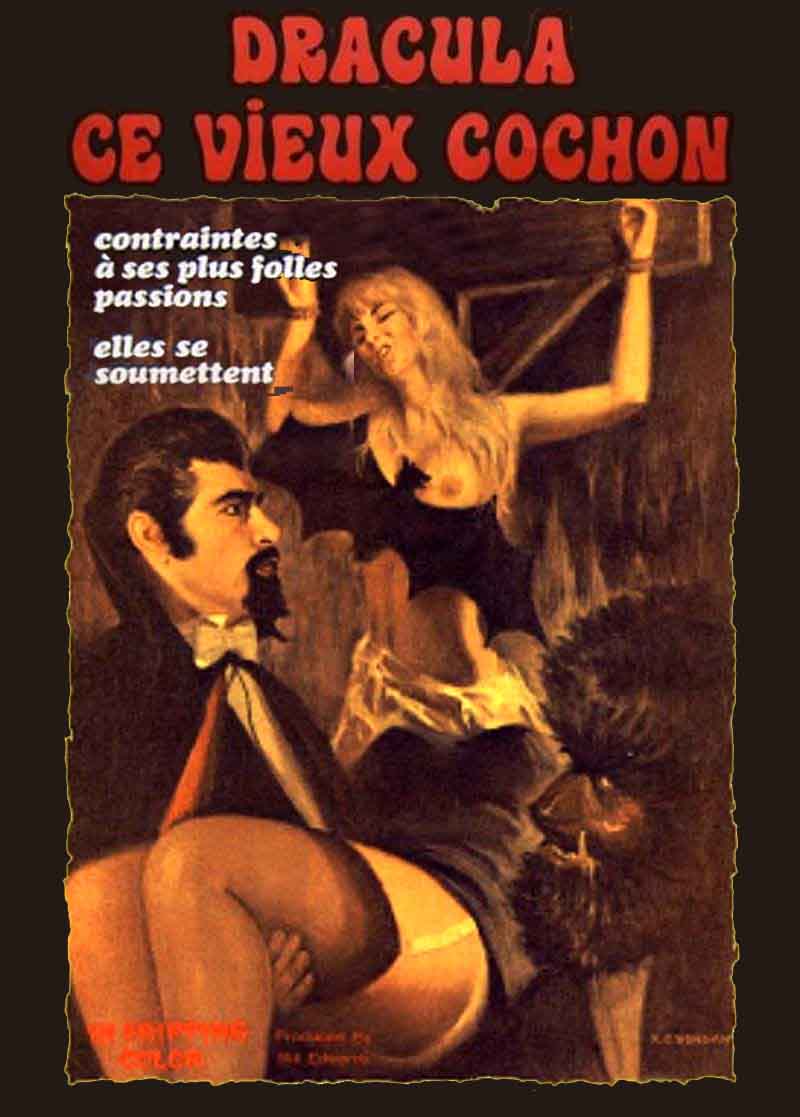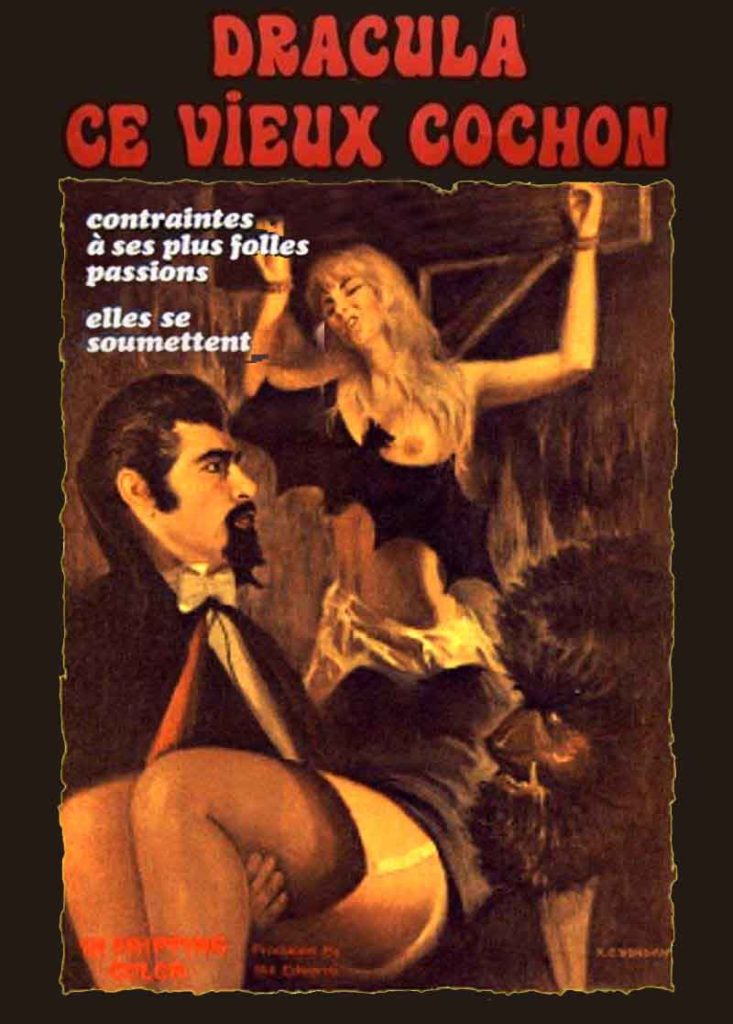Des hordes de démons s’apprêtent à déferler dans notre monde en empruntant les locaux d’une école construite sur l’une des portes de l’Enfer…
YÔKAI HANTÂ : HIRUKO
1991 – JAPON
Réalisé par Shinya Tsukamoto
Avec Kenji Sawada, Masaki Kudou, Hideo Murota, naoto Takenaka, Megumi Ueno
THEMA DIABLE ET DÉMONS
Après le choc de Testsuo et avant de se lancer dans sa séquelle Testsuo 2, Shinya Tsukamoto change de ton avec Hiruko the Goblin. Certes, il est toujours question d’altérations du corps humain, d’horreurs organiques et de visions cauchemardesques. Mais cette fois-ci, le cinéaste japonais brasse un public plus large et se lance dans une approche récréative du genre. Bénéficiant d’un budget plus conséquent que sur ses exercices de style précédents, il installe son équipe dans les légendaires studio de la Toho et adapte avec une vision très personnelle le manga « Ghost Hunter » de Daijiro Moroboshi. Pendant les vacances, le professeur Takashi Yabe explore les sous-sols de l’école où il travaille et y découvre une ancienne tombe d’origine inconnue. L’une de ses élèves, Tsukishima Reiko, passionnée d’archéologie, souhaite se joindre à lui, malgré ses protestations. Tous deux sont soudain attaqués par une force incroyable. À partir de là, les choses dégénèrent et un démon se met à ramper au sol en caméra subjective avec des grondements et des halètements, façon Evil Dead. Hieda Reijiro, un ami archéologue de Yabe venu à sa demande, entre alors en scène. Flanqué de trois étudiants, ce « Ghostbuster » nippon transporte dans sa valise tout un tas de gadgets de son invention bricolés pour chasser les esprits. Les visions folles s’enchaînent bientôt dans un tourbillon surréaliste, comme tous ces gens en proie à une malédiction qui s’arrachent la tête ou ce lycéen dont le dos se couvre d’une brûlure imitant le visage de chacune des victimes du démon.


Hiruko the Goblin adopte donc un ton indéfinissable, quelque part entre la comédie et l’horreur, avec en prime une pointe de poésie. Témoin cette scène incroyable où le visage de la lycéenne Tsukishima émerge à peine à la surface de l’eau, chantant une douce mélopée, jusqu’à ce que des monstrueuses pattes d’araignée surgissent de part et d’autre de sa tête et que le monstre hybride ainsi formé se déplace en rampant dans les fougères. Cette tête montée sur pattes dont la langue démesurée surgit de la bouche nous évoque bien sûr The Thing, une référence que le cinéaste assume, même si l’idée de ce démon lui trottait dans la tête avant que le film de Carpenter ne sorte sur les écrans. Inventifs en diable et réalisés pour la plupart en direct sur le plateau de tournage, les effets spéciaux du film sont souvent percutants, nimbés d’une patine « old school » du plus bel effet. C’est notamment le cas de l’animation image par image, sollicitée pour donner vie à la « tête araignée » dans les plans larges ou pour montrer les ailes qui poussent sur son corps afin de lui permettre de s’envoler dans les airs. Il faut cependant avouer que, bien souvent, la légèreté de ton et l’outrance du jeu des acteurs gâchent l’immense potentiel des nombreuses séquences horrifiques du film.
Têtes-araignées contre reptiles-insectes
Un flash-back situé à mi-parcours du métrage permet de comprendre l’origine du mal. Watanabe, le gardien de l’école, explique en effet que de tels événements funestes se sont déjà déroulés dans l’école soixante ans plus tôt. D’où ces visions hallucinantes de centaines de visages qui hurlent dans un brasier, ou encore d’un enfant dont le front est ceint de trois cornes et le dos orné de visages gravés. Il y a six décennies, la porte vers l’enfer avait été refermée. Mais Yabe vient de la rouvrir, et l’immense cratère ouvert dans les sous-sols de l’école laisse paraître des centaines de démons aux allures de grandes gueules reptiliennes montées sur des pattes d’insectes. Le grand final de Hiruko the Goblin nous offre donc l’affrontement délirant entre les araignées à tête humaines (toutes victimes de la malédiction) et les monstres reptiliens, tandis que les héros s’efforcent de refermer la porte infernale. Osant sans cesse le grand écart, Shinya Tsukamoto désamorce l’outrance de ces scènes folles par des touches d’humour incongrues (comme lorsque Hieda se défend avec une bombe insecticide !). D’une naïveté touchante, l’épilogue de ce long-métrage décidément hors-norme montre le visage de toutes les victimes voguer vers les cieux étoilés sous forme de comètes translucides et souriantes !
© Gilles Penso
À découvrir dans le même genre…
Partagez cet article