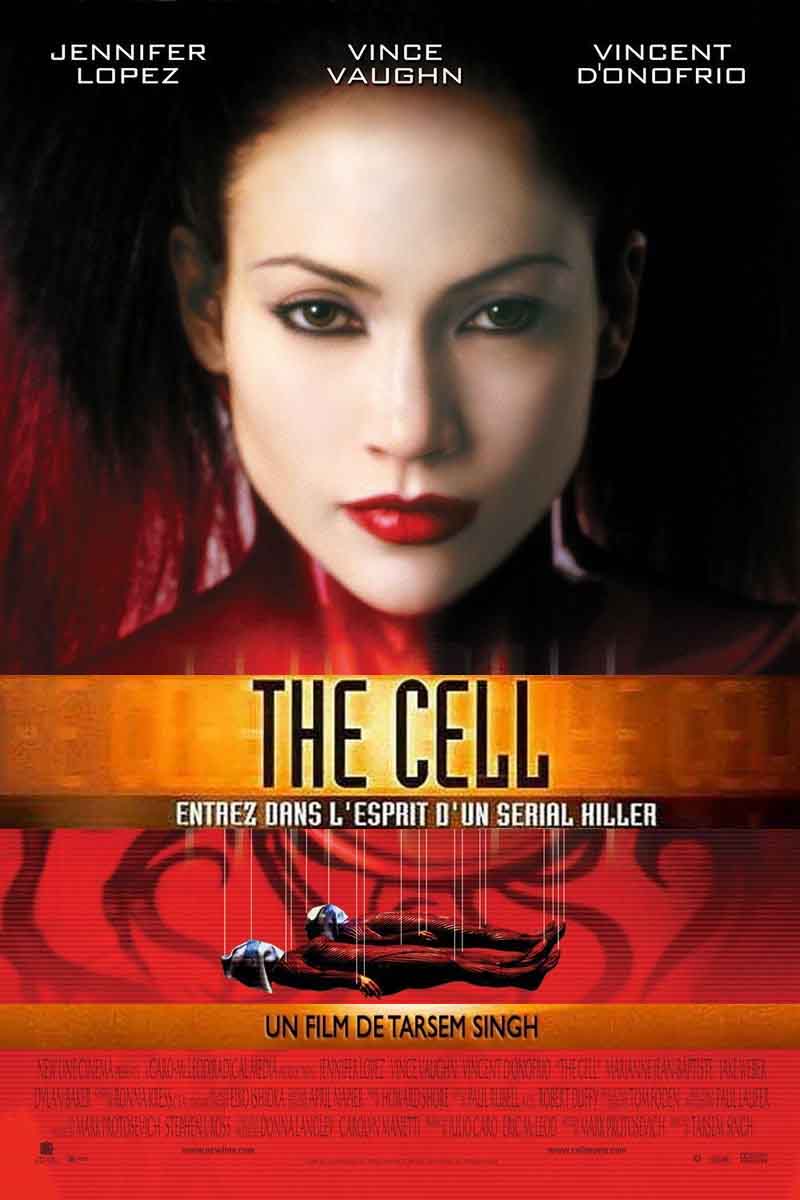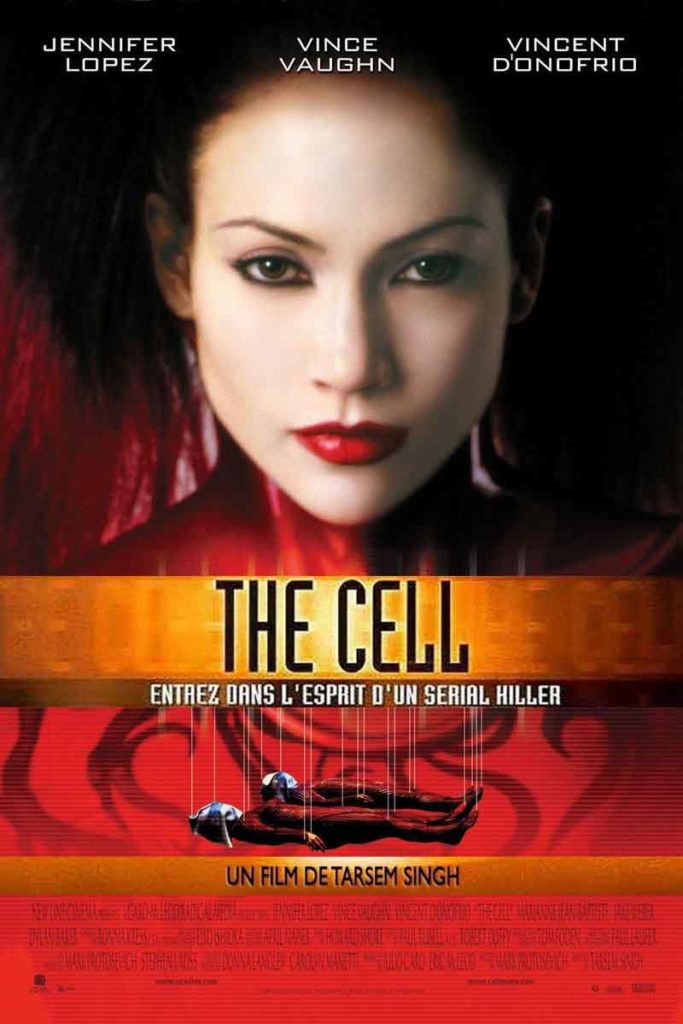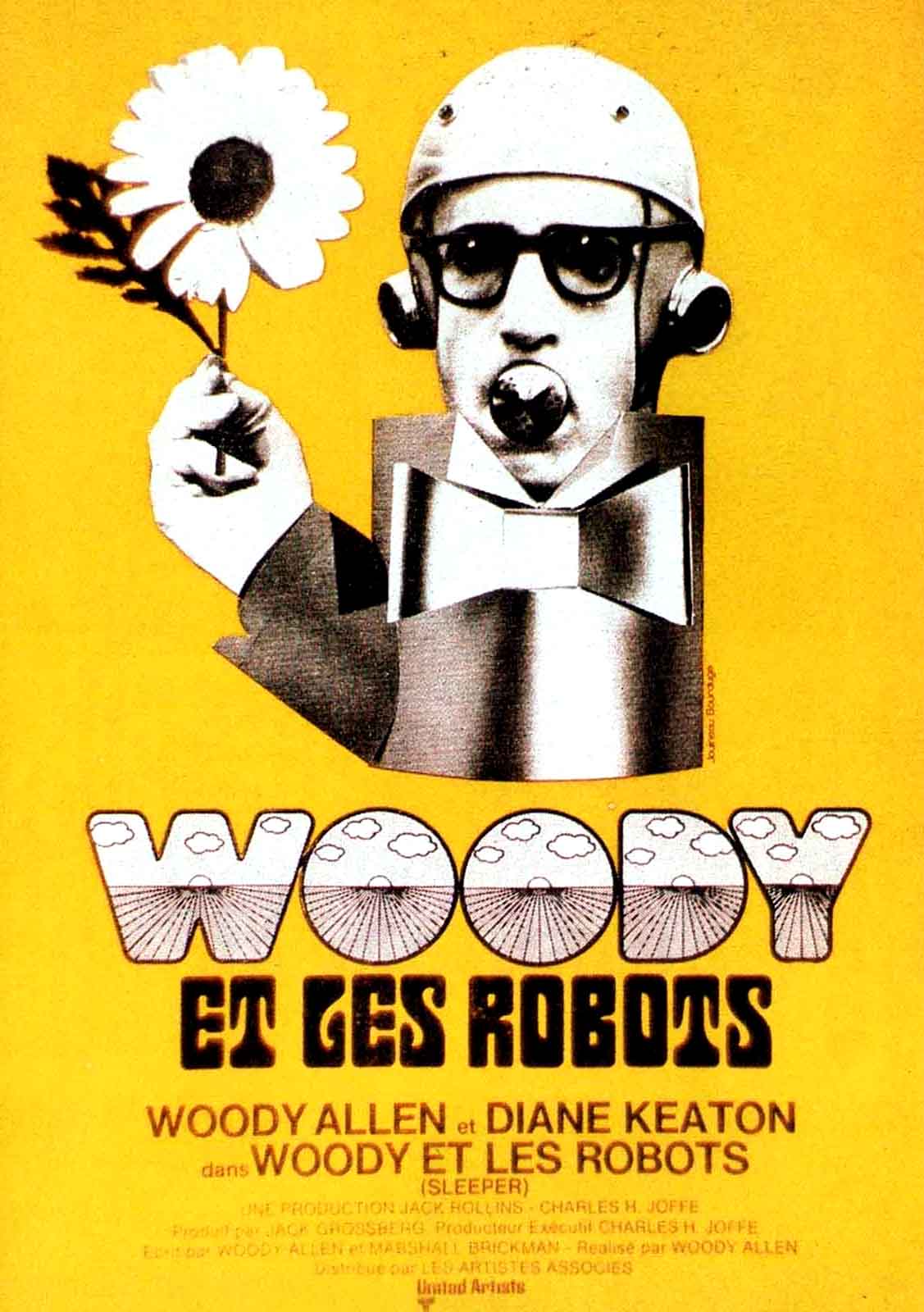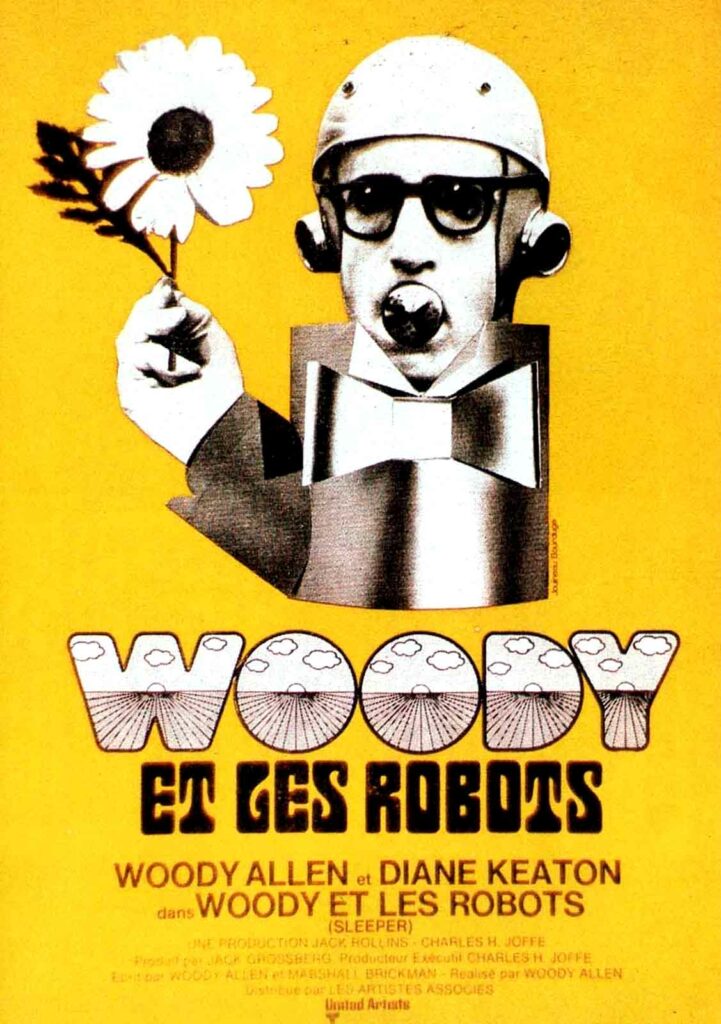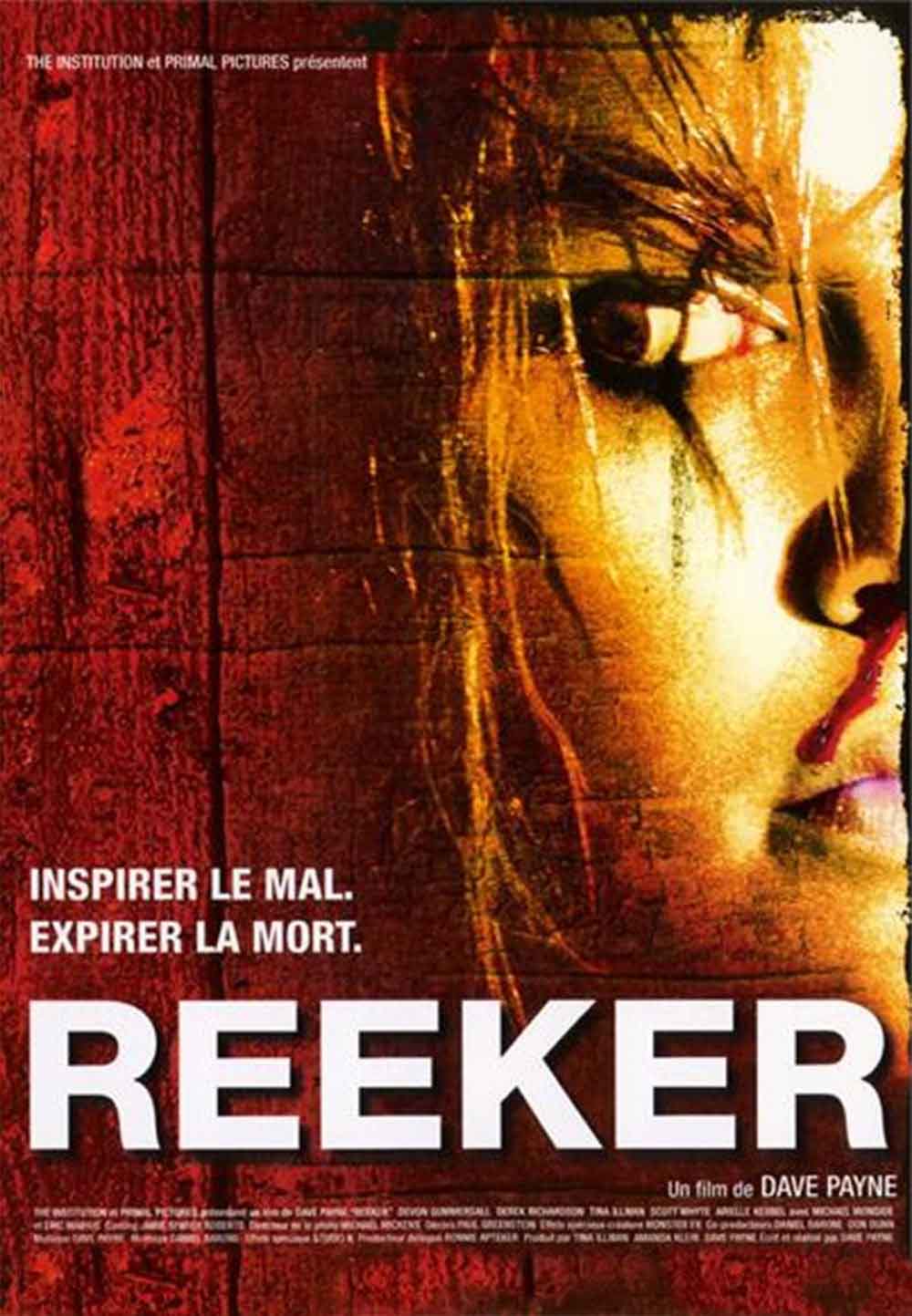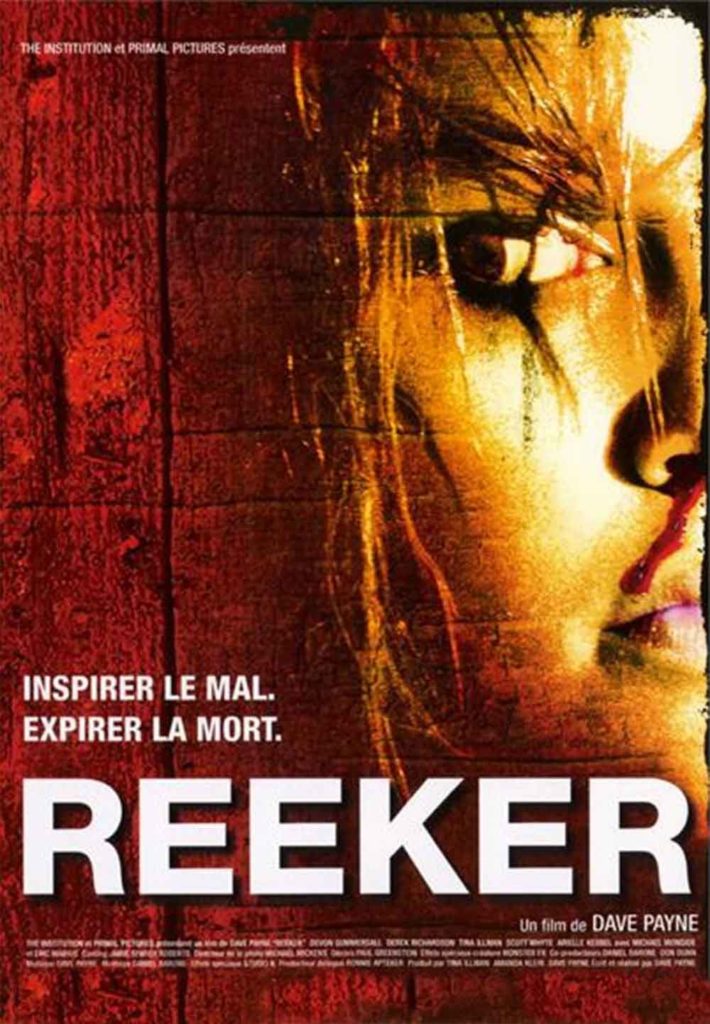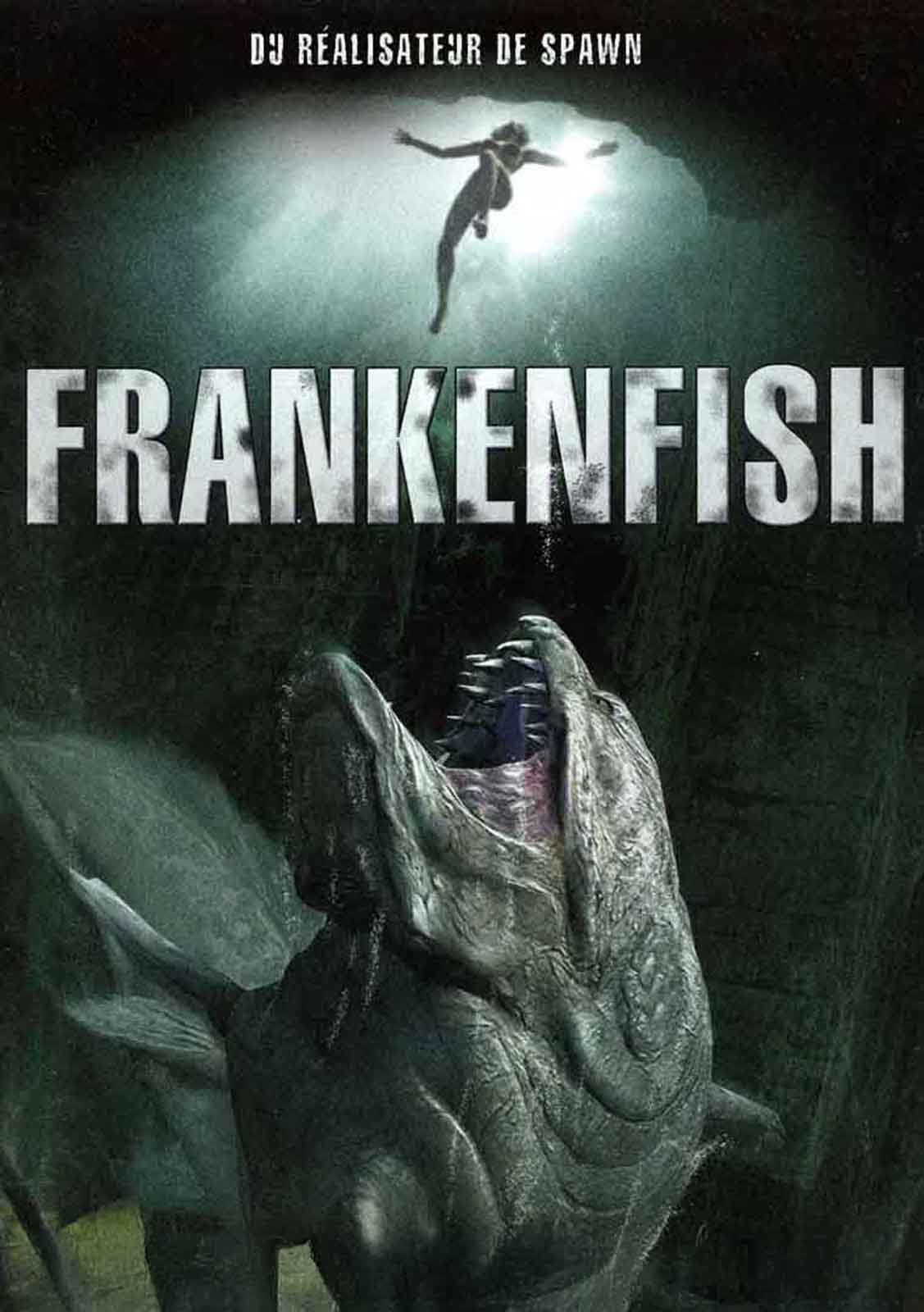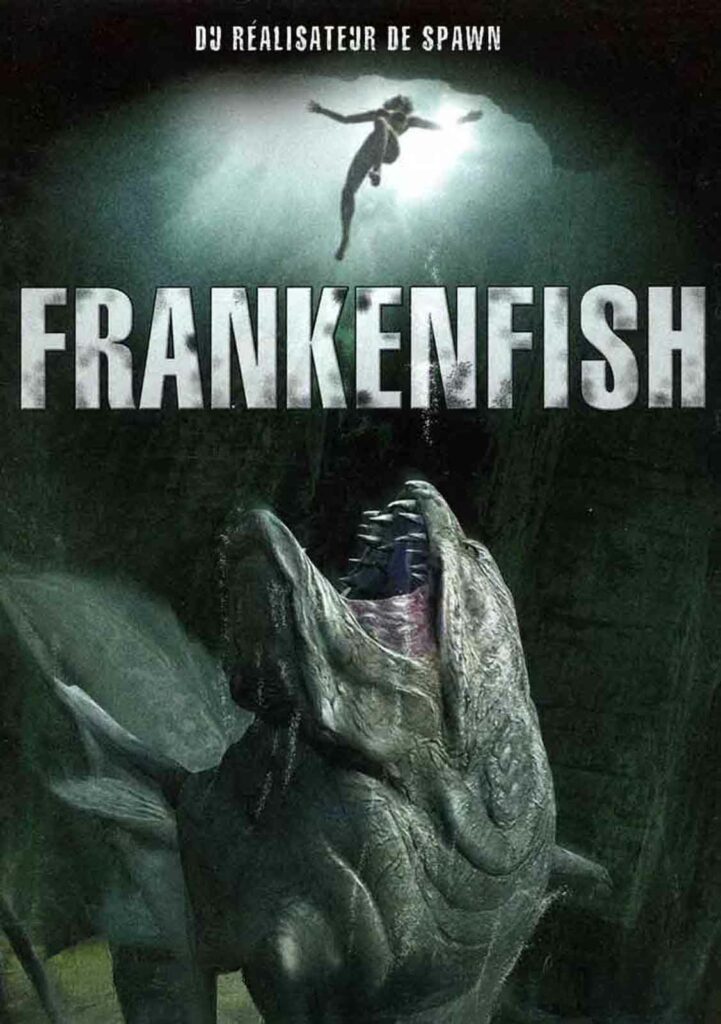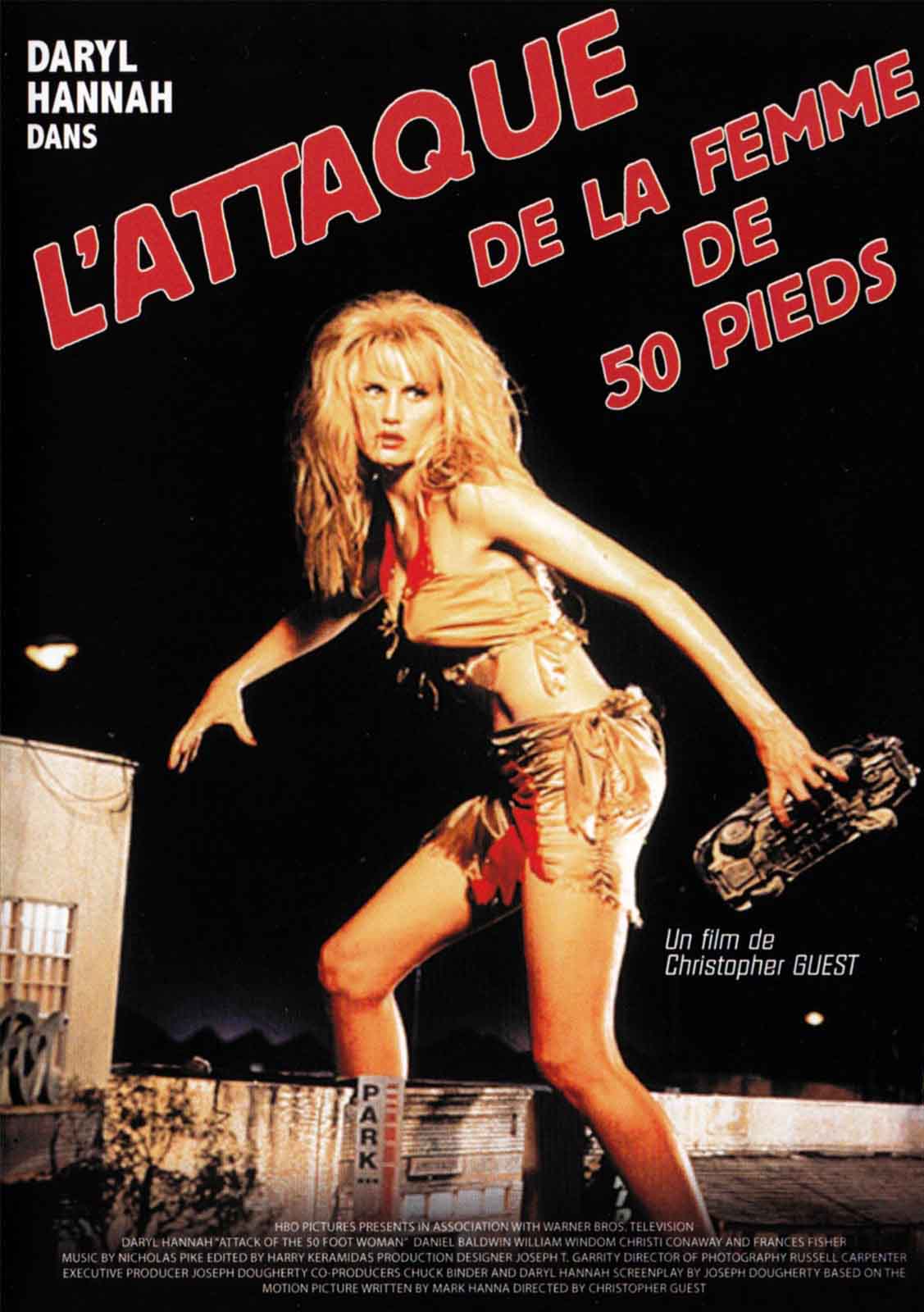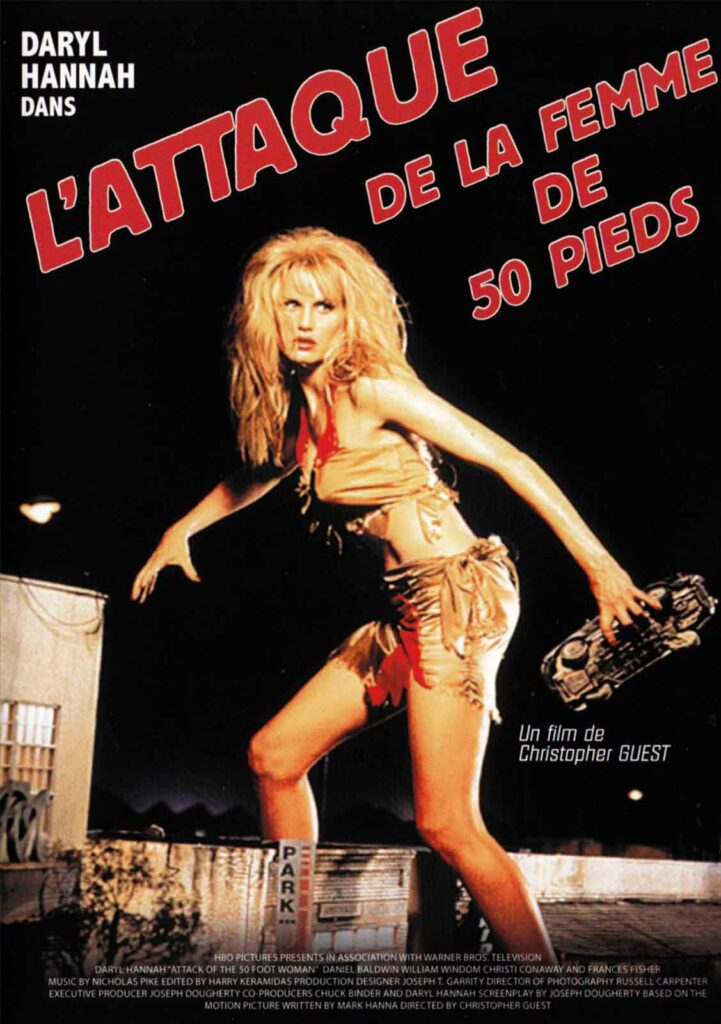Cette première séquelle des Démons du maïs s’intéresse aux méfaits d’enfants diaboliques obéissant au « maître des tumultes »
CHILDREN OF THE CORN 2 : THE FINAL SACRIFICE
1993 – USA
Réalisé par David F. Price
Avec Terrence Knox, Paul Scherrer, Rosalind Allen, Ryan Bollman, Christie Clark, Ned Romero, Ed Grady
THEMA ENFANTS I DIABLE ET DÉMONS I SAGA STEPHEN KING I DÉMONS DU MAÏS
Vaguement inspiré de la nouvelle « Les Enfants du maïs » de Stephen King, Horror Kid (alias Les Démons du maïs) est un film anecdotique qui aura pourtant donné naissance à une saga interminable et protéiforme. Sa première séquelle est confiée à David Price (réalisateur l’année suivante du parodique Dr. Jekyll and Ms. Hyde). Le film commence par la découverte d’un amoncellement de cadavres décomposés dans une cave de la petite ville de Gatlin. Interrogés, les enfants du coin se contentent de dire « j’ai vu le maïs ». Dans un village voisin, Hemingford, les enfants agissent comme ceux de Gatlin, menés par Micah (Ryan Bollman), un nouveau prophète qui obéit au « maître des tumultes ». Le personnage principal du film est le journaliste new-yorkais John Garrett (Terence Knox). Accompagné par son fils adolescent Danny (Paul Scherrer), il mène l’enquête dans l’espoir de redonner un coup de pouce à sa carrière. Lorsqu’ils s’installent dans une chambre d’hôte tenue par l’avenante Angela (Rosalind Allen), le spectateur découvre que le fils de cette dernière n’est autre que Micah. Et tandis que les romances rurales s’esquissent, le curé du village crie à ses ouailles « la fornication c’est la peste ! ».


Bien vite, le film affirme sa nature de slasher dont la seule ambition consiste à multiplier les meurtres graphiques visualisés par les maquillages spéciaux de Bob Keen. Les premières victimes sont des journalistes dans leur van perdus au milieu d’un champ de maïs. L’un est égorgé par un épi tranchant, l’autre empalé par une branche. Plus tard, une vieille bigote est écrasée sous sa propre maison. Puis un homme se vide de son sang en plein office religieux, un médecin est assassiné à coup de seringues et de couteaux et une vieille dame sur un fauteuil électrique est heurtée sur la route par un camion avant d’aller s’éjecter dans une vitrine. Quelques scènes de suspense efficaces ponctuent le film, comme lorsque Dany et sa petite amie s’embrassent dans le champ de maïs puis tombent sur des morceaux de cadavres mutilés, ou lorsque Gareth et son ami Indien sont menacés d’être déchiquetés par une moissonneuse.
La menace fantoche
A vrai dire, la menace qui pèse sur les habitants n’est pas très claire. Les enfants agissent parfois comme de simples tueurs, utilisent d’autres fois des méthodes vaudou en poignardant une statuette en bois, à moins qu’ils ne laissent agir l’entité diabolique elle-même. Le scénario s’efforce maladroitement d’expliquer l’origine du mal, en nous apprenant que de vieux épis de maïs contaminés ont été mélangés avec des épis sains afin de faire des économies, créant des toxines provoquant la démence des enfants. Mais cette explication ne justifie pas pour autant la présence du démon surnaturel qui rode sous la terre. A l’unisson de ce scénario indécis, les effets visuels partent un peu dans tous les sens, alternant les nuages noirs en aquarium, les arcs électriques en rotoscopie ou les hideuses visions subjectives solarisées héritées du film précédent. Les effets numériques commençant alors à se populariser progressivement, un morphing final montre le visage de Micah se transformer en faciès démoniaque avant d’exploser en morceaux. Stephen King refusa catégoriquement d’être associé à cette séquelle, ce qui n’empêcha pas les producteurs de faire apparaître son nom au générique.
© Gilles Penso
Partagez cet article