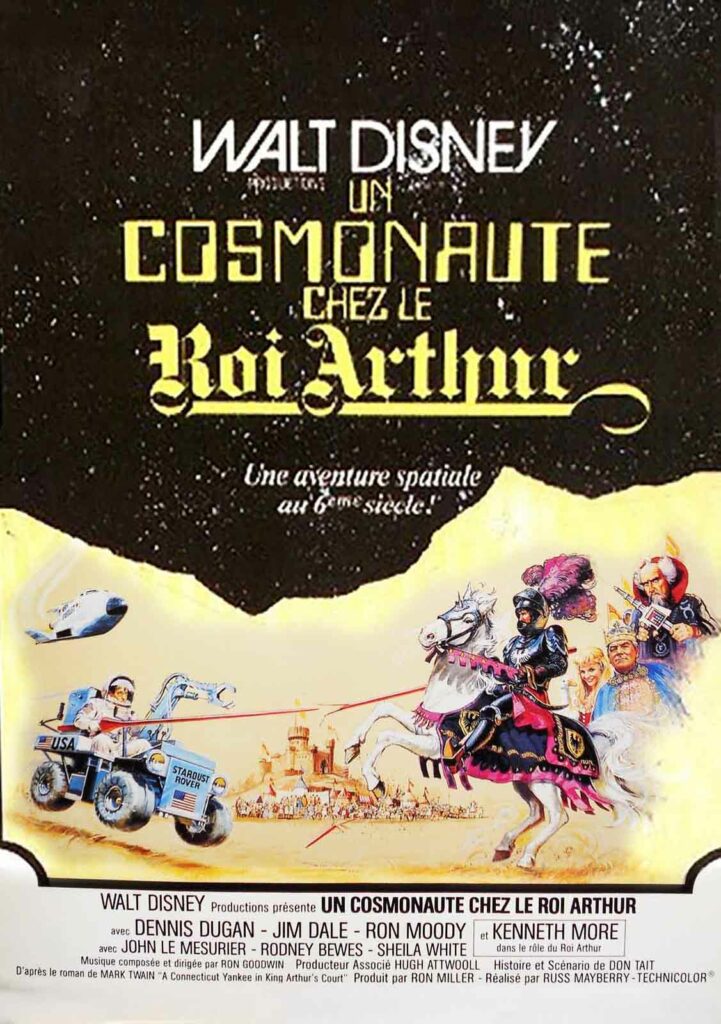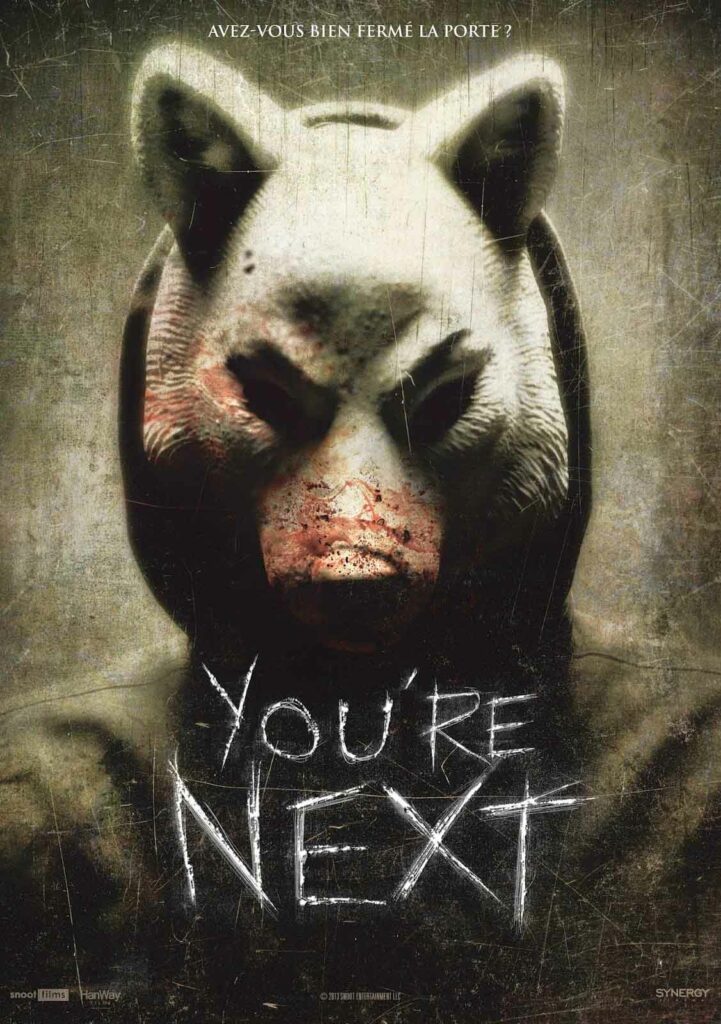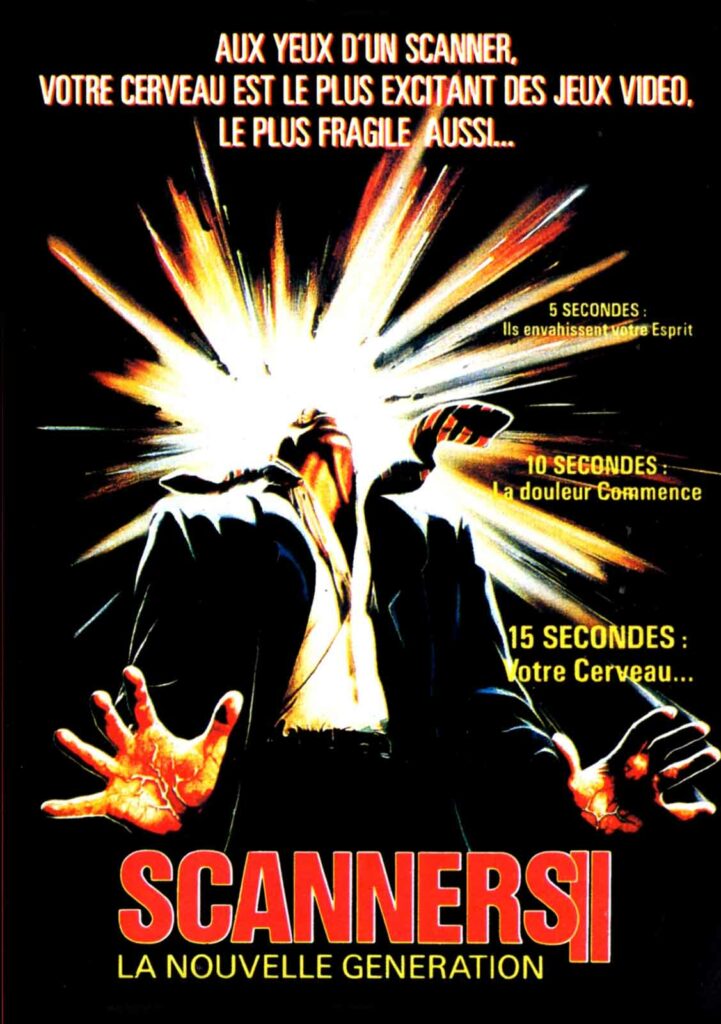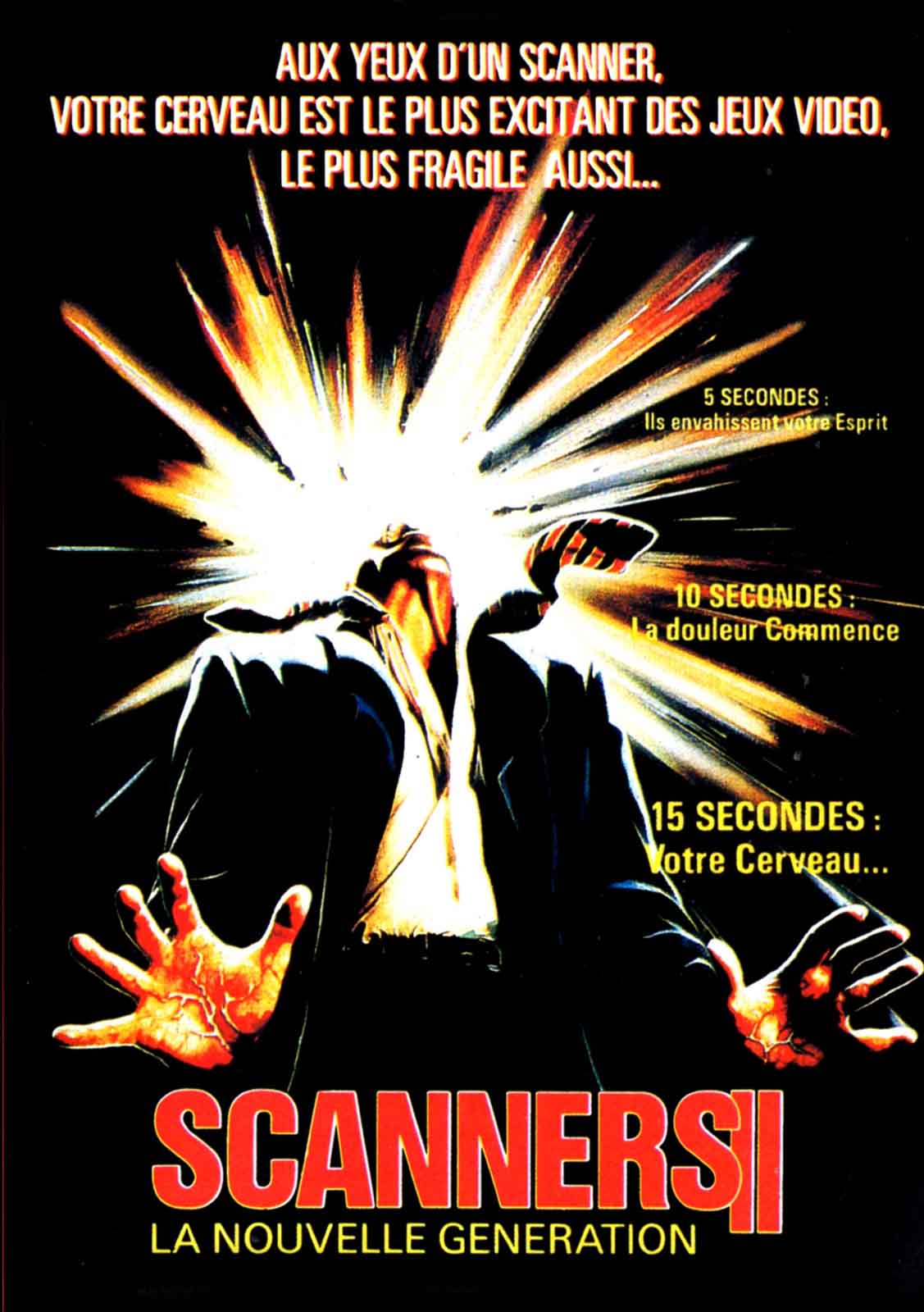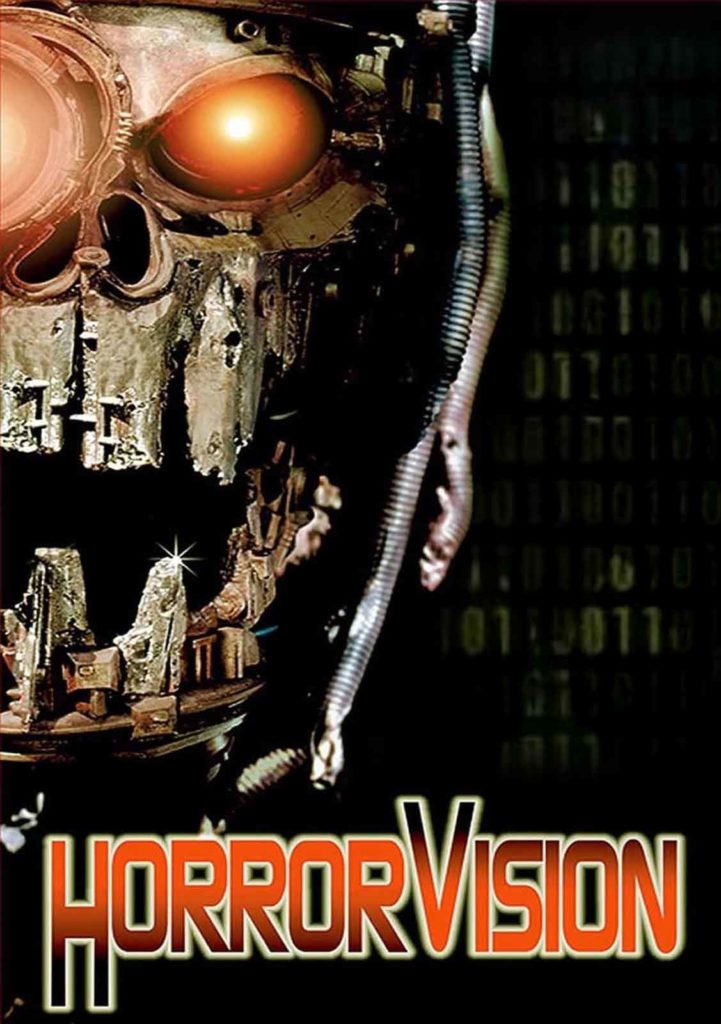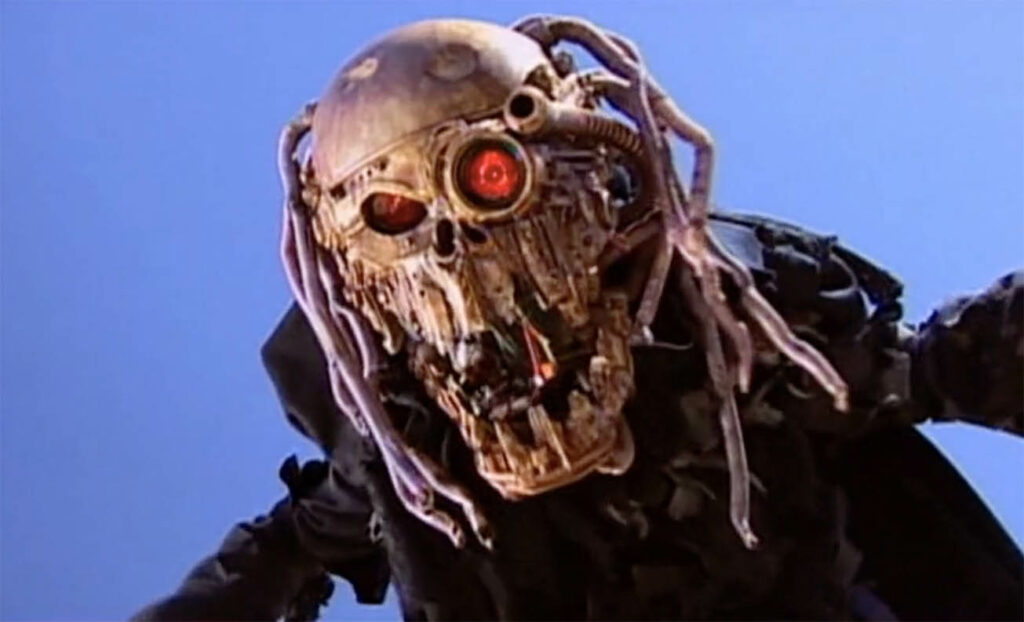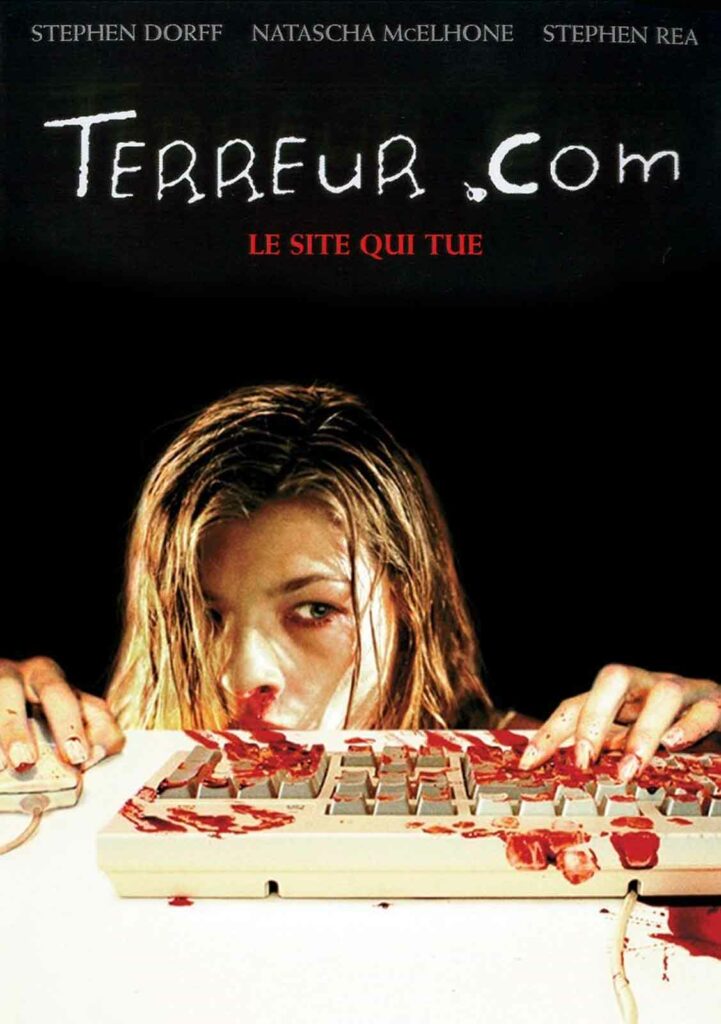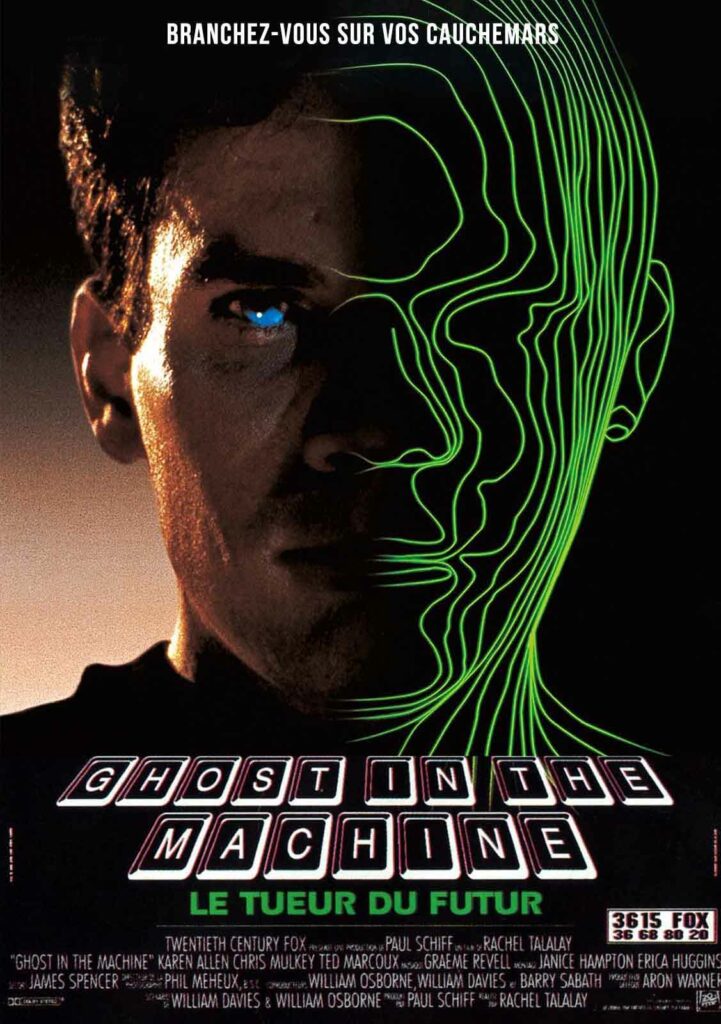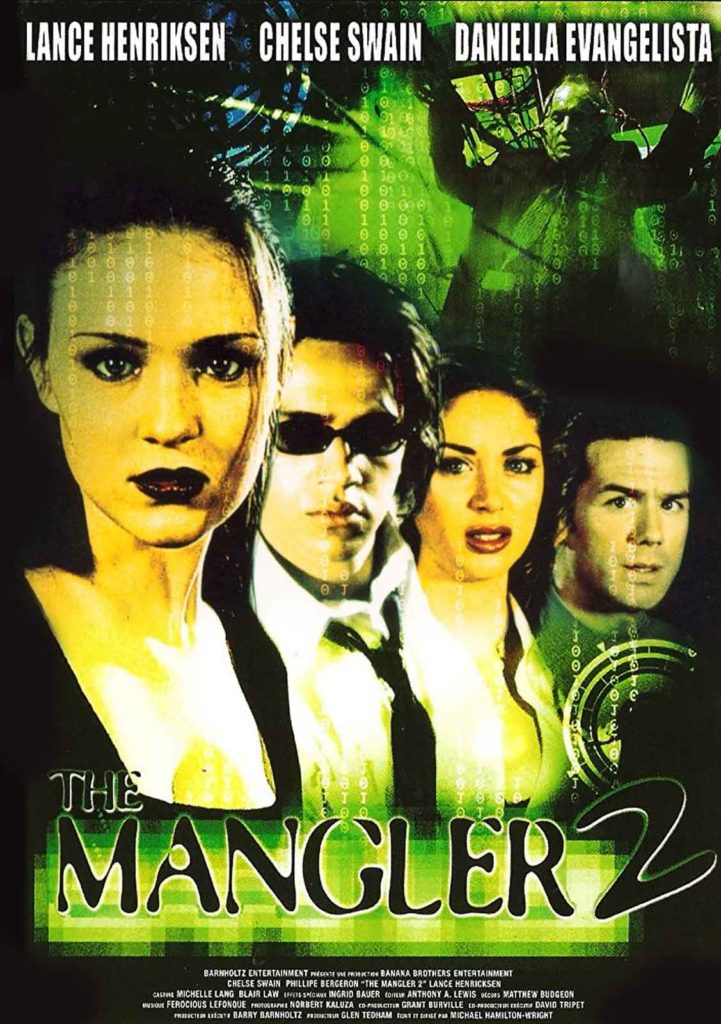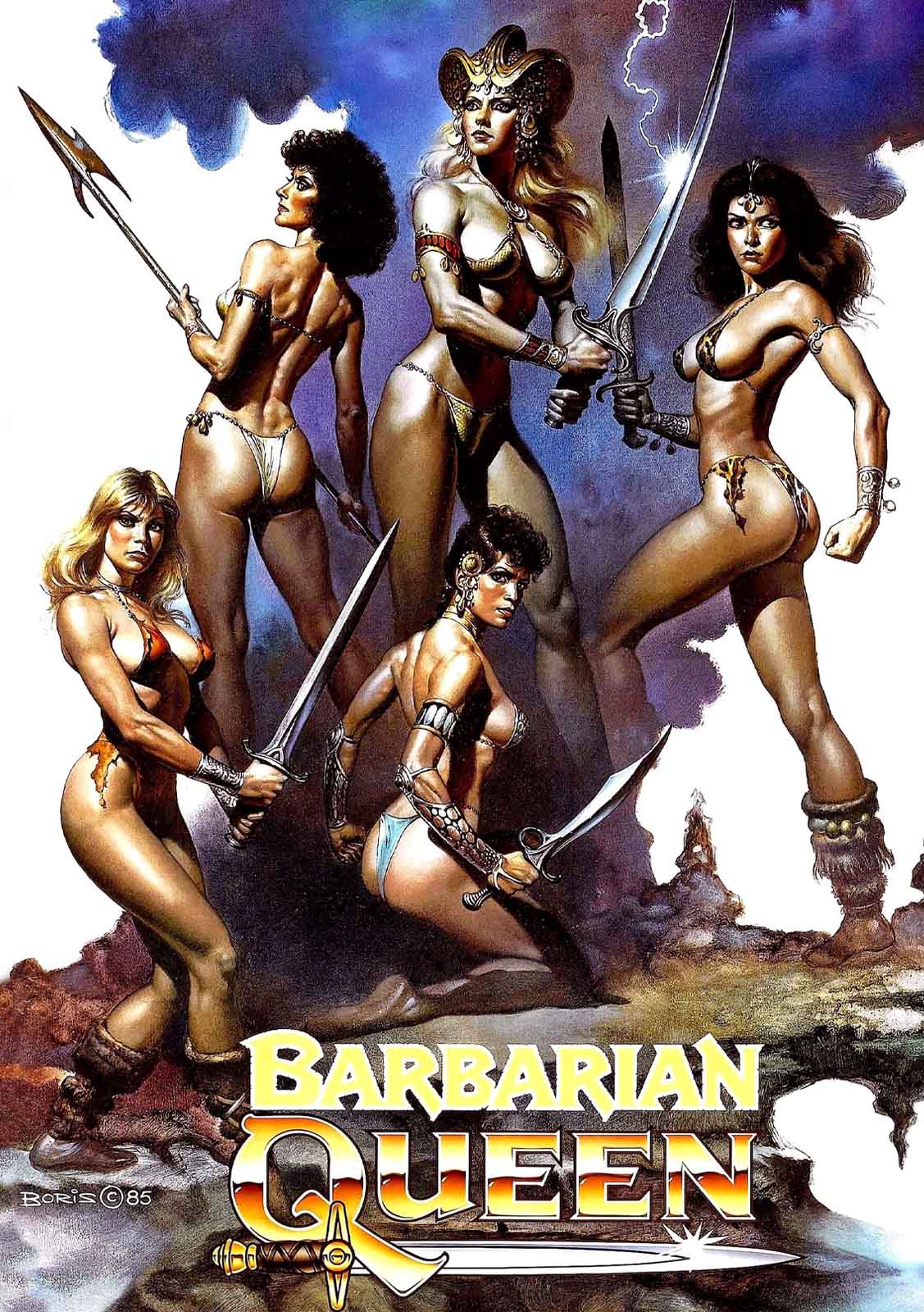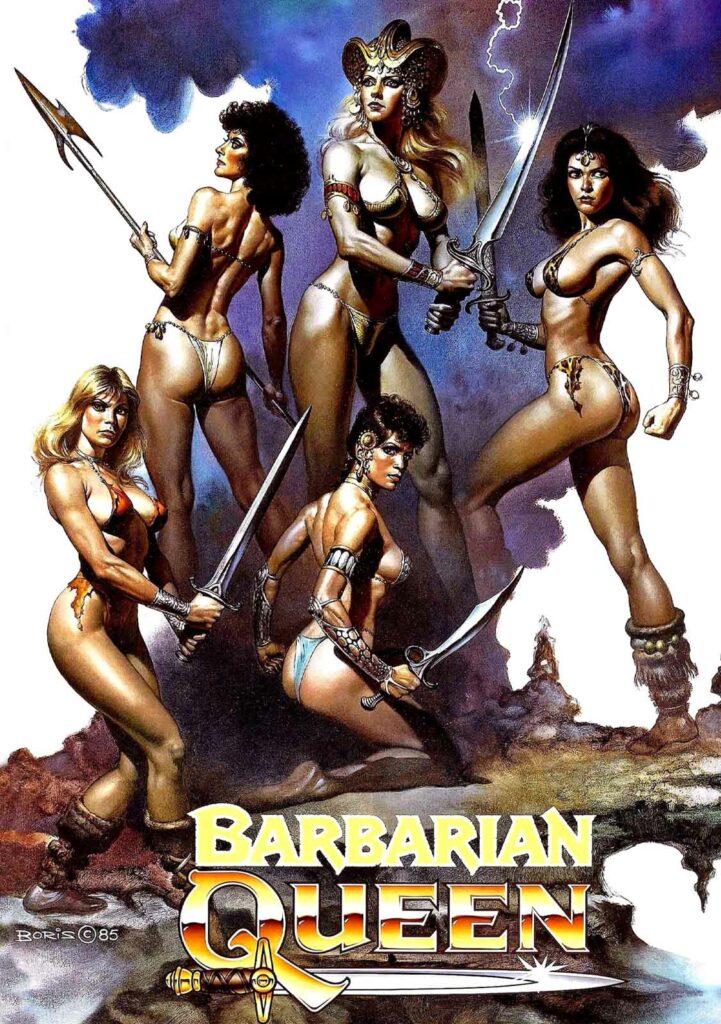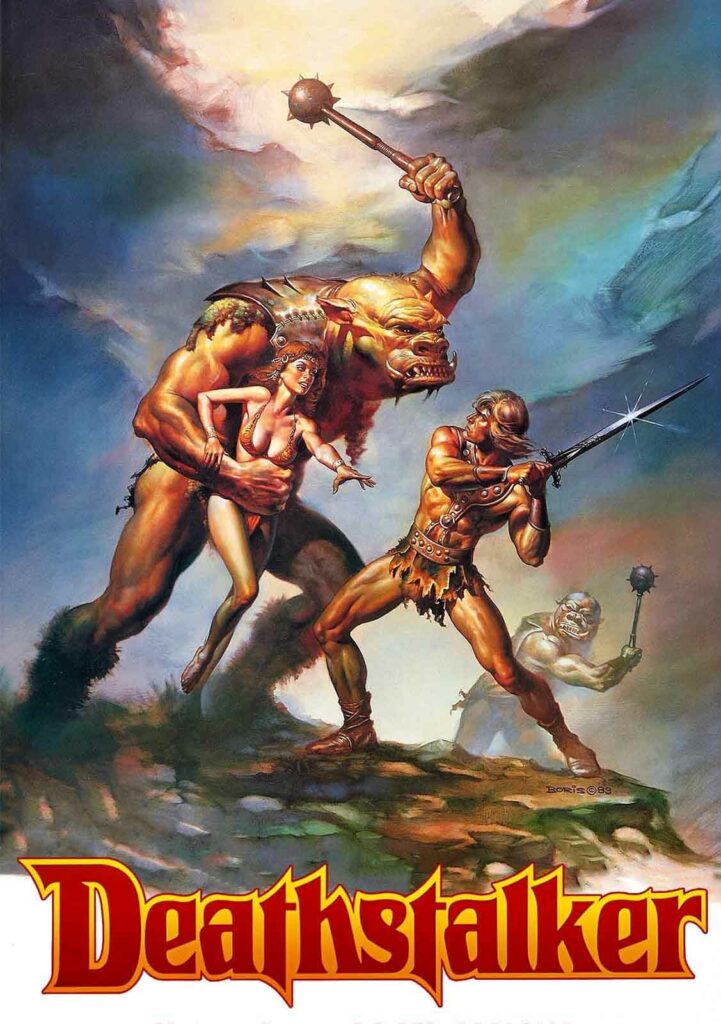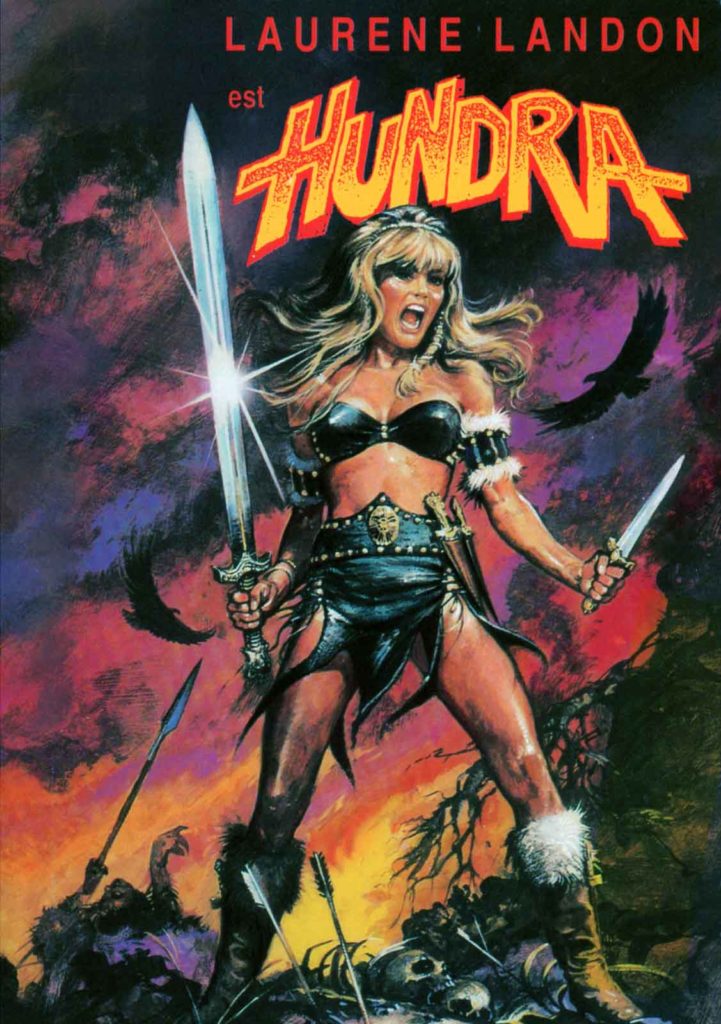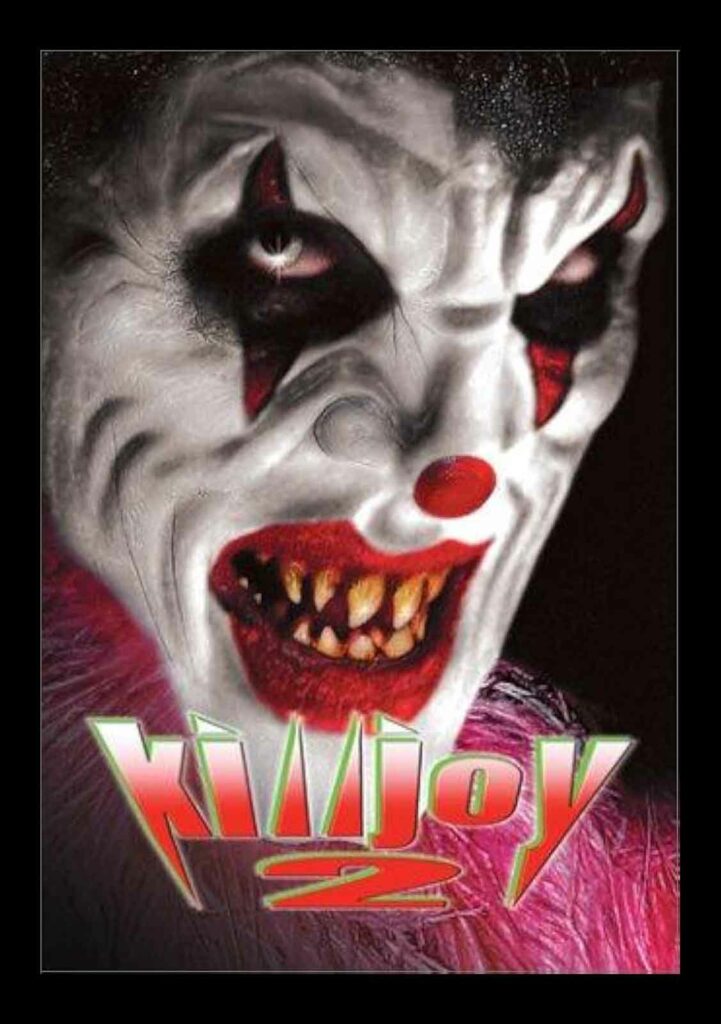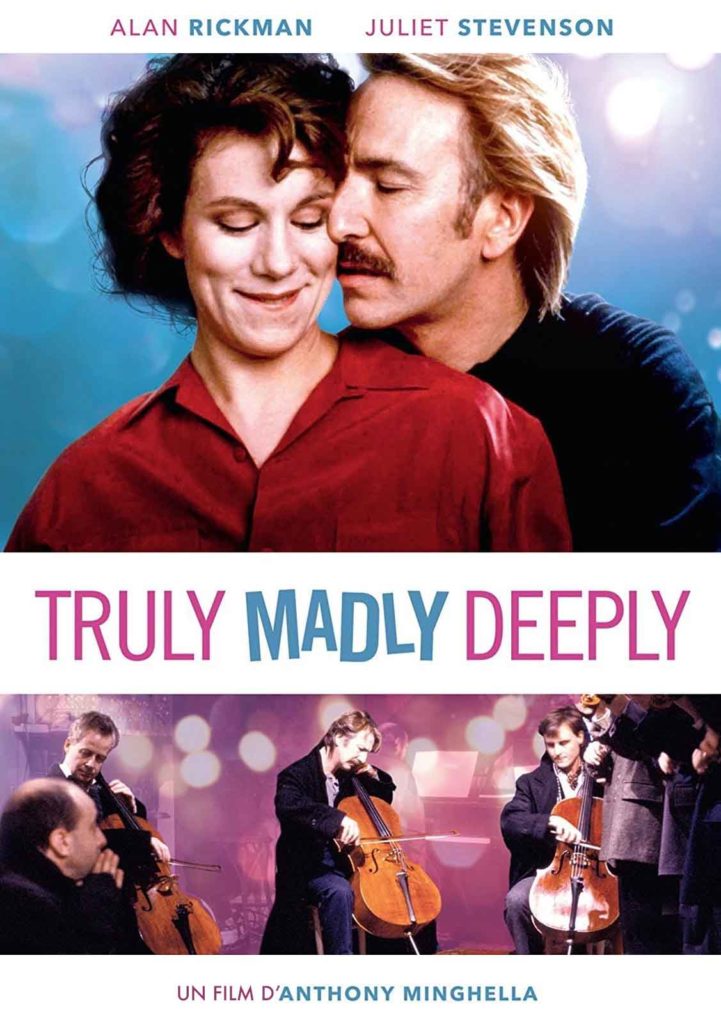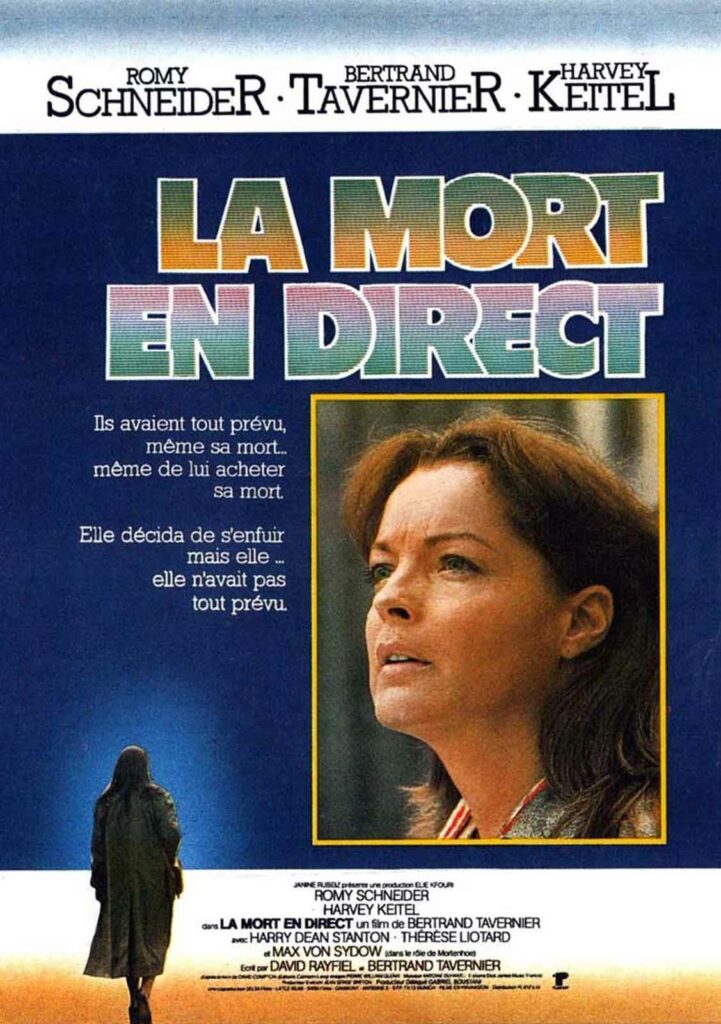Une jeune fille solitaire se venge de ceux qui lui causent du tort grâce à une horde d’énormes araignées apprivoisées…
KISS OF THE TARANTULA
1975 – USA
Réalisé par Chris Munger
Avec Suzanne Ling, Eric Mason, Patricia Landon, Herman Wallner, Beverly Eddins, Jay Scott, Rebecca Eddins, Rita French, W. James Eddins, Jared Davis
THEMA ARAIGNÉES
Développé à partir de 1972 sous le titre Tarantula, sans pour autant présenter le moindre lien avec le classique homonyme de Jack Arnold, Le Baiser de la tarentule est au départ censé être réalisé par John Hayes (Dream No Evil, Bébé vampire, Le Jardin des morts). Le tournage est planifié pour se dérouler à l’automne 1974 en Californie, mais trouver une jeune actrice principale qui n’aura aucun problème pour côtoyer de très près des dizaines de tarentules n’est pas une mince affaire. Le film ne se tournera finalement qu’en décembre avec un autre réalisateur, Chris Munger, qui n’a à son actif qu’un seul autre long-métrage, le drame Black Starlet. C’est finalement à Columbus, Géorgie, que se déroulent les prises de vues, la majorité des rôles étant confiés à des habitants de la région (dont quatre membres de la même famille, les Eddins, pour incarner plusieurs personnages clés du scénario). Suzanne Ling, l’heureuse élue choisie pour tenir le haut de l’affiche aux côtés d’une horde de partenaires velues à huit pattes, est inconnue au bataillon, et n’apparaîtra d’ailleurs dans aucun autre film à notre connaissance. Elle s’en tire pourtant avec les honneurs et assure ce rôle principal complexe avec une certaine conviction.


La petite Susan Bradley (Rebecca Eddins) est passionnée par les araignées, une fascination qui répugne profondément sa mère Martha (Beverly Eddins). Cette dernière déteste tout autant son mariage avec John (Herman Wallner), un entrepreneur de pompes funèbres. Frustrée par sa vie, la mégère entretient une liaison secrète avec Walter (Eric Mason), le frère policier de John, et élabore même un sombre plan pour se débarrasser de son mari. En les entendant comploter, Susan décide de réagir. Elle sort donc une énorme tarentule qu’elle gardait précieusement dans un aquarium et la glisse dans le lit de Martha. Terrifiée, la mère est victime d’une attaque cardiaque. Les années passent. Susan devient une jeune femme séduisante (Suzanne Ling), mais son étrange passion pour les tarentules reste intacte : elle en fait une véritable collection. Alors que son oncle Walter commence à la couver d’un regard libidineux, Susan devient la cible des moqueries de jeunes de son âge. Le soir d’Halloween, un groupe d’entre eux décide de s’introduire chez elle pour dérober un cercueil dans le showroom de son père. Mais leur intrusion tourne mal : ils tombent sur les précieuses araignées de la jeune femme et en tuent une. Susan prépare alors sa vengeance…
Prends garde car l’araignée est là !
Le scénario relativement basique du Baiser de la tarentule semble vouloir décliner celui de Willard en remplaçant les rats par des araignées. On pense aussi beaucoup à Carrie, même si dans ce cas le jeu des influences ne peut pas avoir joué puisque le classique de Brian de Palma n’est sorti que l’année suivante. Accompagnée par une musique synthétique entêtante de Philian Bishop (Messiah of Evil), Susan passe le plus clair de son temps à cajoler ses tarentules, les nourrir, leur parler et se confier à elles. Il faut saluer la pleine implication de la jeune actrice qui interagit sans aucun trucage avec les arachnides, tout comme le reste du casting. Le budget du film (150 000 dollars environ) ne permettant l’emploi d’aucun effet spécial, les bestioles se promènent en effet réellement sur le corps – et parfois le visage – des comédiens. Jay Scott, fournisseur des tarentules (de beaux et gros spécimens avec le corps et les pattes rayés), responsable des araignées sur le plateau et interprète d’une des victimes, effectue là un travail impressionnant. L’impact des séquences mettant en scène les invertébrés est d’autant plus fort que tout ce qui est vu à l’écran est réel. Les séquences de suspense jouent sur l’attente et la durée, laissant tranquillement les bébêtes ramper dans les lits, les voitures ou les conduits d’aération. Fait notable : ici, les araignées elles-mêmes ne tuent personnes mais provoquent des réactions horrifiées. Les gens meurent donc de peur ou se blessent mortellement dans la panique. La facture semi-amateur du métrage joue un peu en sa défaveur, mais le film reste efficace et développe quelques rebondissements inattendus jusqu’à son final cruellement ironique.
© Gilles Penso
À découvrir dans le même genre…
Partagez cet article