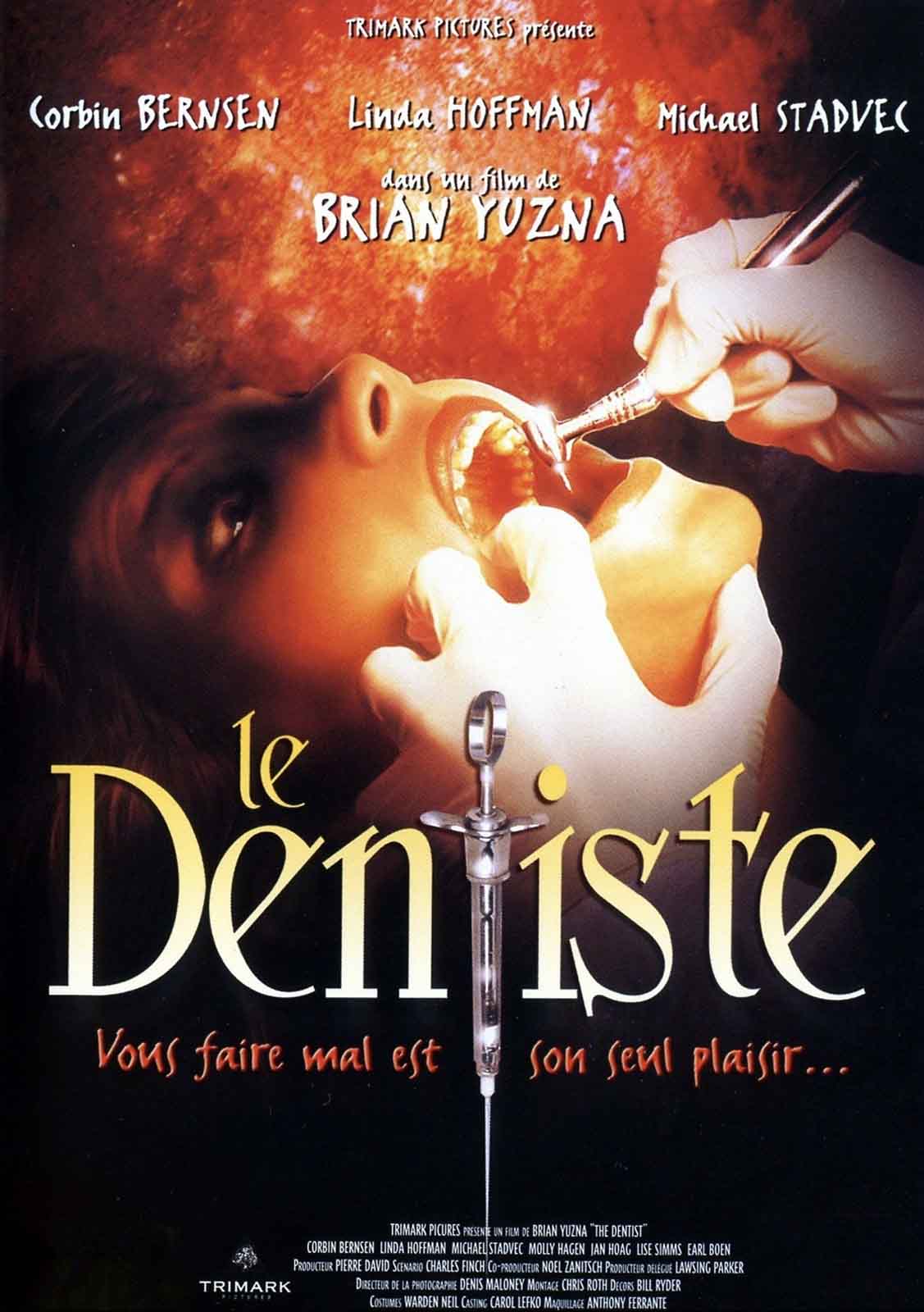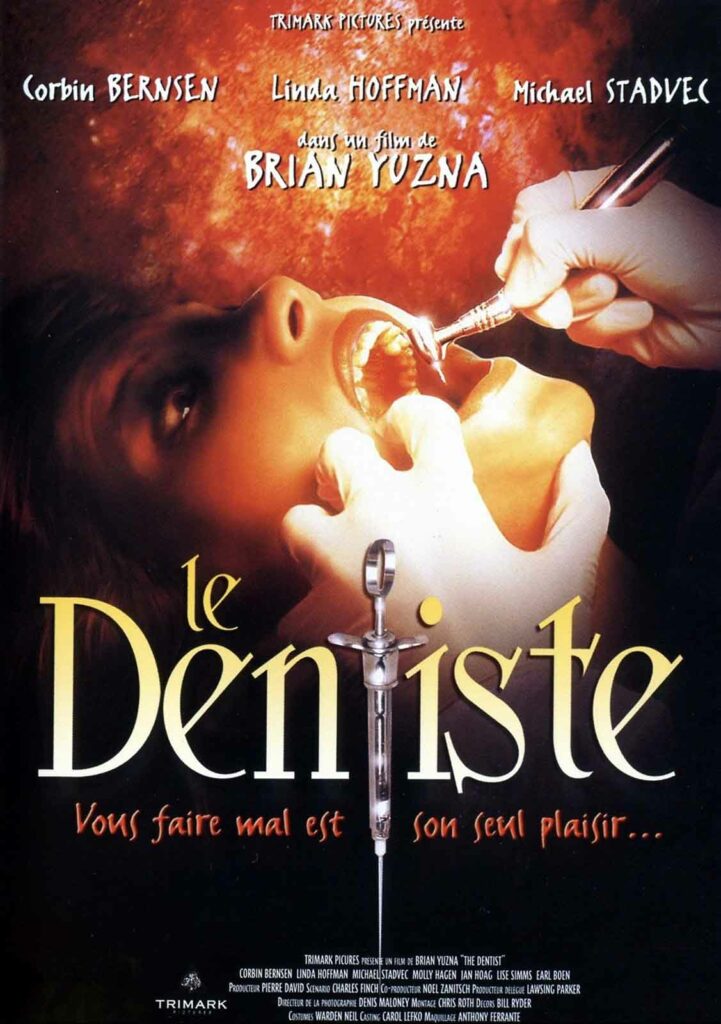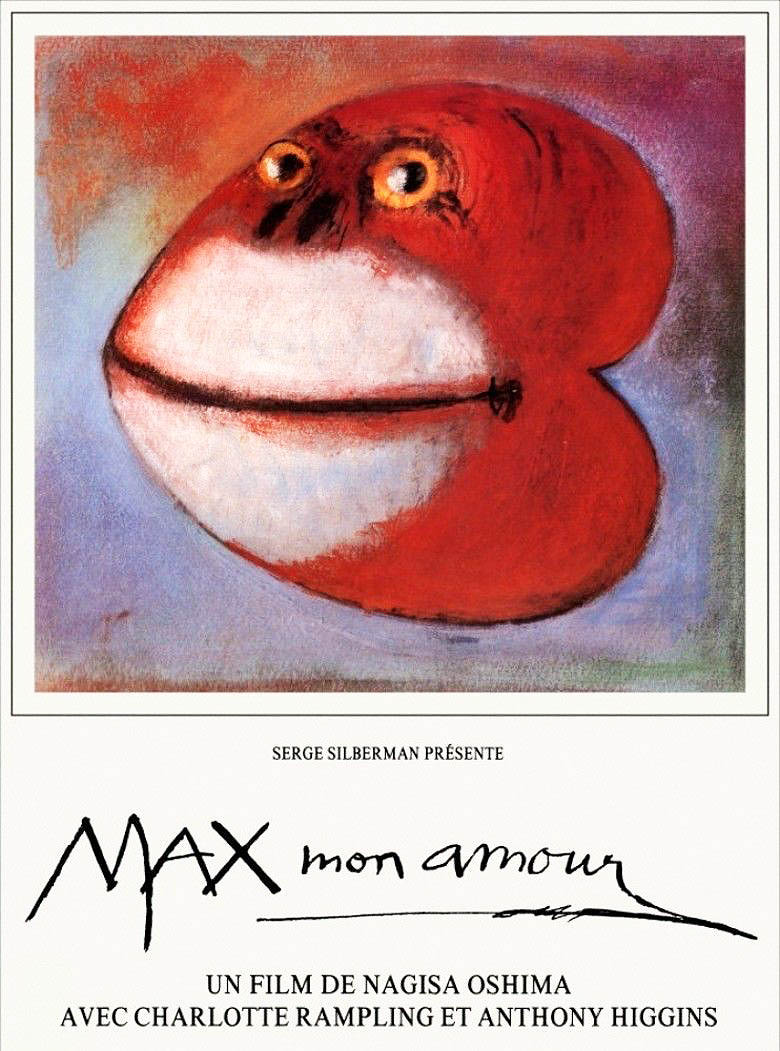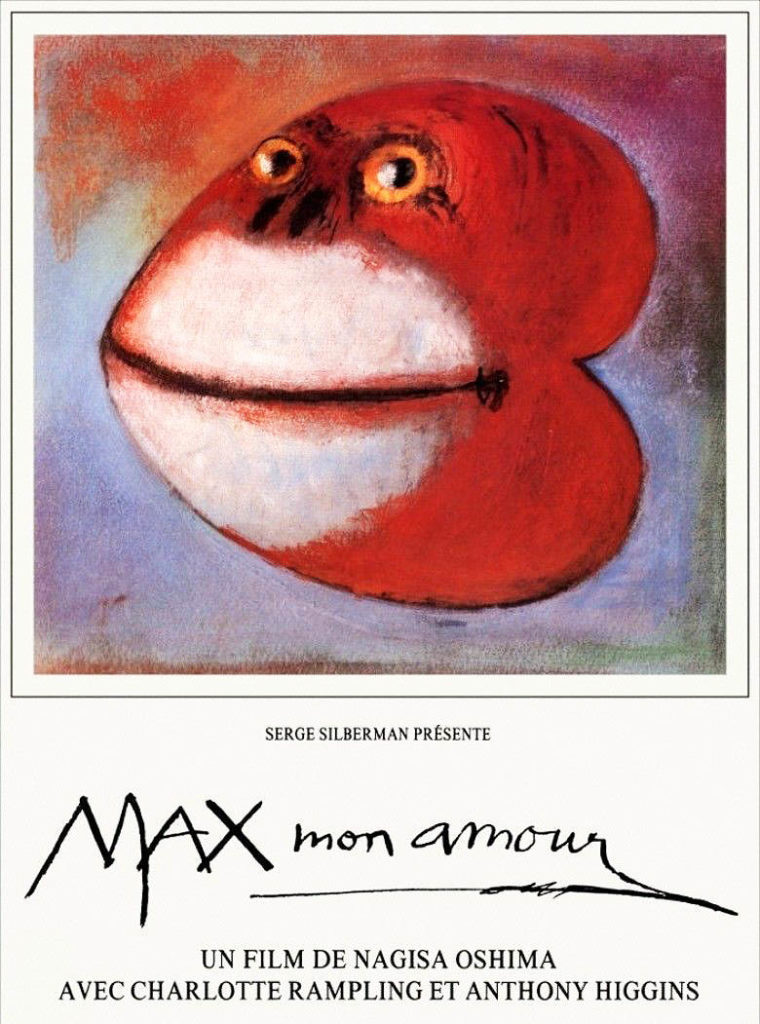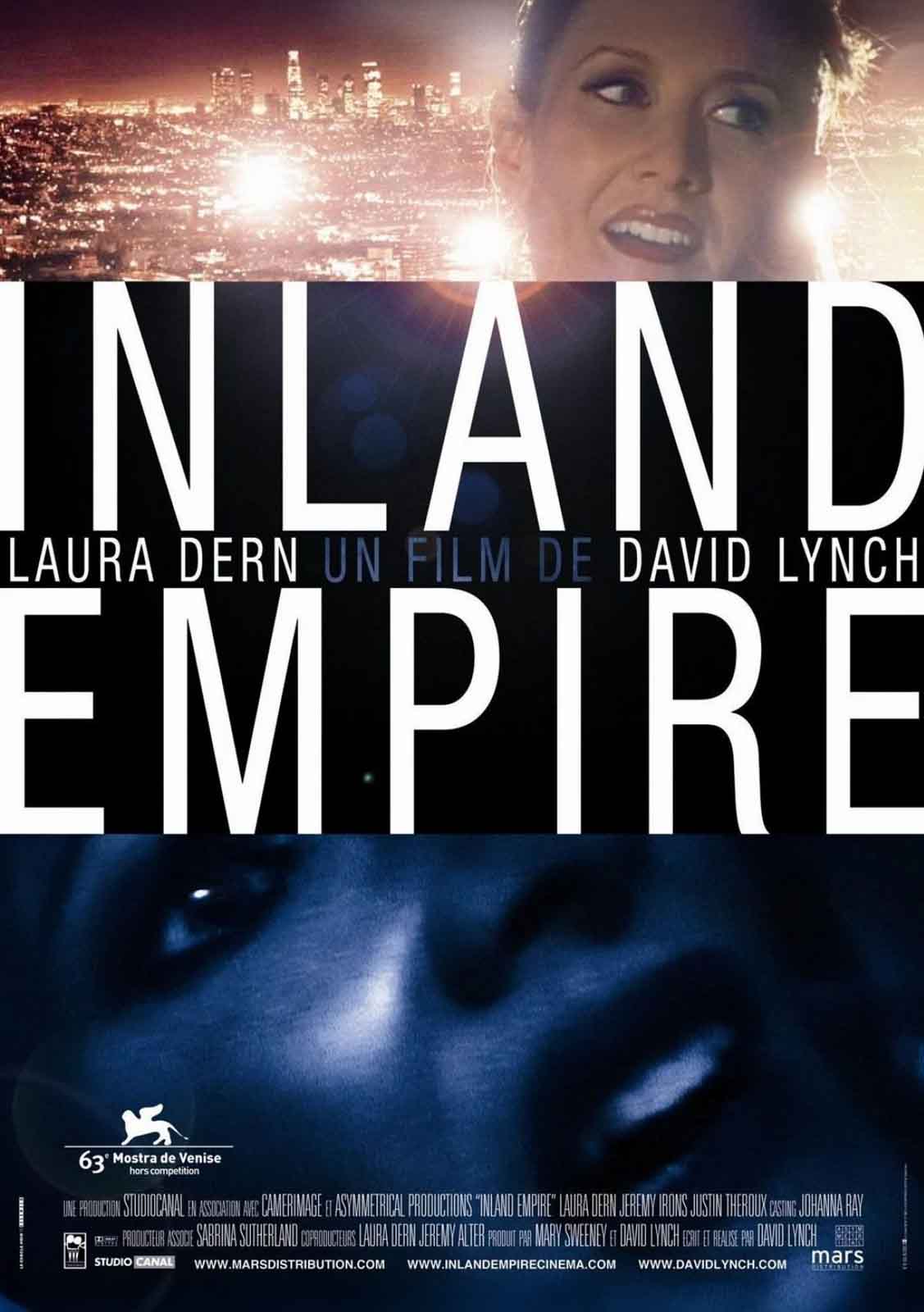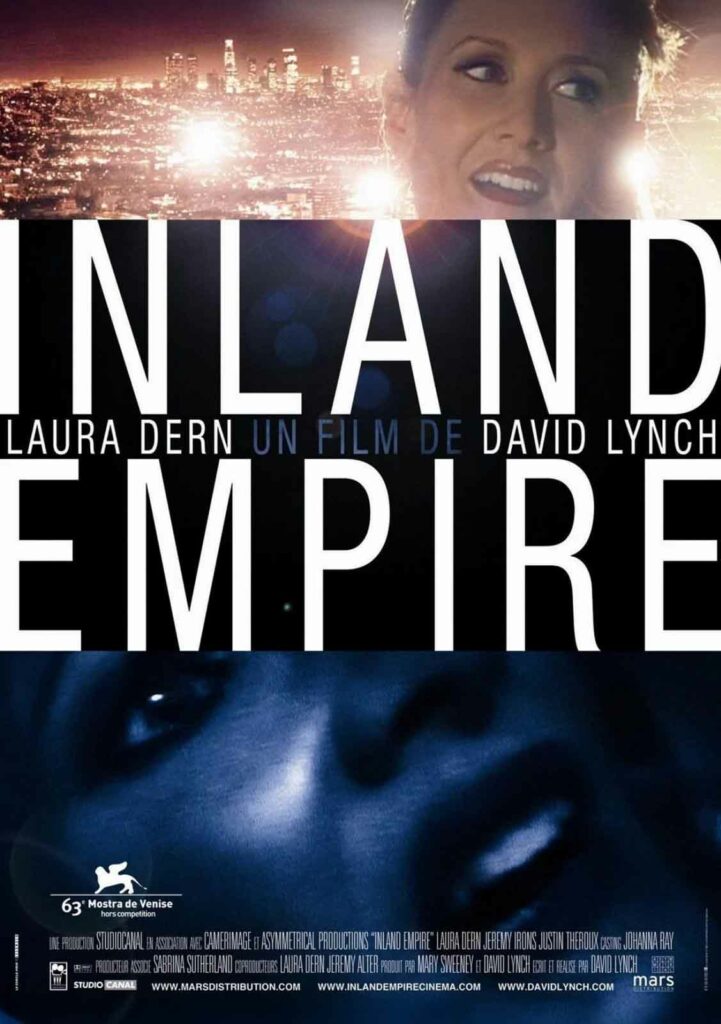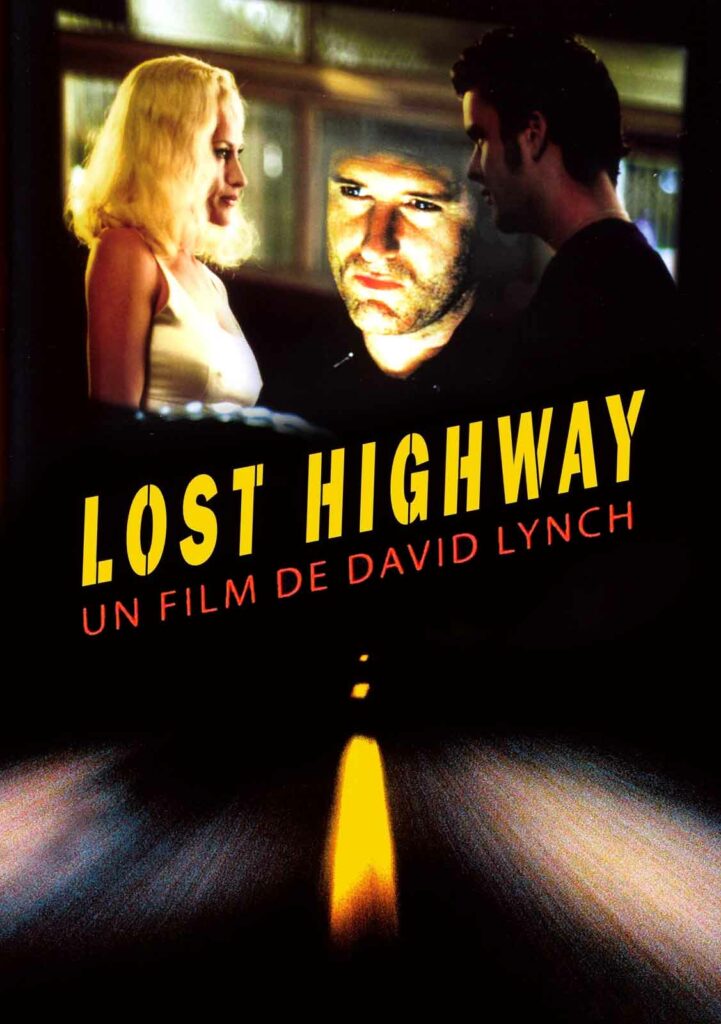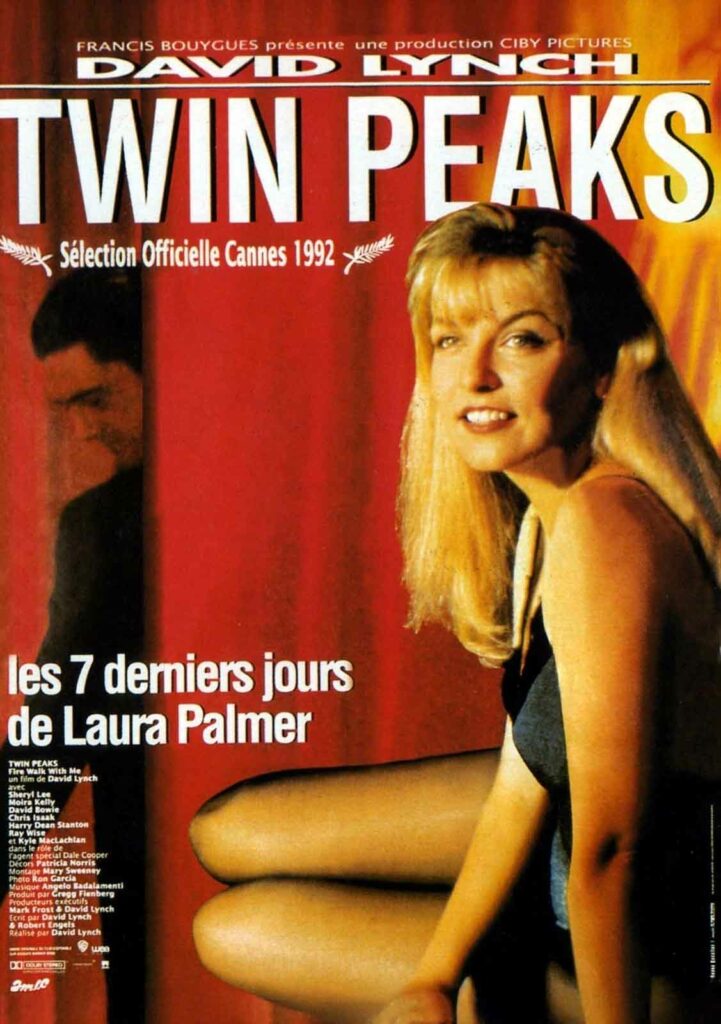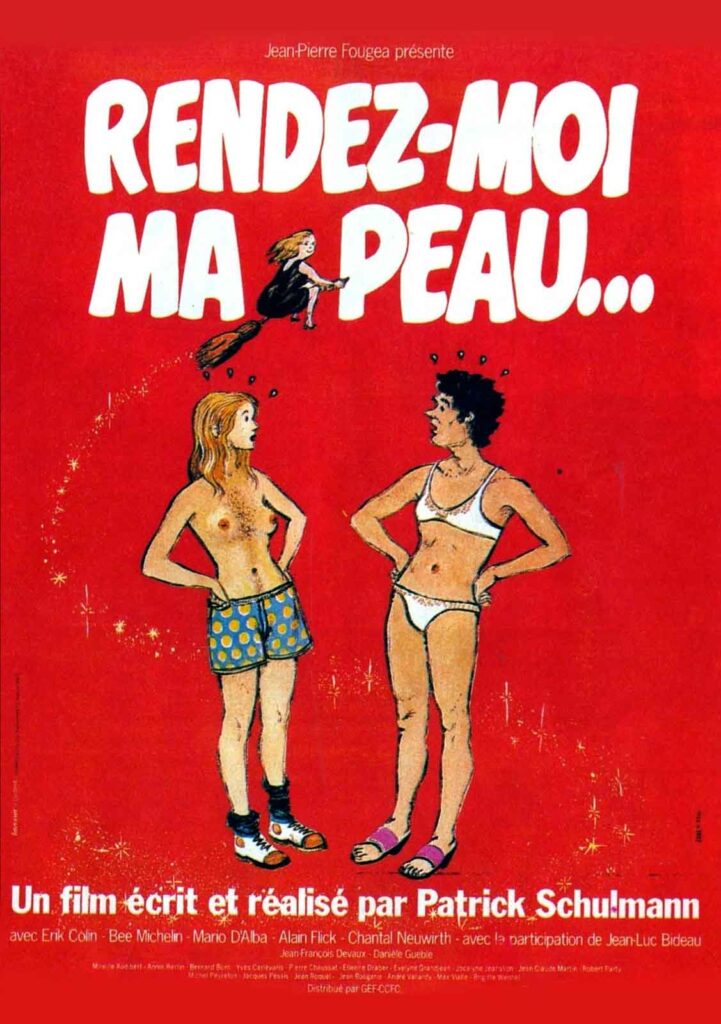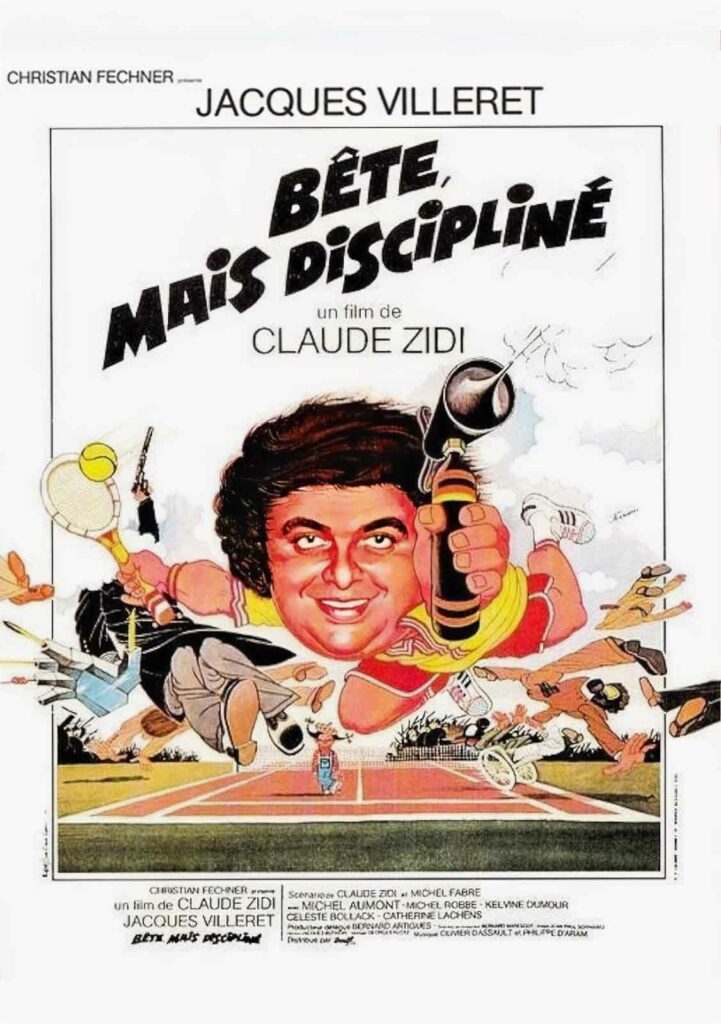Une fillette et son père vivent dans le huis-clos de leur appartement transformé en abri contre un monde extérieur menaçant. Mais d’où le danger vient-il ?
FREAKS
2018 – USA
Réalisé par Zach Lipovsky, Adam B. Stein
Avec Emile Hirsch, Bruce Dern, Lexy Kolker, Amanda Crew, Grace Park, Aleks, Paunovic, Michelle Harrison, Ava Telek
THEMA ENFANTS I POUVOIRS PARANORMAUX
Zach Lipovsky et Adam B. Stein sont des amoureux du genre fantastique, qu’ils ont exploré sous de nombreuses formes à travers des films variés aux budgets souvent étriqués. De la série Mech-x4 à l’adaptation live de Kim Possible en passant par Leprechaun Origins, Dead Rising ou Forever Boy, les duettistes ont œuvré séparément ou en duo sur une série d’œuvrettes sympathique mais pas vraiment destinées à passer à la postérité. La surprise que procure le visionnage de Freaks n’en est que plus grande. Étonnant, émouvant, effrayant, palpitant, leur premier long-métrage pour le cinéma est une bombe qui transcende un thème connu pour le réinventer sous un angle résolument original. Rien dans la filmographie précédente de Lipovsky et Stein ne laissait présager un tel choc. Et si le titre semble abusivement usurpé au classique de Tod Browning, les deux films n’ayant à priori rien en commun, le Freaks de 1932 et celui de 2018 sont pourtant unis par un leitmotiv commun : les conséquences destructrices de la peur de la différence de l’autre, avec pour corollaire la relativité des notions de normalité et de monstruosité.


Le film garde ses mystères un bon moment, accumulant l’étrangeté, la bizarrerie et l’inquiétude, distillant chichement les indices nous permettant petit à petit de comprendre la situation. Mais tout finit par s’expliquer progressivement, et le tableau qui se révèle n’a rien de rassurant. Notre point d’identification est Chloé, une petite fille de sept ans qui vit cloitrée chez elle avec son père. Leur maison est dans un drôle d’état, toutes les fenêtres sont bouchées, la porte est fermée à triple tour. Tous deux vivent visiblement en huis-clos depuis bien longtemps. Mais chaque fois que la tentation de mettre le nez dehors est trop forte, les arguments du père sont sans appel : le monde extérieur est dangereux, sinistre, mortel. Il ne faut sortir sous aucun prétexte. Pourtant, lorsque Chloé entraperçoit furtivement l’extérieur à travers deux morceaux de ruban adhésif collés sur les vitres, la lumière est engageante, le ciel est serein, l’atmosphère semble paisible. Son père est-il paranoïaque ? Fou ? Dissimulateur ? Lui cache-t-il des choses ? Aurions-nous affaire à une variante masculine de la mère possessive de Bad Boy Bubby ? Un jour, attirée par la musique d’un marchand de glace ambulant, Chloé brave l’interdit et monte dans le camion du mystérieux Mr. Snowcone. Ce dernier lui apprend qu’elle est une petite fille très spéciale et que la société est divisée en deux catégories : les normaux et les anormaux…
L’enfer c’est les autres
Freaks s’appuie sur l’interprétation remarquable de sa poignée d’acteurs principaux. Emile Hirsch est poignant en père méfiant et anxieux dont les fêlures ne s’expliquent que par bribes. Le vétéran Bruce Dern nous laisse perplexes dans le rôle de ce vendeur de glaces bizarre qui cache bien son jeu. Quant à Lexy Kolker, c’est une véritable révélation. Sa prestation de fillette désemparée qui ignore tout de son incroyable potentiel laisse augurer une carrière prometteuse. Ce solide trio de comédiens est magnifié par une mise en scène stylisée, simple et élégante, secouée par des moments de fulgurance. Ces derniers sont principalement liés à la manifestation physique des « super-pouvoirs » des parias, ceux que le gouvernement craint et chasse impitoyablement, ces êtres à part qui seraient des super-héros chez Marvel ou DC, mais qu’on rabaisse ici au statut de monstres, de « freaks ». On pense aux X-Men, à Firestarter, à Carrie, à Furie, et pourtant Freaks ne ressemble ni à du Stephen King, ni à du Brian de Palma, ni à du Bryan Singer. C’est un film singulier, déconcertant, très prenant, qui ouvre des portes vers un semblant d’avenir meilleur mais laisse peu d’espoirs quant aux travers de la nature humaine, toujours rétive à côtoyer la différence et à faire preuve de tolérance.
© Gilles Penso
Partagez cet article