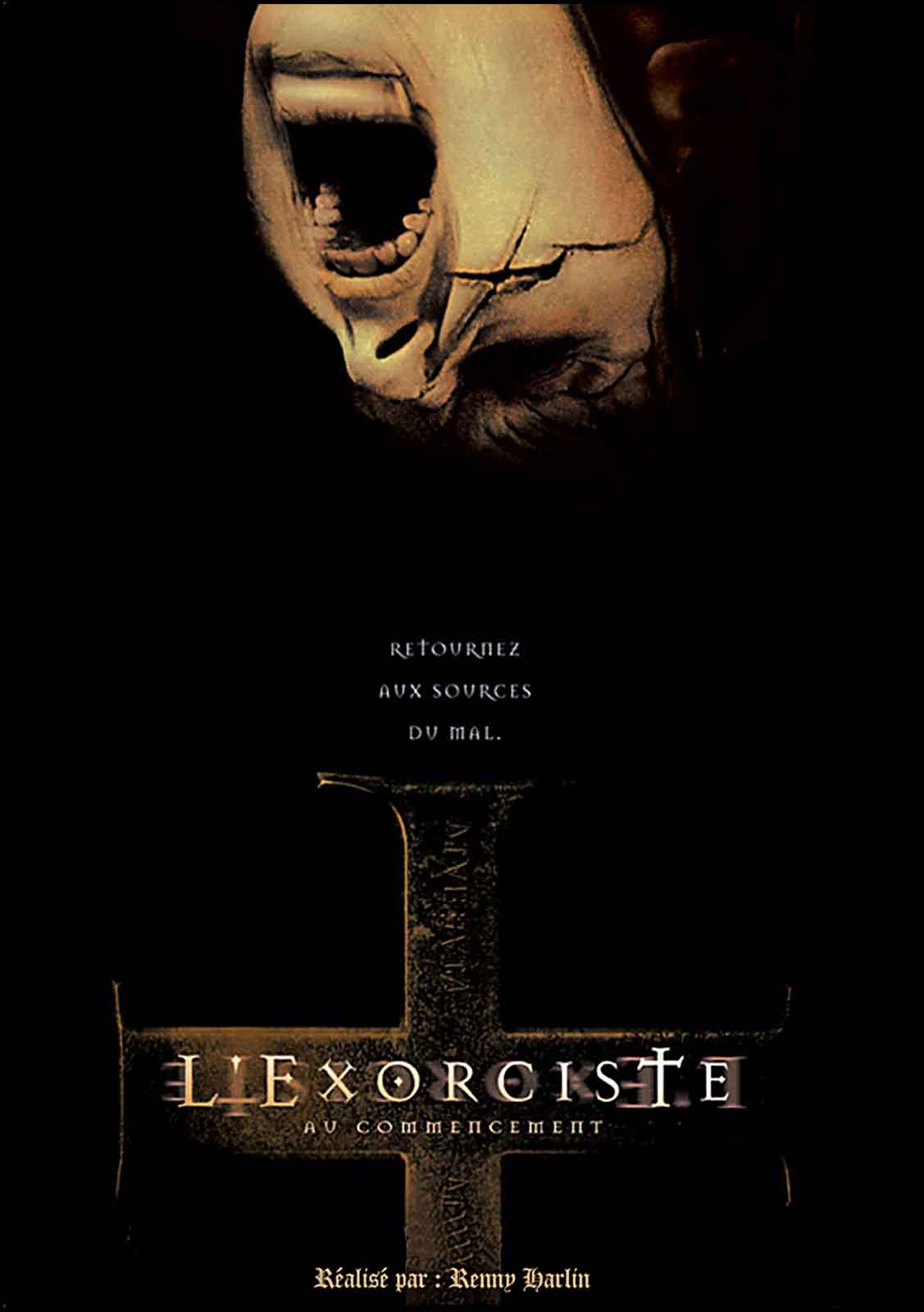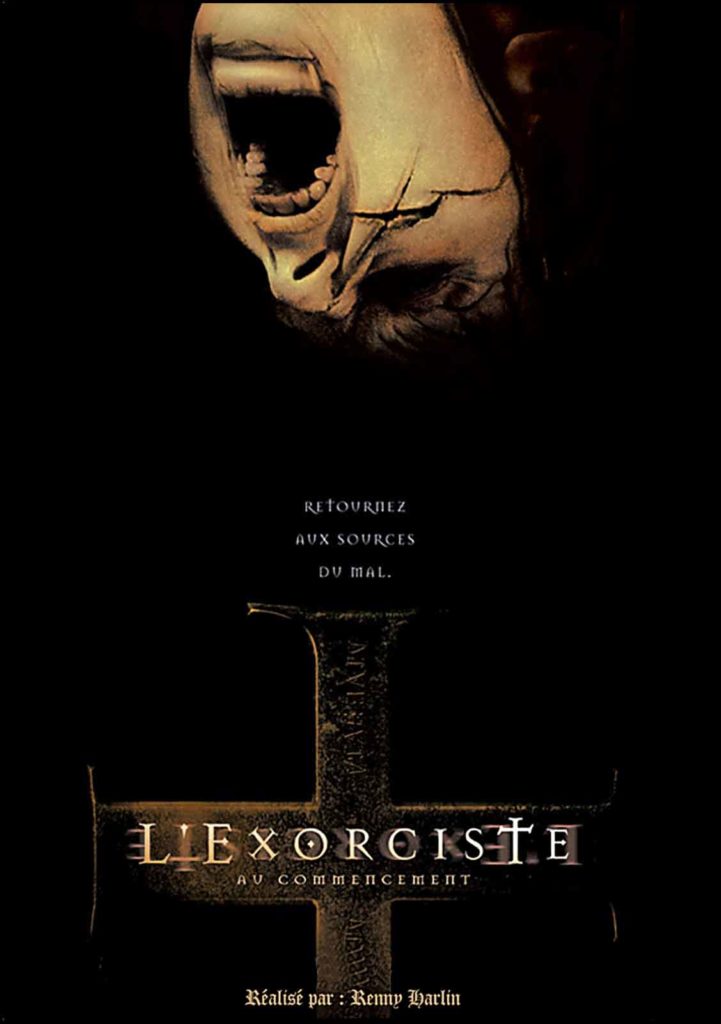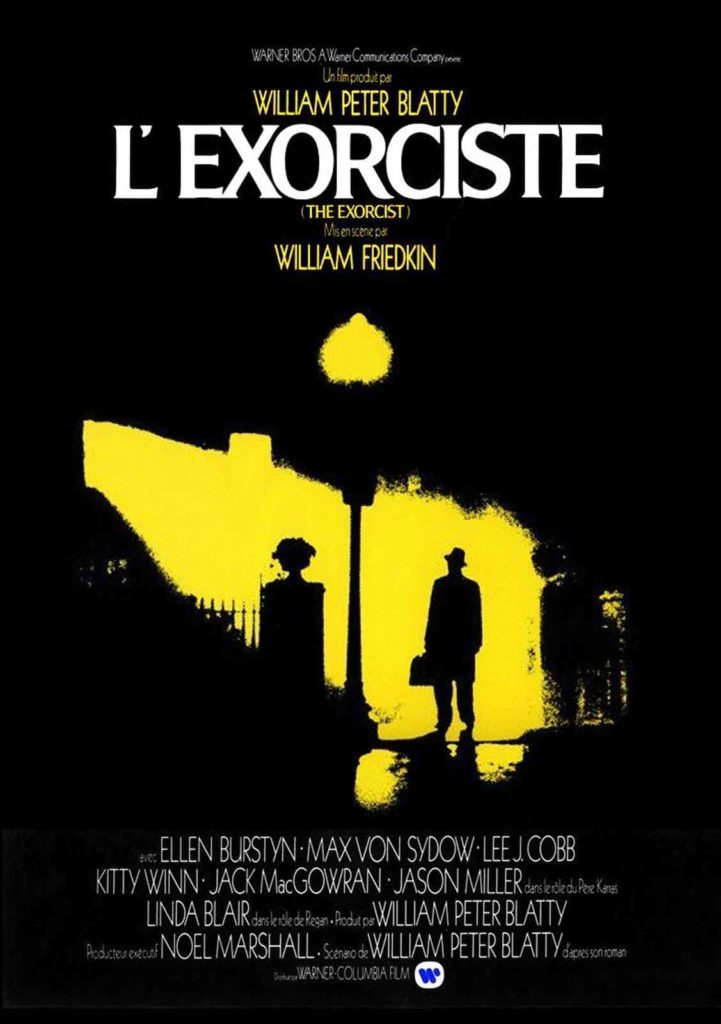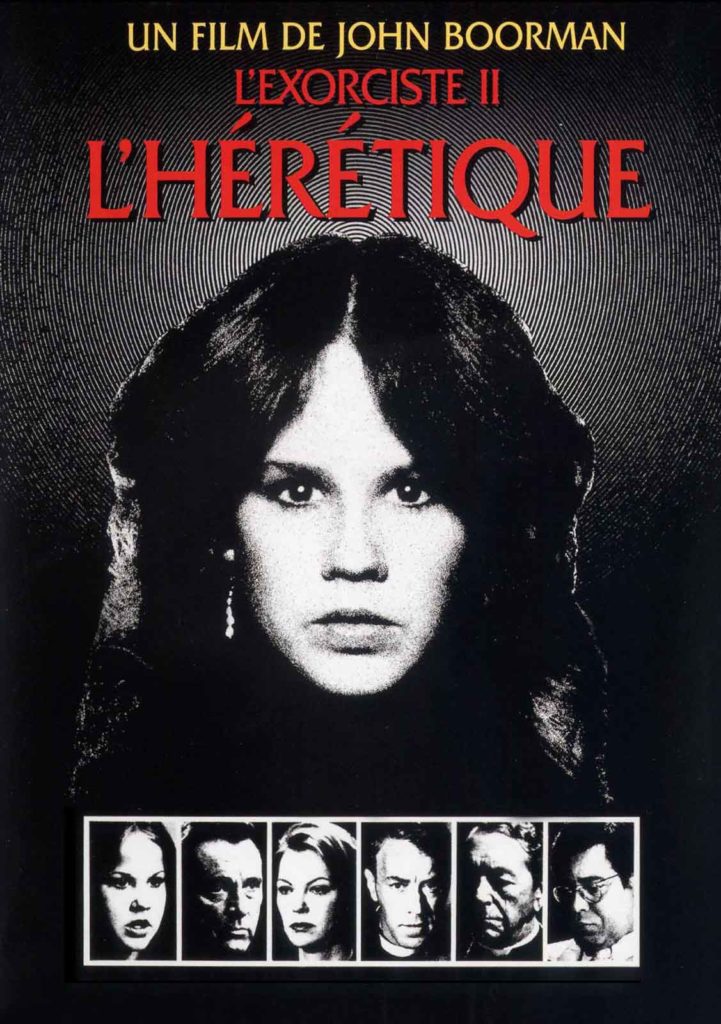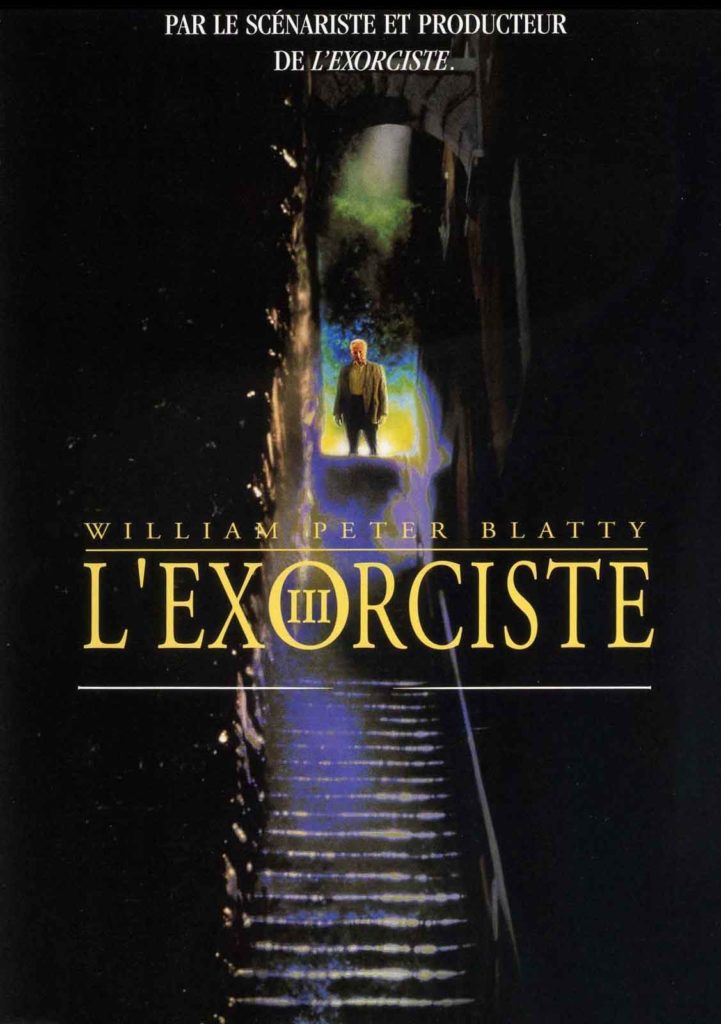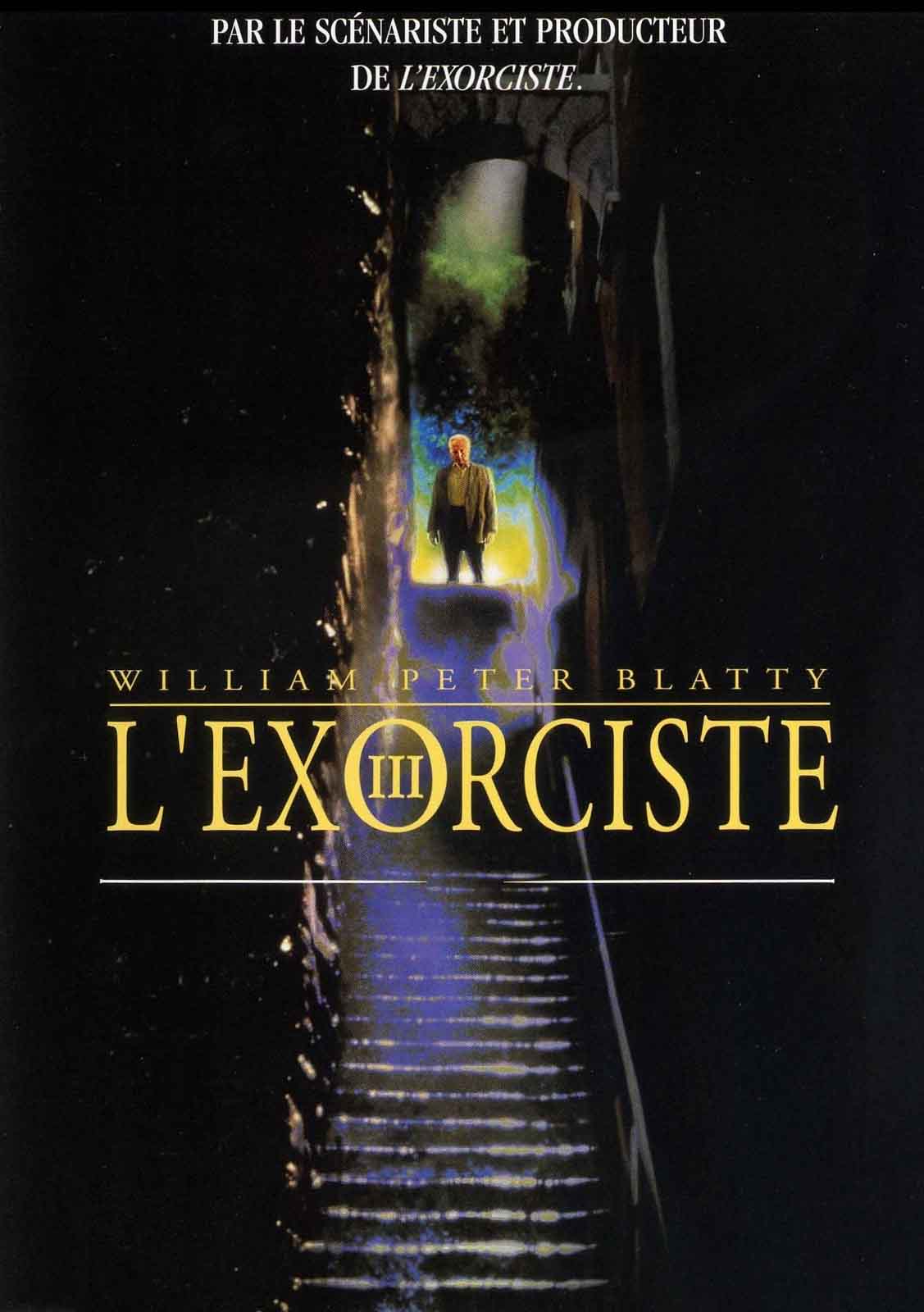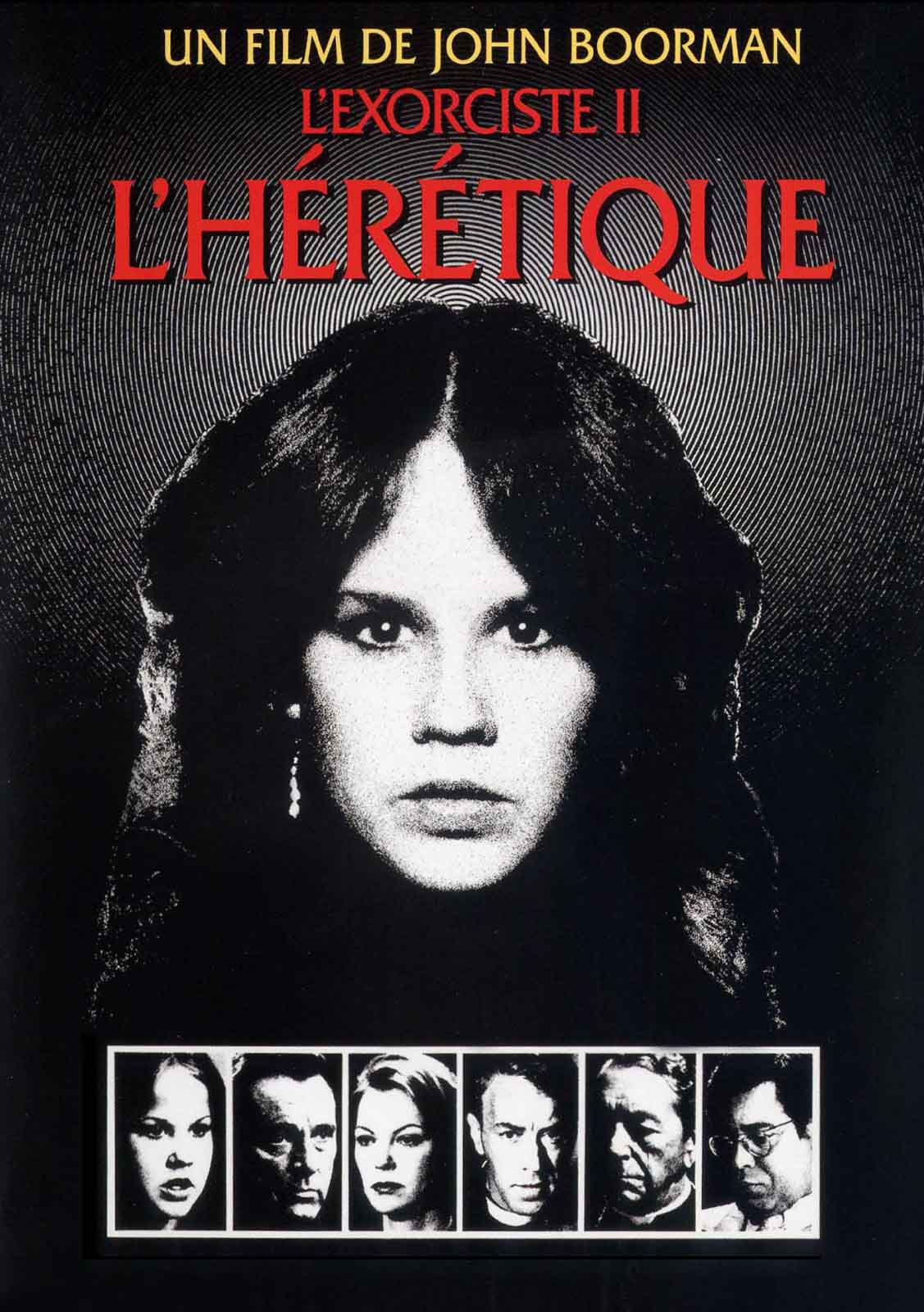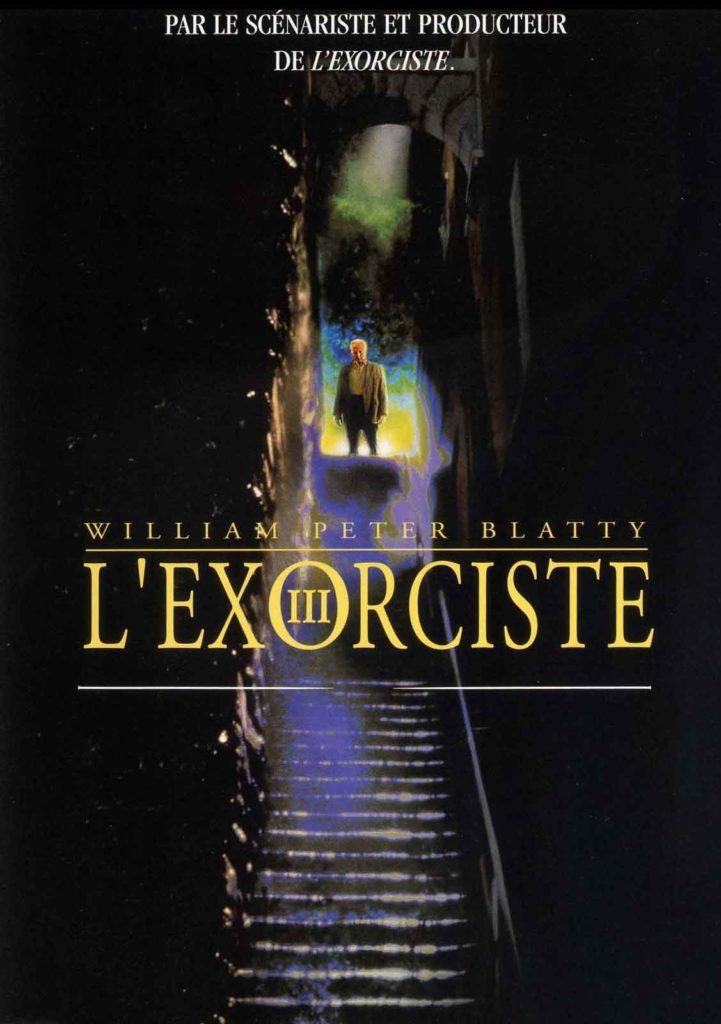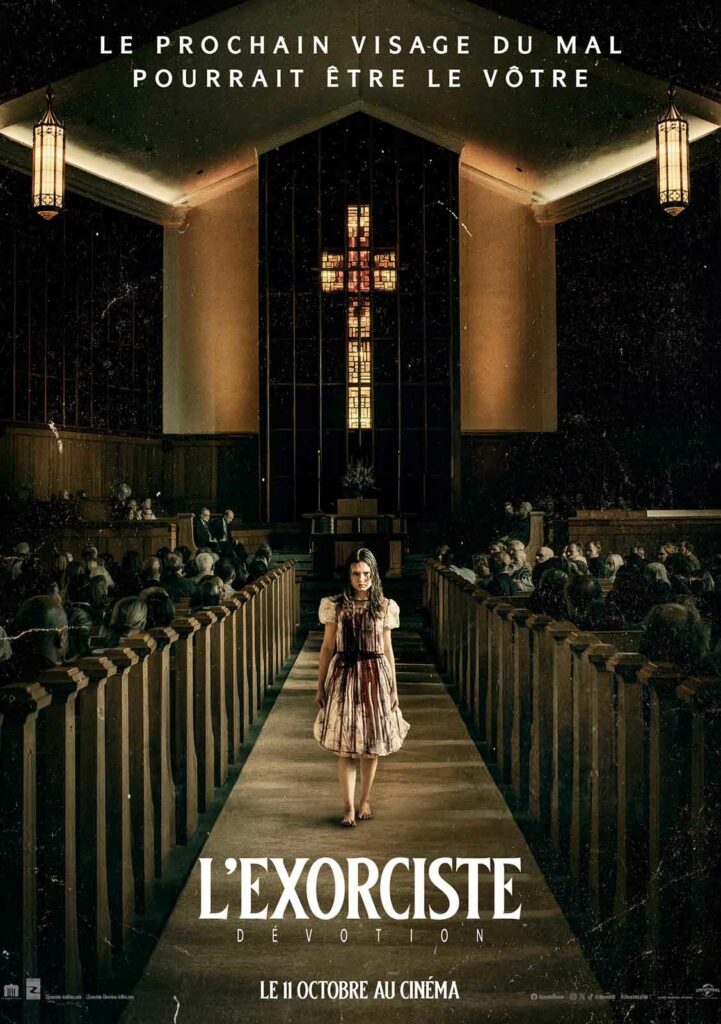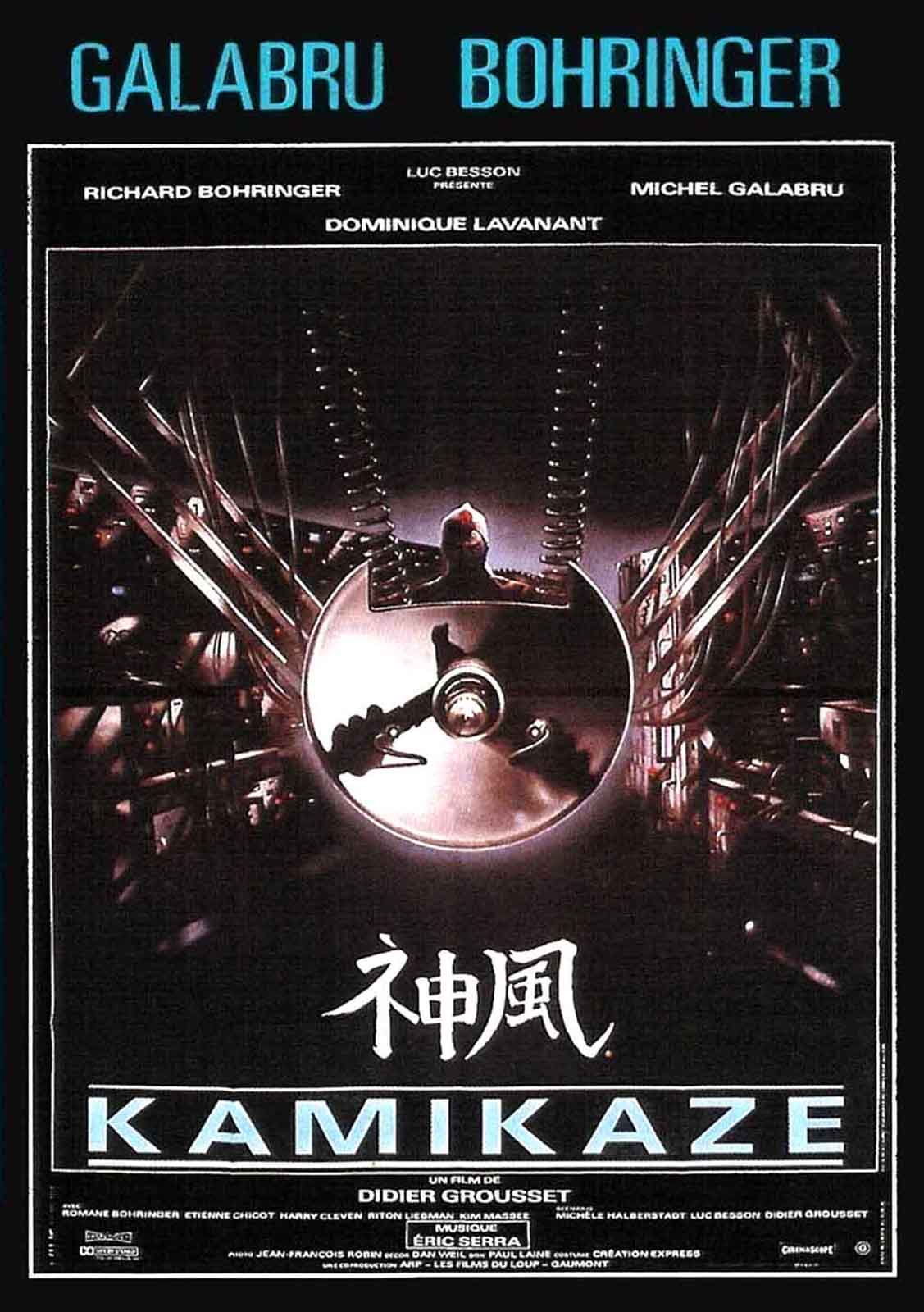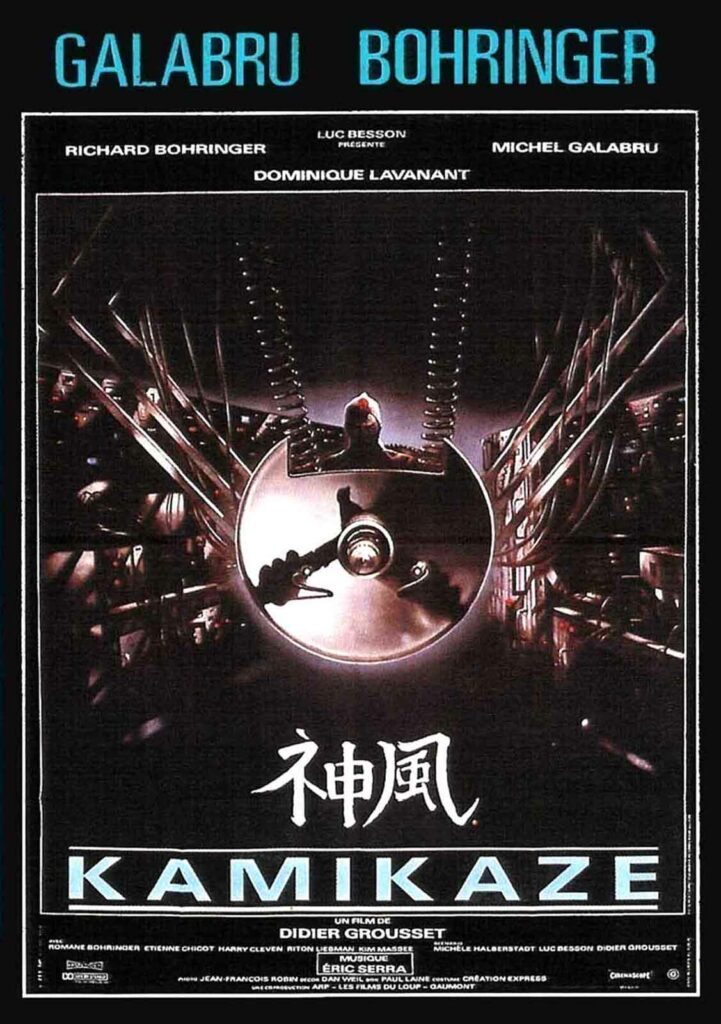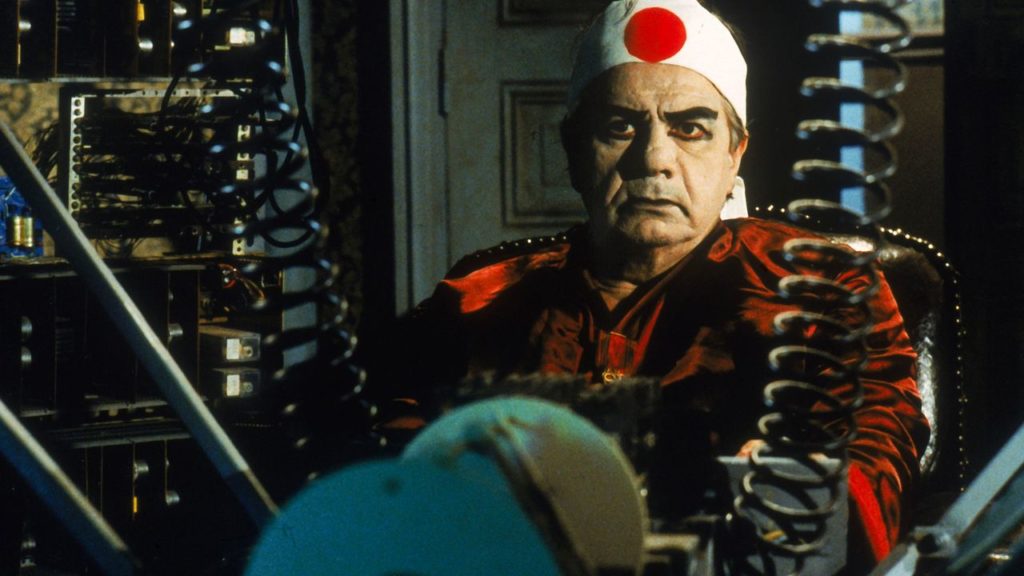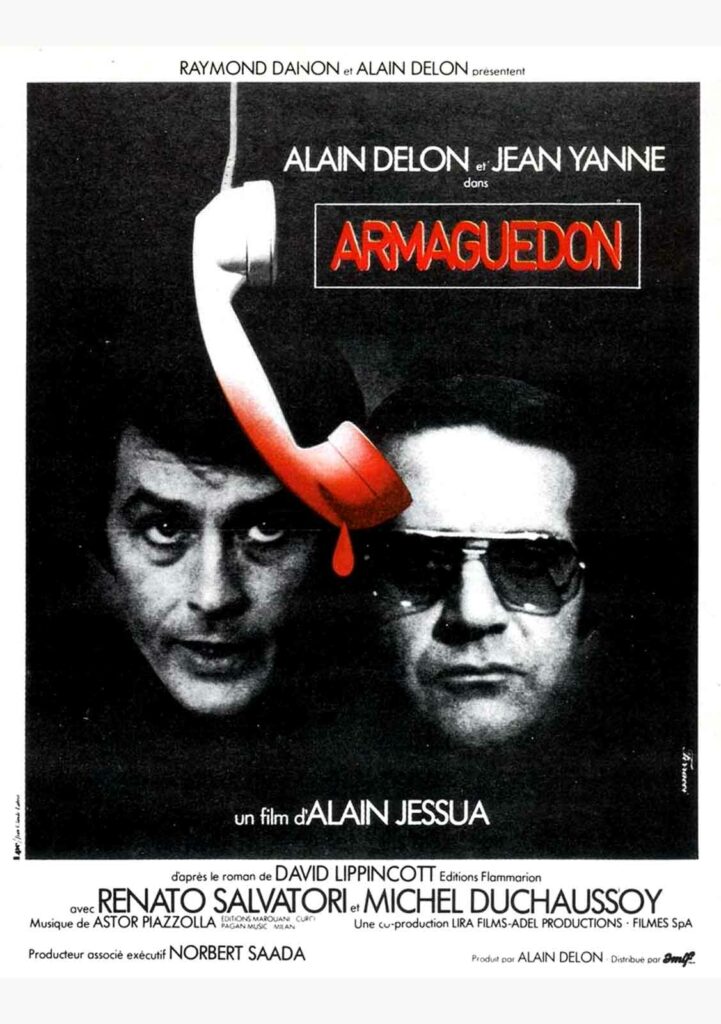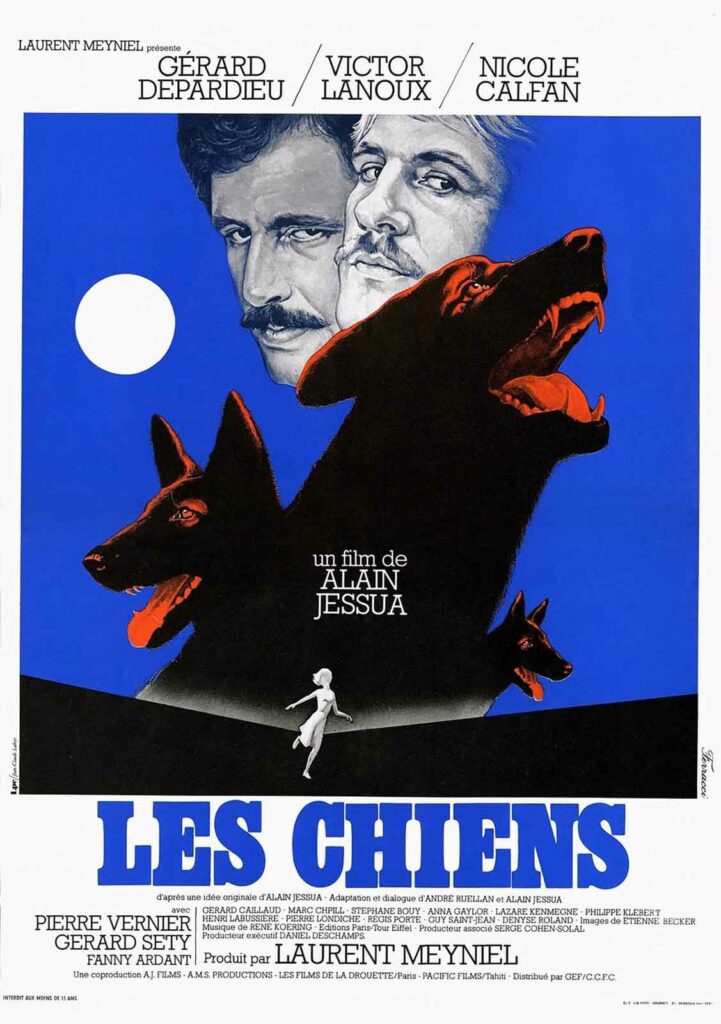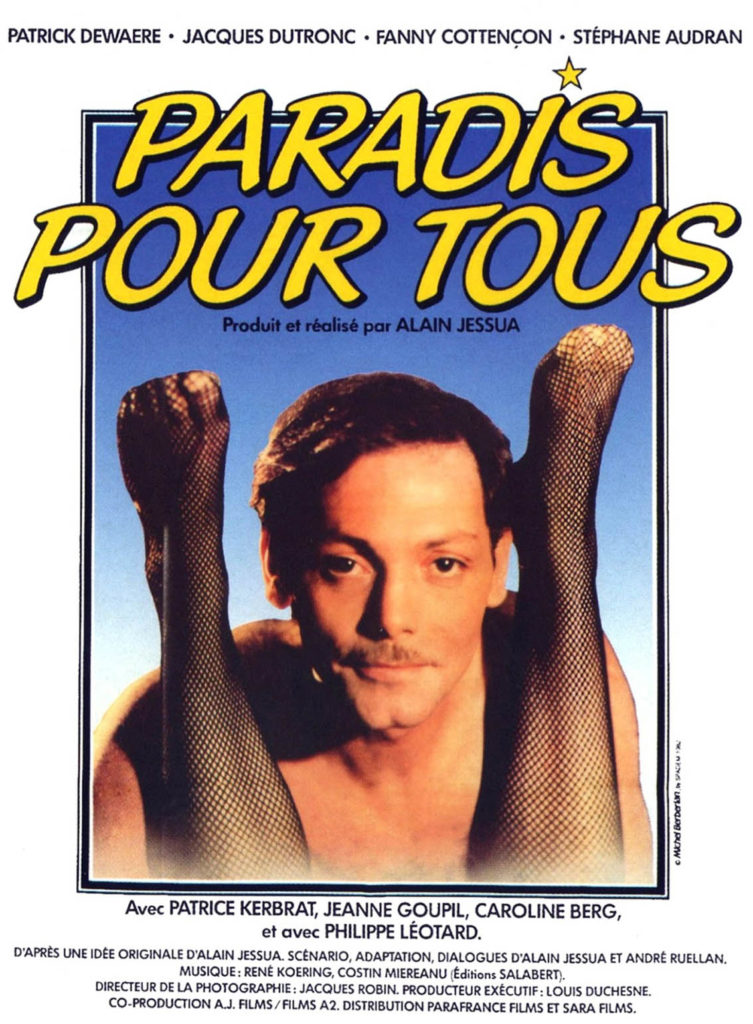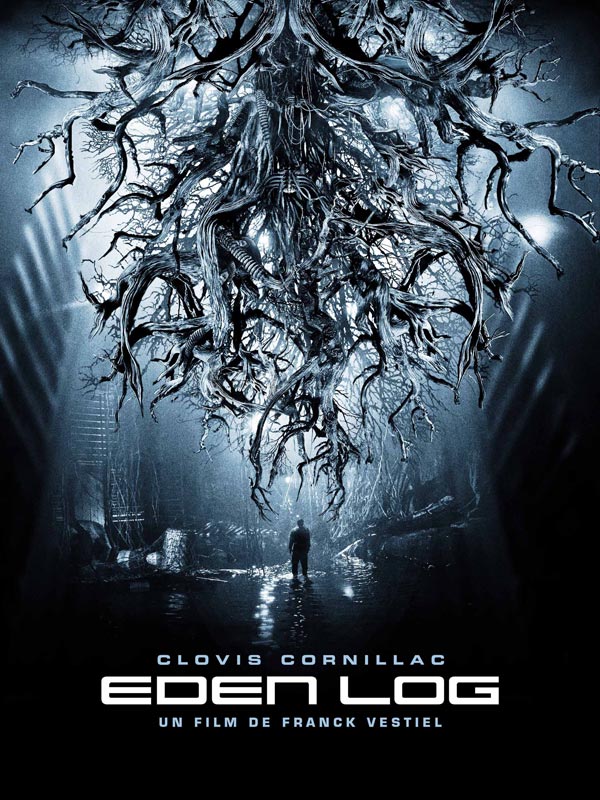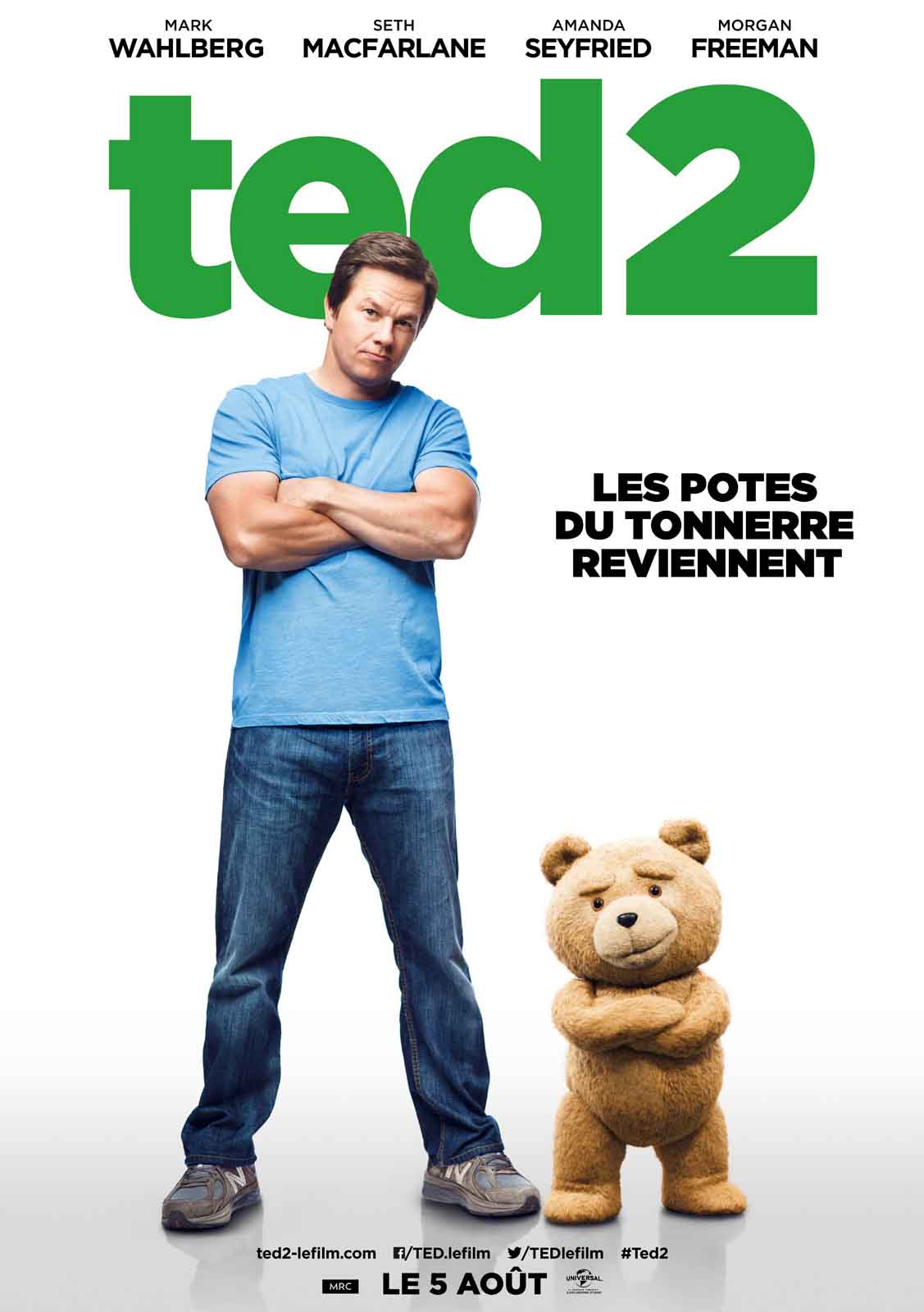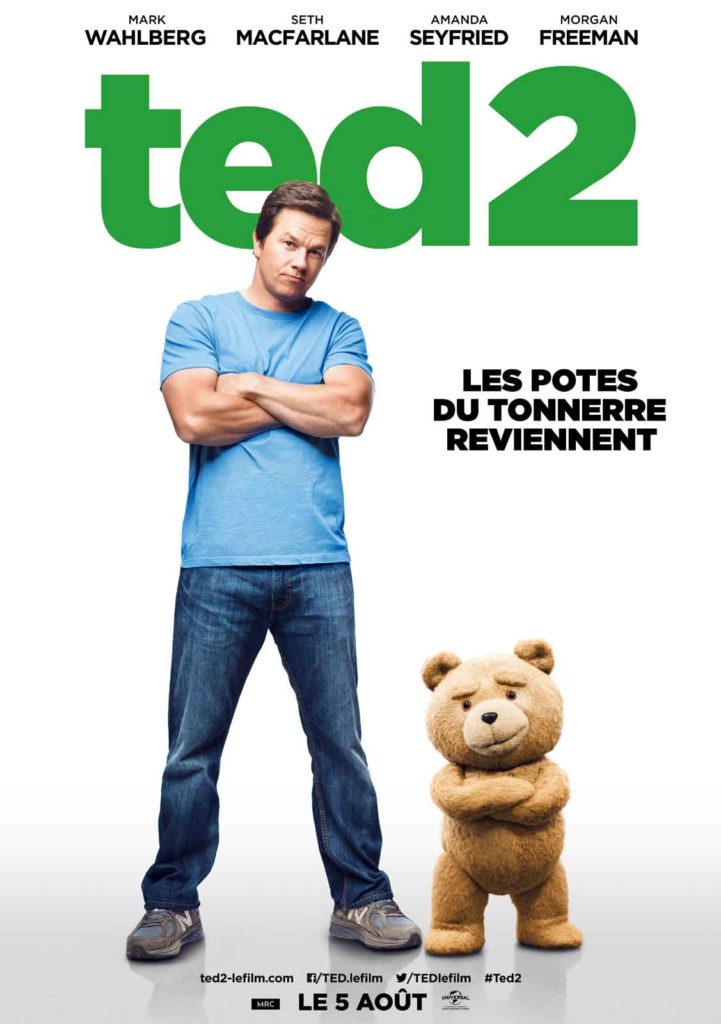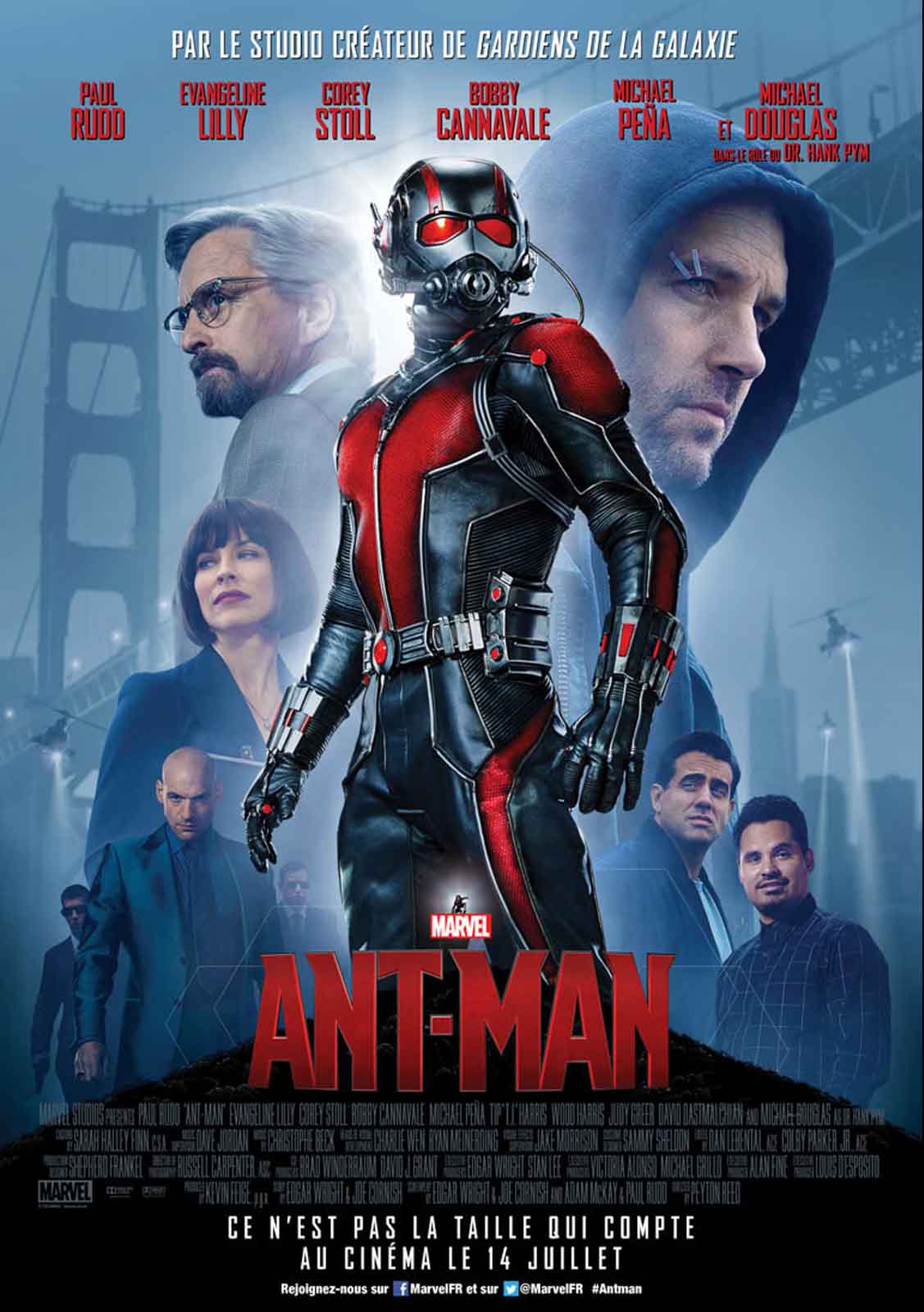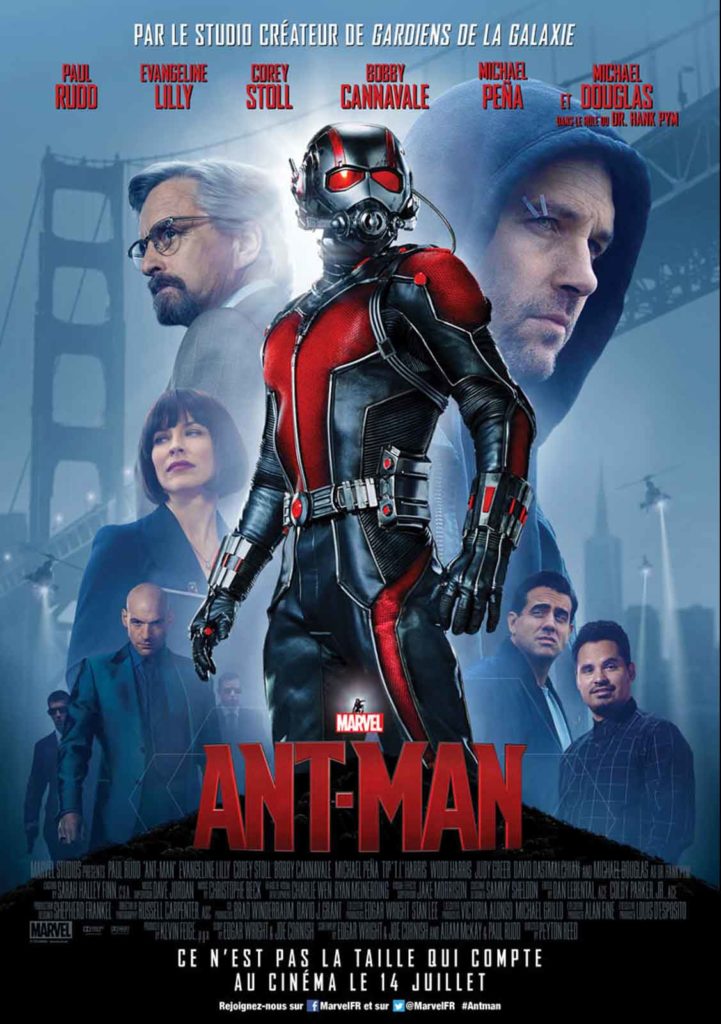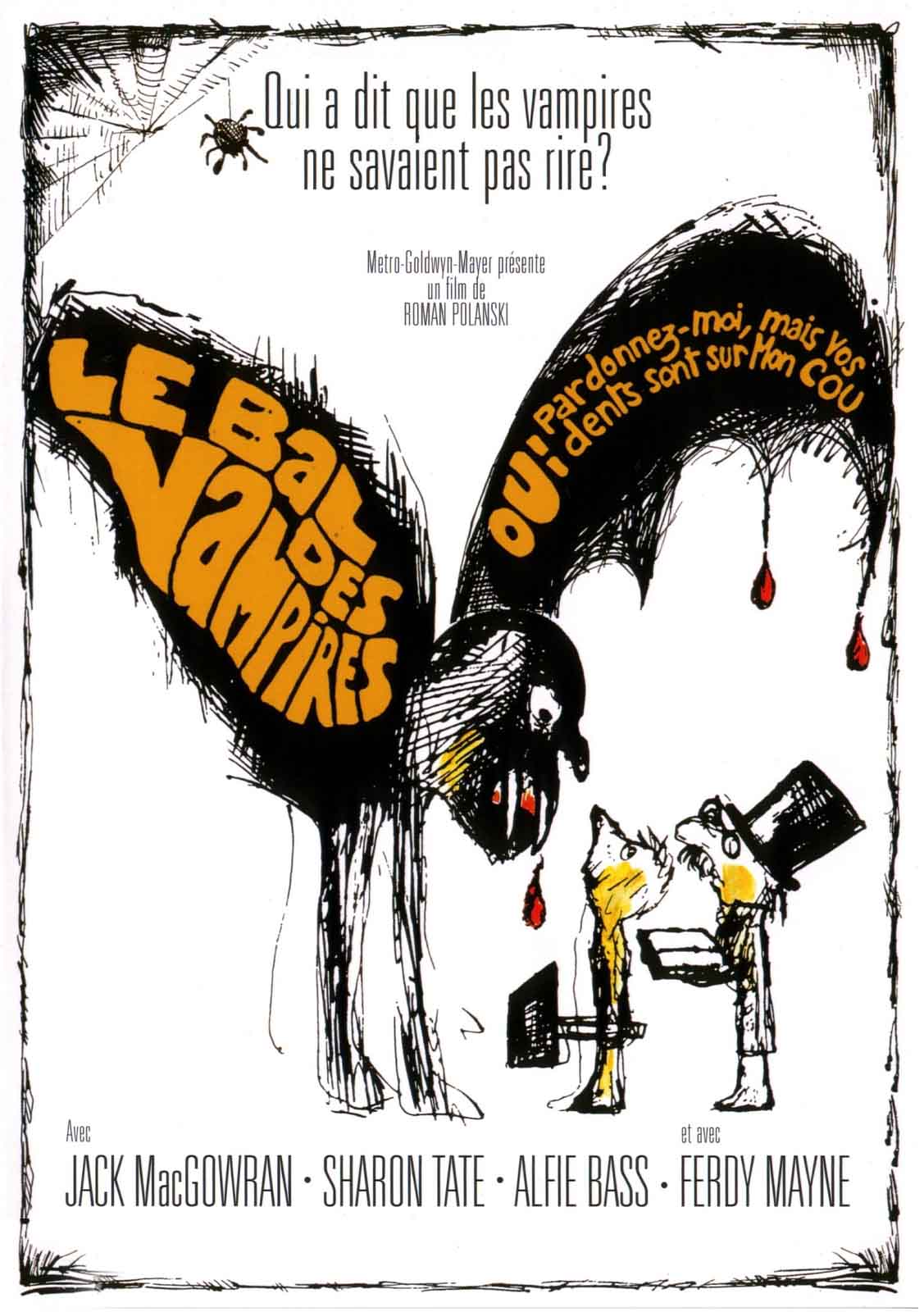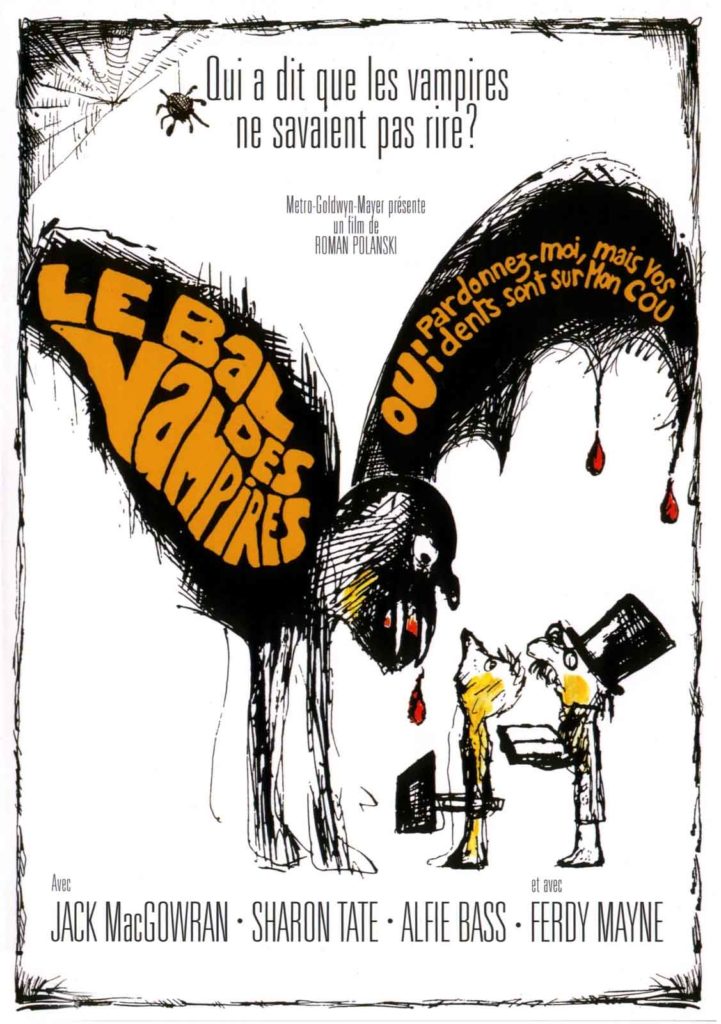Une tentative manifeste de retrouver la recette du succès de Ghostbusters, en remplaçant les fantômes par des créatures issus des jeux vidéo des années 80
PIXELS
2015 – USA
Réalisé par Chris Columbus
Avec Adam Sandler, Josh Gad, Michelle Monaghan, Peter Dinklage, Kevin James, Brian Cox, Sean Bean, Denis Akiyama
THEMA EXTRA-TERRESTRES
Nous sommes à New York. Un homme jette un vieux téléviseur sur le trottoir puis s’éloigne. Soudain, des pixels multicolores surgissent de l’écran cathodique et se mettent à voguer dans les cieux. Les vaisseaux de Space Invaders détruisent les taxis, les blocs de Tetris anéantissent les buildings, Pac Man dévore les lignes de métro, Donkey Kong sème la panique, et bientôt toute la planète est réduite à l’état de Pixel. En deux minutes trente, le réalisateur Patrick Jean raconte ainsi la revanche surréaliste des jeux vidéo des années 80 sur la société moderne. Dès sa diffusion en 2010, cet audacieux court-métrage baptisé Pixels attire tous les regards et notamment ceux d’Adam Sandler, bien décidé à en produire une adaptation à grande échelle dont il tiendrait la vedette. Cinq ans plus tard, le long-métrage sort sur tous les écrans du monde, réalisé par Chris Columbus sous l’égide du studio Sony-Columbia. Sandler y joue Sam Brenner, un ancien champion de jeux vidéo devenu installateur de home cinémas. Un jour, son ami d’enfance Will Cooper (Kevin James), devenu rien moins que le président des Etats-Unis, l’appelle à la rescousse. Des créatures tout droit sorties de jeux vidéo d’arcade se mettent en effet à envahir la planète. Pourquoi ? Parce qu’un message envoyé aux aliens en 1982, contenant des images de jeux vidéo classiques, a été interprété comme une déclaration de guerre. La Terre est désormais attaquée par des personnages inspirés des jeux d’antan, et seuls des rétrogamers confirmés semblent pouvoir les arrêter. Brenner s’adjoint donc les services de deux ex-spécialistes des arcades, Eddie Plant (Peter Dinklage) et Ludlow Lamonsoff (Josh Gad) pour préparer la contre-attaque.
Dès ses premières minutes, Pixel cherche à faire du charme aux « geeks » de tous poils en s’efforçant de solliciter une complicité qui lui semble acquise. Allusions et clins d’œil en cascade à la pop-culture des années 80, apparitions de guest-stars ciblées (Dan Aykroyd nous renvoie à S.O.S. Fantômes auquel les posters de Pixels semblent se référer), bande originale saupoudrée de tubes des eighties… Tous les ingrédients sont là, mais la magie n’opère pas. Sous prétexte de n’être « qu’une » comédie, Pixels passe totalement à côté de son sujet, s’interdisant toute réflexion sur la nostalgie régressive d’une génération de quadragénaires refusant obstinément d’évacuer les émois de leur adolescence tenace.
Chris Columbus en petite forme
Avec ses ambitions étriquées, son scénario simpliste, ses dialogues exaspérants, son accumulation de clichés et la condescendance manifeste avec laquelle il appréhende ses spectateurs, Pixels n’a pas grand-chose pour plaire, d’autant qu’il ne provoque que rarement le rire – un comble pour une comédie ! Même les effets visuels sont discutables. La simplicité du design original de Pac-Man, Space Invaders ou Donkey Kong avait parfaitement été restituée en 3D dans le court de Patric Jean. Mais ici, les jeux d’arcade ressemblent à des rubik’s cube scintillants et multicolores franchement hideux. Quant à Chris Columbus, il assure le service minimum, ayant visiblement oublié depuis bien longtemps le grain de folie qui l’animait lorsqu’il écrivait les scénarios de Gremlins, Les Goonies ou Le Secret de la pyramide.
© Gilles Penso