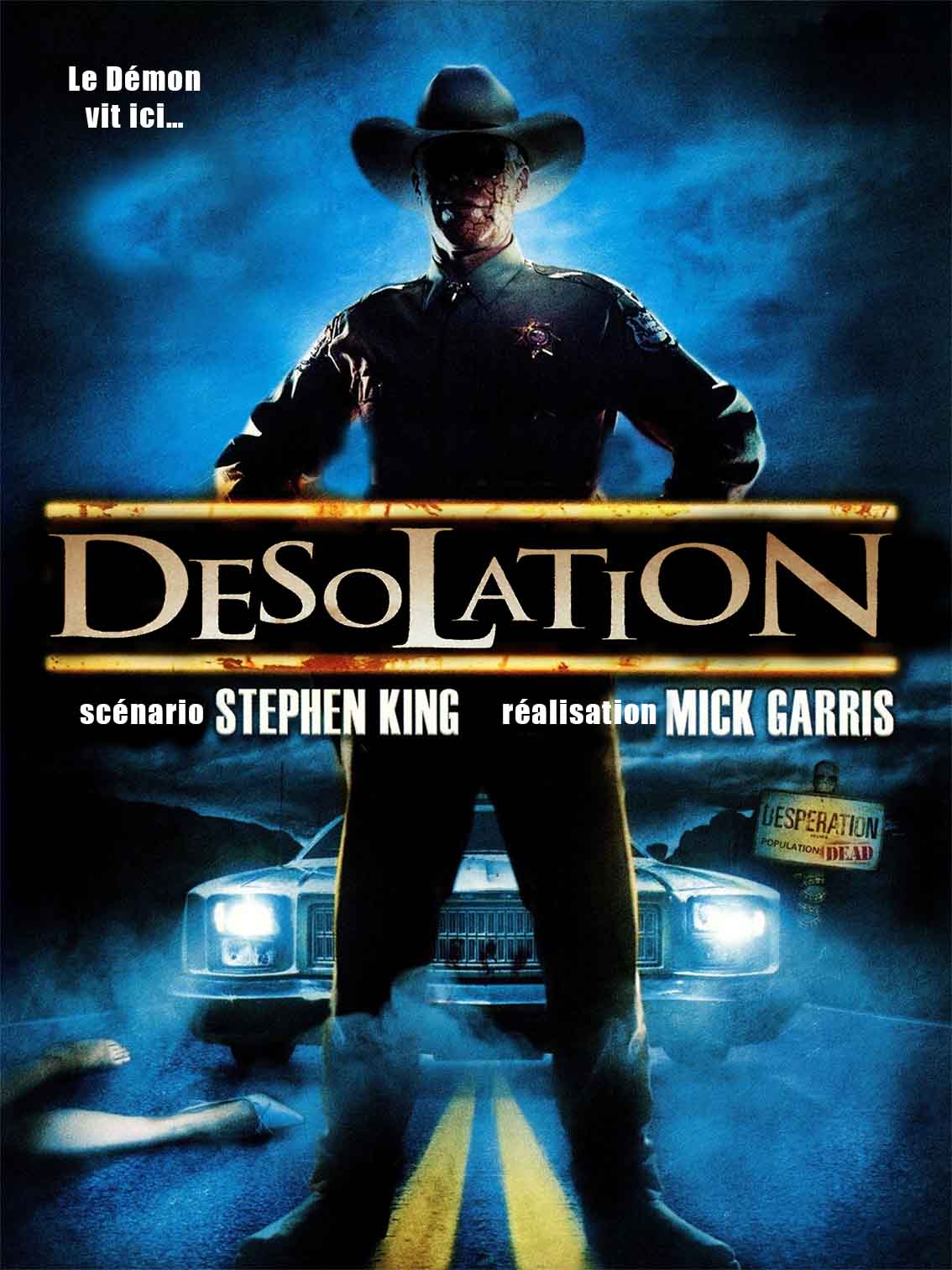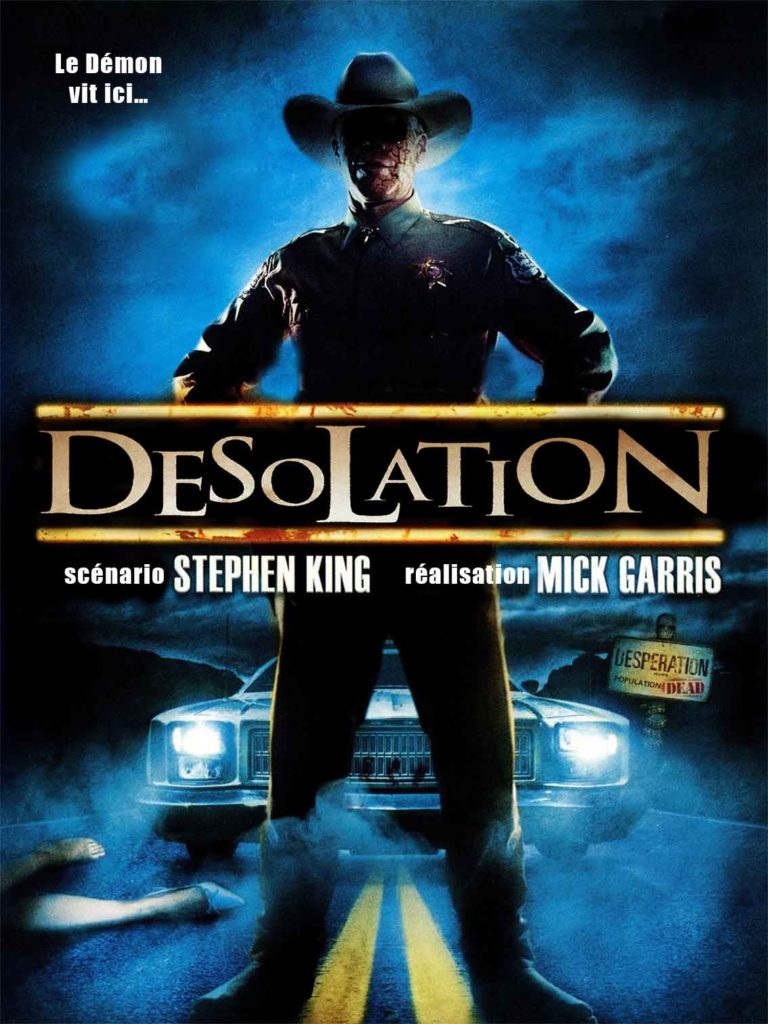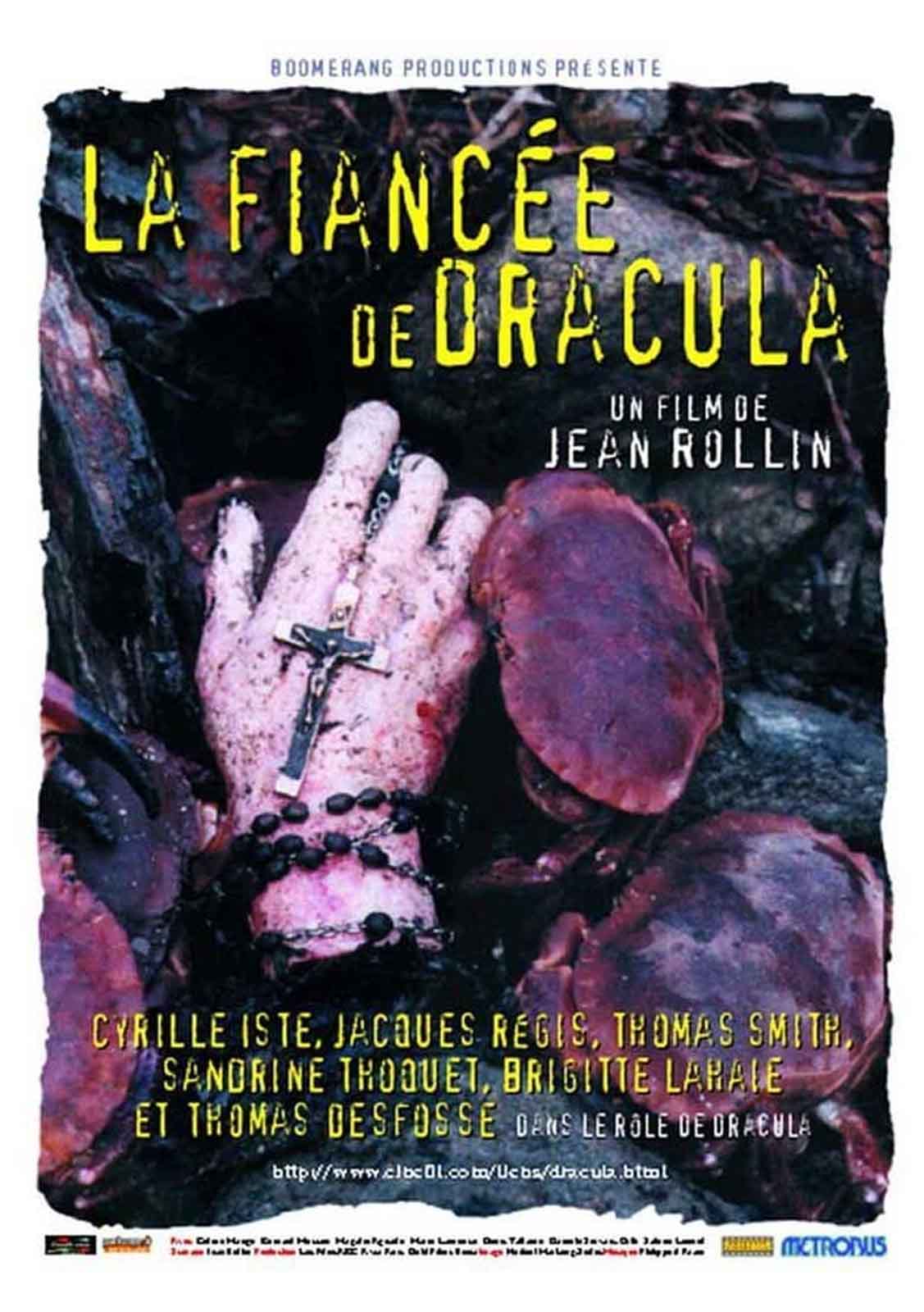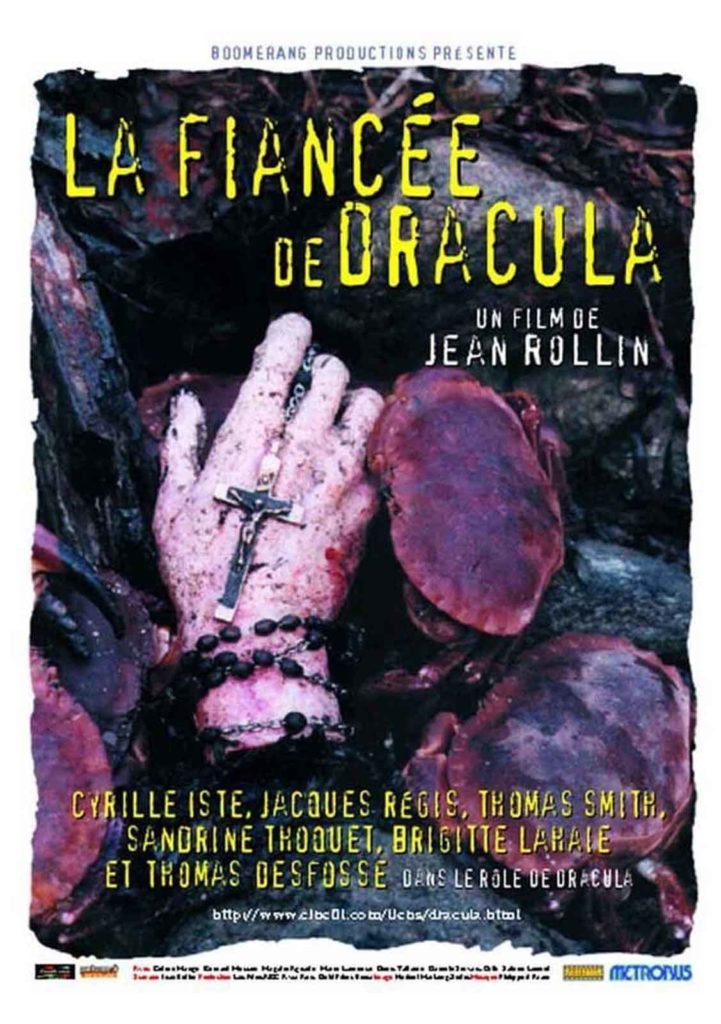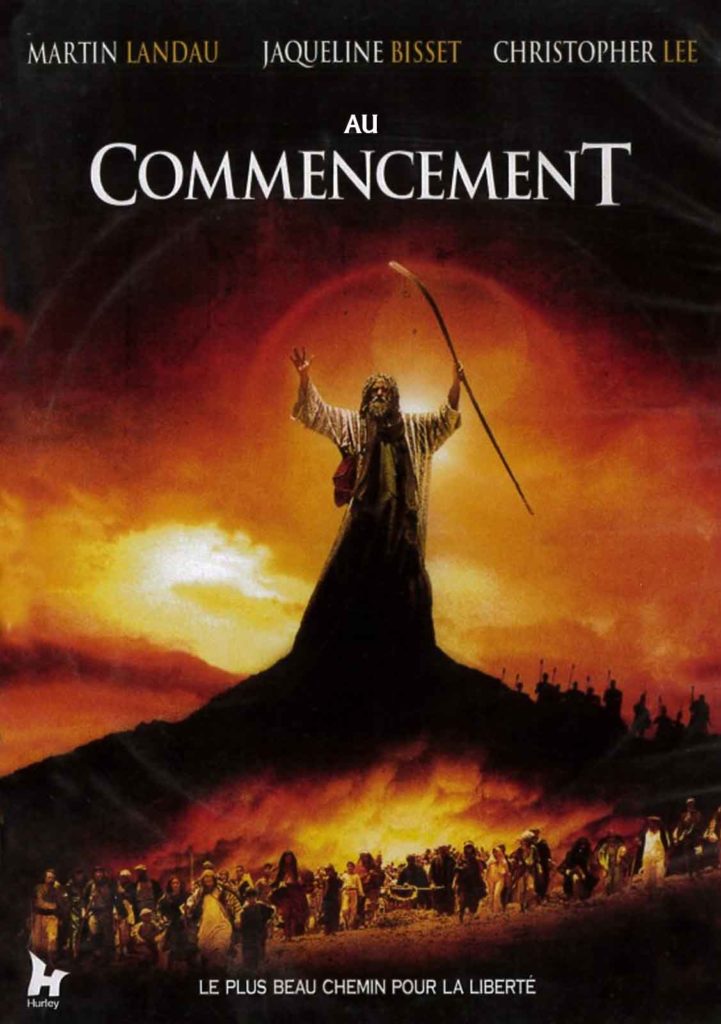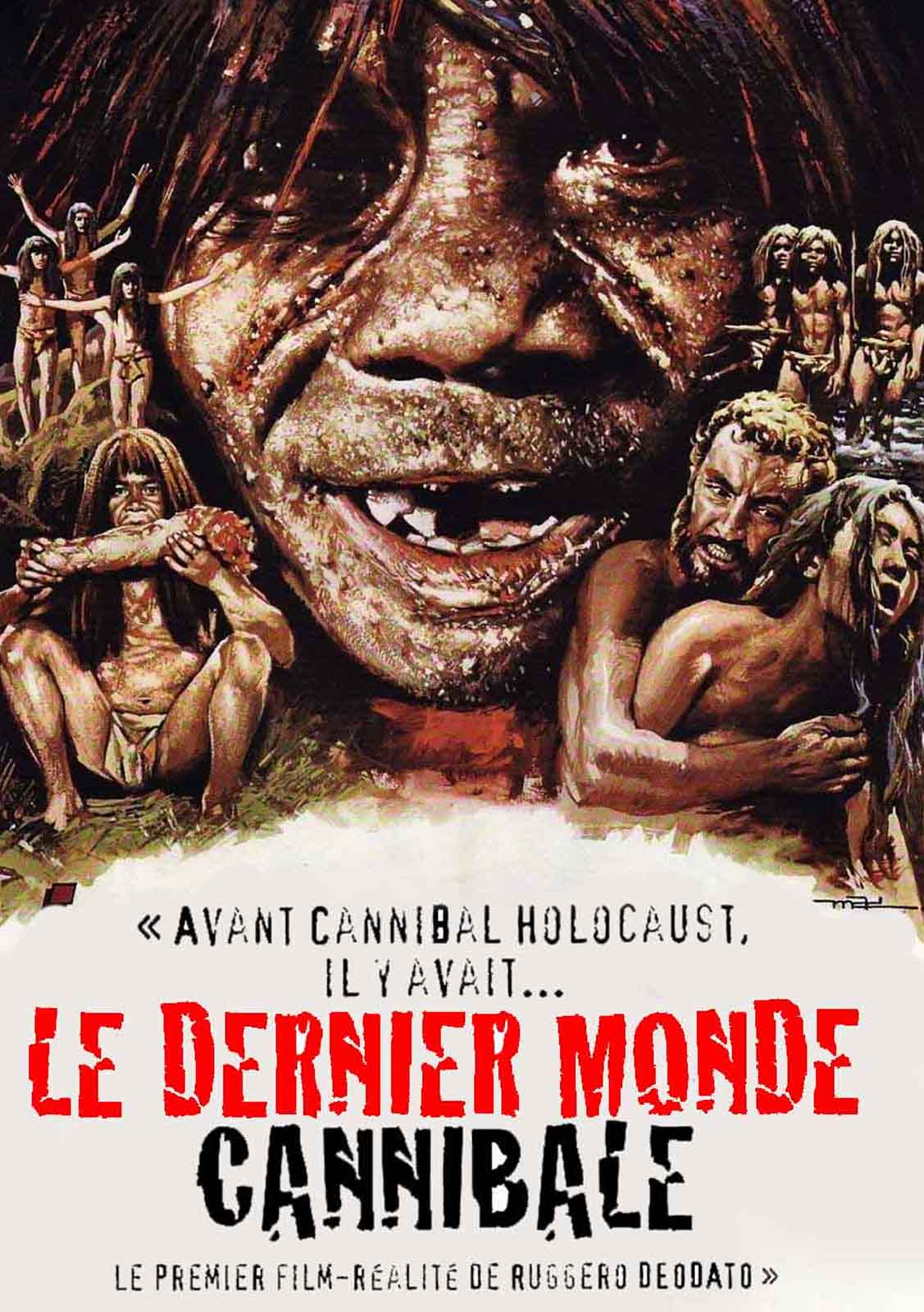Le fantôme d’un homme abattu en pleine rue enquête sur son propre meurtre et veille sur sa fiancée…
GHOST
1990 – USA
Réalisé par Jerry Zucker
Avec Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg, Tony Goldwyn, Vincent Schiavelli, Rick Aviles
THEMA FANTÔMES
Dans le sous-genre du film de fantôme romantique, Ghost est assurément l’un des plus populaires. Sorti en 1990 à cheval sur deux décennies, il intègre l’influence des productions Amblin/Spielberg des années 80, tout en annonçant la récupération sous une forme industrielle des codes et figures du cinéma de genre par les blockbusters des années 90. Le scénario de Ghost se présente ainsi comme un mélange de romance, de comédie, de thriller et bien sûr de fantastique – une alchimie possible mais requérant un réel don d’équilibriste. S’agissant du premier film en solo de Jerry Zucker après ses collaborations à la série de films parodiques des Y a-t-il…?, il réussit/contourne le pari en adoptant un (non) style qui fait office de (plus bas) dénominateur commun pour lier les différents genres à l’écran. Ainsi, la nature ectoplasmique du héros passe au second plan dès que le drame pointe le bout de son nez, tandis que les révélations sur la trahison ayant mené à sa mort sont livrées au spectateur en parallèle des scènes romantiques et de comédie. Sam (Patrick Swayze), un golden boy de la finance à Wall Street, et Molly (Demi Moore), une artiste-sculptrice, sont deux jeunes tourtereaux qui ont tout pour être heureux. À la sortie d’un théâtre, alors qu’ils évoquent pour la première fois l’éventualité du mariage, un malfrat à la petite semaine tente de les détrousser. Un coup de feu est tiré ; Sam meurt sur le coup mais il se réveille, hors de son corps, et découvre qu’il est devenu un fantôme. Incapable de communiquer avec Molly, il va découvrir que sa mort n’était pas accidentelle et que son associé Carl (Tony Goldwyn) tente non seulement de se rapprocher un peu trop vite de Molly mais manigance aussi un détournement de fonds que Sam aurait pu faire capoter. Ce dernier trouve l’aide d’une voyante (Whoopi Goldberg) capable de l’entendre. Il va la guider pour déjouer le plan de Carl et protéger Molly…


Si le film de fantôme romantique compte quelques classiques oniriques comme L’Aventure de Madame Muir ou Le Portrait de Jennie, l’approche de Jerry Zucker se veut bien plus terre-à-terre et souligne ses effets au bazooka. À tel point qu’un mauvais esprit pourrait rapprocher certains dialogues des parodies qui firent sa renommée. Comme lorsque Patrick Swayze, l’air grave, explique à sa dulcinée que la vie est trop belle et qu’il va forcément leur arriver quelque chose, cinq minutes avant qu’il ne soit tué. Ou cet accident d’avion annoncé au journal télévisé qui lui fait se demander s’il ne devrait pas annuler son prochain vol pour un voyage d’affaire. Quant à la scène iconique les voyant se livrer à des préliminaires en malaxant de la glaise, difficile de ne pas sourire en voyant la forme suggestive de leur création, particulièrement lorsqu’elle apparait apparaît dans le cadre, érigée devant l’entre-jambe de Demi Moore… David Zucker, le propre frère de Jerry, parodiera la scène l’année suivante dans Y a-t-il un flic pour sauver le président ? sans avoir à changer grand-chose. Le besoin de tout expliciter via les dialogues ou les images (d’où l’adoption d’une description chrétienne du paradis et de l’enfer alors que le scénariste et le réalisateur sont tous deux de confession juive) encombre aussi le film lorsque Sam découvre les particularités de sa vie dans l’entre-deux mondes : sa rencontre avec un fantôme dans le métro (Vincent Schiavelli, une « gueule » habituée aux seconds rôles) donne ainsi lieu à une scène d’entrainement à la Yoda durant laquelle Sam parvient à pousser des objets.
Entre la vie et la Moore
Bien que le scénariste Bruce Joel Rubin et Jerry Zucker se parent d’une caution artistique en donnant à leur film une dimension shakespearienne (le couple voit Macbeth au théâtre et le scénario en émule l’intrigue : Macbeth tuait aussi le roi par ambition et était hanté par son « esprit »), difficile de justifier la double-nomination pour l’Oscar du Meilleur Film et du Meilleur Scénario. Il serait toutefois hypocrite de ne pas reconnaitre que, malgré (ou grâce à) son manque de sophistication, Ghost est un agréable divertissement, fluide et sans aspérité. Son atout principal tient sans aucun doute à son couple-vedette qui, par chance ou flair, plut aussi bien au public féminin que masculin, empêchant ainsi le film d’être taxé (selon les clichés établis) de « film fantastique avec Patrick Swayze » (donc pour monsieur), ou « de comédie romantique avec Demi Moore » (donc pour madame). Ghost comme ciment cinéphile du couple ? Cela peut en tout cas expliquer sa première place au box-office de l’année 1990. Paradoxalement, Always de Steven Spielberg, sur un sujet similaire, ne trouva pas grâce aux yeux du public un an plus tôt, peut-être justement parce qu’il assumait sa dimension fabuleuse et plus « féminine ». Enfin, pour les curieux (courageux ?), Ghost a fait l’objet d’un remake japonais en 2010 et d’une adaptation peu inspirée sous forme de comédie musicale à Broadway.
© Jérôme Muslewski
Partagez cet article