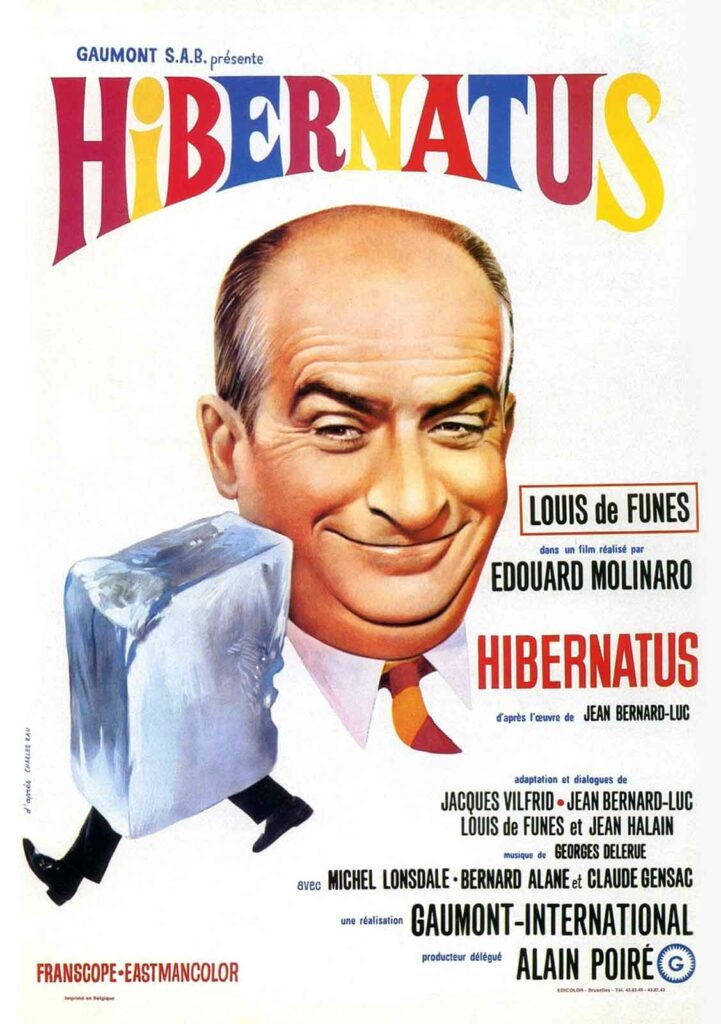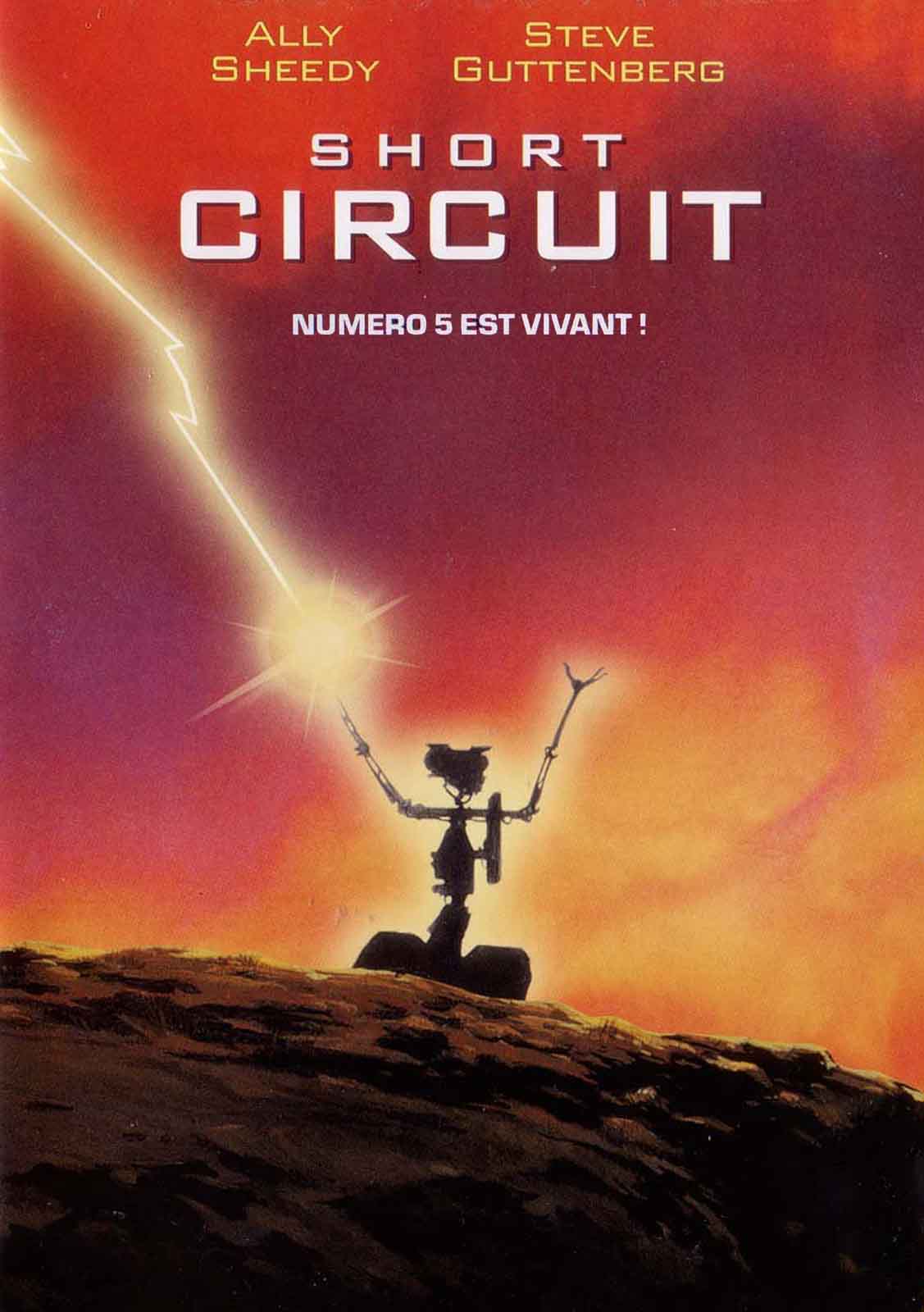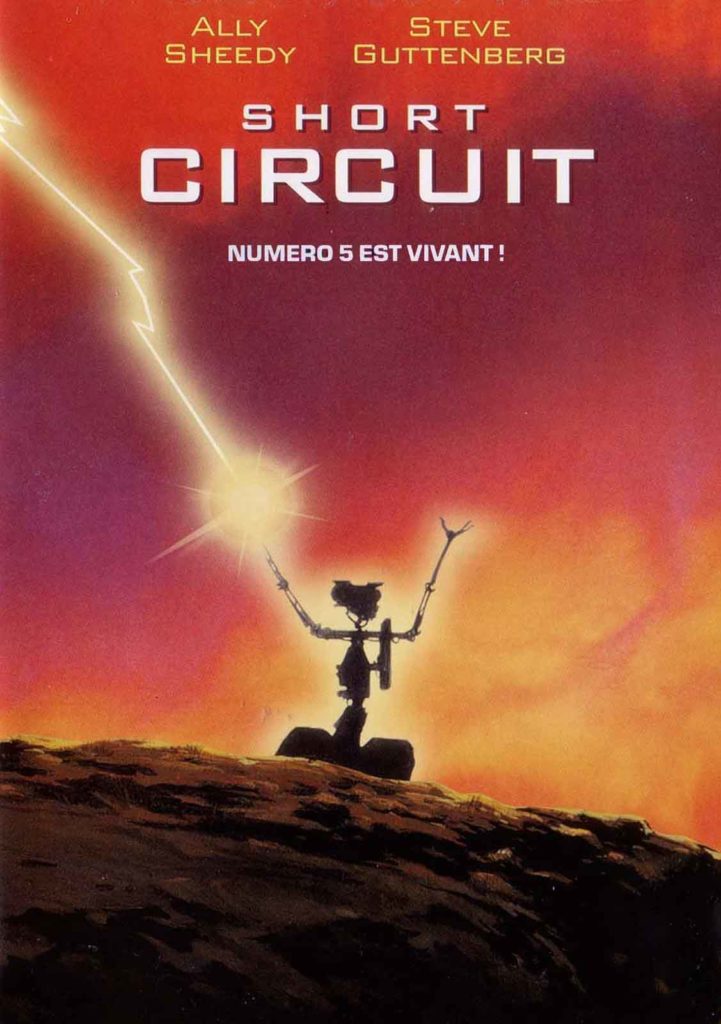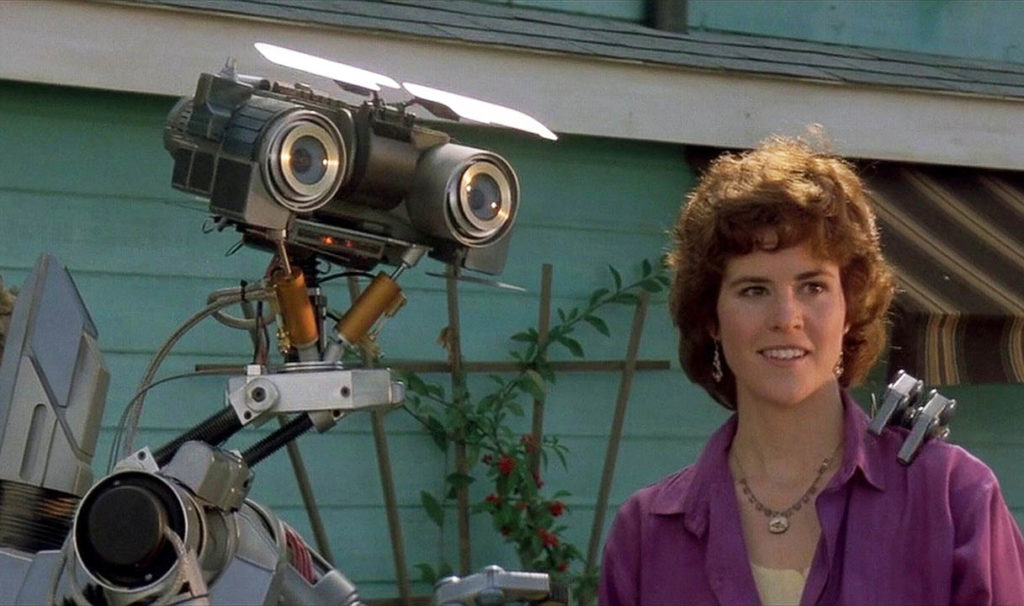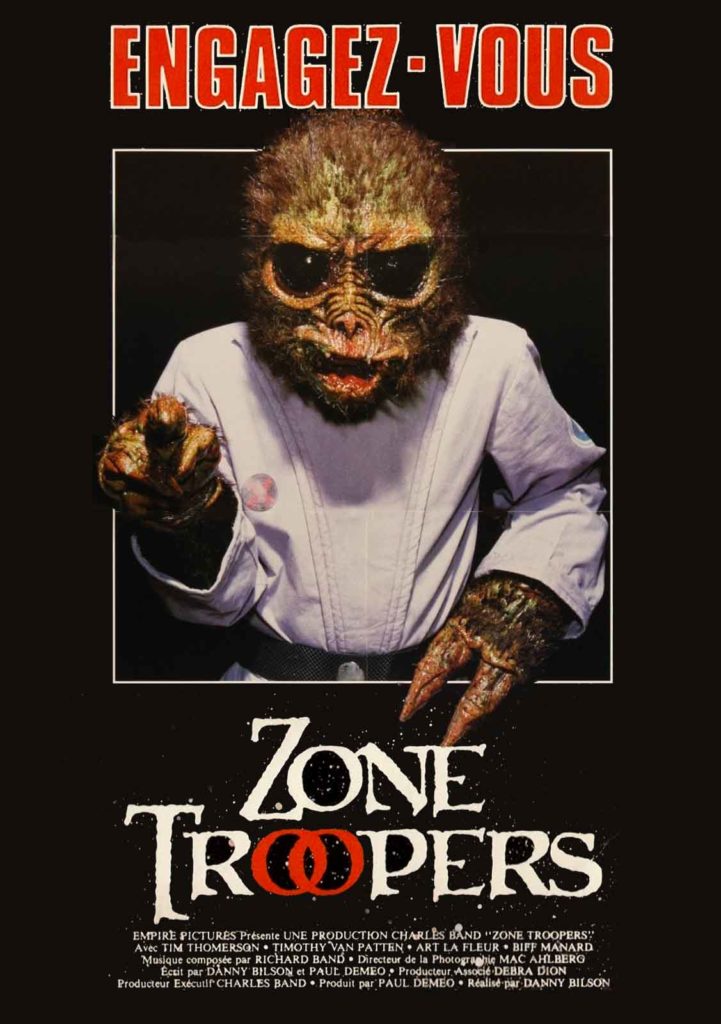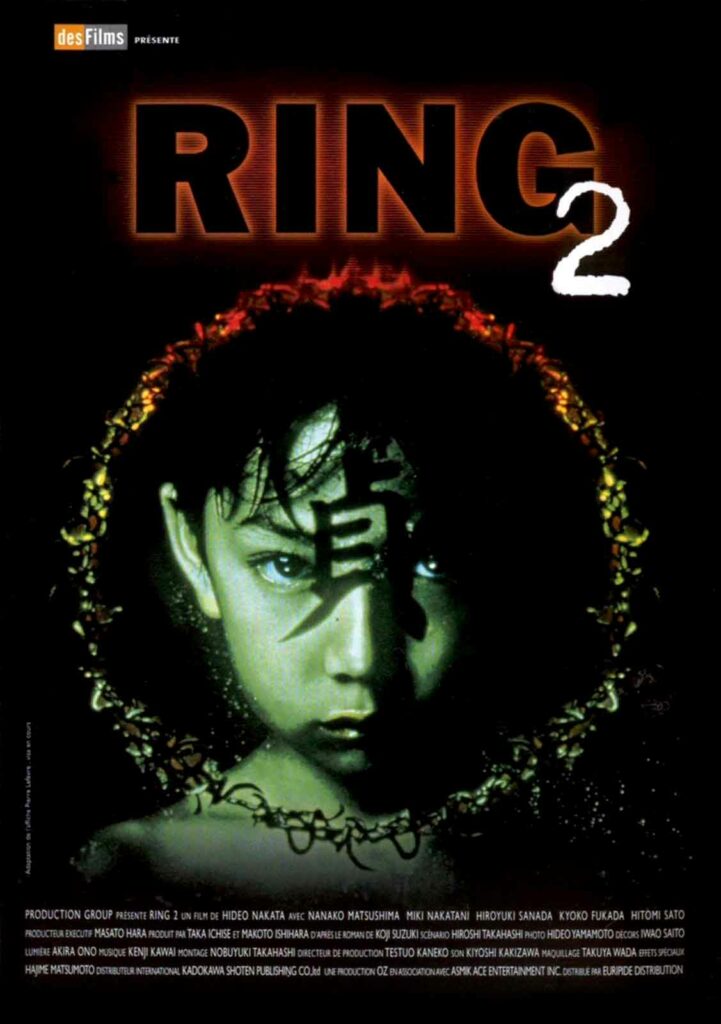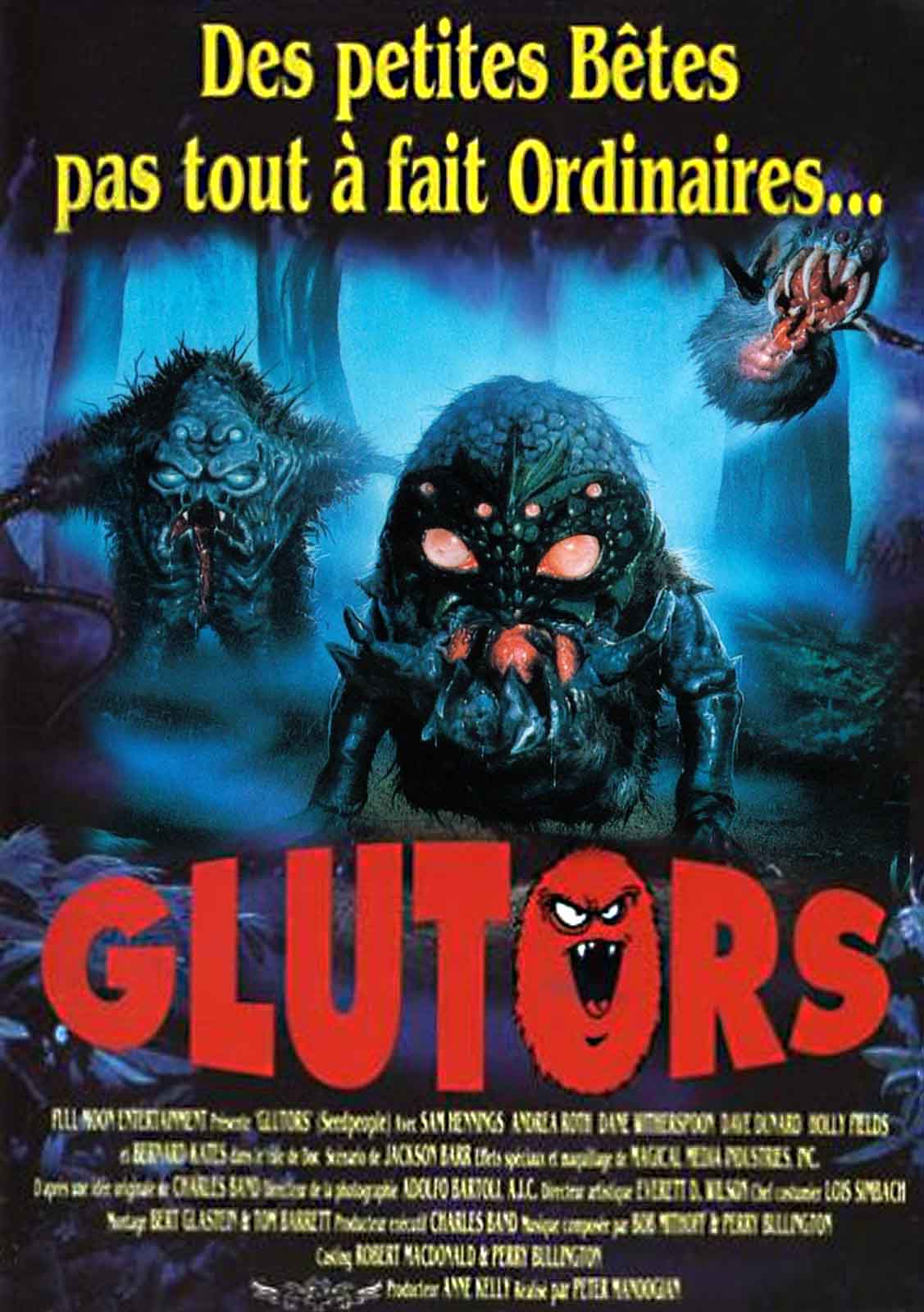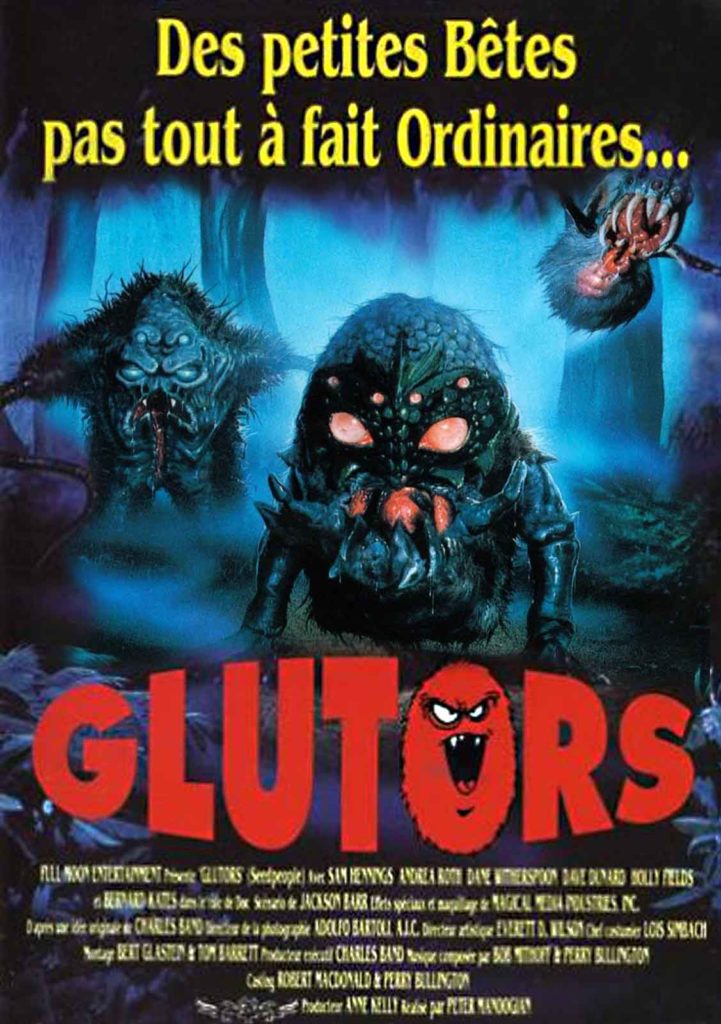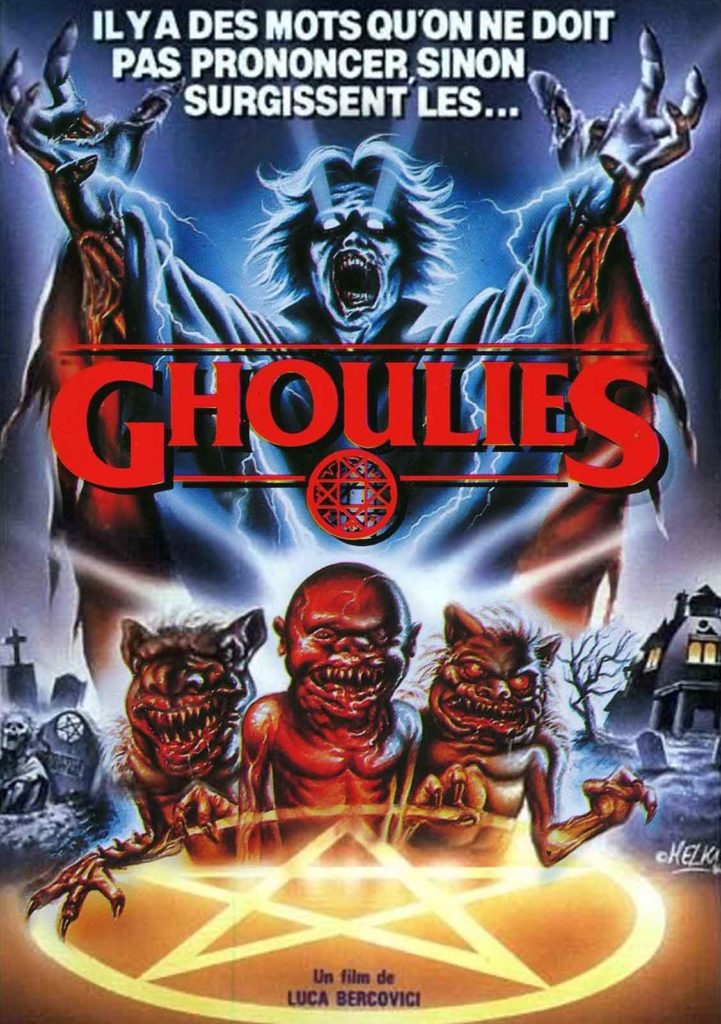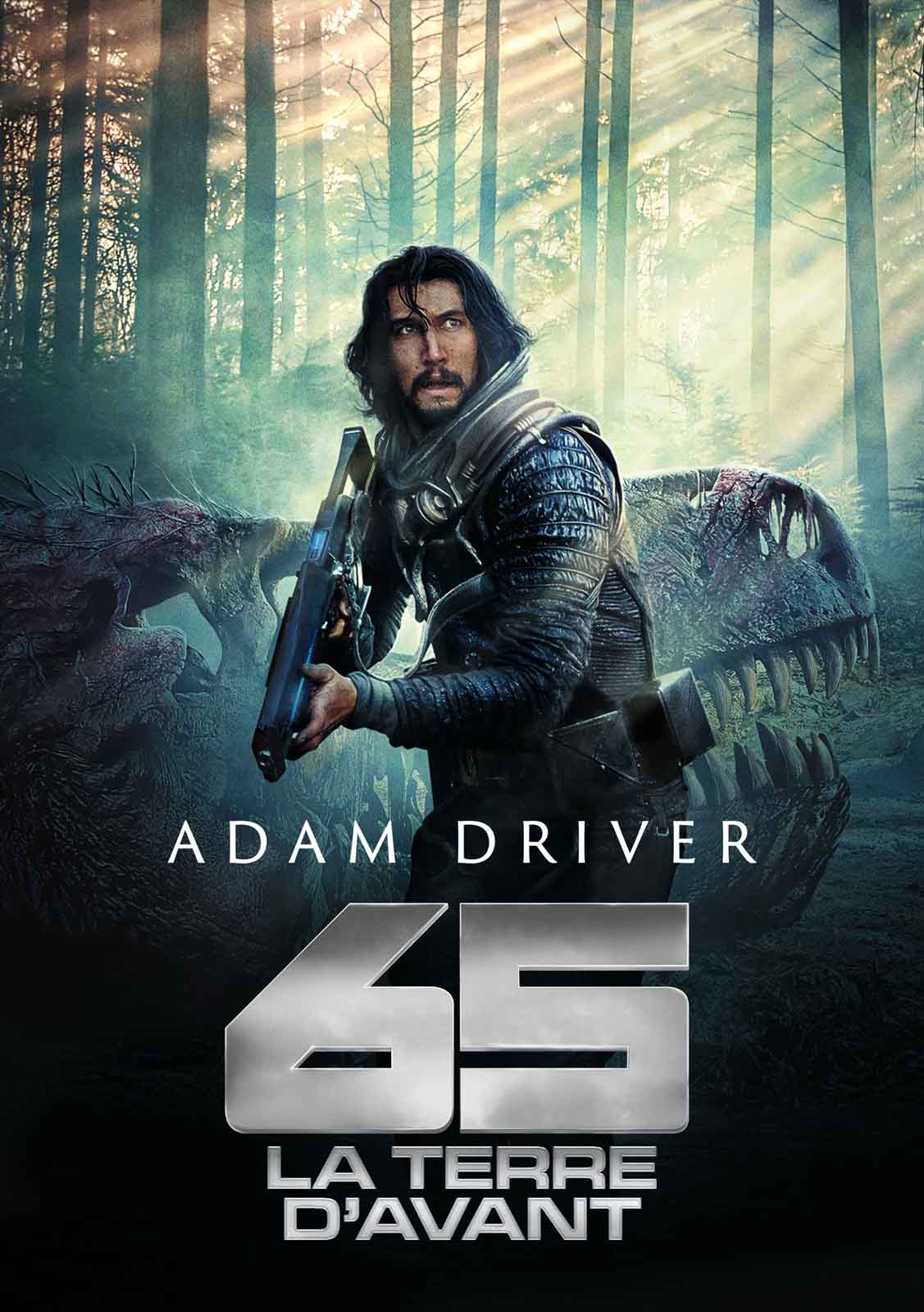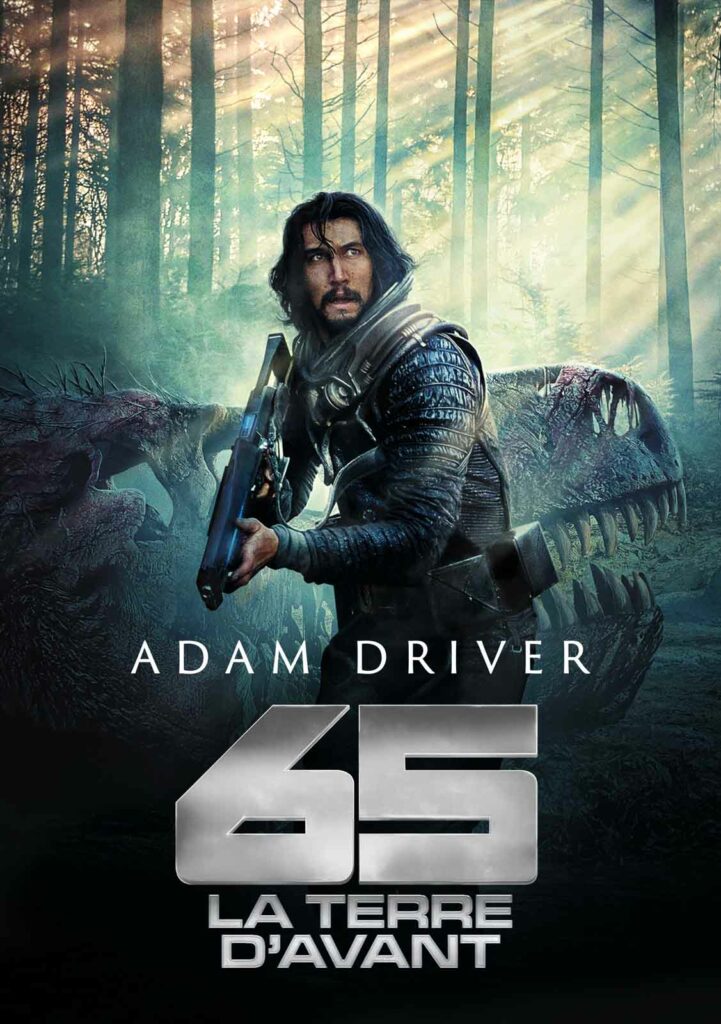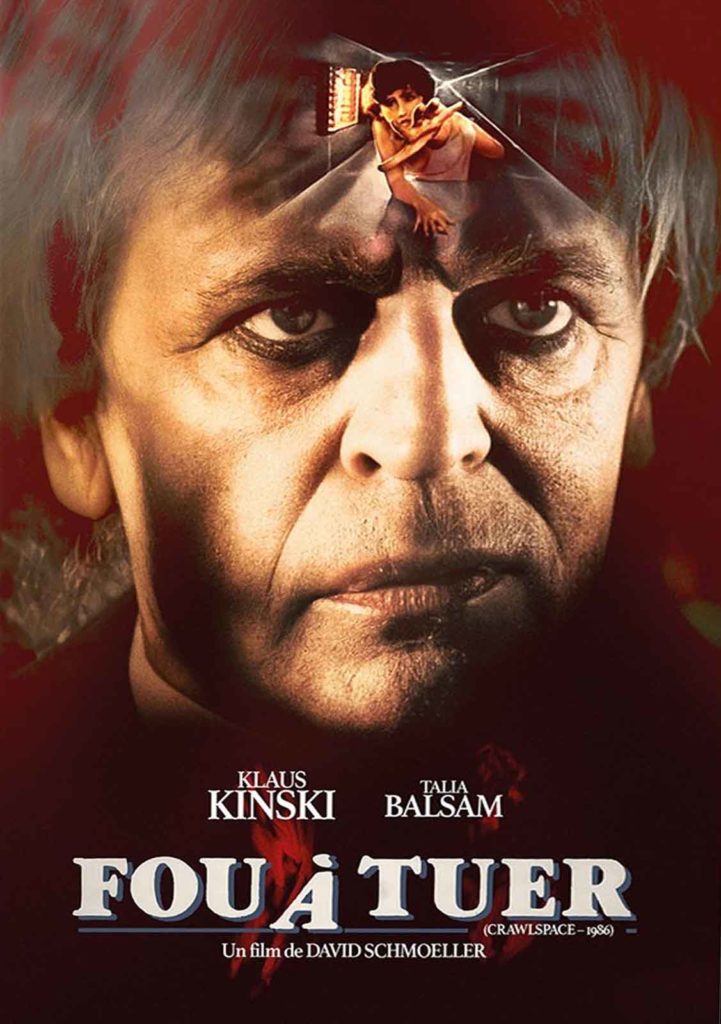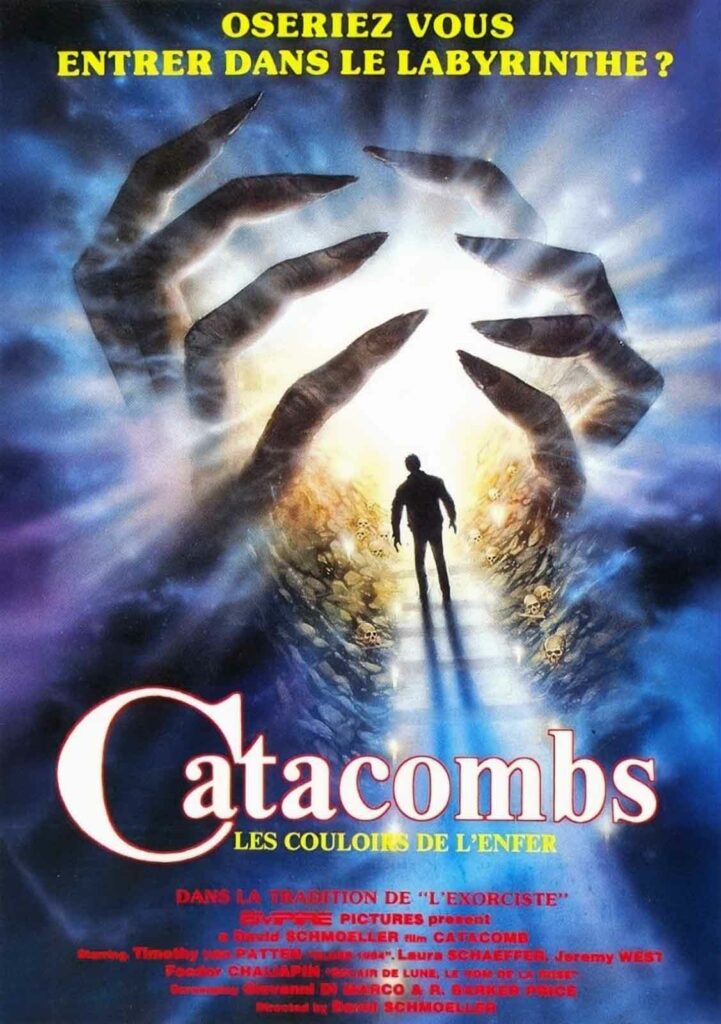Un huis-clos à flanc de falaise où l’automobiliste Louis de Funès et deux autostoppeurs risquent à tout moment de tomber dans le vide…
SUR UN ARBRE PERCHÉ
1971 – FRANCE
Réalisé par Serge Korber
Avec Louis de Funès, Géraldine Chaplin, Olivier de Funès, Alice Sapritch, Danielle Durou, Hans Meyer, Fernand Berset, Daniel Bellus, Jean-Jacques Delbo
THEMA CATASTROPHE
Alors qu’il travaille avec Serge Korber sur L’Homme-orchestre, une comédie gorgée de numéros musicaux qui lui permet d’exploiter avec brio ses dons de pantomime et d’offrir à son propre fils Olivier un rôle en tête d’affiche, Louis de Funès demande au cinéaste quel sera son prochain film. Korber lui parle alors d’un projet ambitieux nommé L’Accident. Il s’agit d’un film catastrophe d’un genre particulier, puisque c’est un huis-clos mettant en scène un couple coincé dans une voiture en équilibre à flanc de falaise. Les deux protagonistes menacés à tout moment d’être précipités dans le vide seront incarnés par Yves Montand et Annie Girardot, qui ont donné leur accord. De Funès adore l’idée et se dit que la situation décrite dans le scénario serait le support idéal d’une comédie originale. Face à son enthousiasme, Serge Korber revoit sa copie avec le scénariste Pierre Roustang et le dialoguiste Jean Halain. Exit Montand et Girardot (pourtant au faîte de leur gloire à l’époque), place à Louis de Funès. Ironiquement, les deux acteurs donneront ensuite la réplique à la superstar comique dans deux films ultérieurs, respectivement La Folie des grandeurs et La Zizanie. Grâce au nom de De Funès, véritable sésame, la production de Sur un arbre perché se monte rapidement.


De Funès incarne l’un de ces petits bourgeois antipathiques dont il raffole (affublé d’une perruque improbable), en l’occurrence le promoteur français Henri Roubier, revenu d’Italie après avoir conclu un accord lui assurant la mainmise sur les autoroutes européennes avec l’un de ses associés. Alors qu’il roule le long de la Méditerranée, Roubier embarque un jeune auto-stoppeur (Olivier de Funès) et une ravissante jeune femme en difficulté (Géraldine Chaplin). Les deux passagers le contraignent à faire un détour par Cassis, ce qui ne l’arrange guère. Alors que la nuit tombe et qu’il est exaspéré par ses deux passagers, Roubier manque un virage et son véhicule chute dans le vide au-dessus d’un précipice. L’automobile et ses occupants se retrouvent miraculeusement perchés sur un pin parasol accroché à la paroi d’une falaise. Tous trois tentent de se dégager, mais au moindre de leur mouvement, la voiture bouge, menaçant de basculer dans le vide. Leur vie ne semble alors plus tenir qu’à un fil…
Équilibre instable
Porter à l’écran le scénario de Sur un arbre perché représente un défi logistique hors du commun. Une fausse voiture allégée est réellement installée à flanc de montagne, sur un faux pin parasol. Pendant cinq semaines, Korber et son équipe filment tous les plans larges grâce à ce dispositif grandeur nature à l’intérieur duquel s’agitent trois cascadeurs qui doublent les acteurs principaux. Des alpinistes et un hélicoptère sont également sollicités pour ces prises de vue vertigineuses. La suite du tournage se déroule en studio, à l’intérieur d’une voiture montée sur vérins devant une falaise factice reconstituée par le chef décorateur Rido Mondelli. Les gros moyens sont donc à l’œuvre. Mais dès que se met en place le dispositif du film catastrophe, une évidence saute aux yeux du spectateur : Louis de Funès n’est pas dans son élément. Le génial comédien qui, habituellement, saute, gesticule, traverse l’espace avec fougue et transforme son corps en élastique monté sur ressort, se retrouve soudain confiné dans l’espace réduit d’une voiture. Privé de la latitude de jeu qu’il lui faudrait, il est en demi-mesure, face à des compagnons de jeu peu convaincants qui peinent donc à lui donner la réplique. Comme on pouvait le craindre, le public ne répond pas présent. Sur un arbre perché sera l’un des rares flops de Louis de Funès. Il faut tout de même reconnaître au film une audace et une originalité indiscutables. Après le tournage, Olivier de Funès abandonnera définitivement la carrière d’acteur à laquelle le destinait son père pour devenir pilote de ligne.
© Gilles Penso
À découvrir dans le même genre…
Partagez cet article