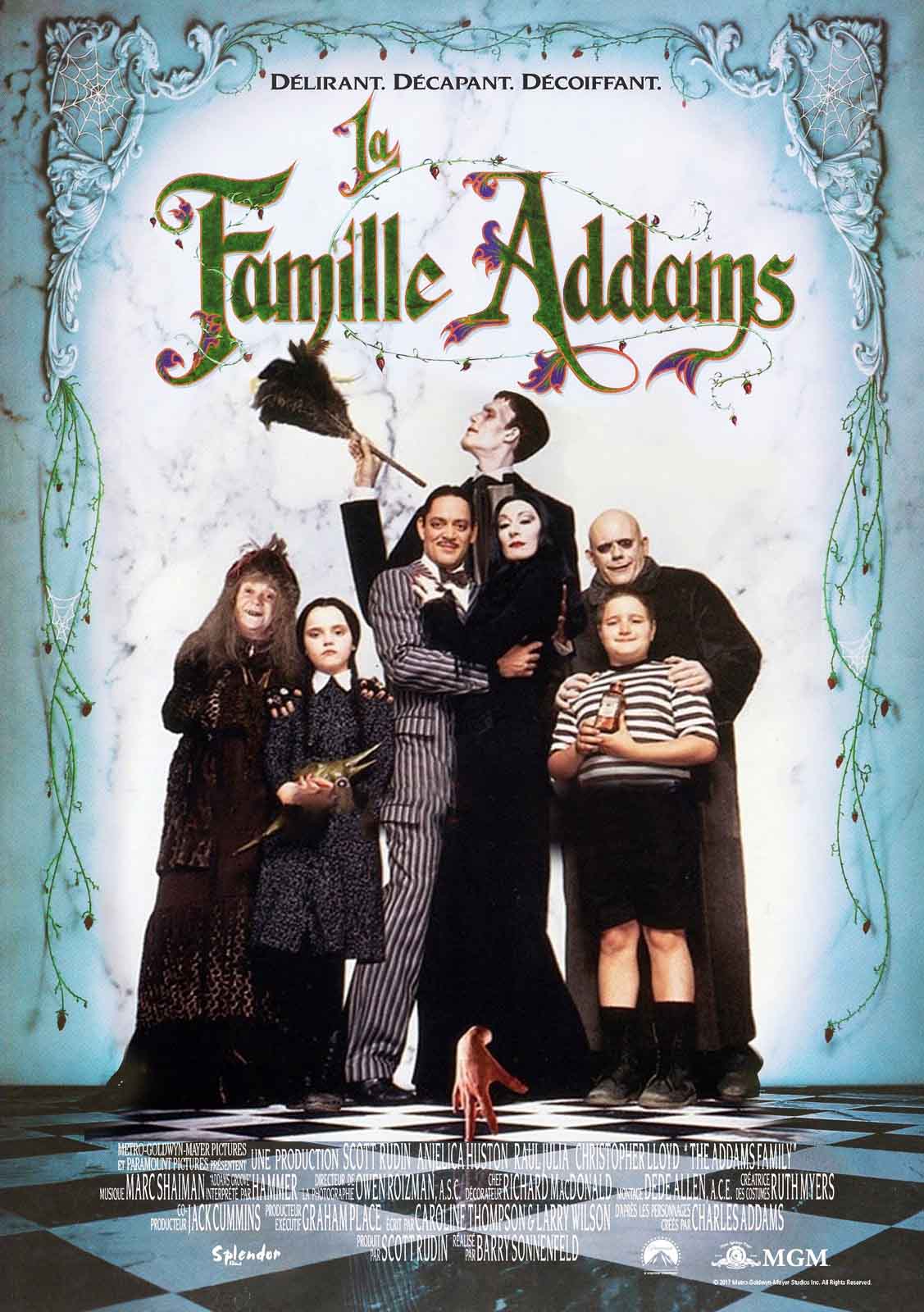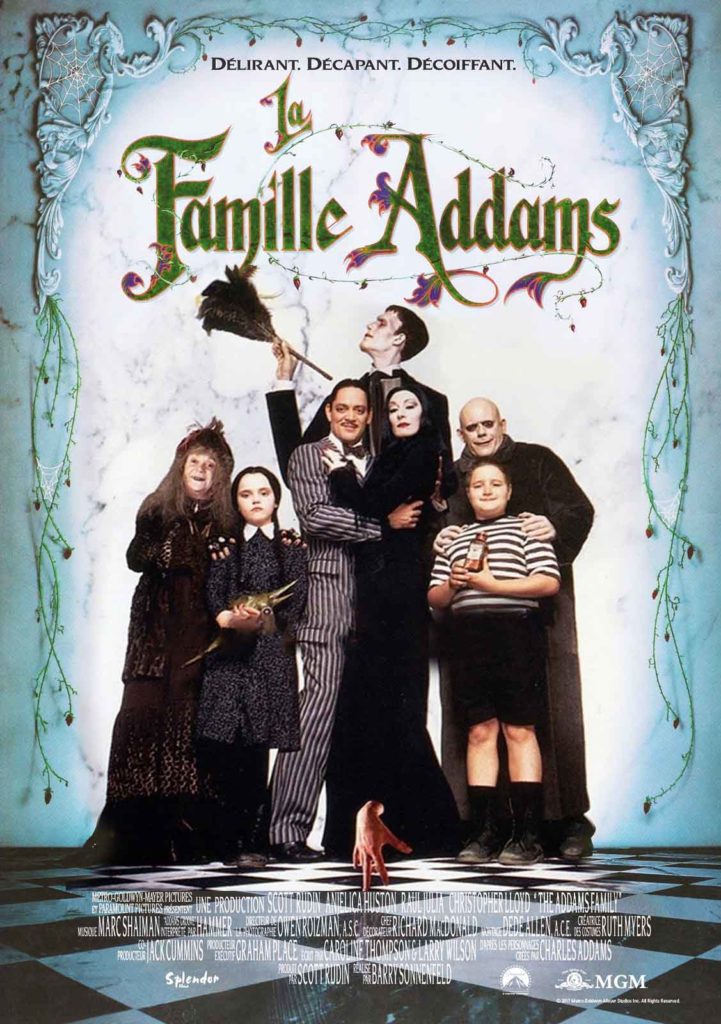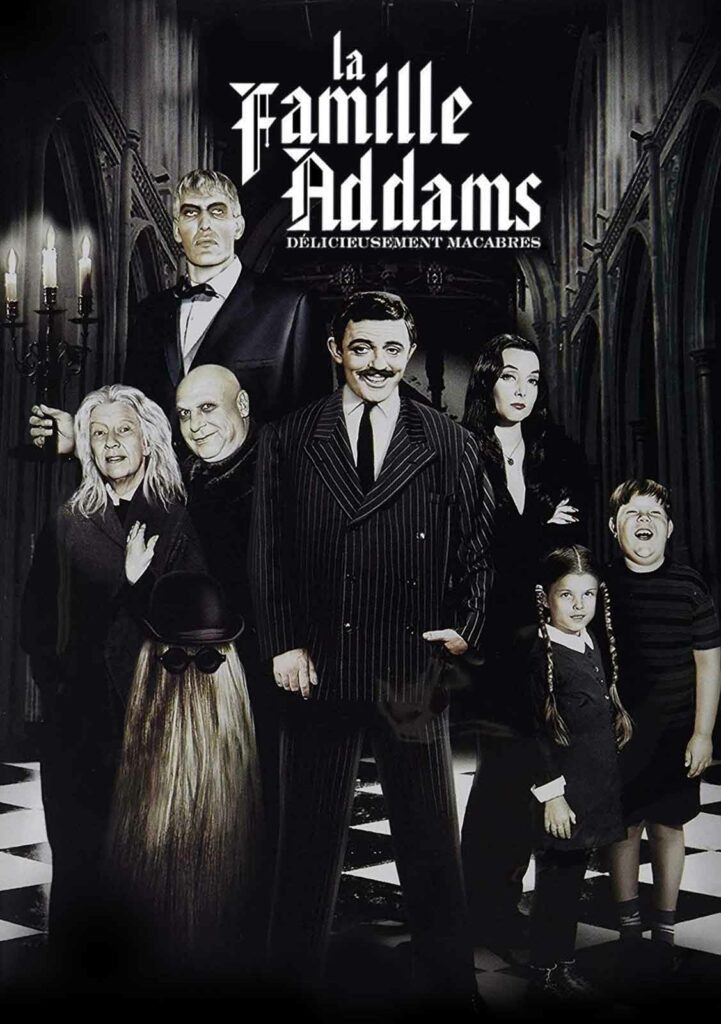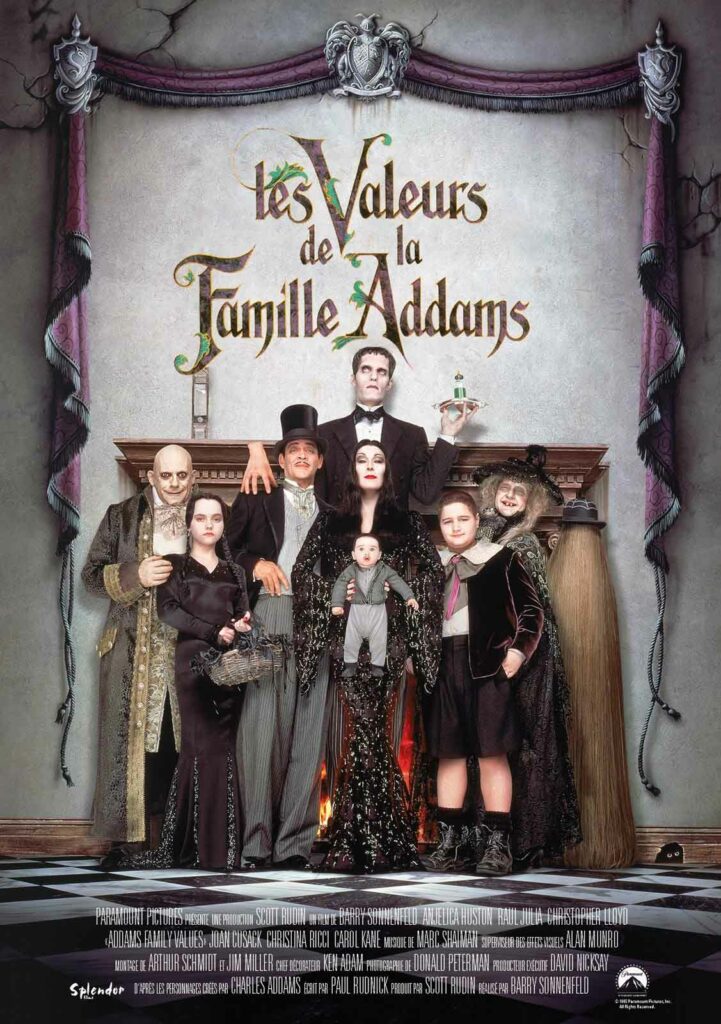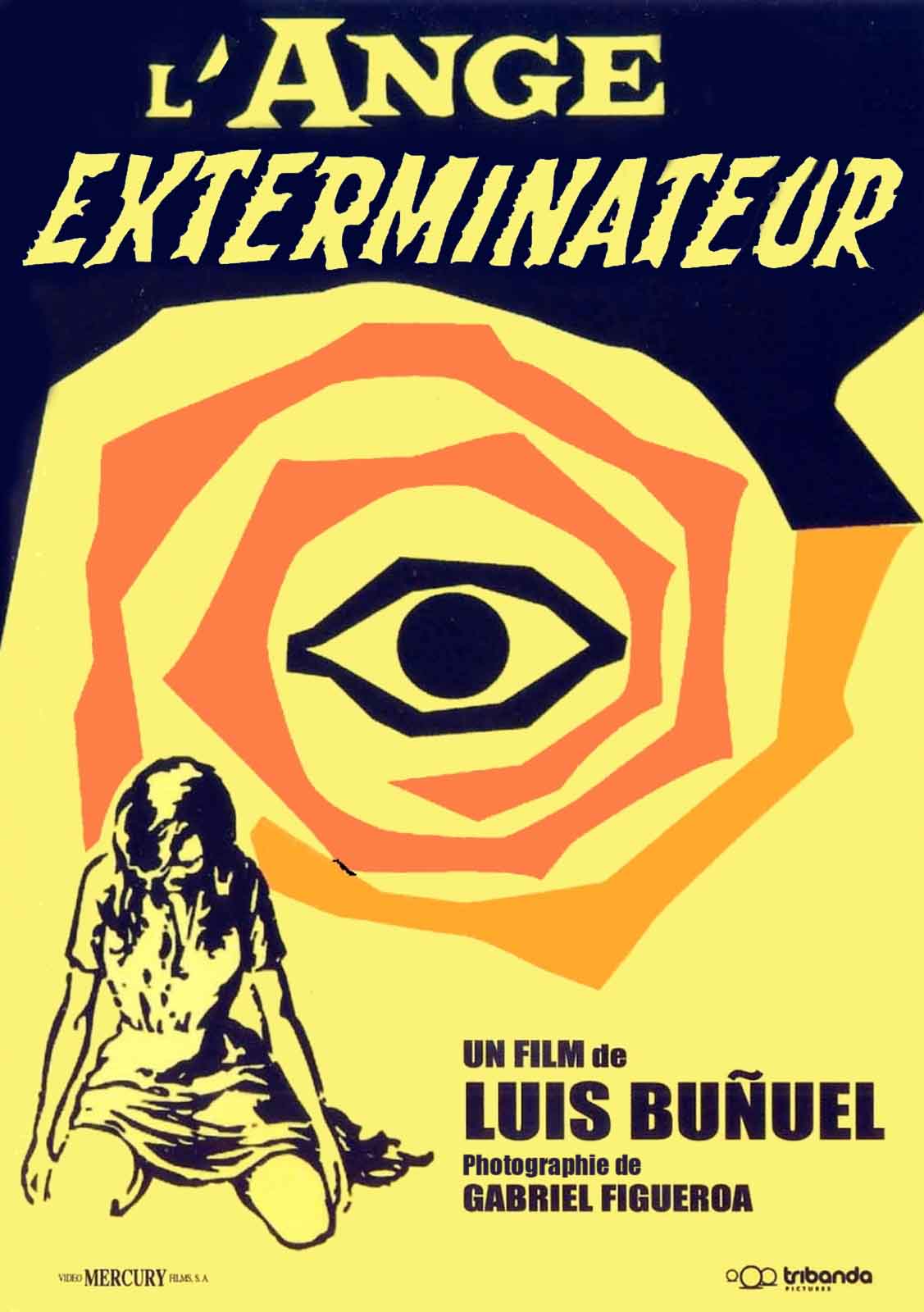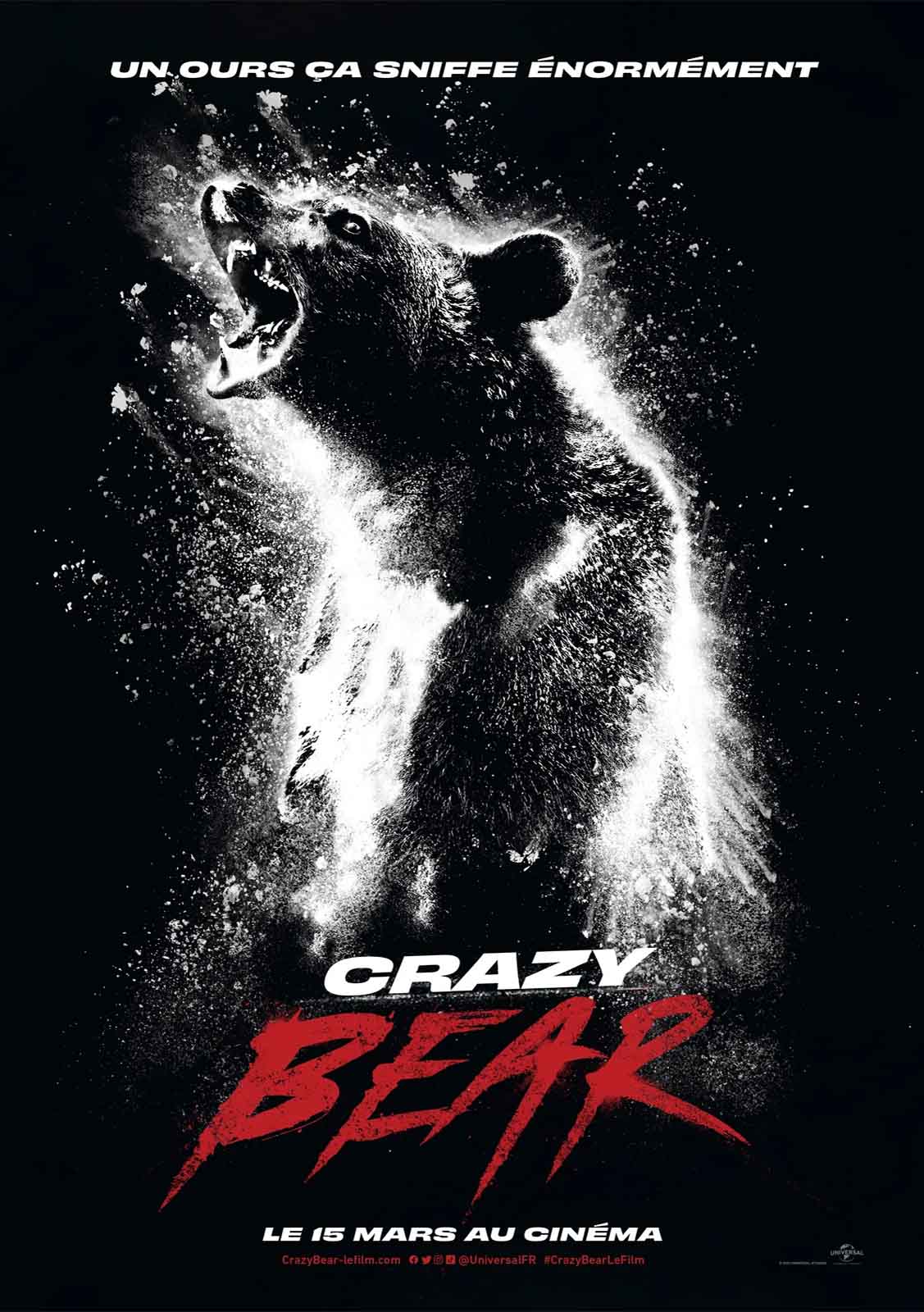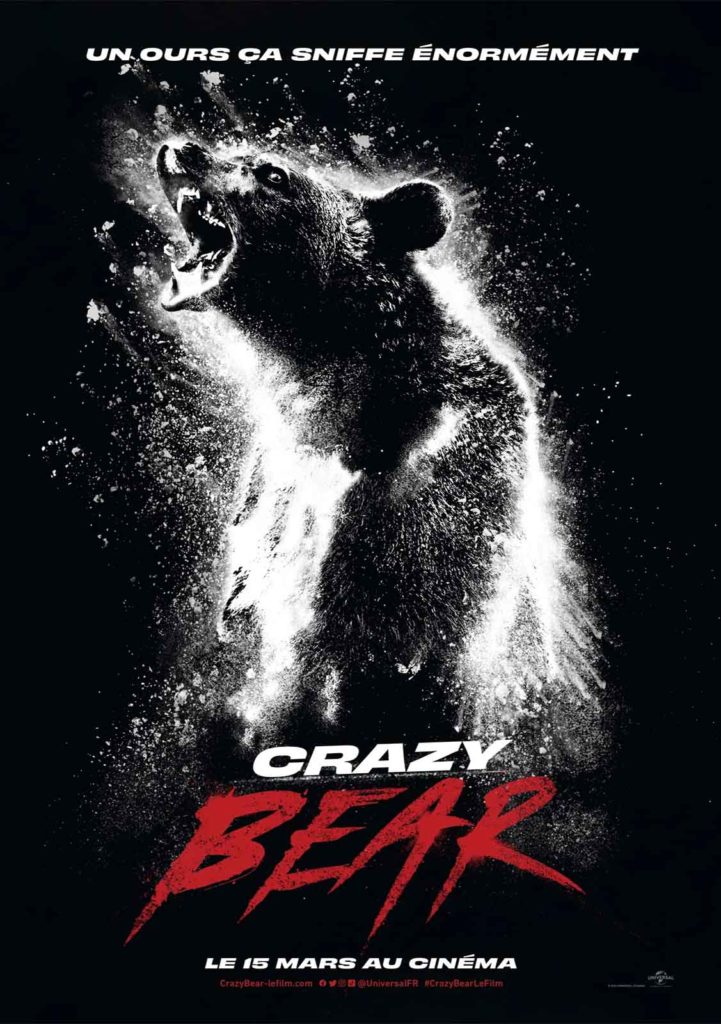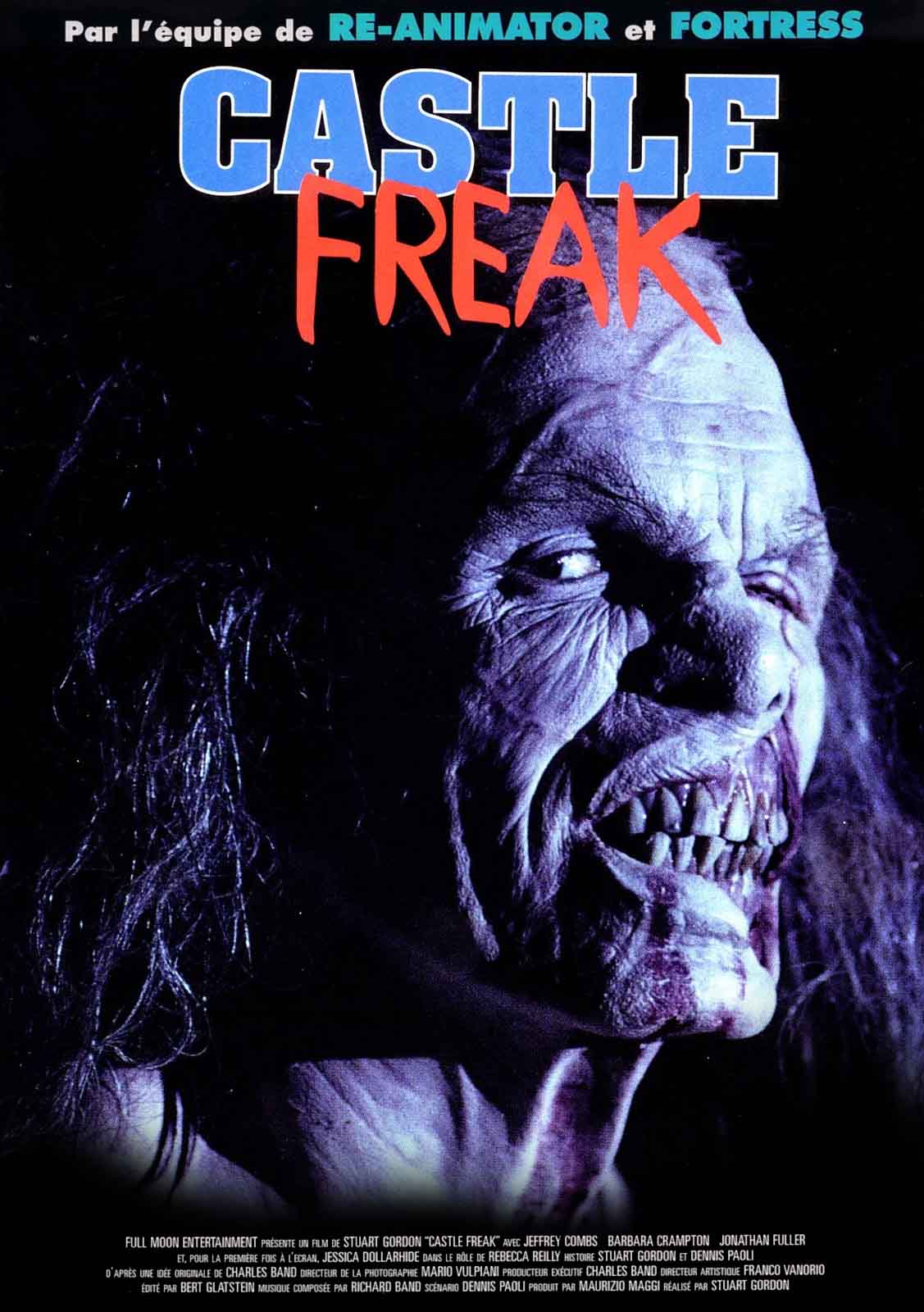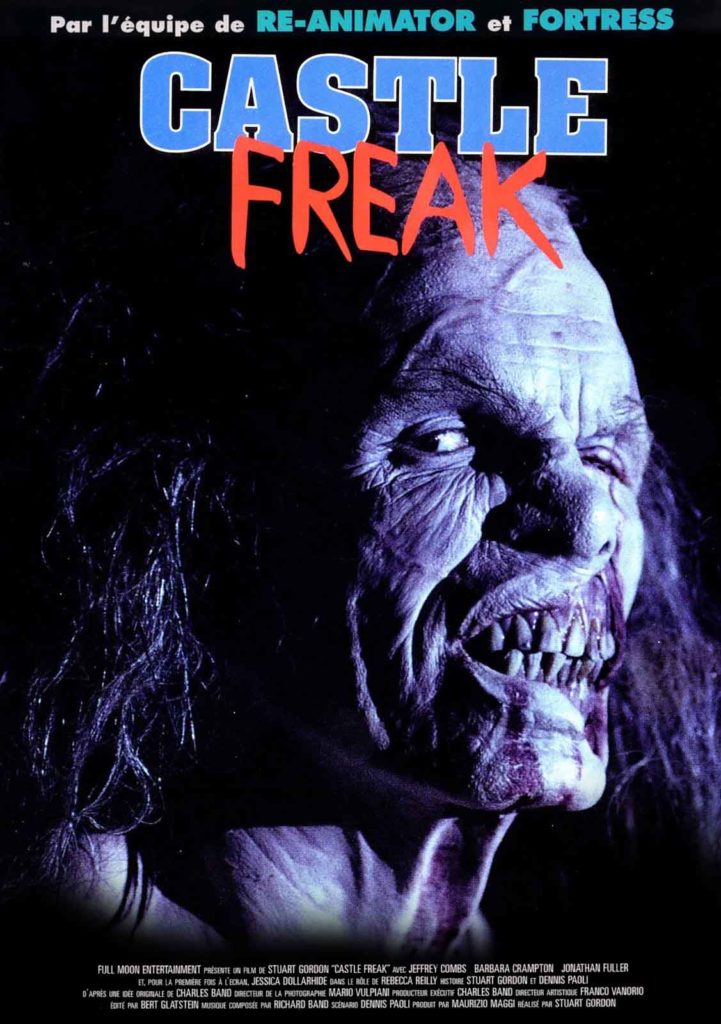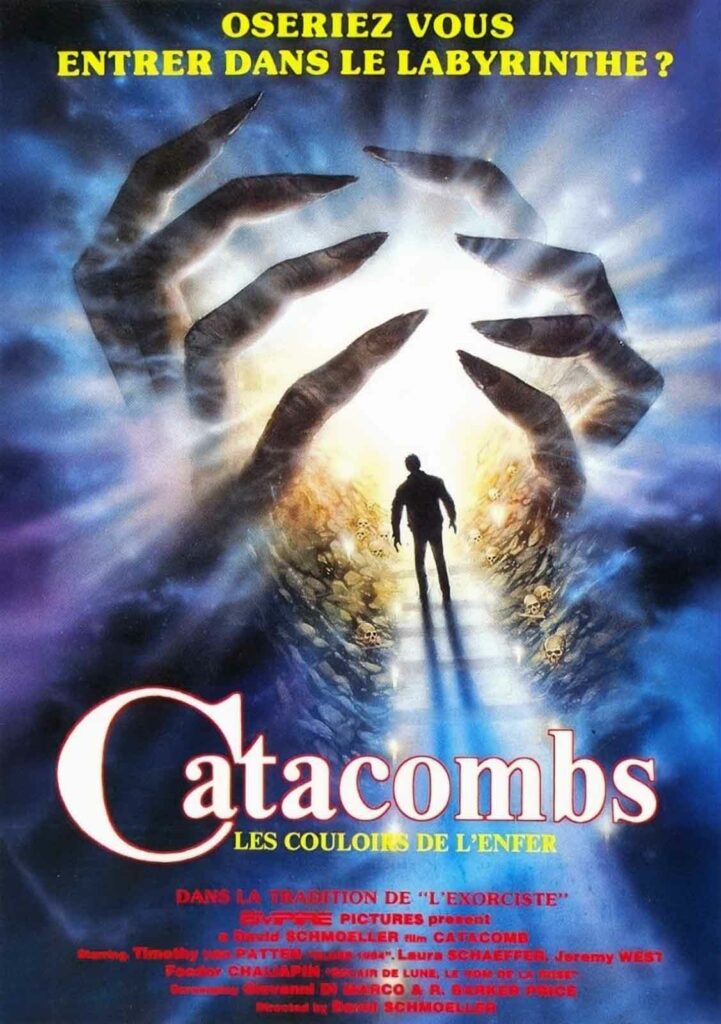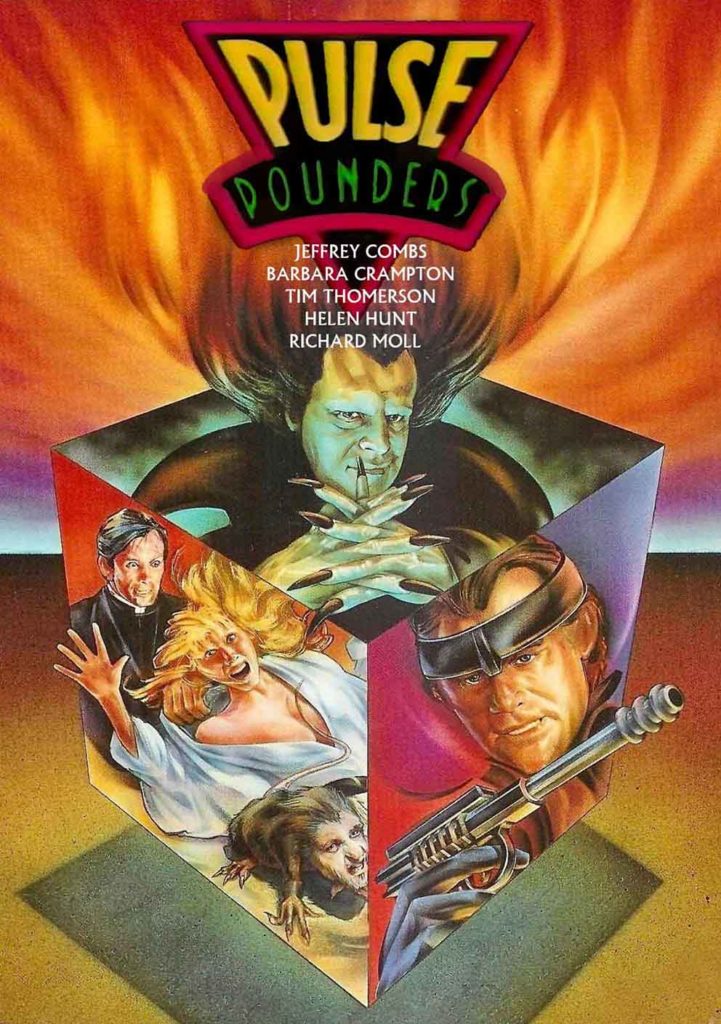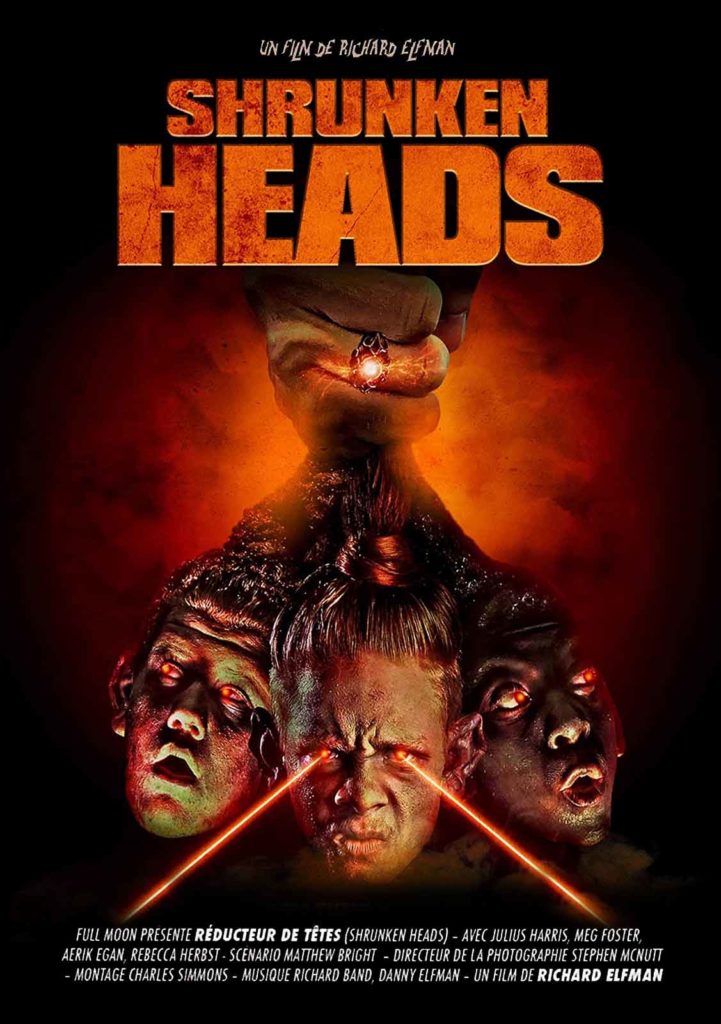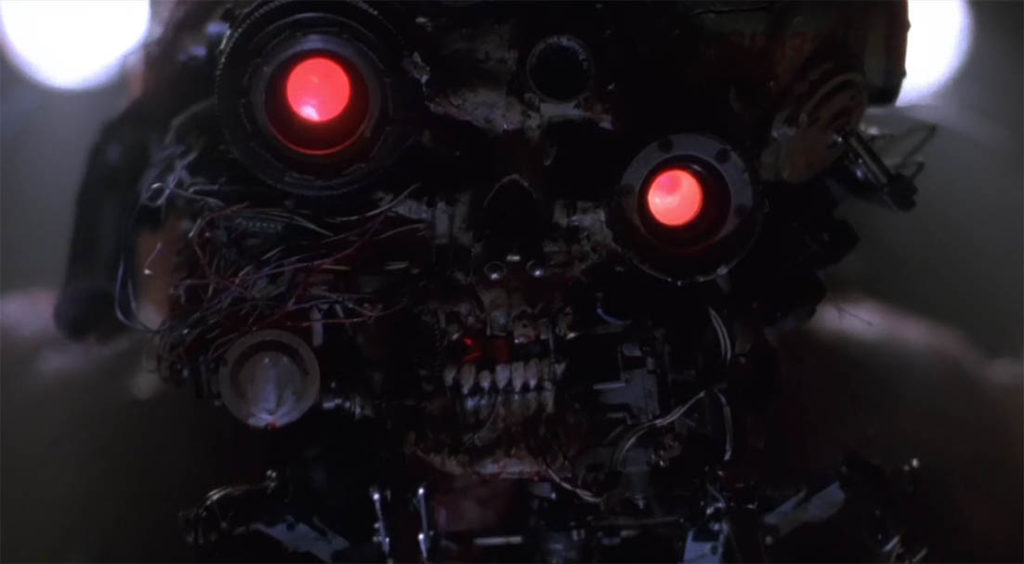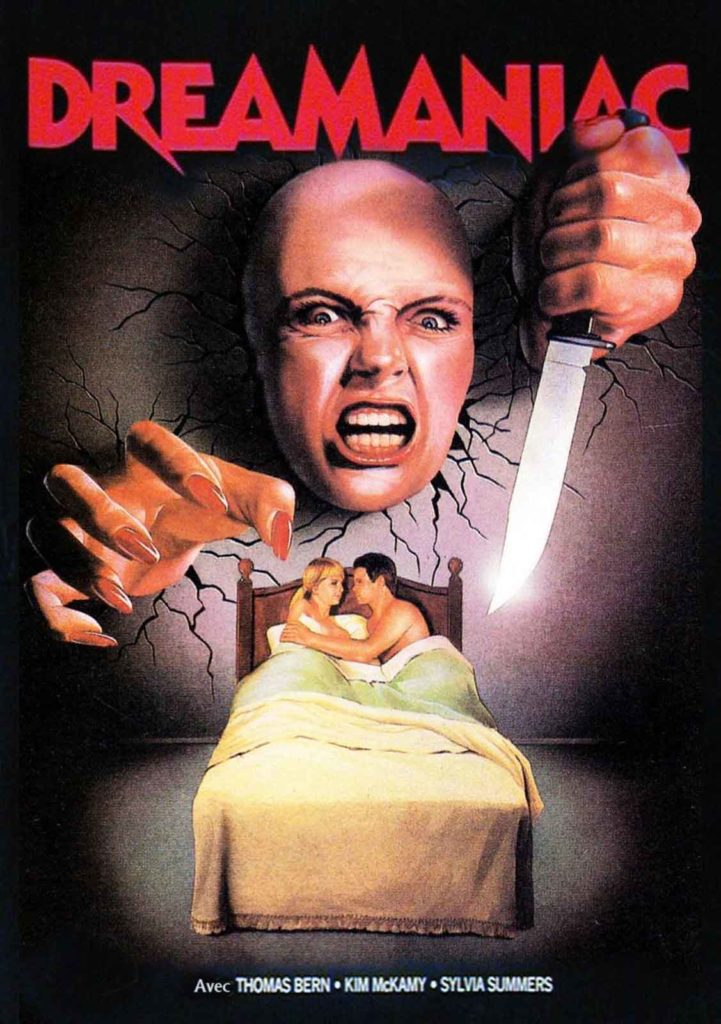Face à une nouvelle menace extra-terrestre, les hommes en noir incarnés par Will Smith et Tommy Lee Jones reprennent du service…
MEN IN BLACK II
2002 – USA
Réalisé par Barry Sonnenfeld
Avec Will Smith, Tommy Lee Jones, Rip Torn, Lara Flynn Boyle, Johnny Knoxville, Rosario Dawson, Tony Shalhoub, Patrick Warburton, Jack Kehler, David Cross
THEMA EXTRA-TERRESTRES I SAGA MEN IN BLACK
Toutes les planètes semblaient s’être alignées pour la sortie de Men in Black, immense succès ayant trouvé aux yeux du public l’équilibre idéal entre la comédie, la science-fiction et la mécanique éprouvée du « buddy movie ». Le scénariste David Koepp est donc chargé de plancher rapidement sur l’écriture d’un deuxième film. Mais l’auteur (très courtisé après ses travaux sur Jurassic Park et Mission impossible) doit passer son tour pour partir œuvrer sur Panic Room et Spider-Man. Le scénario de Men in Black II est donc confié à Robert Gordon, puis à Barry Fanaro qui révise la première version en y ajoutant des touches d’humour référentielles et en positionnant le retour de l’agent K (Tommy Lee Jones) plus tôt dans le récit. Une relation amoureuse est prévue entre J (Will Smith) et le témoin d’un phénomène extra-terrestre (Rosario Dawson). Le réalisateur Barry Sonnenfeld, qui rempile derrière la caméra, n’est pas très chaud pour cette sous-intrigue sentimentale peu conforme aux personnages tels qu’il les conçoit, mais ses protestations n’ont pas beaucoup d’impact auprès du studio. Will et Rosario se feront donc les yeux doux dans le film. Dans le rôle de la grande méchante venue d’ailleurs, c’est d’abord Famke Janssen qui est sélectionnée. Mais la « bad girl » de Goldeneye n’est pas disponible et cède sa place à Lara Flynn Boyle, transfuge de la série Twin Peaks.


C’est un agent J un peu blasé que nous découvrons en début de métrage. Avec sa désinvolture habituelle, Will Smith retrouve la veste et les lunettes noires de l’homme du gouvernement chargé de régler le plus discrètement possible les affaires extra-terrestres sur Terre. Mais depuis que son mentor K s’est volontairement fait effacer la mémoire pour couler des jours tranquilles loin des aliens de tous poils, J a beaucoup de mal à trouver un partenaire à la hauteur. Pendant un temps, il fait équipe avec Frank (un chien très bavard). Or une nouvelle menace venue de l’espace se profile bientôt. Il s’agit de Serleena (Lara Flynn Boyle), une redoutable créature végétale ayant pris l’apparence d’un mannequin de lingerie fine. Pour la combattre, il n’y a qu’une seule solution : faire revenir l’agent K.
Mauvais alien
L’idée principale de Men in Black II consiste donc à inverser les rôles que tenaient Will Smith et Tommy Lee Jones dans le premier film. Cette fois-ci, J est l’homme en noir expérimenté qui ne s’étonne plus de rien et K l’individu candide et ordinaire qui va devoir tout redécouvrir avec stupeur. Bien sûr, l’effet de surprise n’a plus vraiment cours et l’on sent bien l’embarras des différents scénaristes qui se sont succédé pour écrire ce second épisode, cherchant en vain à retrouver l’alchimie du film original. Les ficelles sont un peu grosses, les rebondissements très modérément convaincants et les acteurs eux-mêmes semblent n’y croire qu’à moitié, comme s’ils se livraient un peu à contrecœur à l’exercice obligatoire de la séquelle. Bien sûr, quelques passages drôles parviennent toujours à se frayer un chemin au fil du film, notamment les facéties canines de l’agent Frank ou les interventions de Peter Graves dans son propre rôle, mais la spontanéité n’est pas toujours au rendez-vous. Même les effets spéciaux manquent de finesse, notamment cette profusion d’images de synthèse excessives ou ces incrustations très approximatives. Prévu pour se situer au beau milieu des tours jumelles du World Trade Center, le final du film a été relocalisé suite aux attentats du 11 septembre. Men in Black II s’achève donc par une espèce de feu d’artifice au-dessus de la Statue de la Liberté. La troisième aventure des hommes en noir redressera fort heureusement la barre qualitative de la franchise.
© Gilles Penso
Partagez cet article