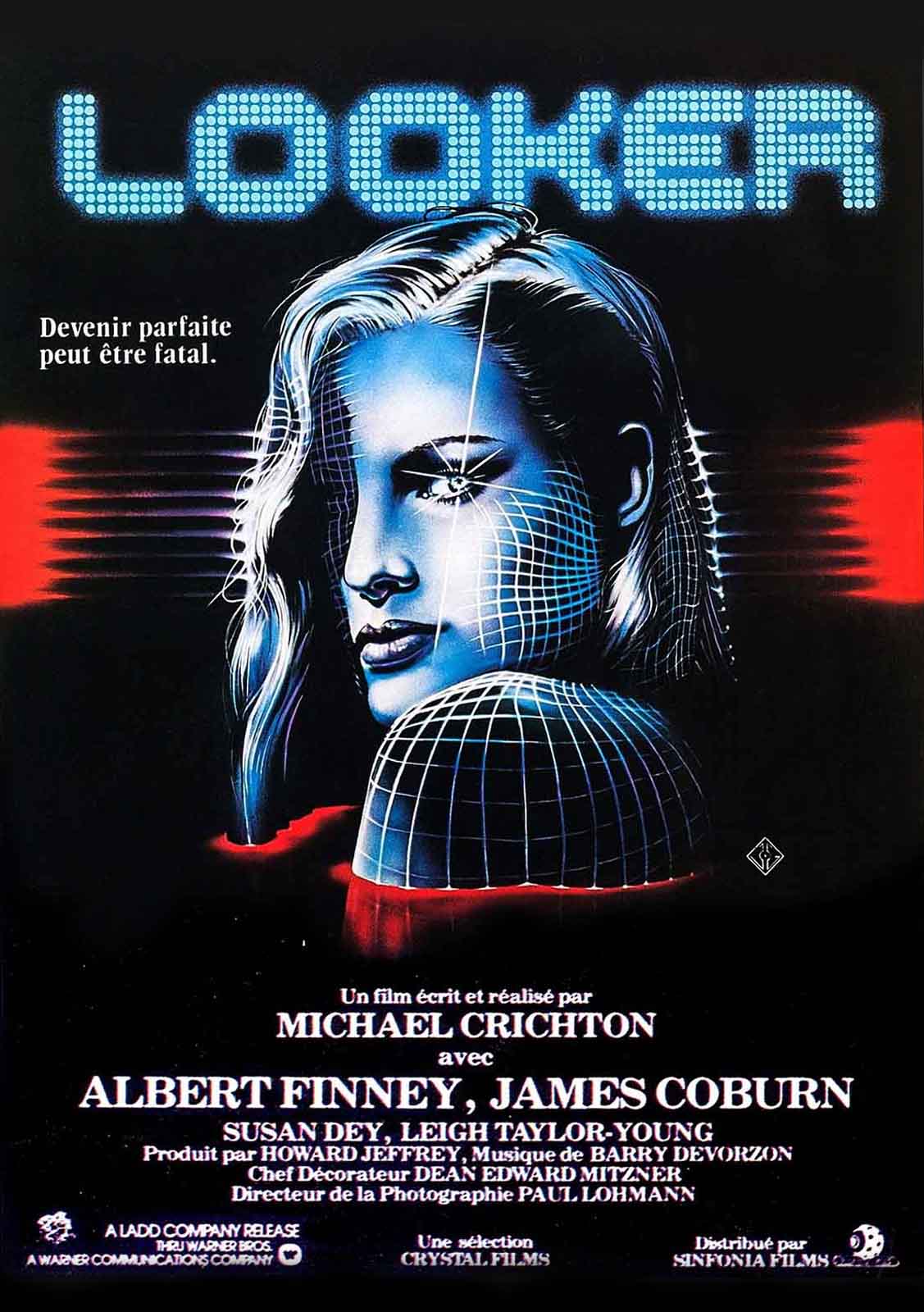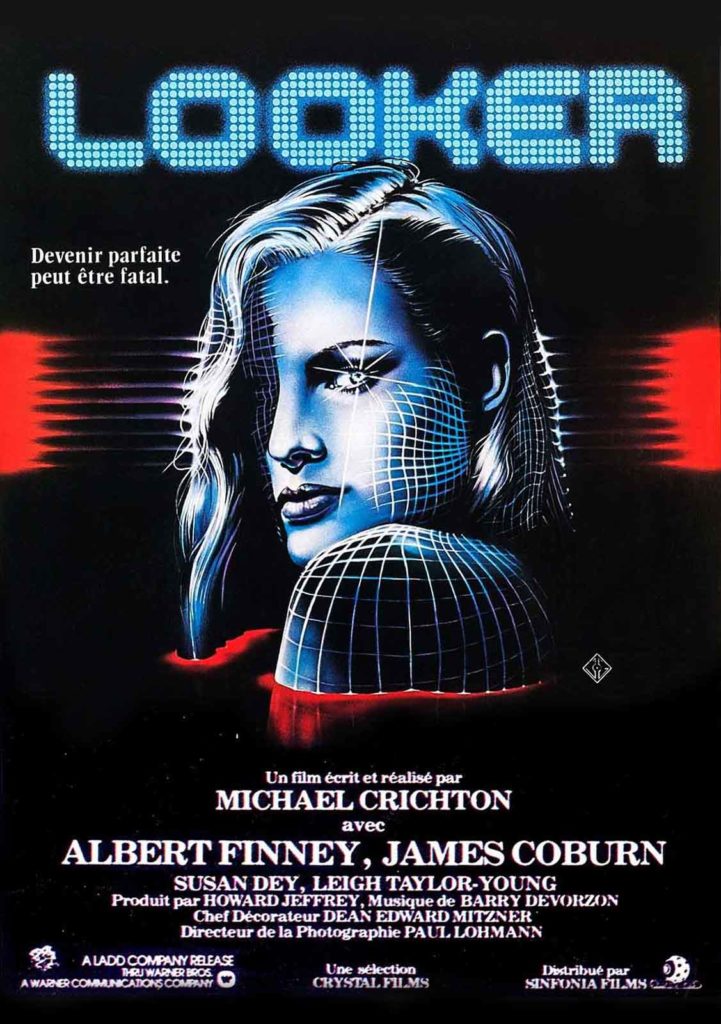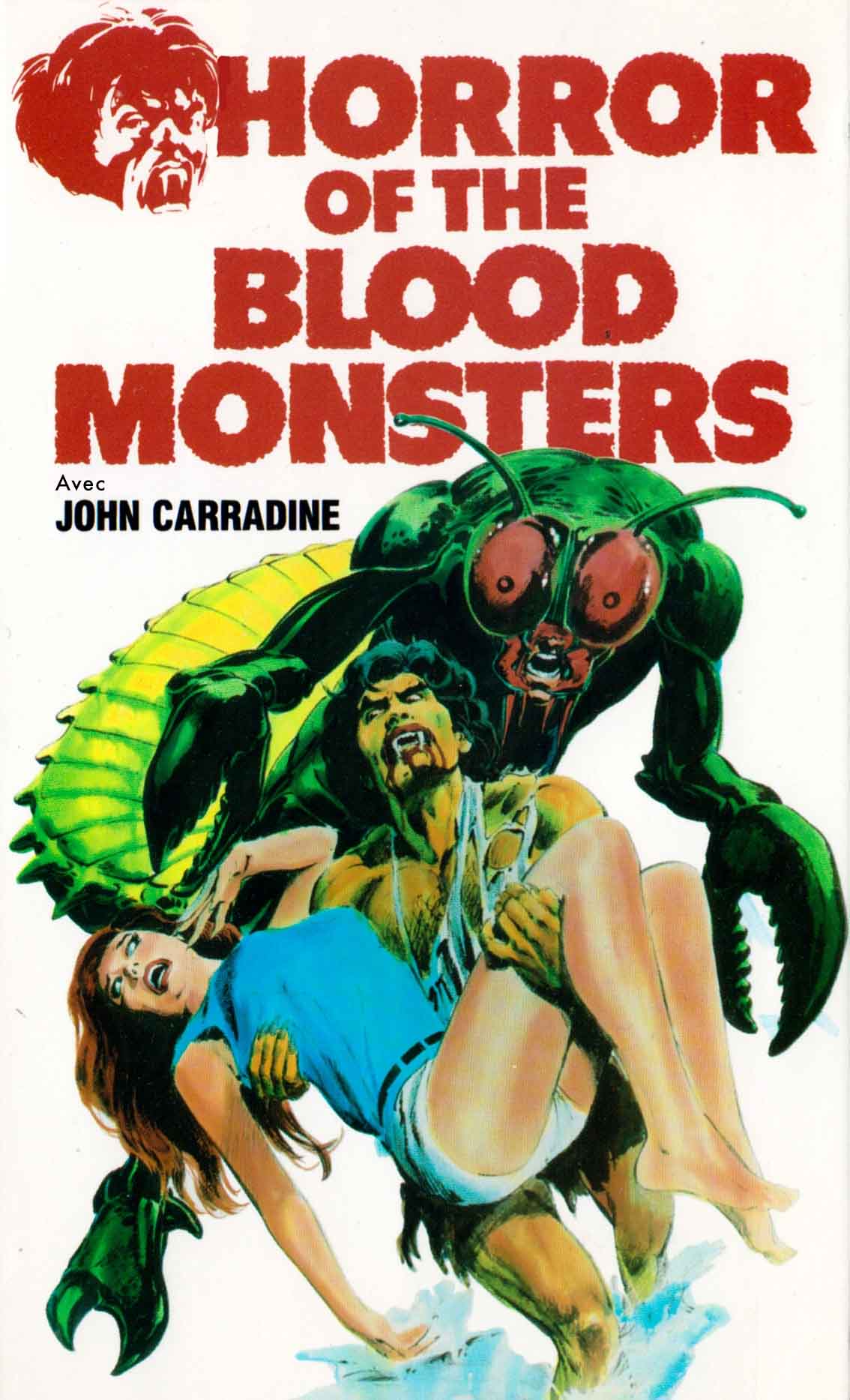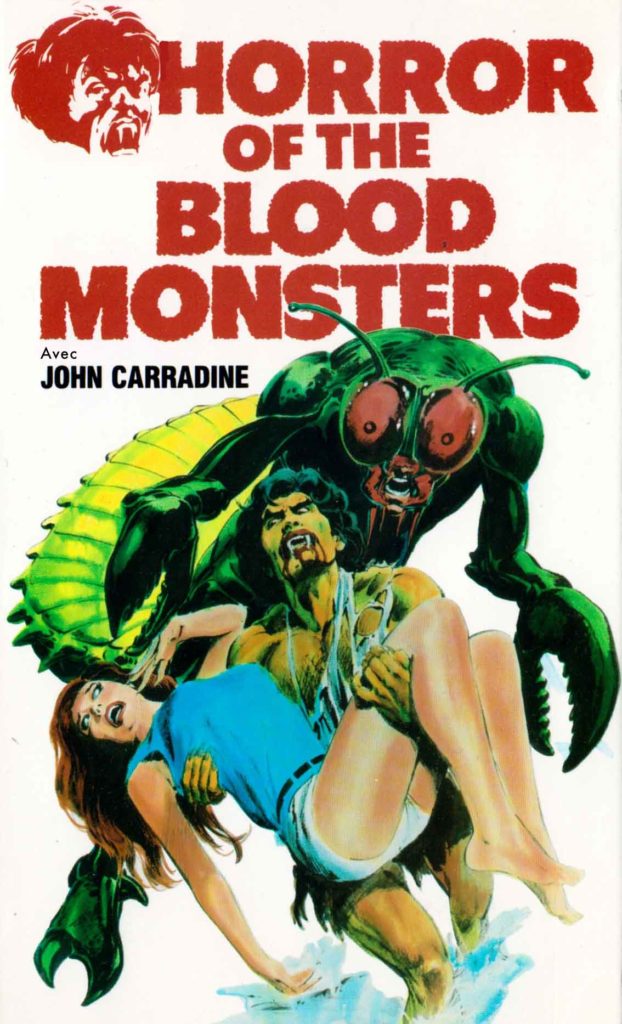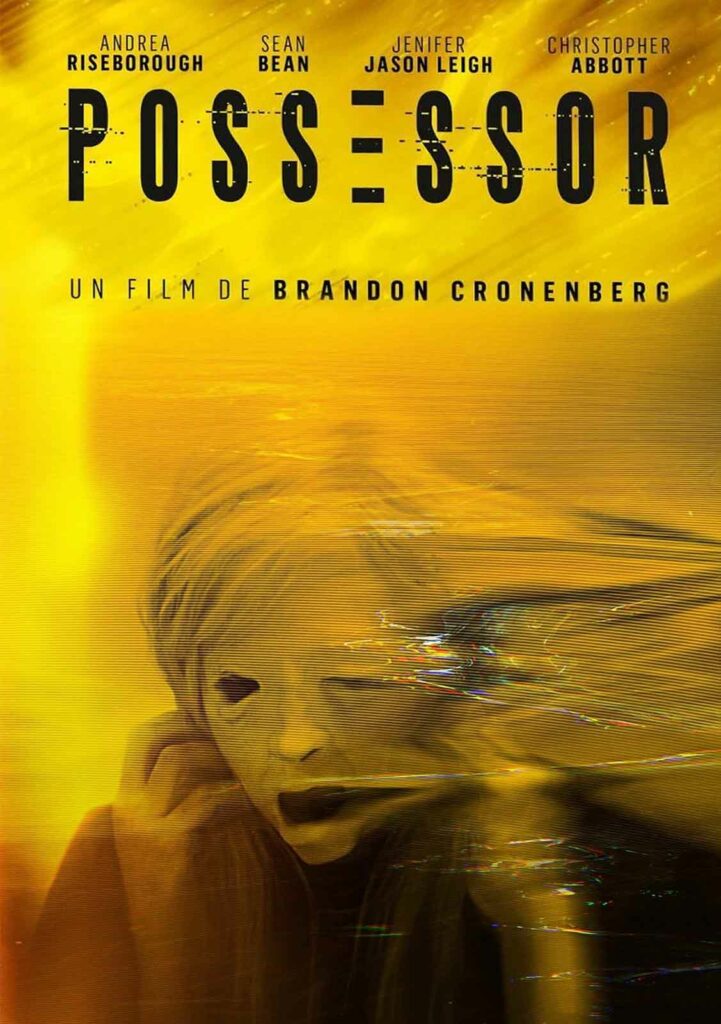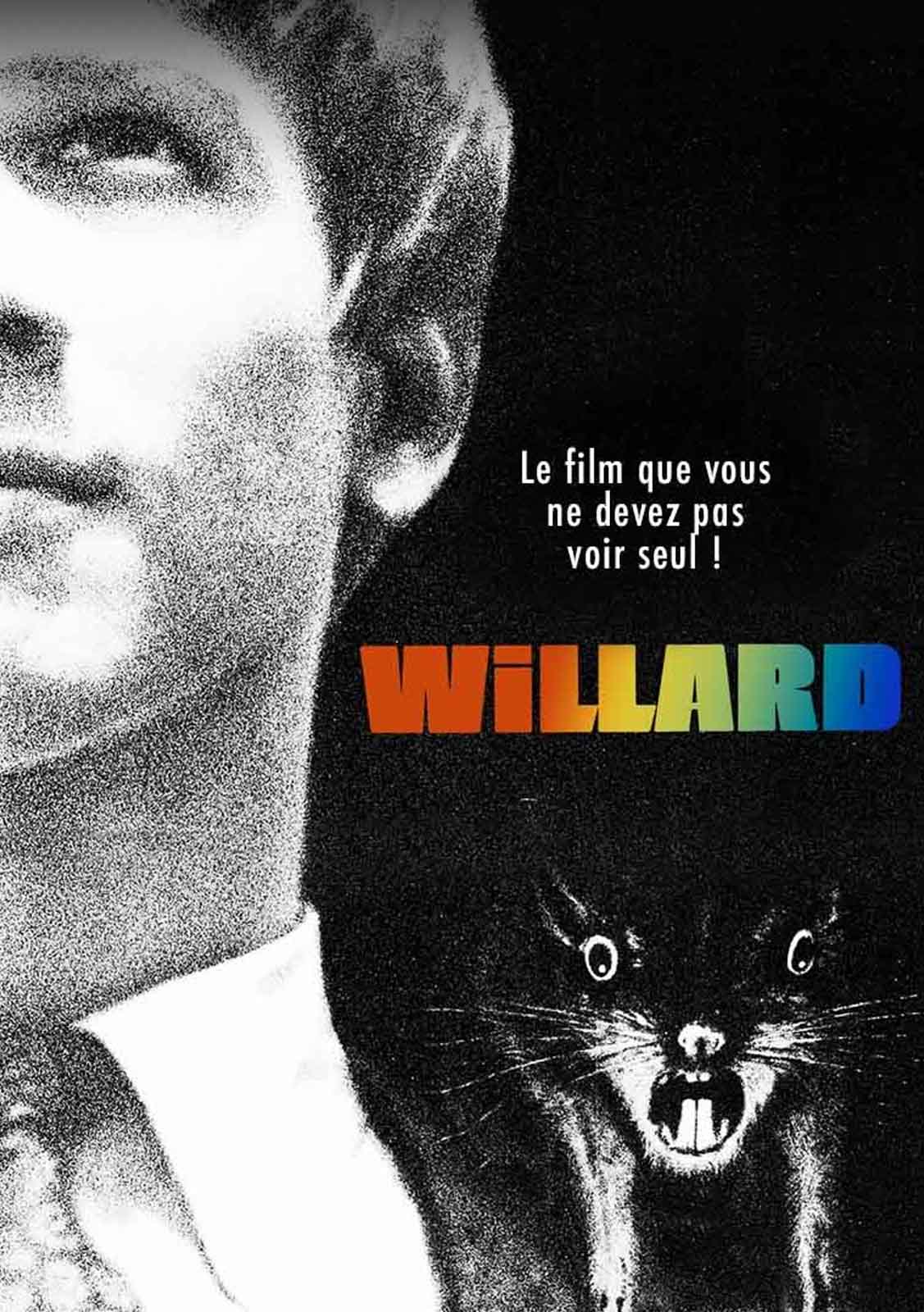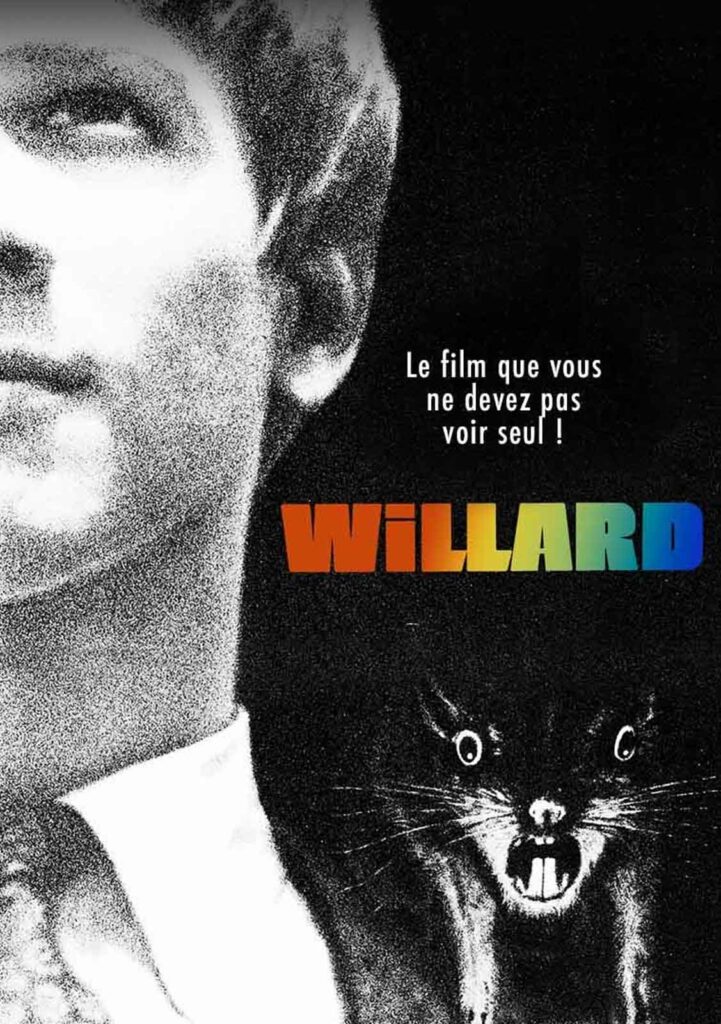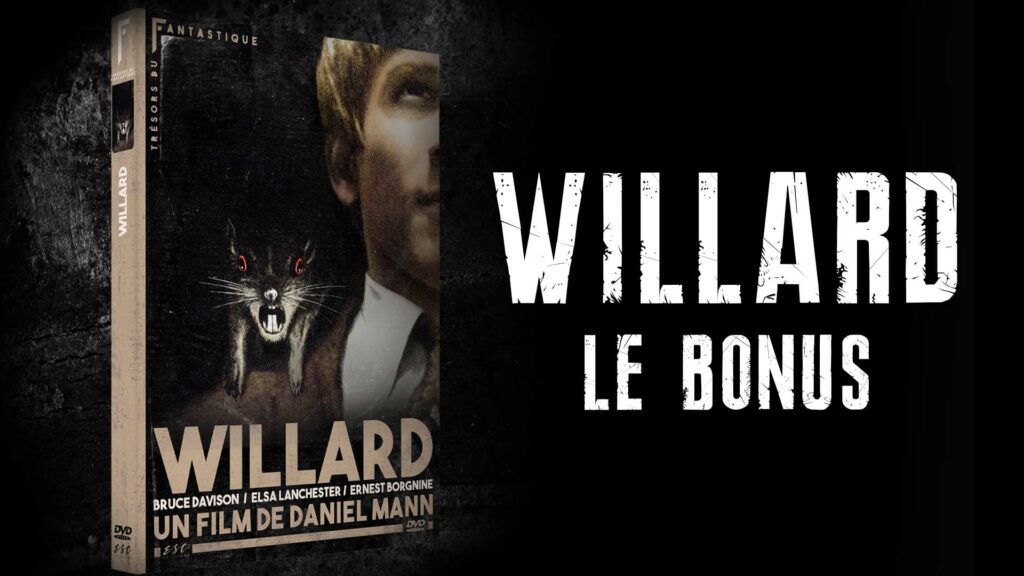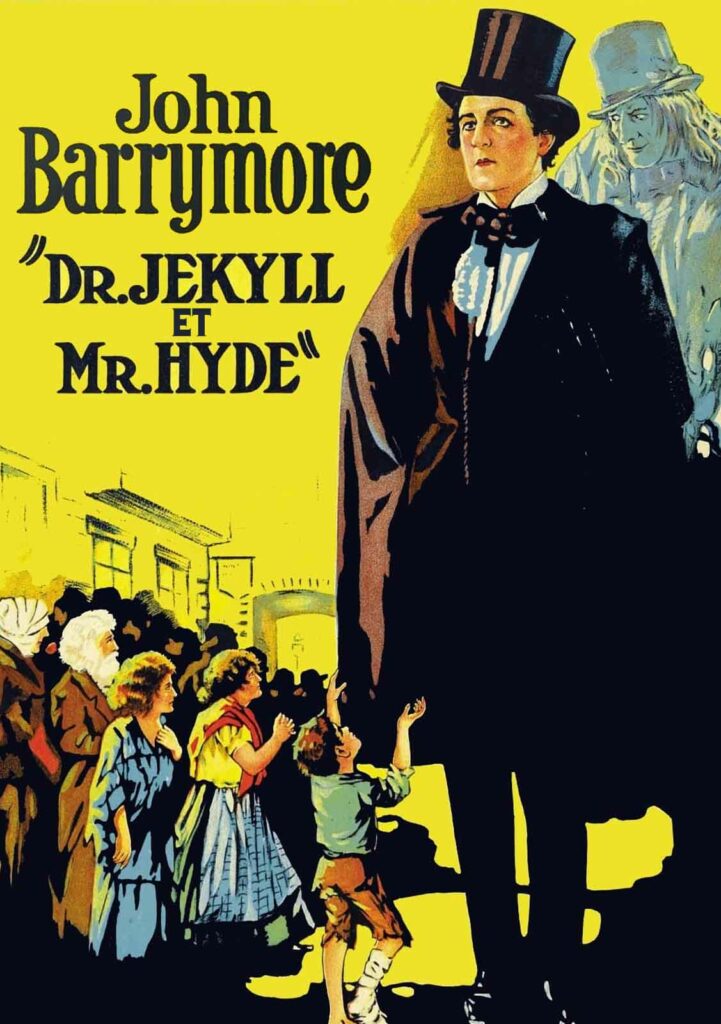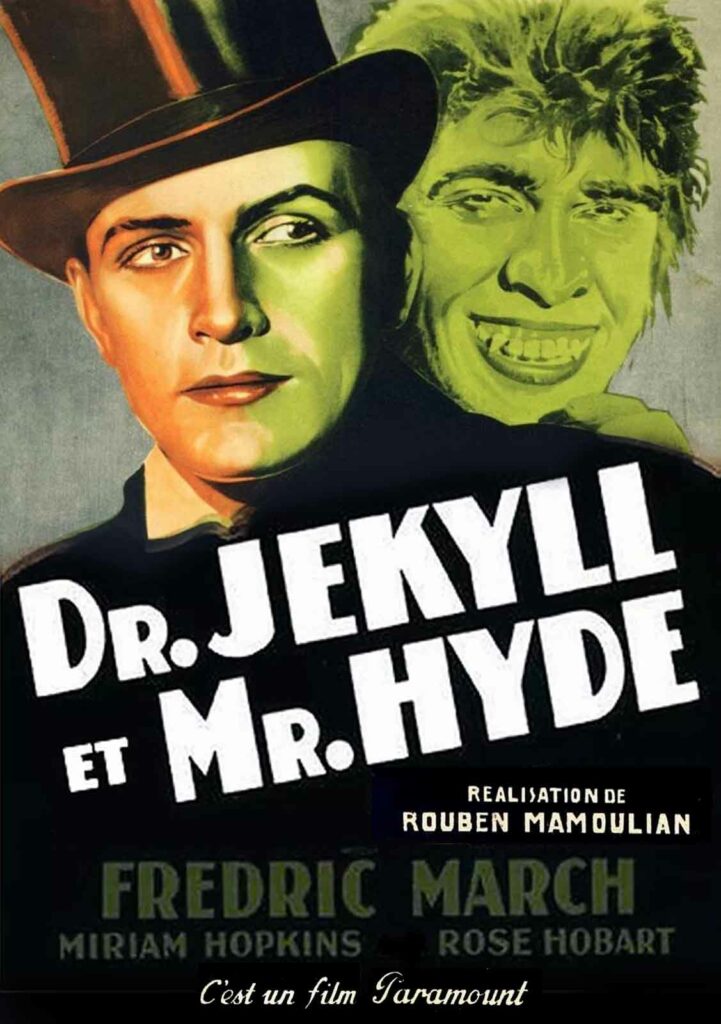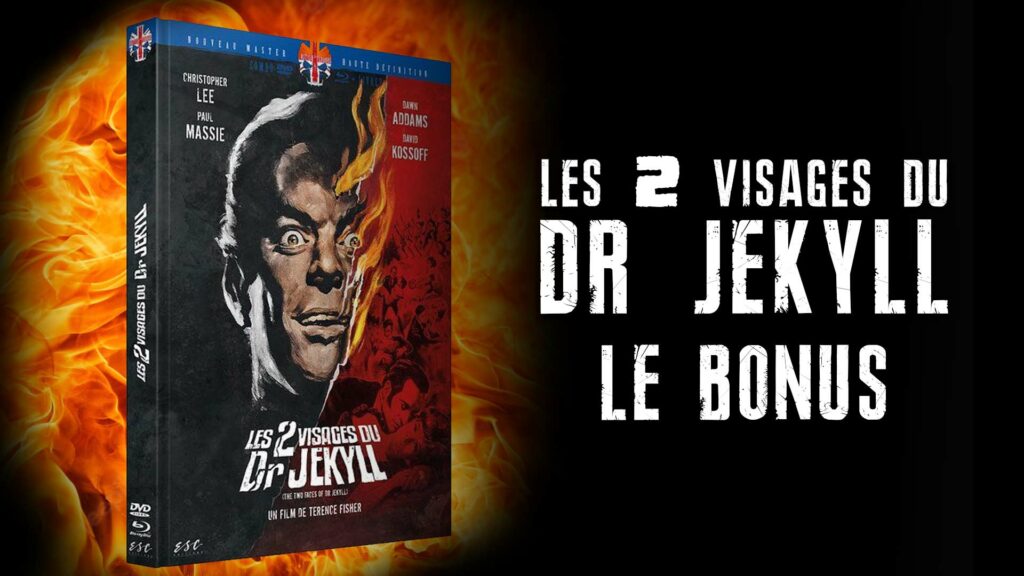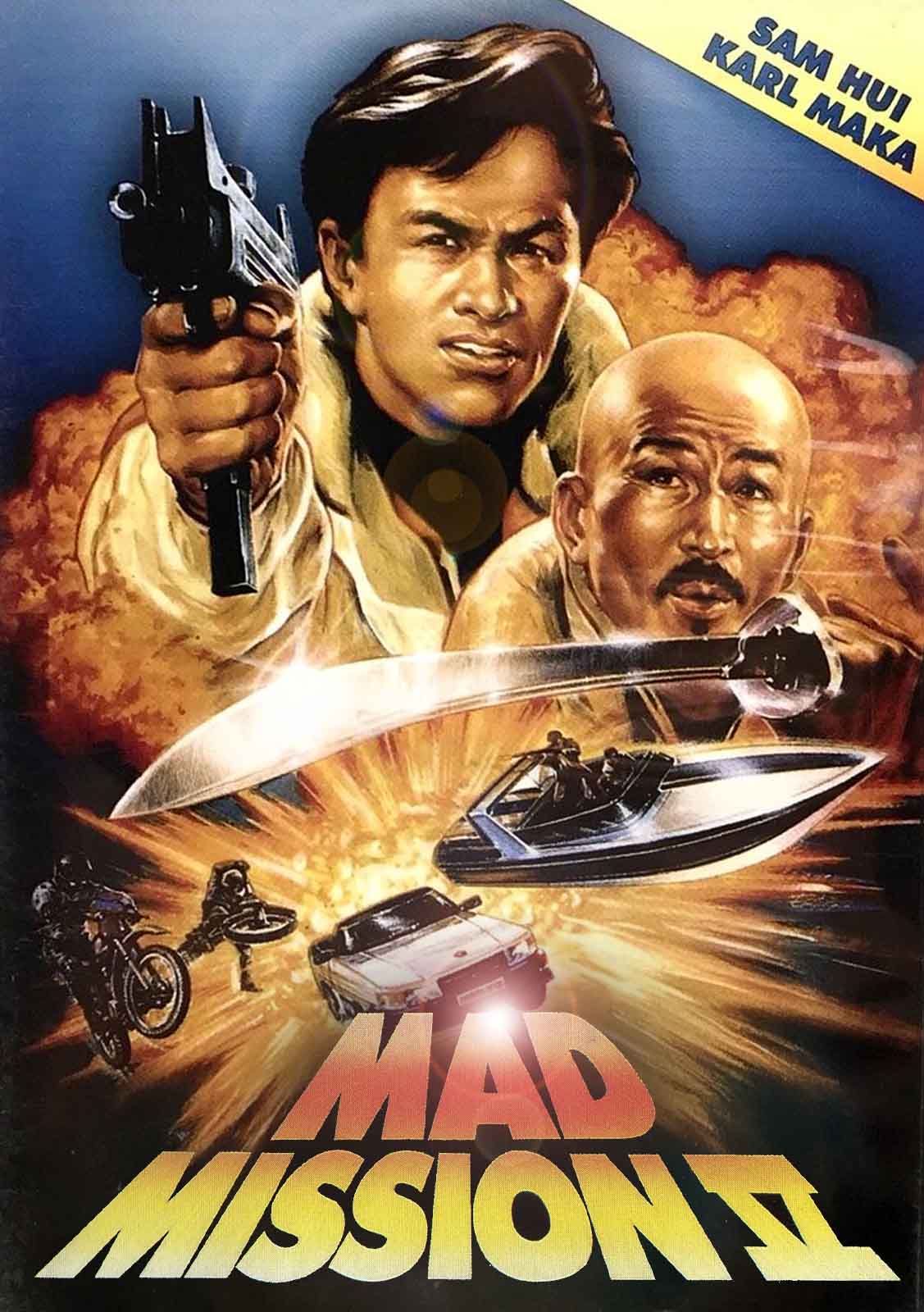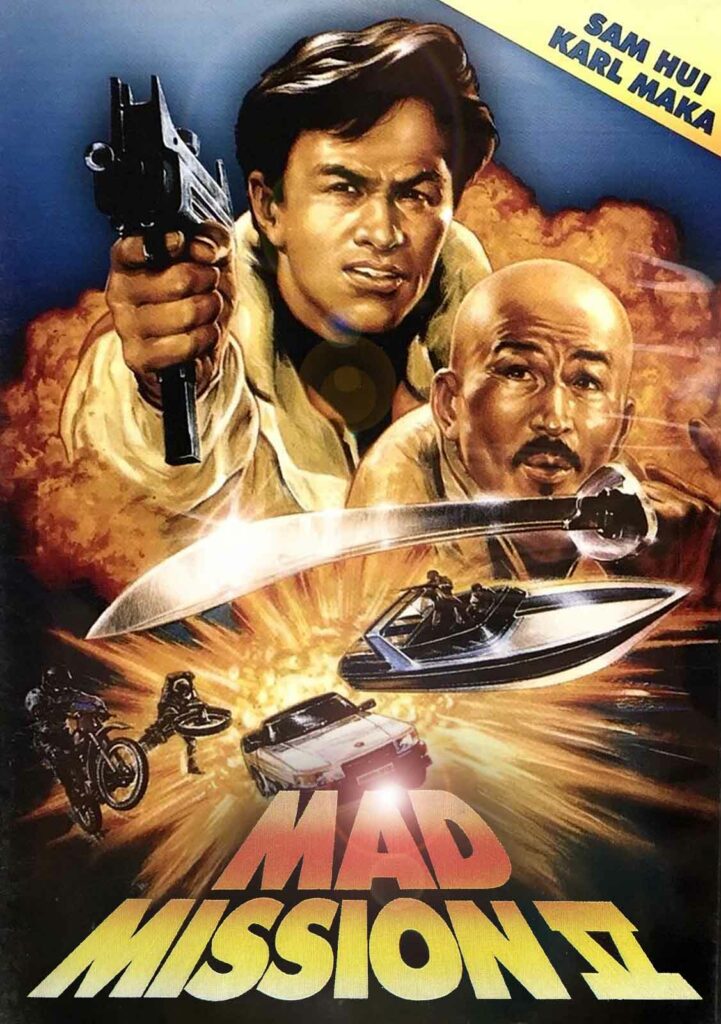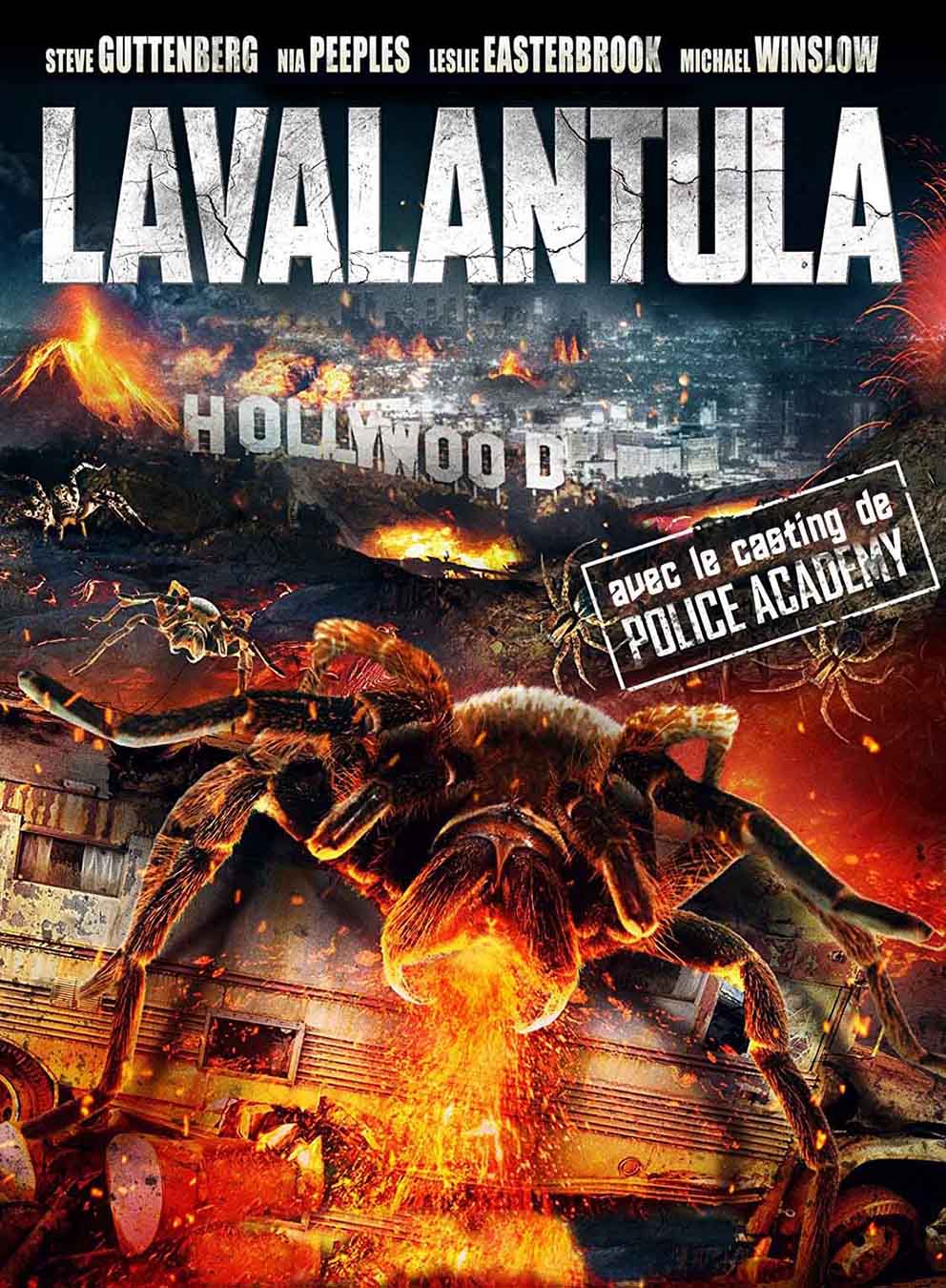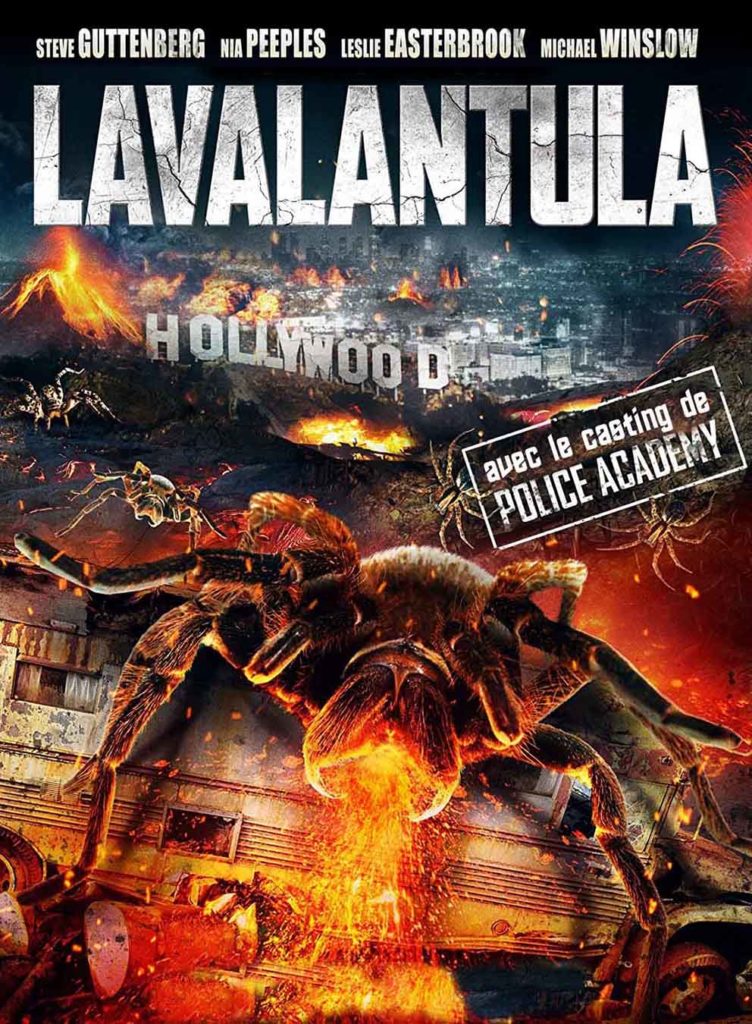Roger Corman persiste et signe dans le domaine du film de monstres géants avec des parasites gluants infestant les marais d’une bourgade de Floride
ATTACK OF THE GIANT LEECHES
1959 – USA
Réalisé par Bernard L. Kowalski
Avec Bruno Ve Sota, Yvette Vickers, Michael Emmet, Ken Clark, Gene Roth, Jan Shepard, Tyler McVey, Dan White
THEMA INSECTES ET INVERTÉBRÉS
Deux ans après L’Attaque des crabes géants, Roger Corman réitère dans le domaine des invertébrés démesurés avec cette Attaque des sangsues géantes dont il confie cette fois la mise en scène à Bernard Kowalski, vétéran de séries télévisées telles que Gunsmoke ou Les Incorruptibles. Prometteurs, le titre et les posters d’époque dissimulent hélas un film ennuyeux et longuet malgré sa modeste durée de 62 minutes. Nous sommes dans une petite ville de Floride, où les autochtones viennent volontiers traîner derrière le comptoir du ventripotent barman Dave Walker (Bruno VeSota), sosie quelque peu amorphe d’Orson Welles. L’épouse de ce dernier, Liz (Yvette Vickers), est une bimbo provocante qui fait saliver tous les habitués du bar, notamment l’athlétique Cal (Michael Emmet). Tandis que le drame conjugal couve, un accident secoue les chaumières. Un chasseur a en effet été retrouvé défiguré dans les marais. Attribuant ce décès violent à un crocodile, la police classe rapidement l’affaire. Mais Steve Benton (Ken Clark), un agent chargé de chasser les braconniers et de préserver l’environnement, décide de mener sa propre enquête. Comme il s’agit d’un beau gosse blond et musclé, et qu’il est amoureux d’une jolie brunette dont le père est scientifique, les amateurs des clichés de la science-fiction à l’ancienne ne sont pas dépaysés.


Au-delà de son désespérant premier degré, le film s’efforce tout de même de dresser une série de portraits pittoresques pour le moins récréatifs, notamment le shérif alcoolique, les piliers du bar et l’apathique barman. Ce dernier finit par surprendre son épouse aux bras de Cal. Sortant enfin de sa léthargie, il les mène jusqu’aux marais du bout de son fusil… Jusqu’à ce que les deux partisans de l’adultère ne soient soudain engloutis par des sangsues géantes, comme le titre l’indique assez bien. Sauf qu’en guise de monstres assoiffés de sang, nous n’avons droit qu’à de grands morceaux de caoutchouc qui flottent dans l’eau. Les deux victimes suivantes sont des pêcheurs, et il faudra attendre un certain temps avant de voir les sangsues géantes plus distinctement, autrement dit deux comédiens engoncés dans des costumes en plastique truffés de ventouses.
Sens dessus dessous
Après avoir capturé leurs proies humaines, les monstres les emmènent dans une grotte souterraine pour leur sucer le sang. D’où une séquence assez dantesque où tout le monde hurle, le visage blafard et couvert de plaies, sous les assauts répétés des sangsues pataudes (dont l’une met deux bonnes minutes à s’extraire maladroitement de l’eau). Une fois que les autorités comprennent à quel type de monstruosité elles ont affaire, le vieux professeur nous gratifie d’une explication scientifique de dernière minute : les sangsues ont probablement été irradiées, car Cap Canaveral n’est pas loin, or la NASA a parfois utilisé l’énergie atomique pour le lancement des fusées. CQFD. Quant au climax, il est pour le moins expéditif : un corps à corps sous l’eau, Ken Clark imitant Johnny Wessmüller dans les vieux Tarzan, puis une explosion finale à la dynamite réglant définitivement leur compte à ces improbables sangsues.
© Gilles Penso
À découvrir dans le même genre…
Partagez cet article