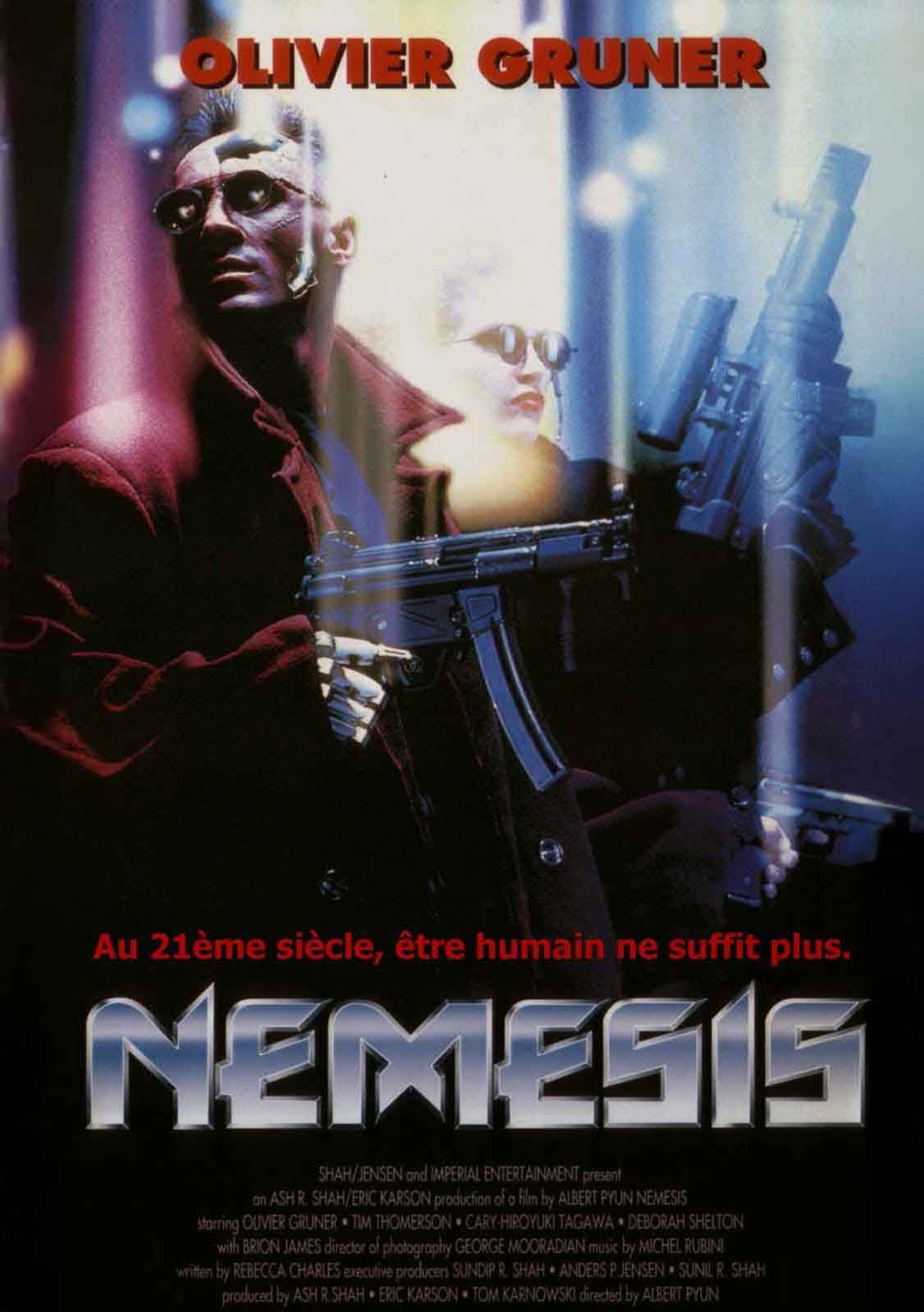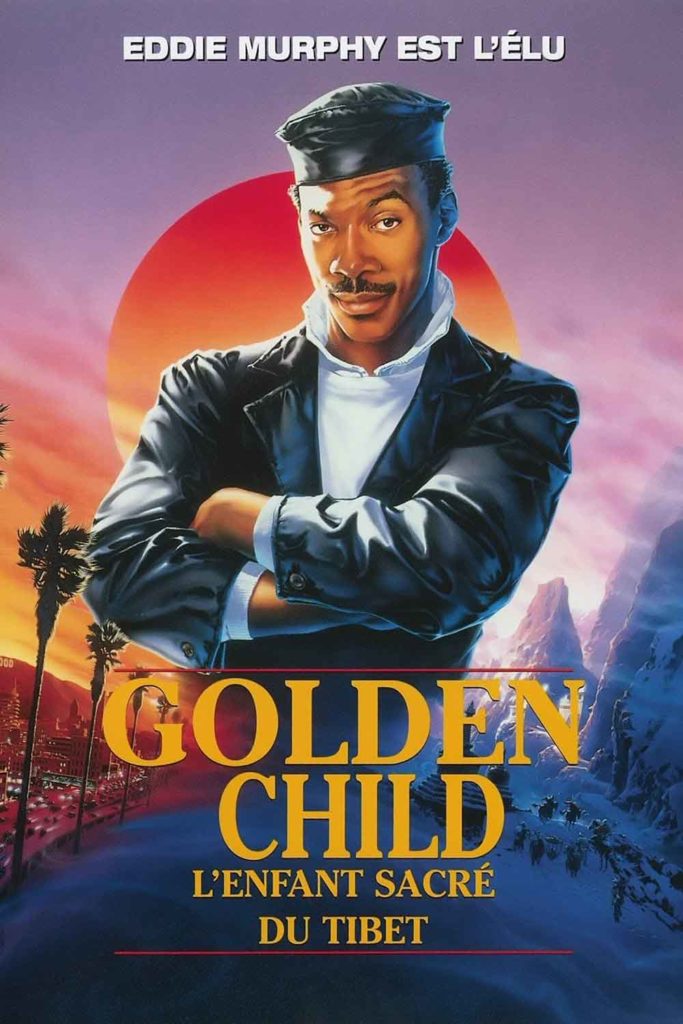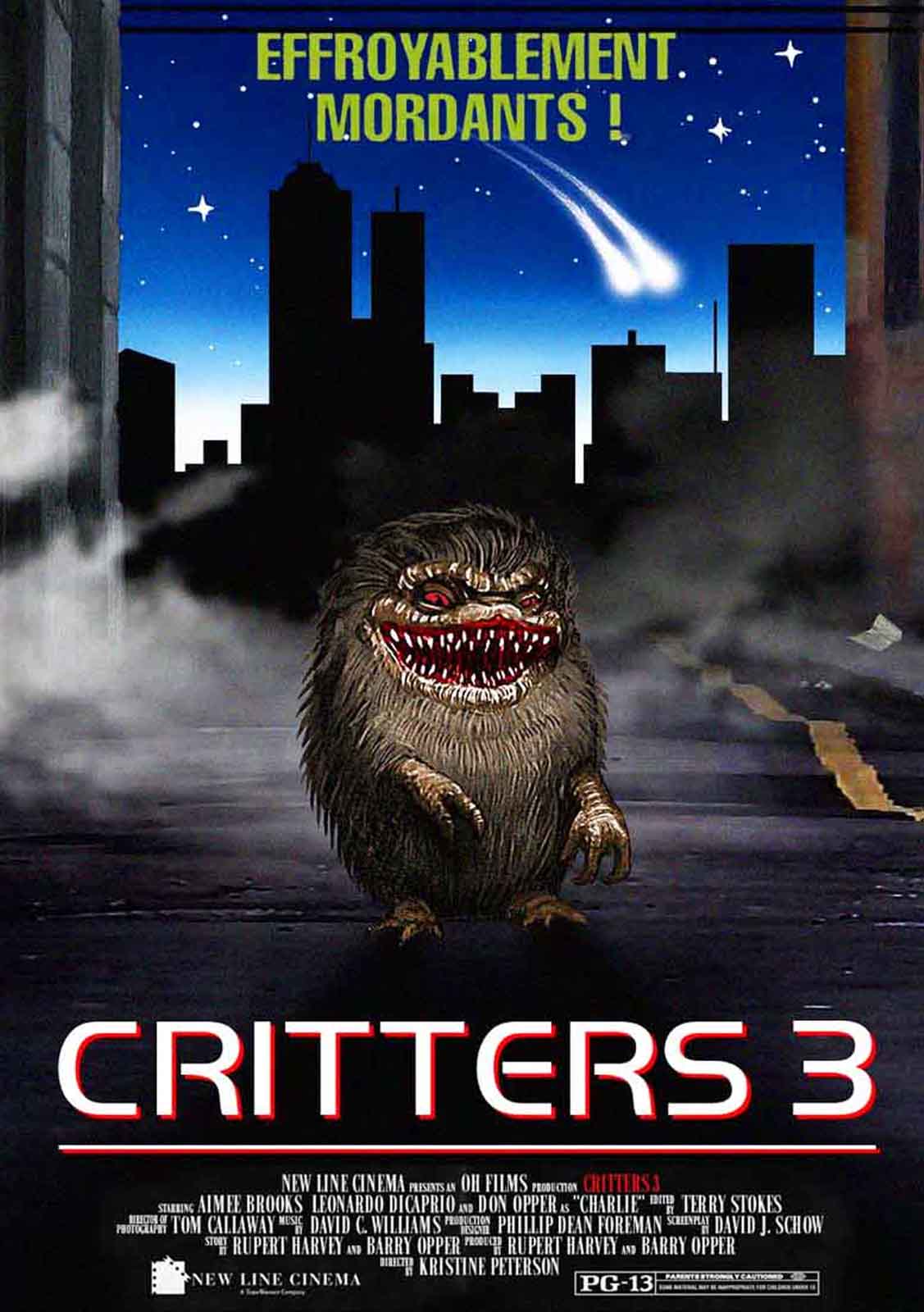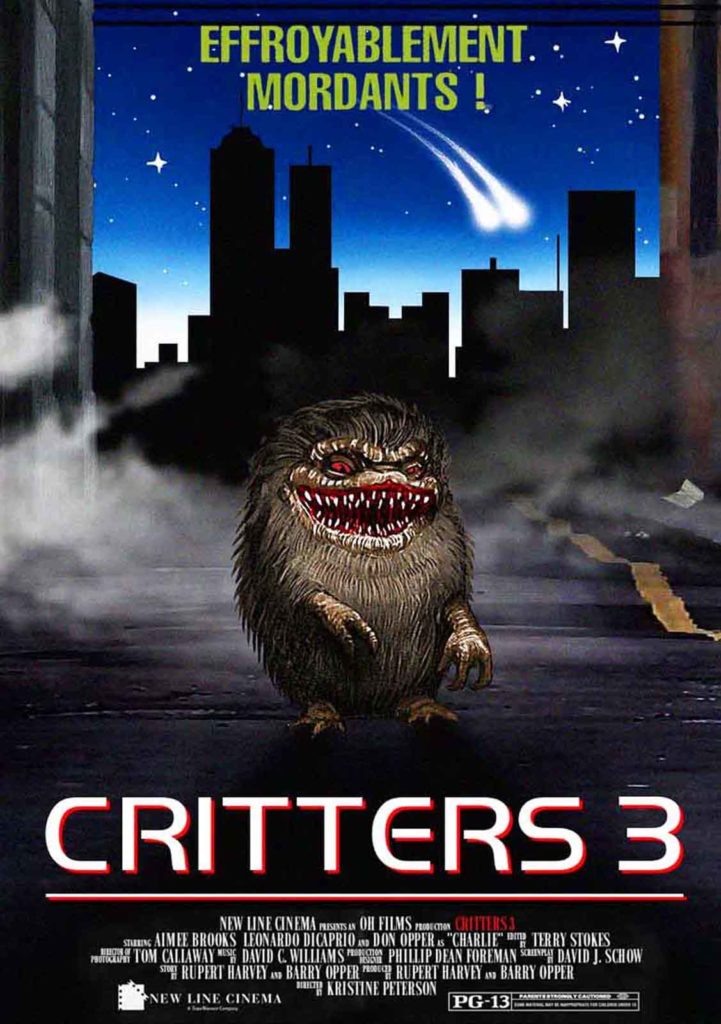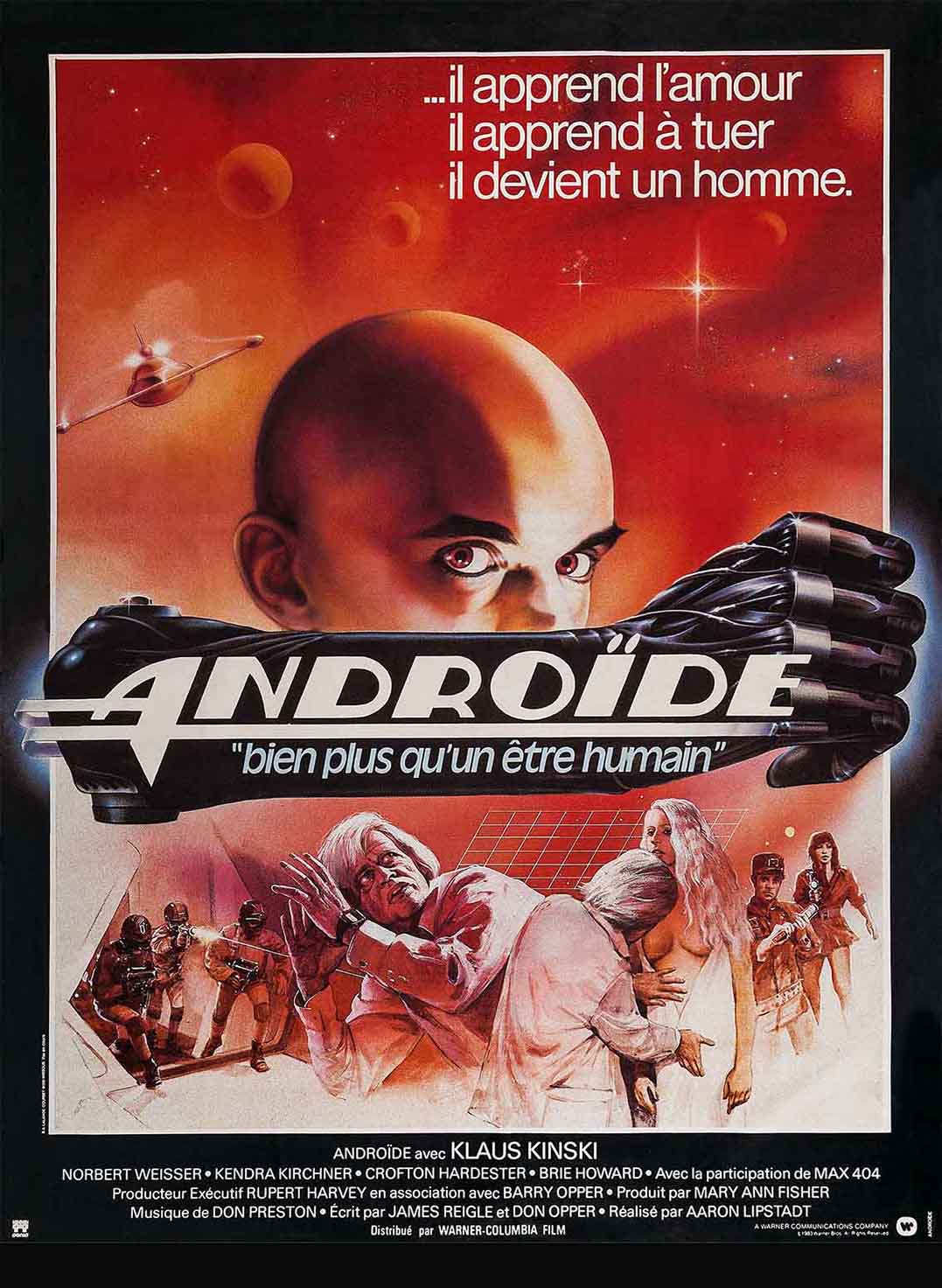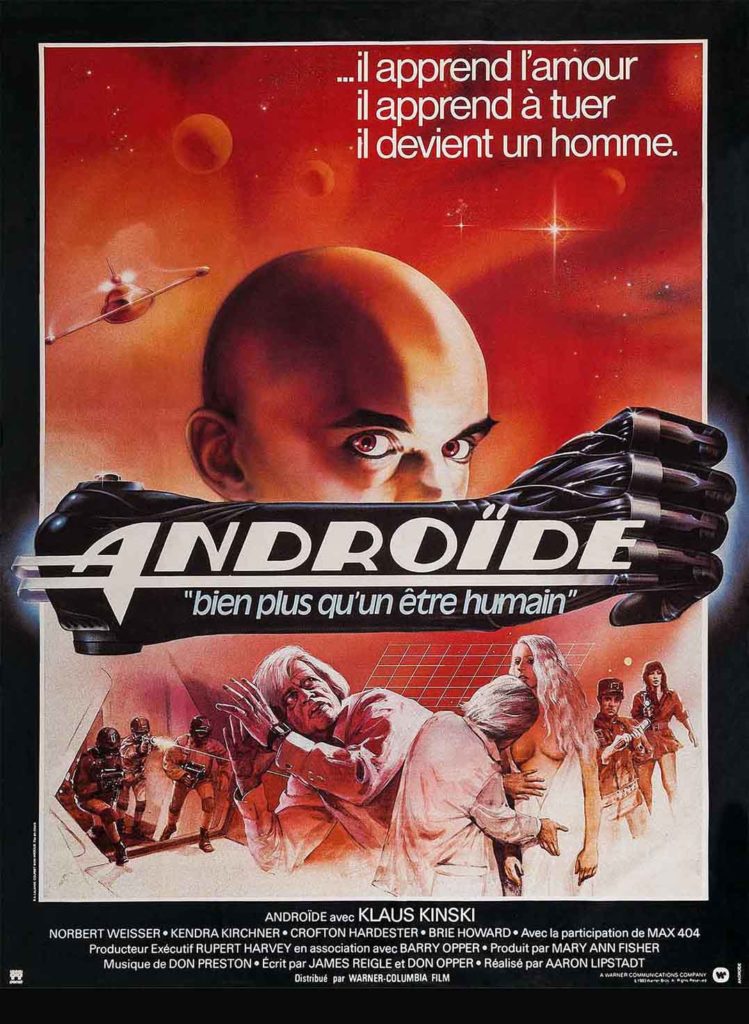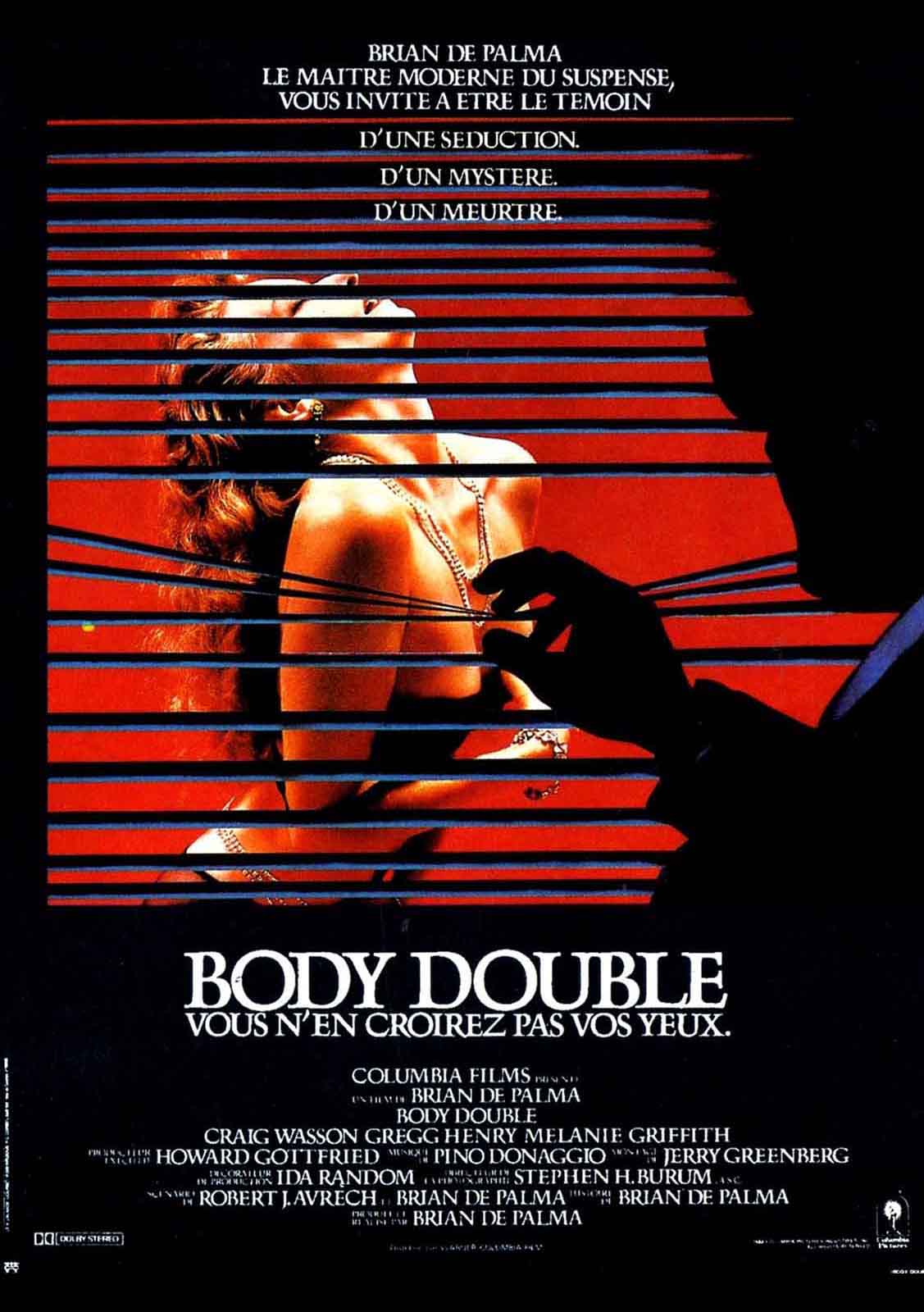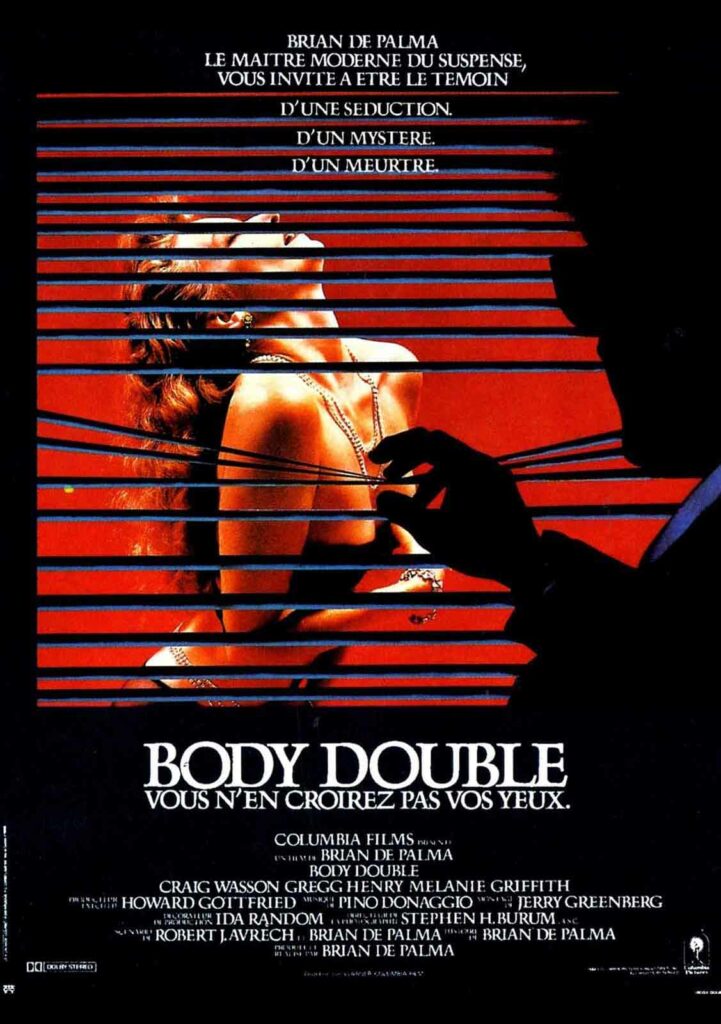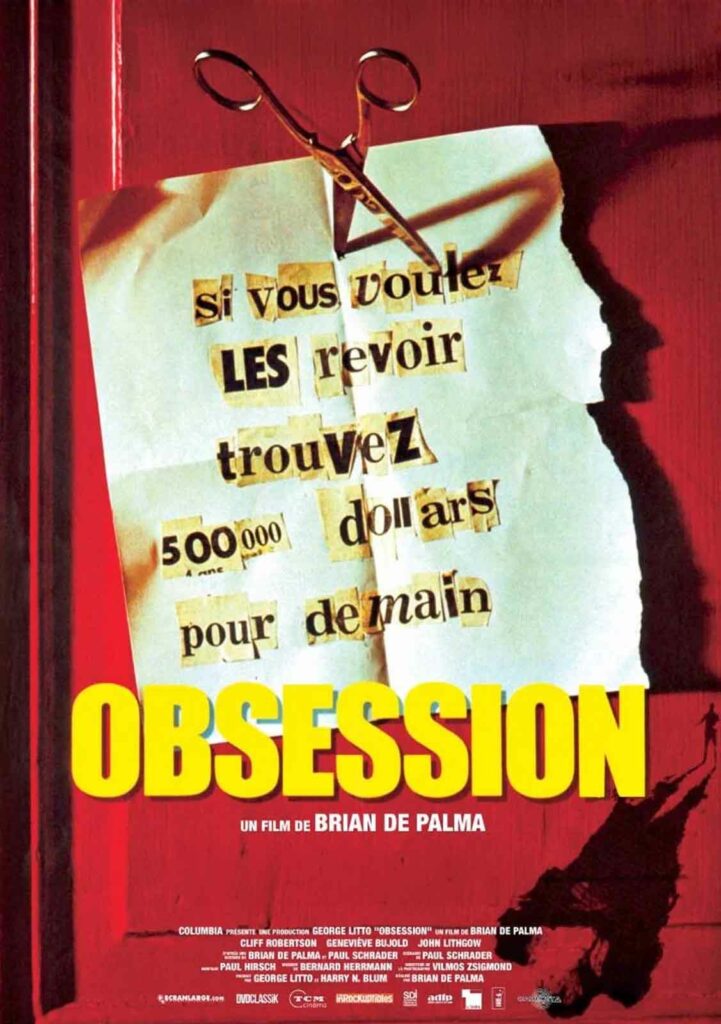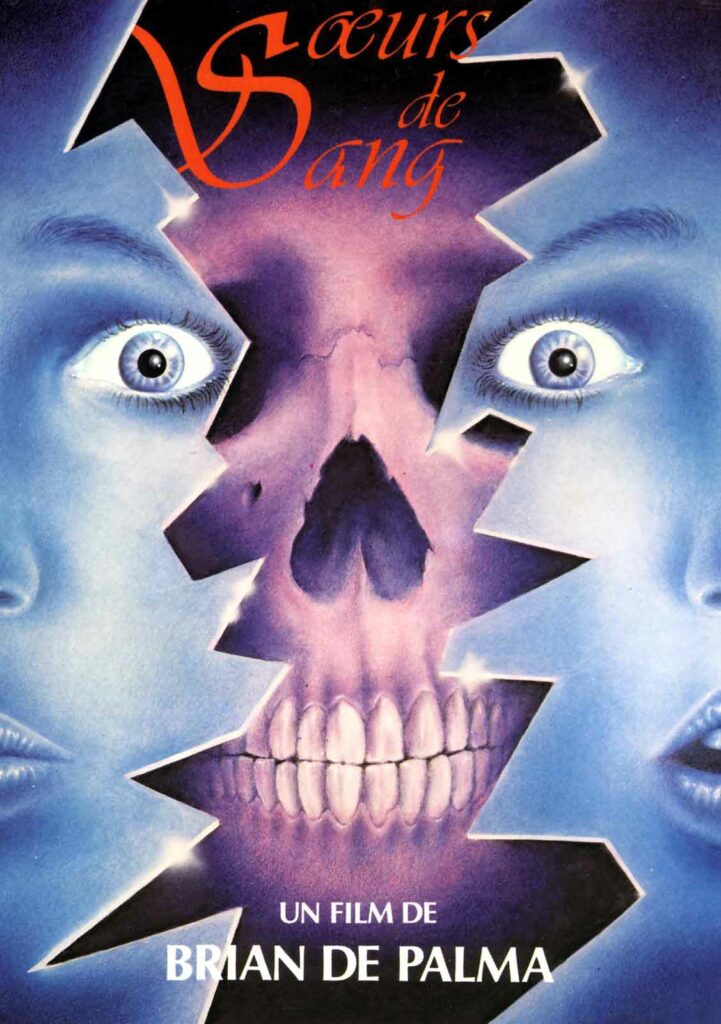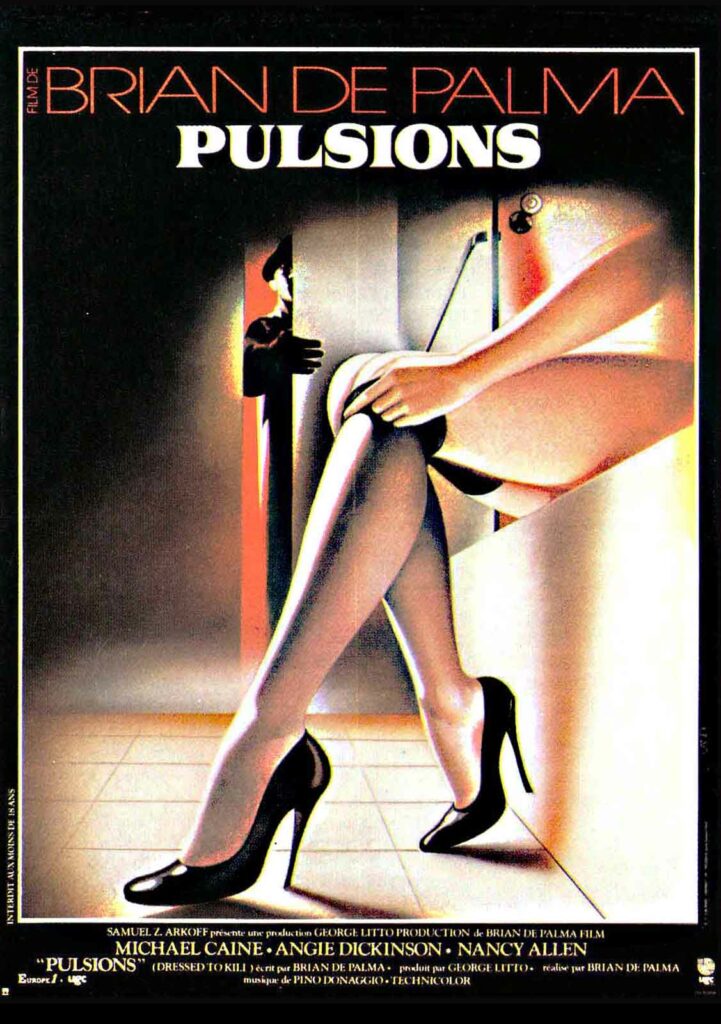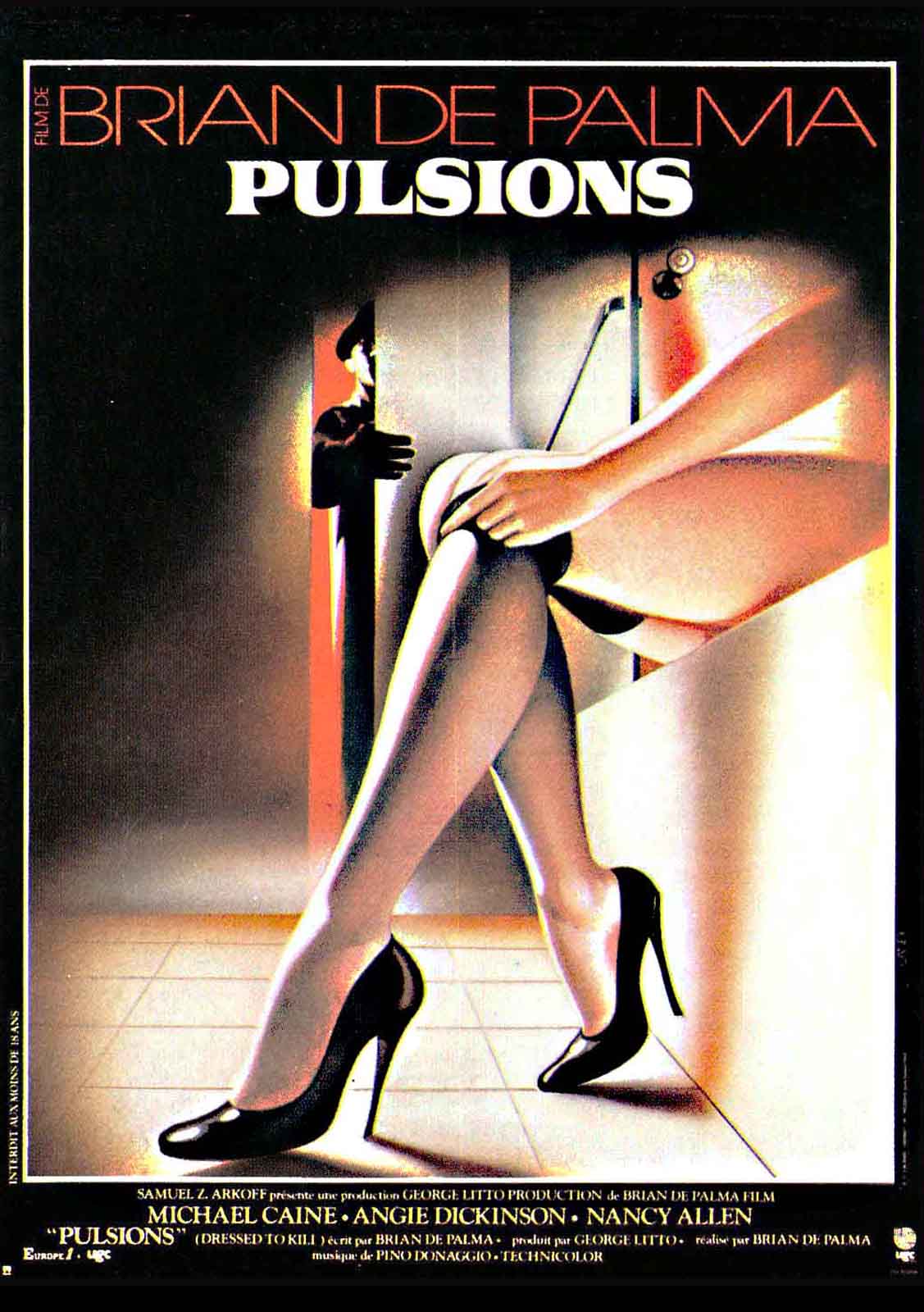Un casting de haut niveau s’anime dans ce conte pour enfants qui s’autorise tous les excès et toutes les impertinences
LEMONY SNICKET’S A SERIES OF UNFORTUNATE EVENTS
2004 – USA
Réalisé par Brad Siberling
Avec Jim Carrey, Meryl Streep, Jude Law, Emily Browning, Liam Aiken, Kara et Shelby Hoffman, Timothy Spall, Bill Connolly
THEMA CONTES
Les romans pour enfants ayant le vent en poupe au début des années 2000, grâce au succès colossal de la saga Harry Potter, les studios Nickelodeon Movies ont décidé de s’attaquer à l’œuvre de l’écrivain Daniel Handler. Les Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire adapte ainsi les trois premiers volumes d’une saga baptisée « A Series of Unfortunate Events » et met en scène Violette, Klaus et Prunille, trois enfants surdoués dont les parents meurent soudainement dans un terrible incendie. Orphelins du jour au lendemain, ils se retrouvent à la tête d’une fortune colossale dont ils pourront bénéficier dans quatre ans, lorsque Violette aura atteint sa majorité. En attendant, l’austère Monsieur Poe, banquier de son état et exécuteur testamentaire des parents Baudelaire, s’efforce de les placer dans une famille d’accueil respectable. C’est là qu’intervient l’affreux oncle Olaf, parent éloigné et comédien raté qui endosse divers déguisements pour attirer les orphelins dans ses griffes et tenter de récupérer leur argent…


Avec à son actif Casper et La Cité des anges, Brad Silberling n’avait pas démontré de talent particulier en matière de mise en scène et d’inventivité. D’où la surprise très agréable qui attend les spectateurs des Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Car la première grande qualité du film est liée à la réussite sa direction artistique. Tout commence avec les décors sublimement surréalistes concoctés par Rick Heinrichs, collaborateur régulier de Tim Burton. De la vieille maison sur pilotis au château décrépi en passant par la colossale demeure champêtre, la ville portuaire, la caverne mystérieuse ou le théâtre d’un autre âge, on n’en finit plus d’admirer ces panoramas gothiques et résolument atemporels. Les effets spéciaux hallucinants d’ILM sont à l’avenant, nous donnant à voir un serpent géant jouant avec une petite fille, un train sur le point d’écrabouiller les jeunes héros ou encore une attaque de sangsues carnivores !
Les métamorphoses de Jim Carrey
Ajoutez à cela des costumes surprenants, des maquillages excessifs et une partition envoûtante de Thomas Newman, et vous obtenez l’un des contes pour enfants les plus originaux jamais transposés à l’écran. D’autant qu’ici, le ton est volontiers cynique, les clichés sont détournés et les happy-ends soigneusement évités. Il faut avouer que le film repose aussi beaucoup sur ses interprètes enfants et adultes. Parmi ces derniers, Jim Carrey et Meryl Streep nous offrent des prestations proprement hilarantes, versions caricaturales et cartoonesques des méchants de la littérature enfantine classique. Habitué aux maquillages outranciers depuis The Mask, Carrey se retrouve ainsi affublé de prothèses en tout genre, sous les mains habiles de Bill Corso qui décrit son personnage comme un mixage entre un vampire, un vautour, Lon Chaney et Laurence Olivier ! On note au détour du casting quelques apparitions en forme de clin d’œil, comme celle de Dustin Hoffmann campant un savoureux critique théâtral. Bref, une œuvre franchement rafraîchissante qui confirme le flair et l’audace de l’équipe de Nickelodeon.
© Gilles Penso
Partagez cet article