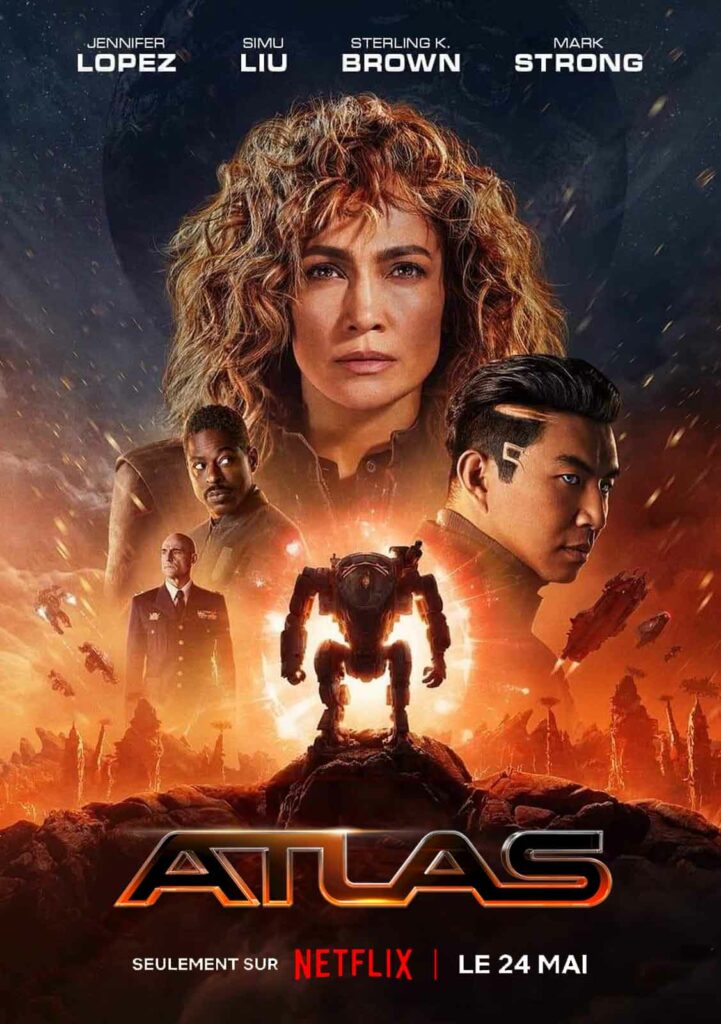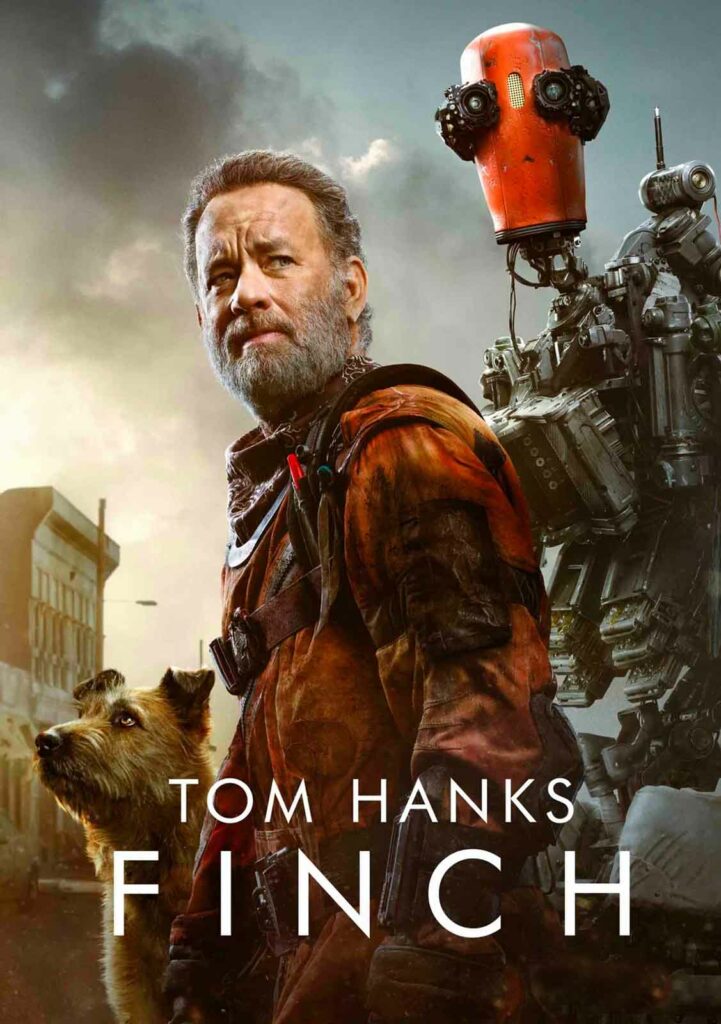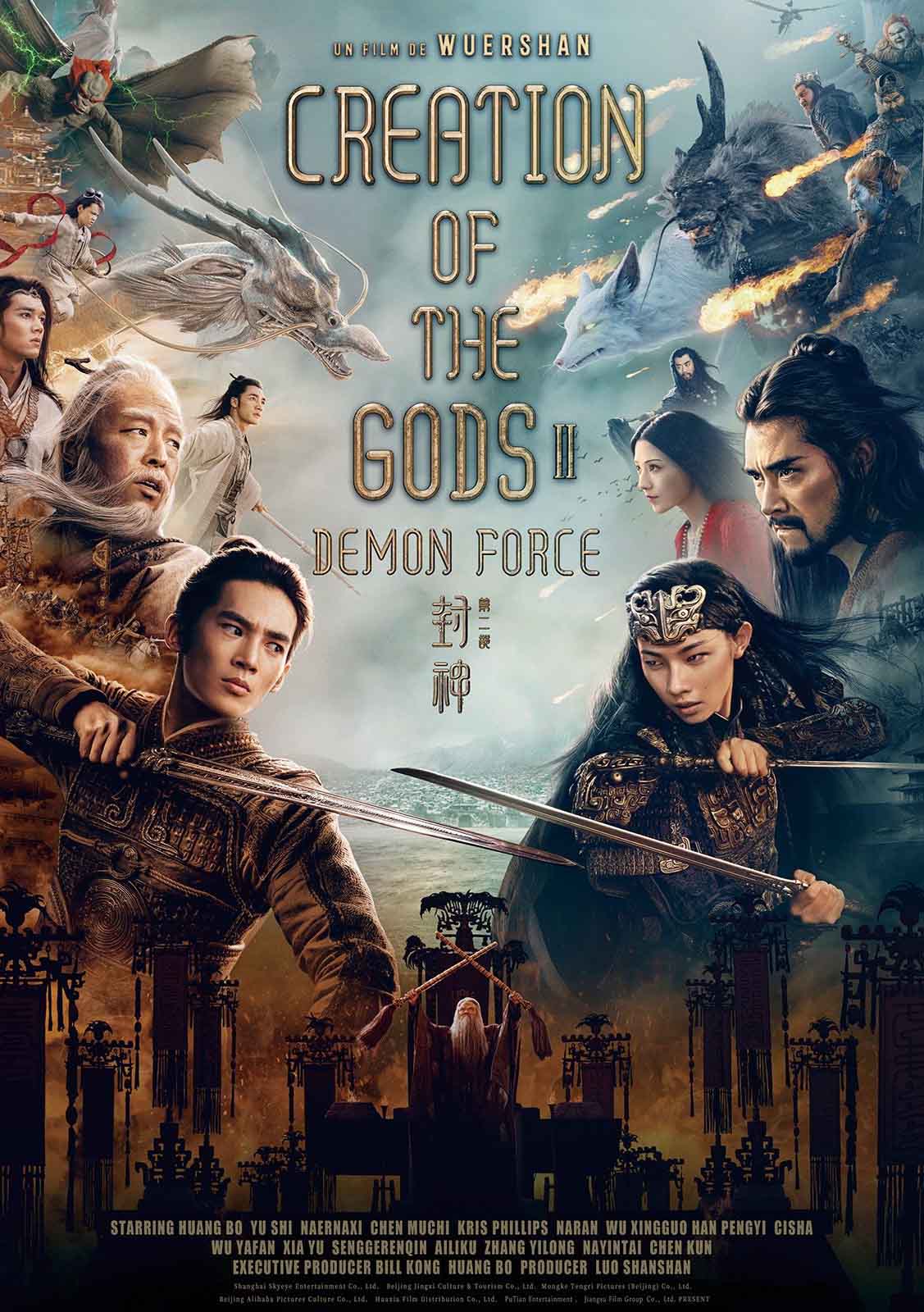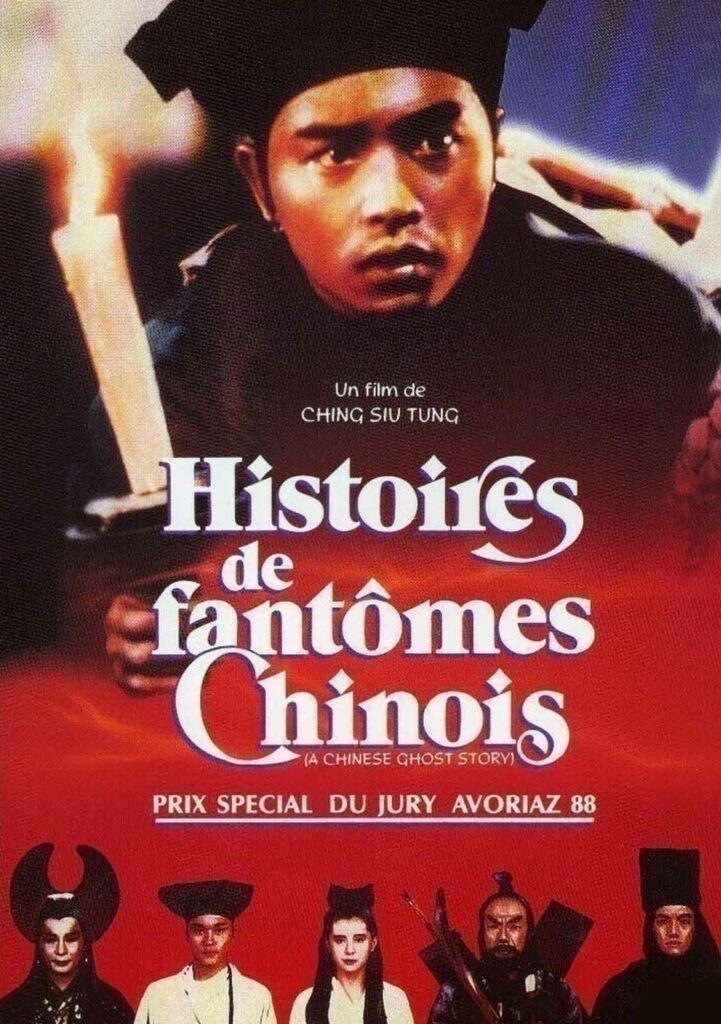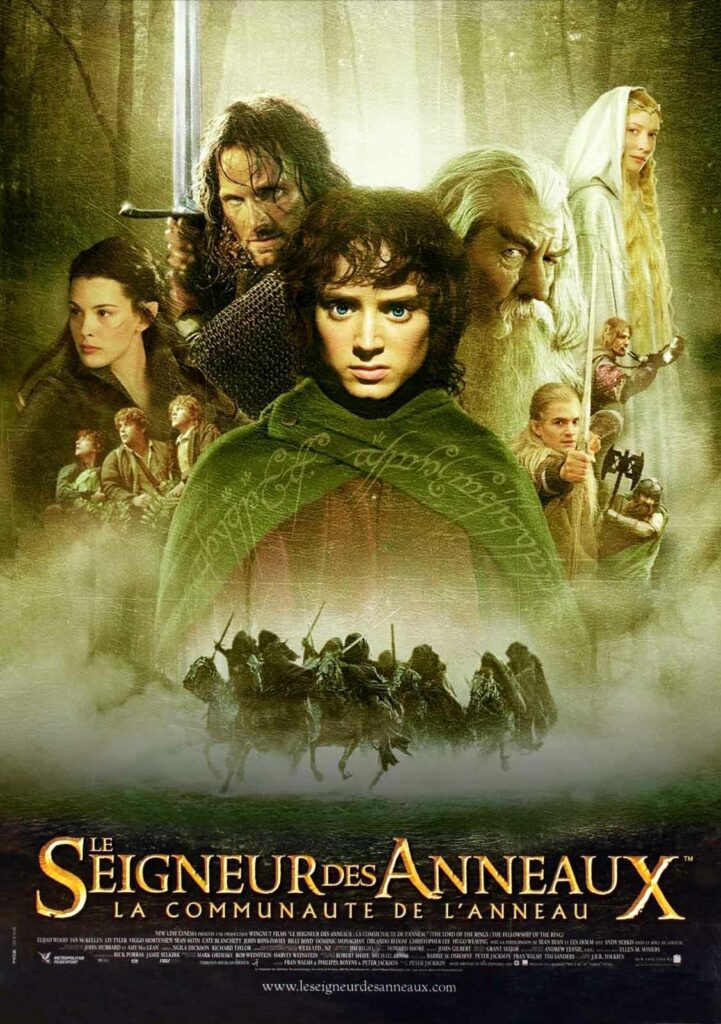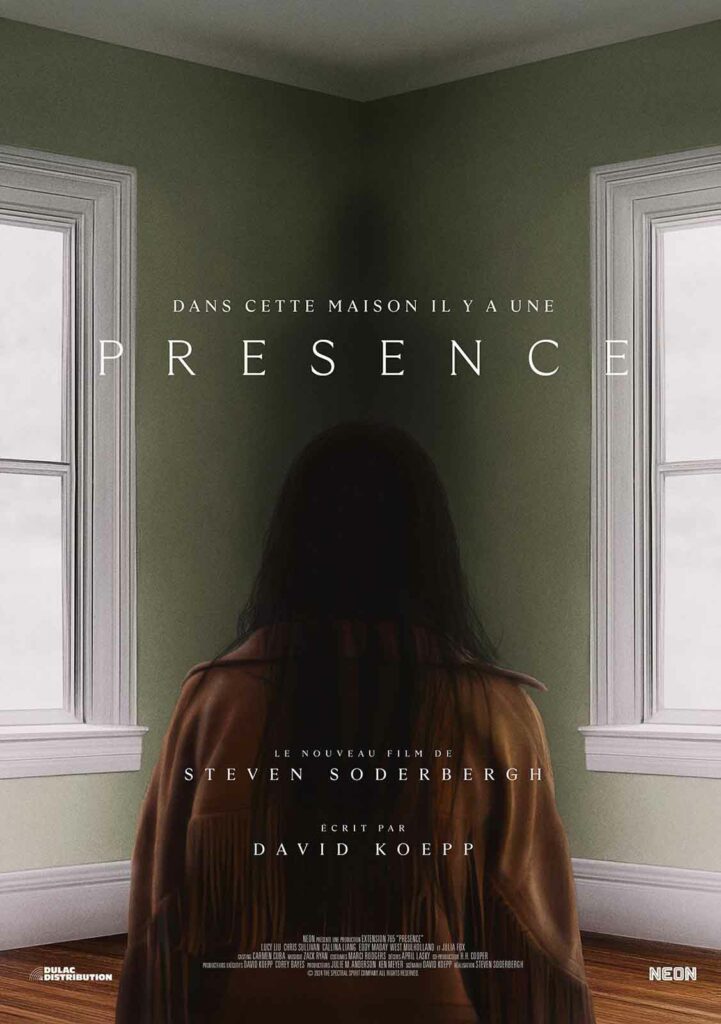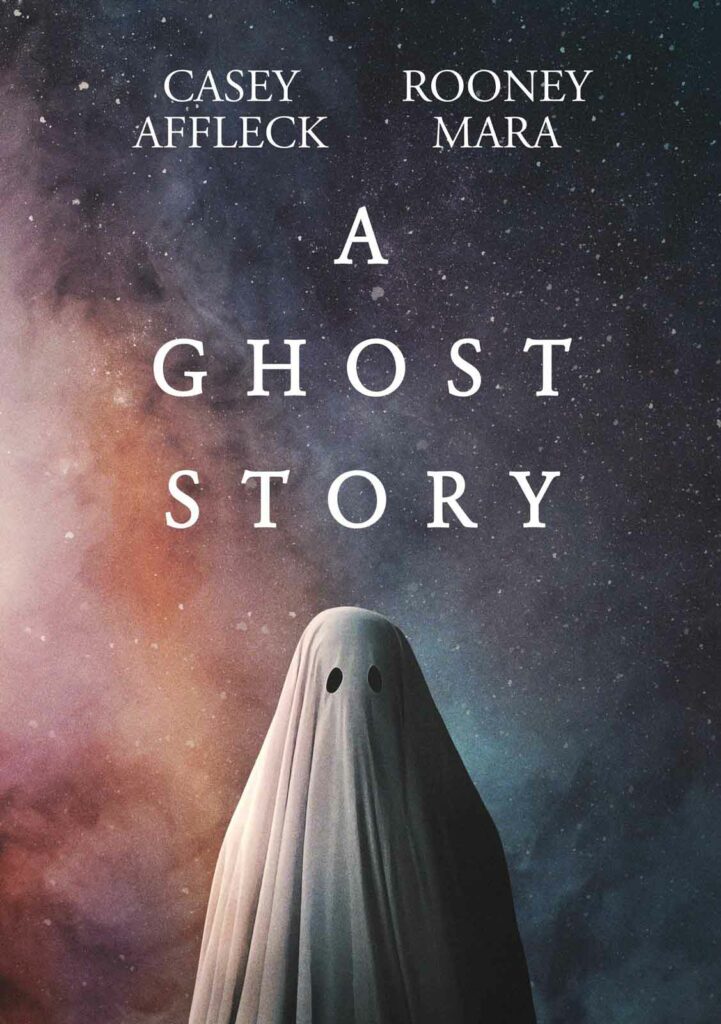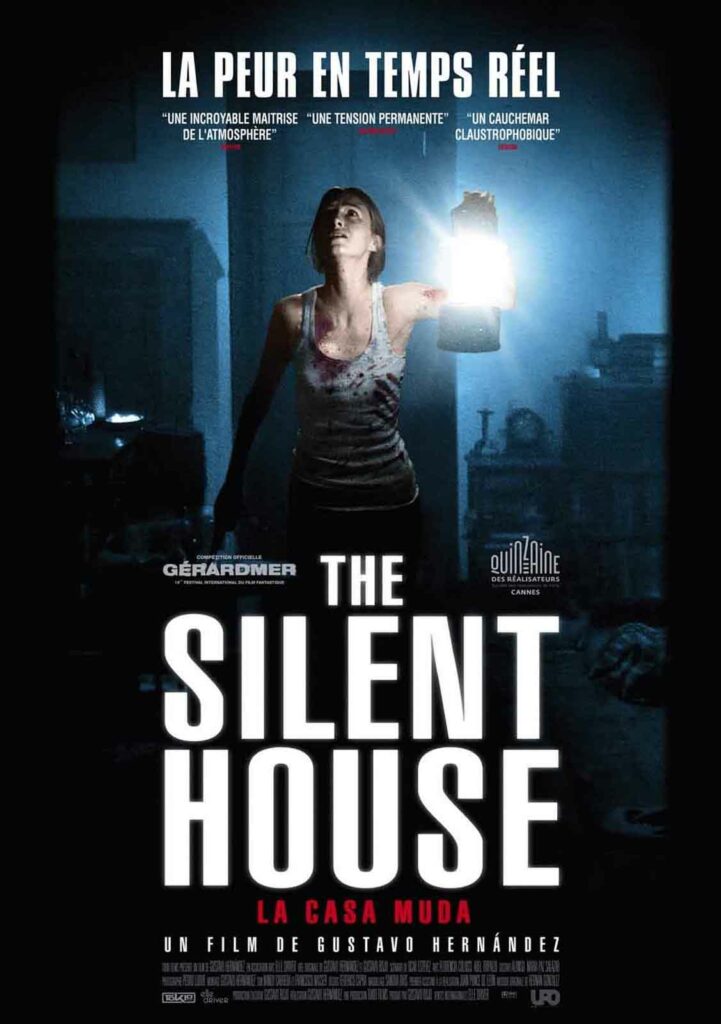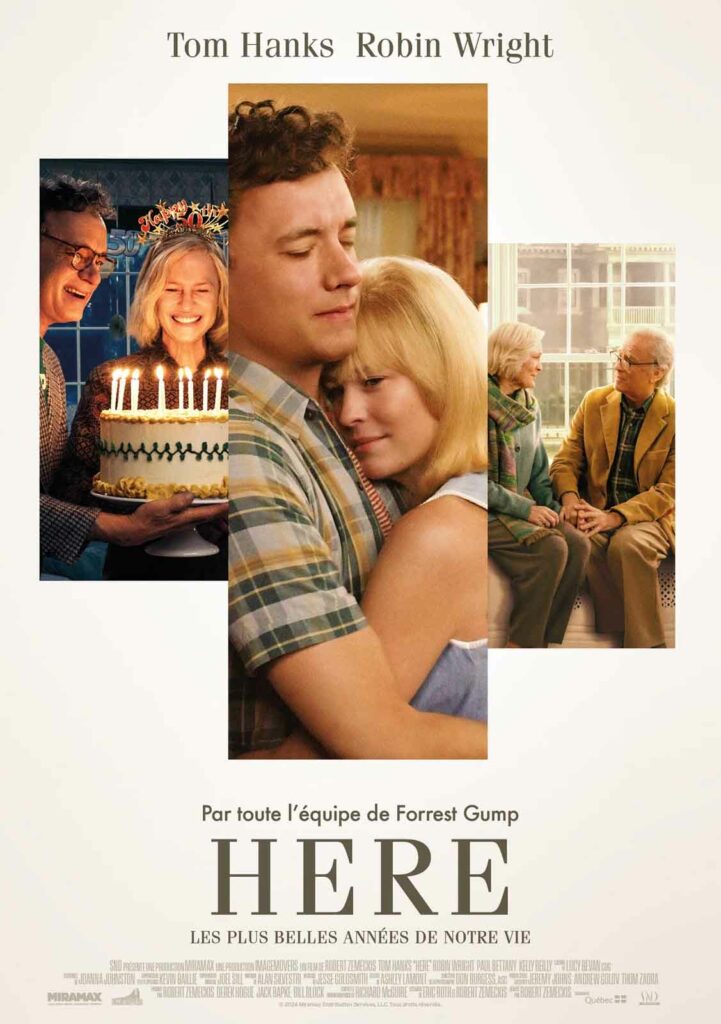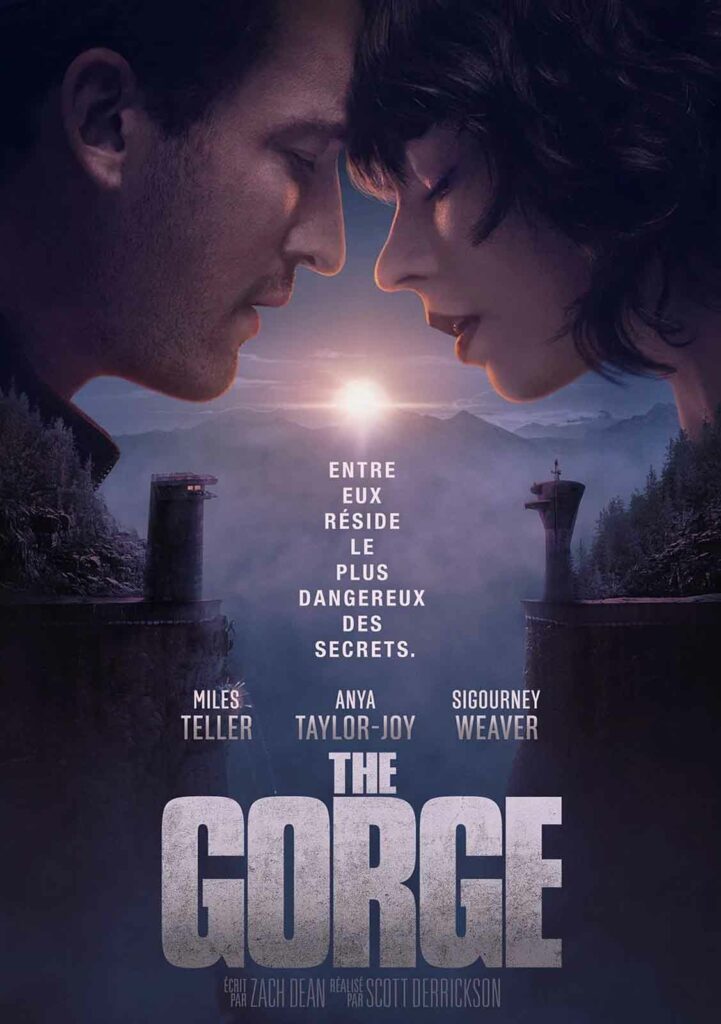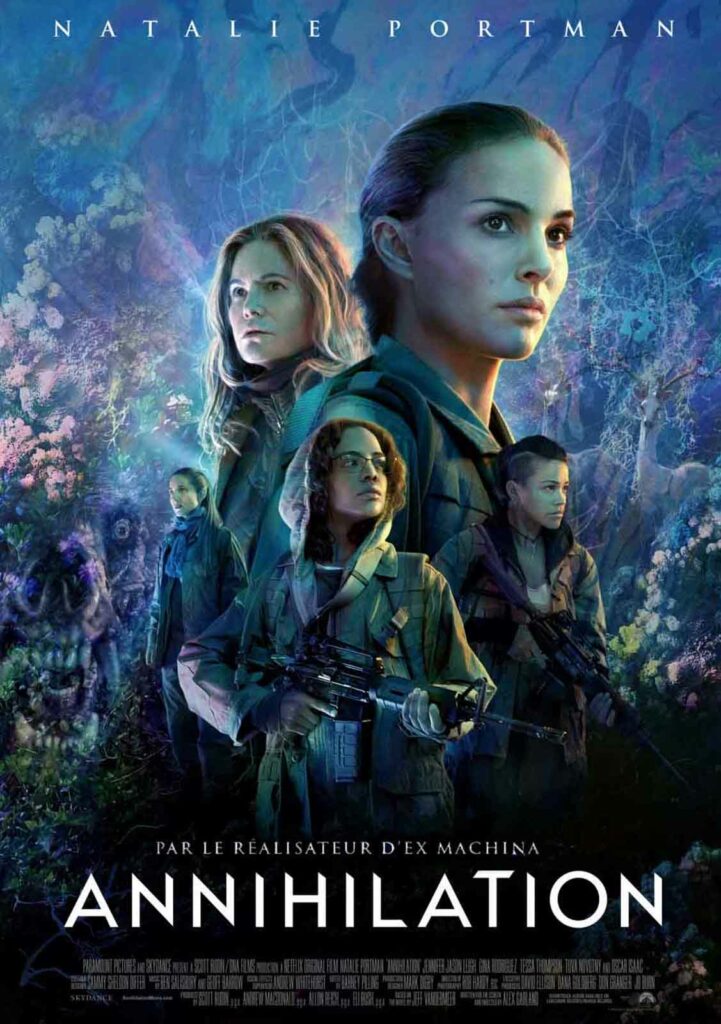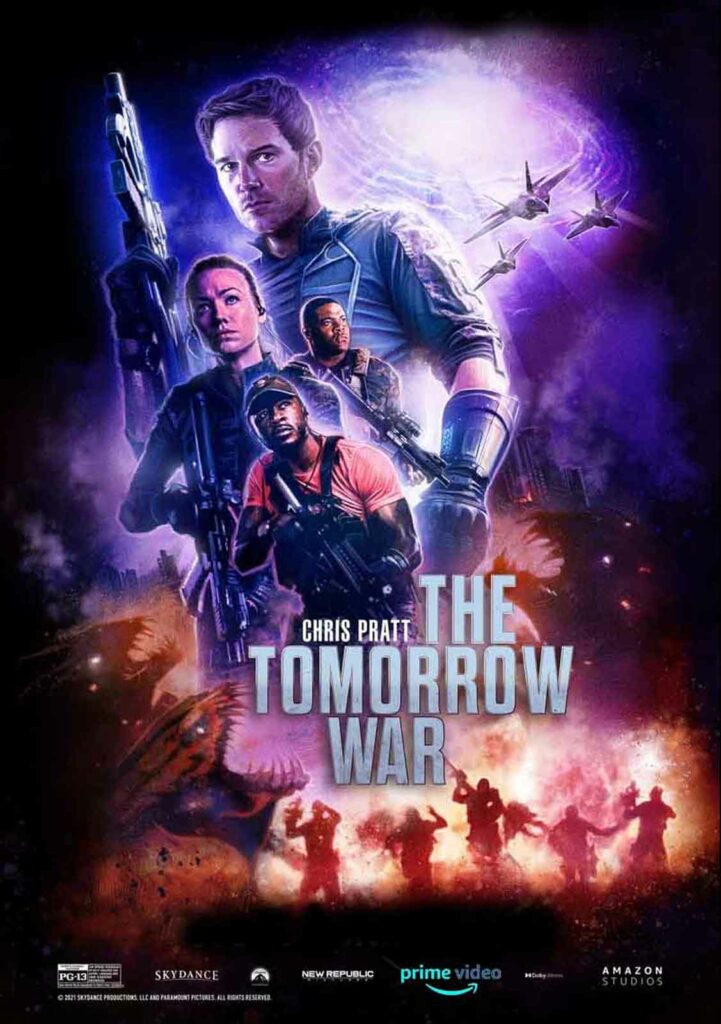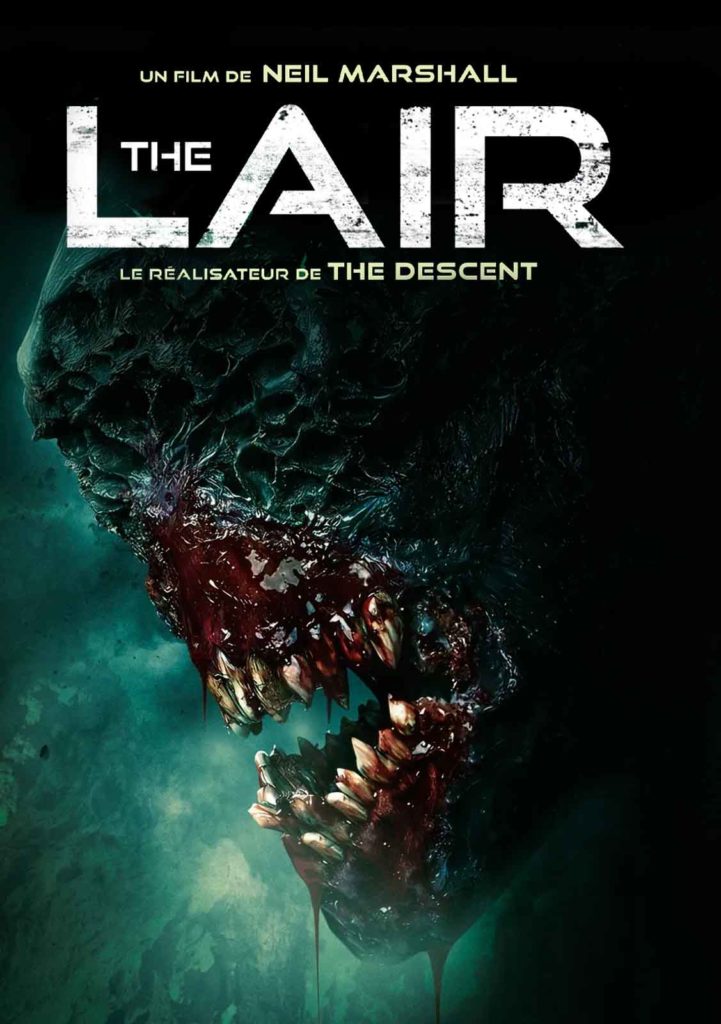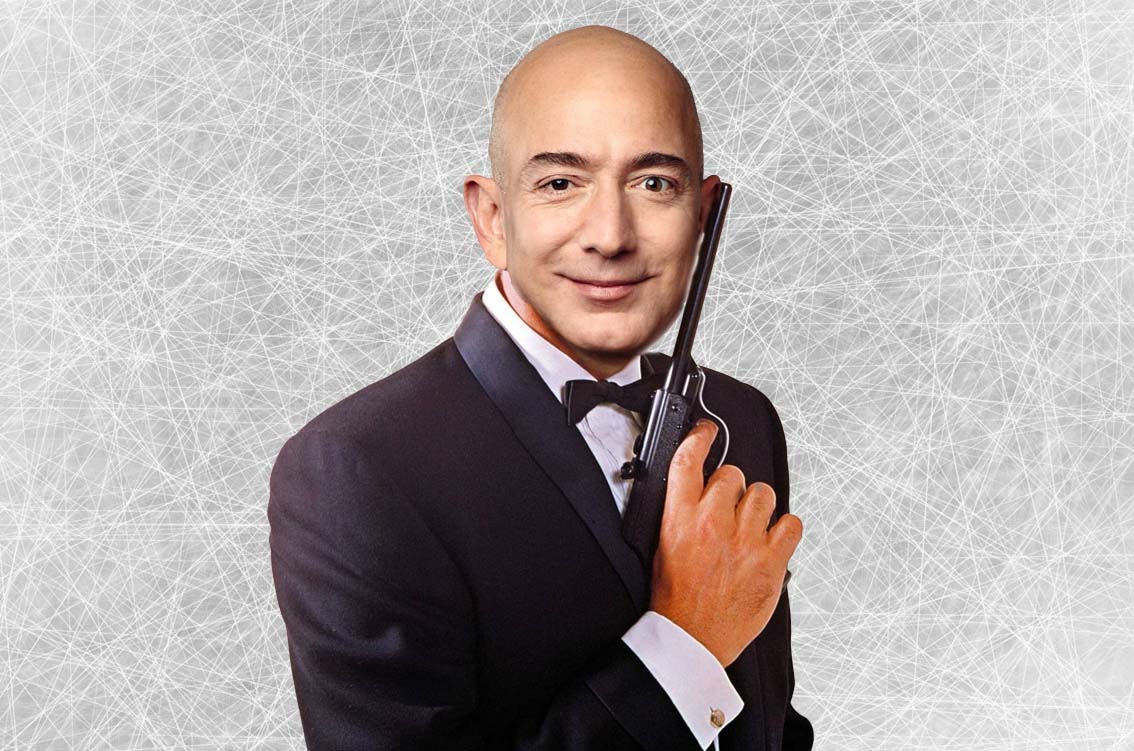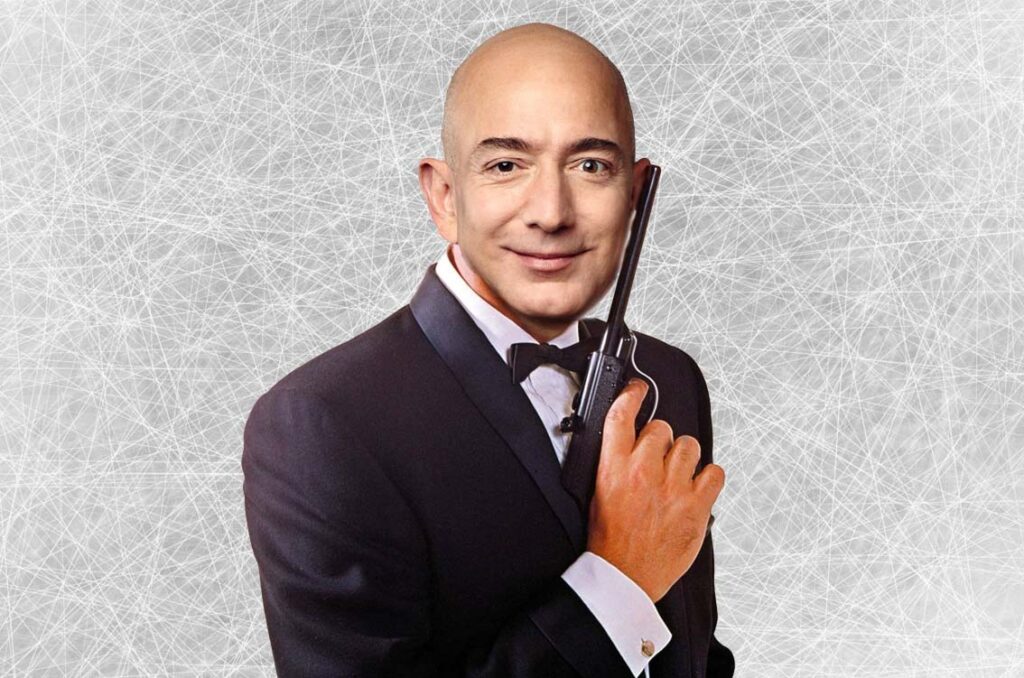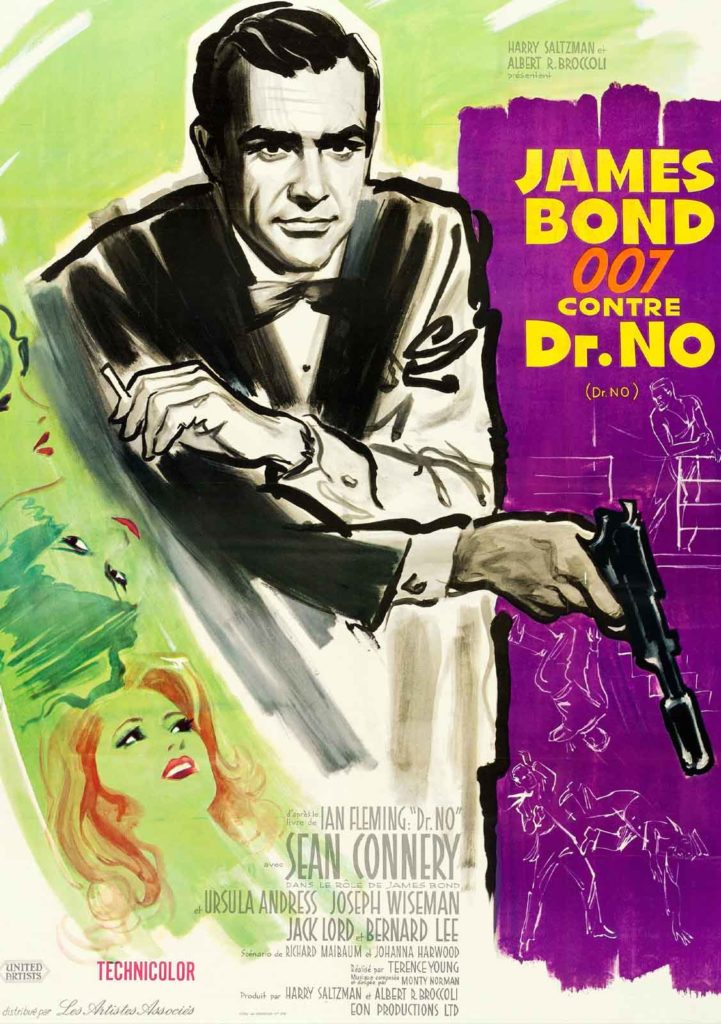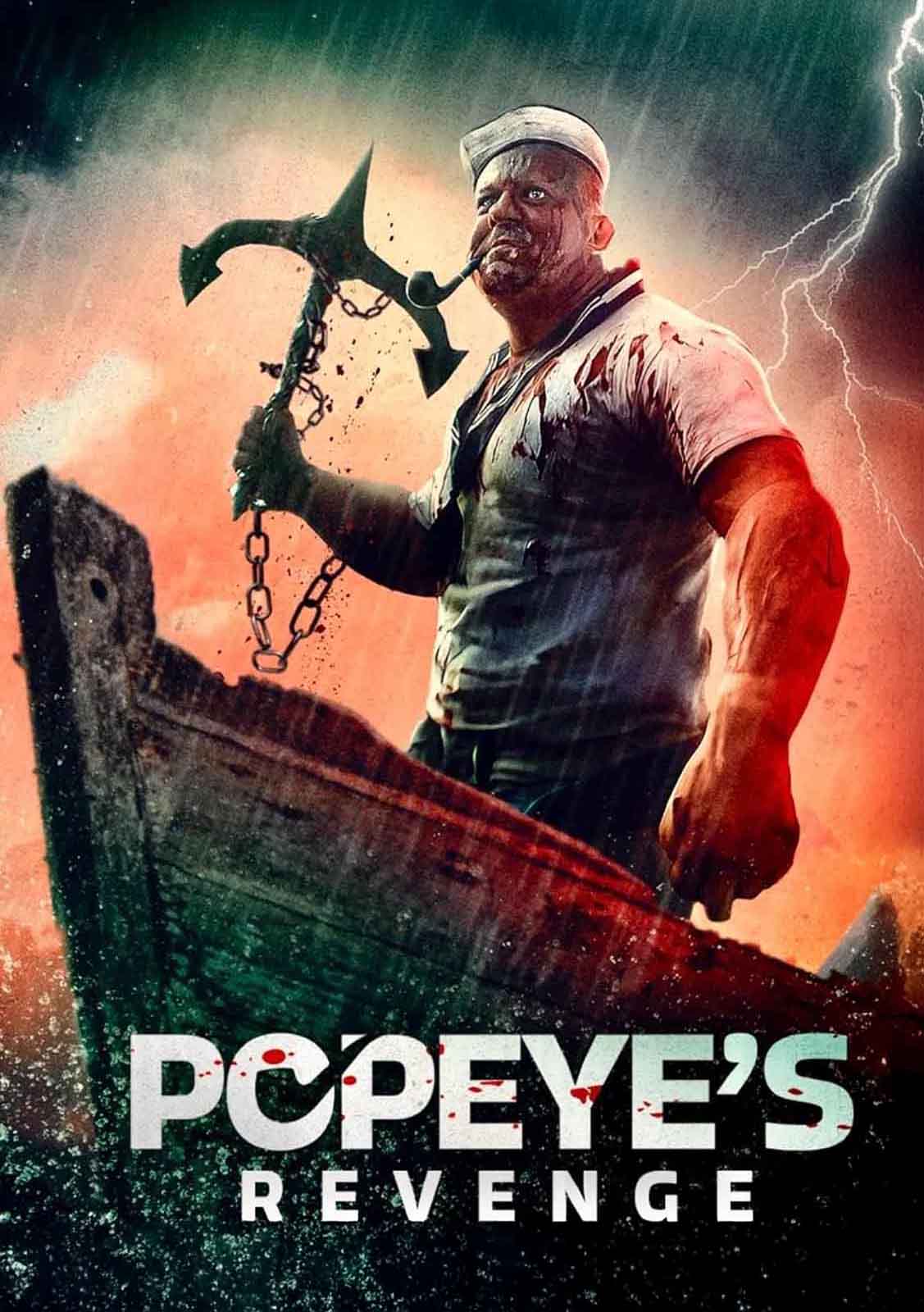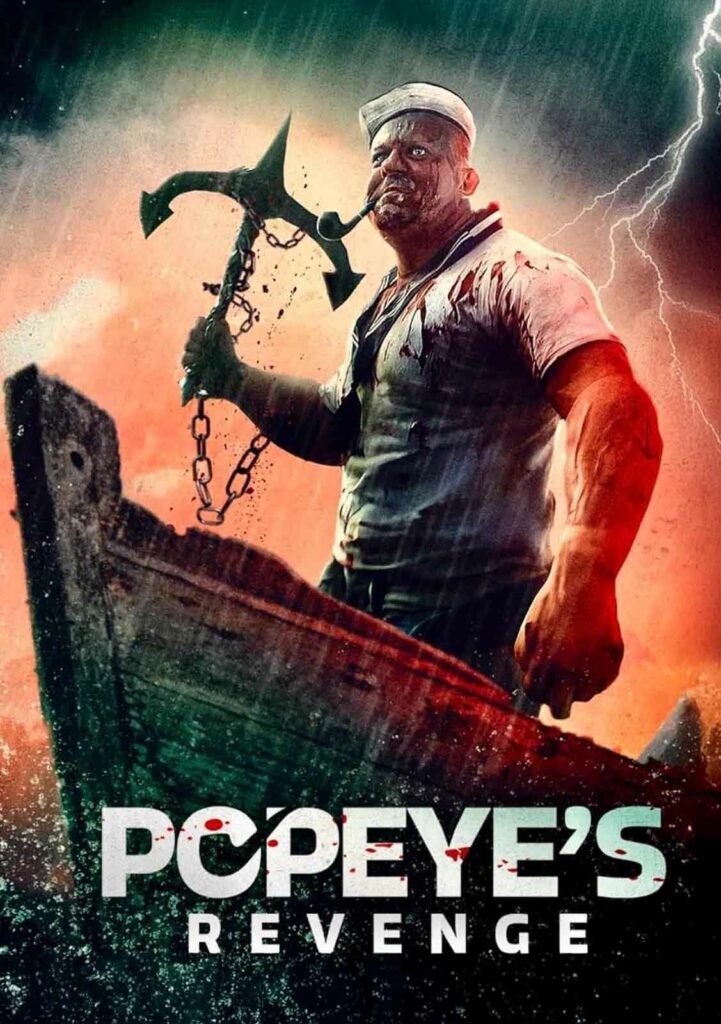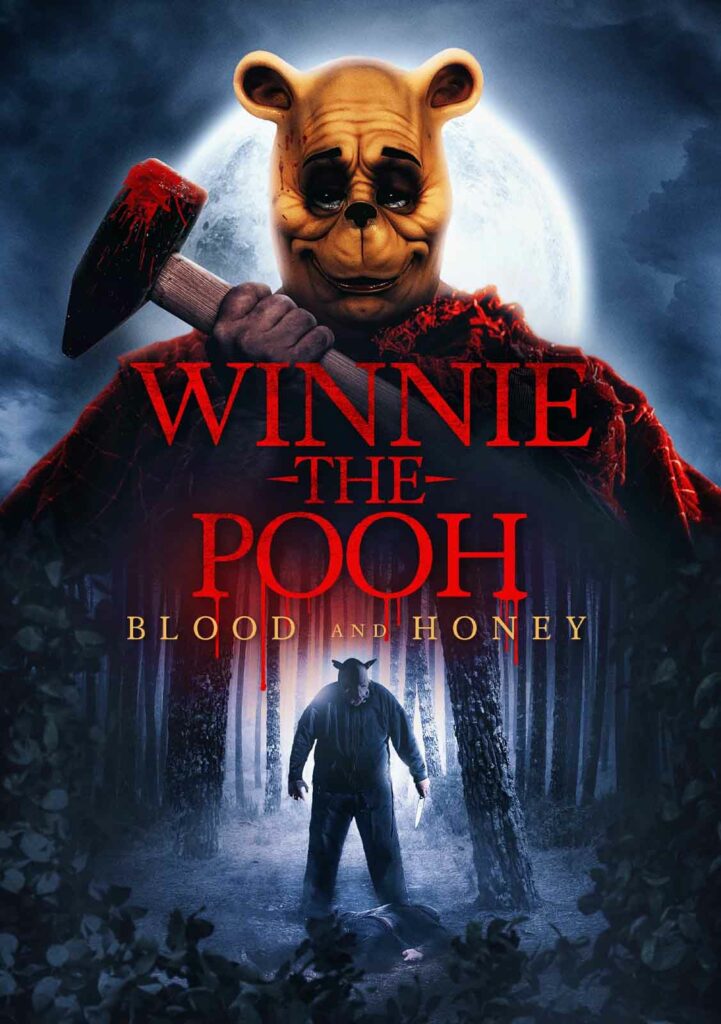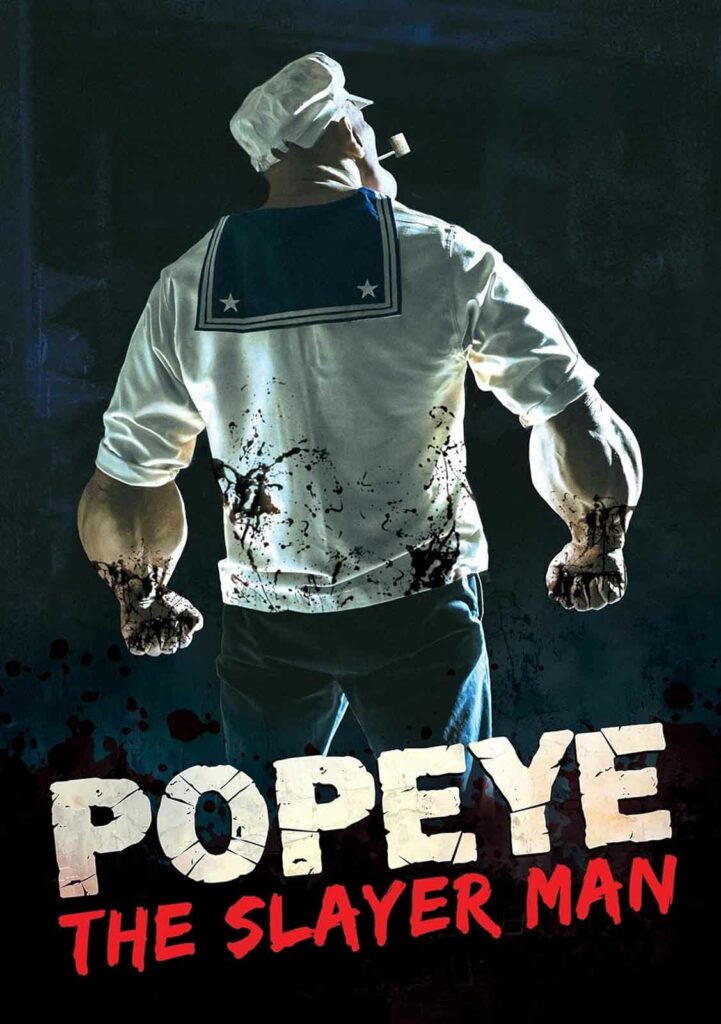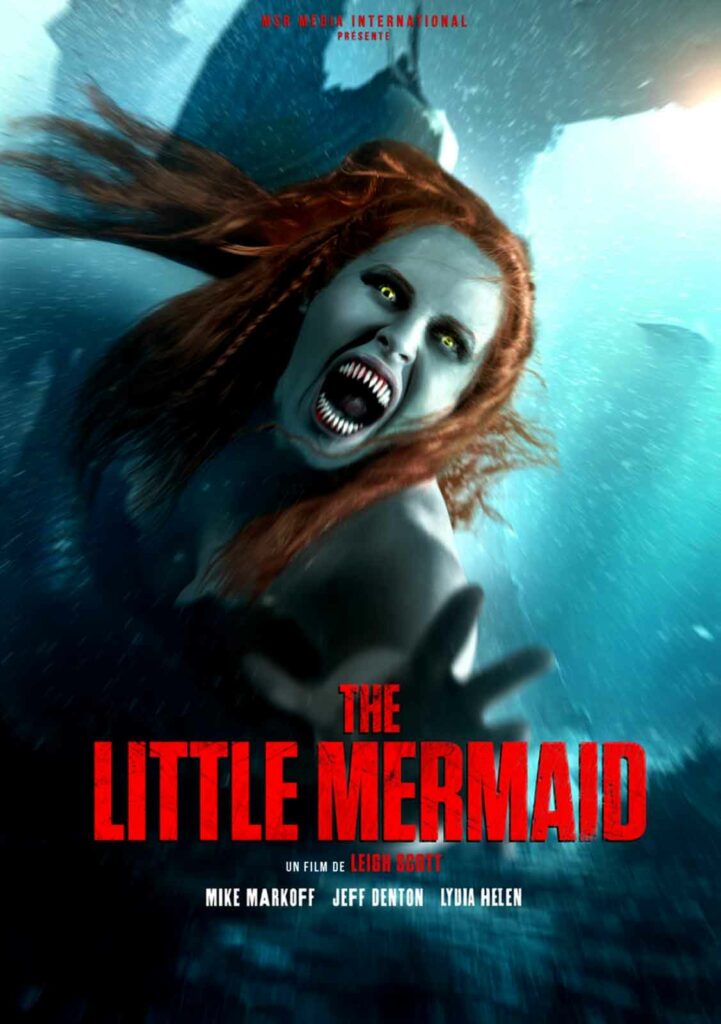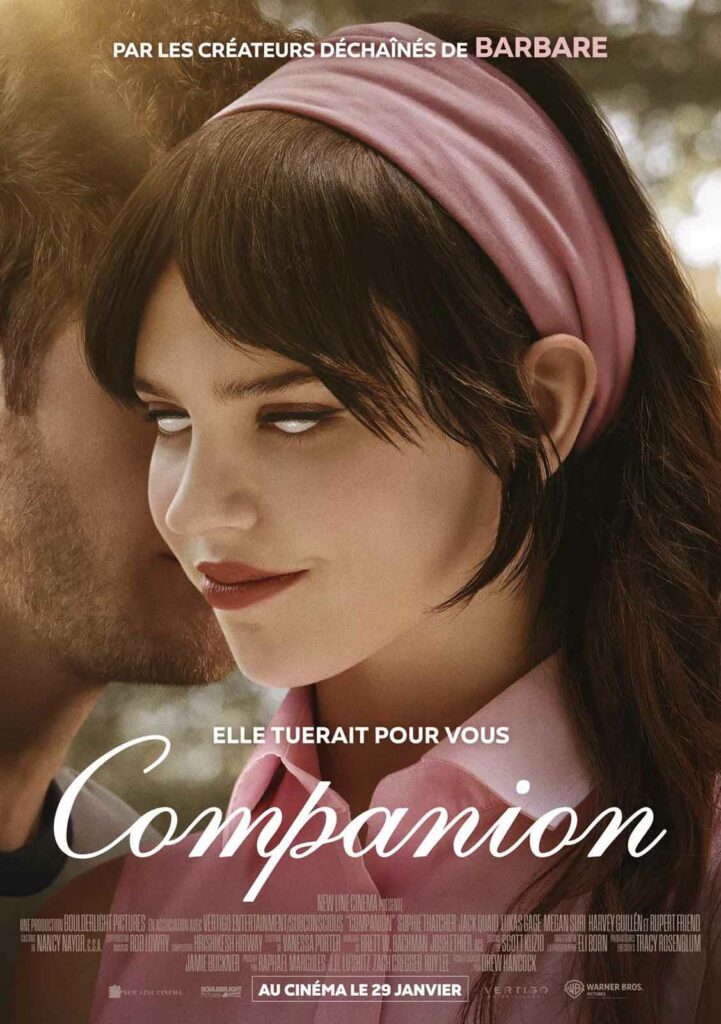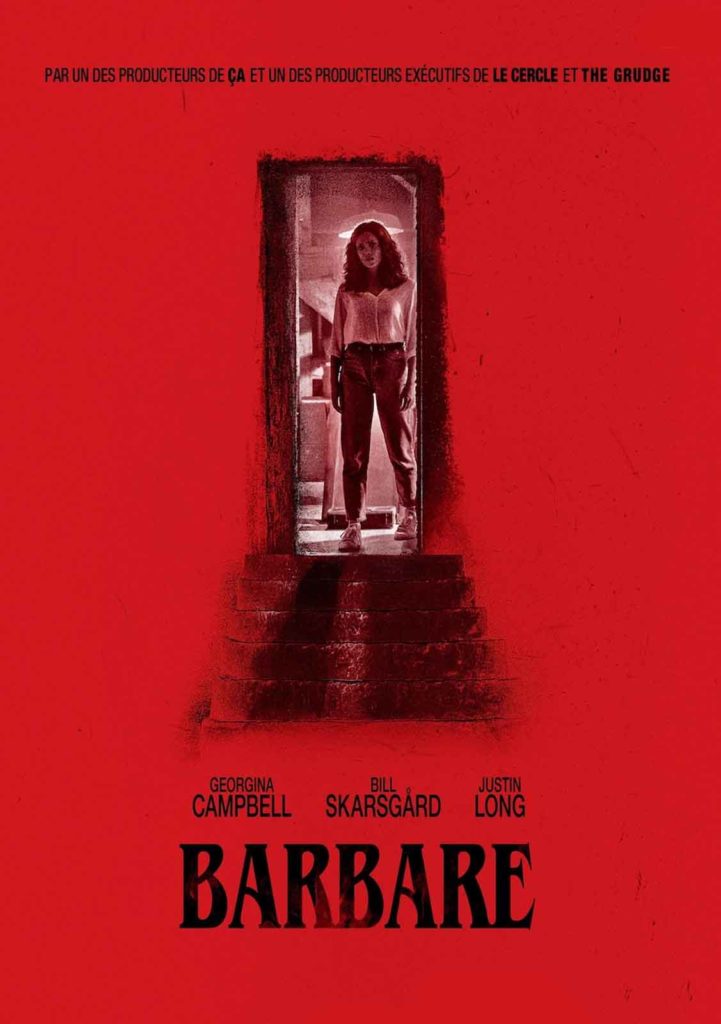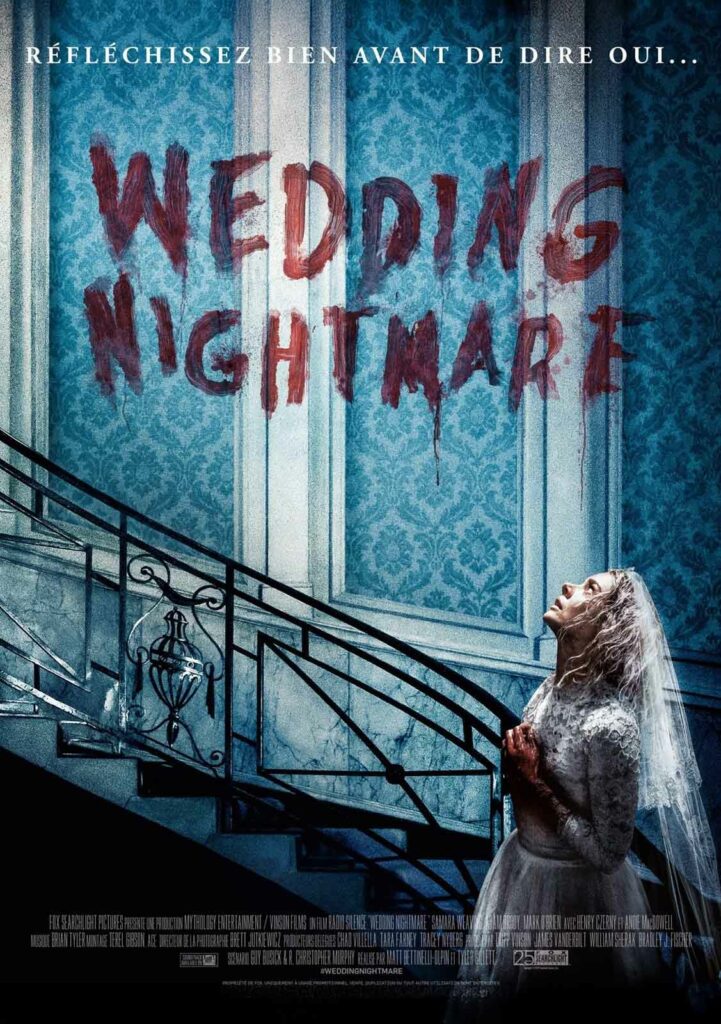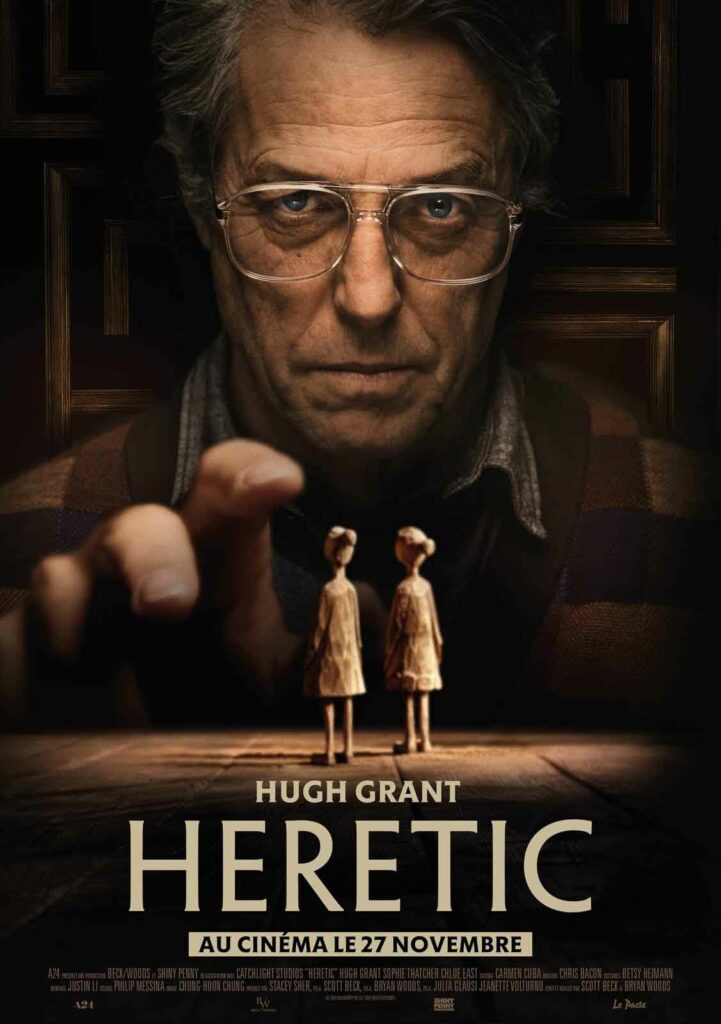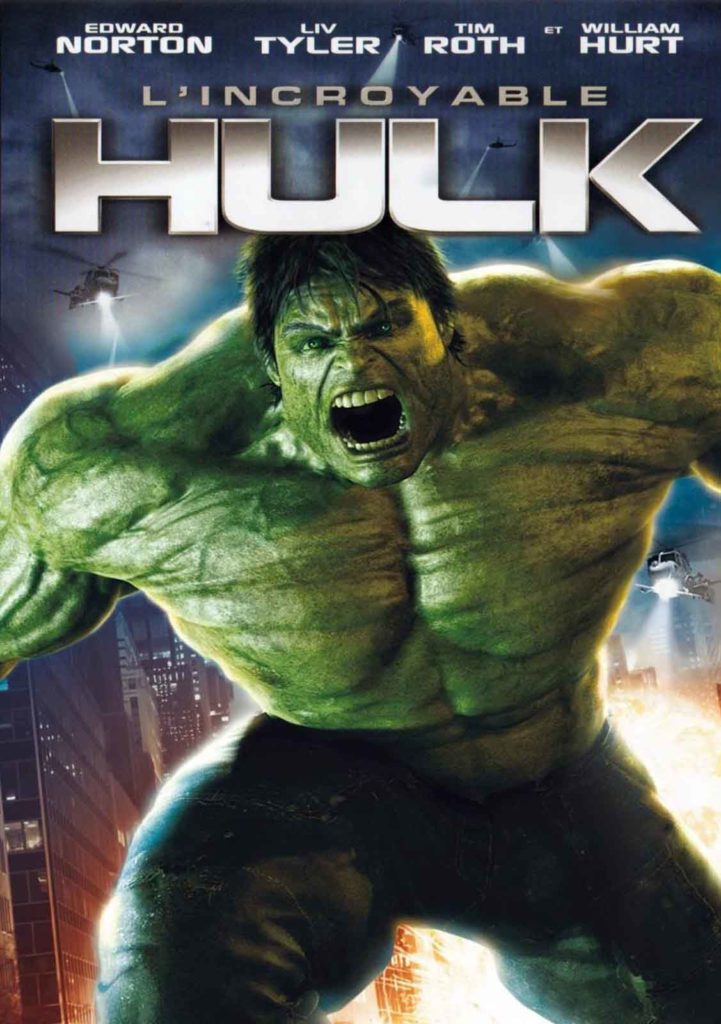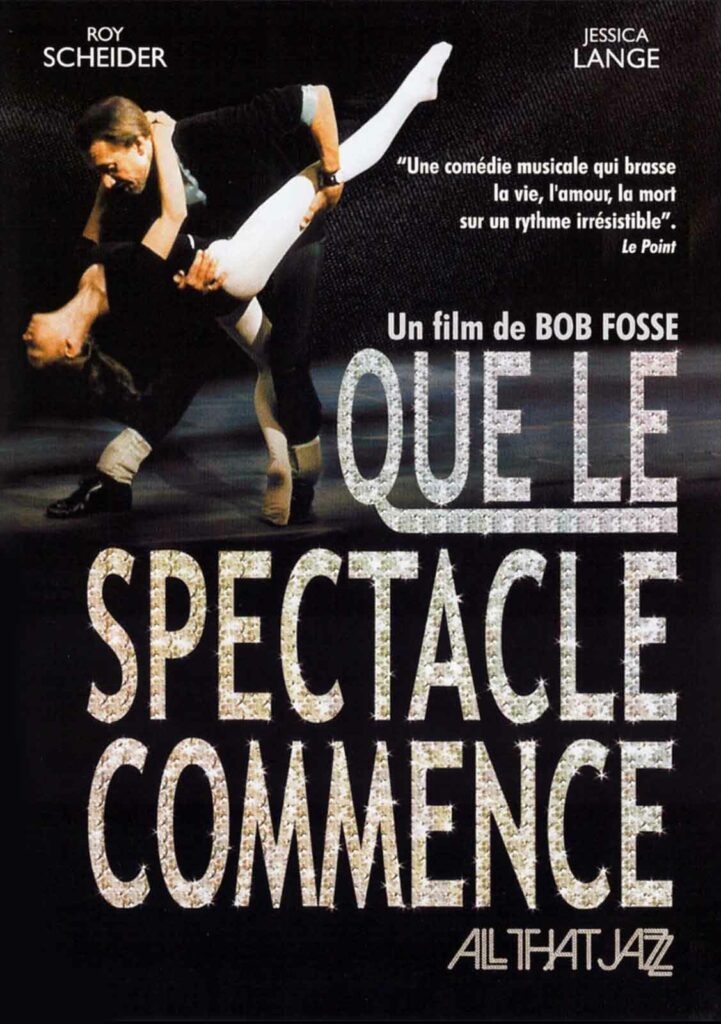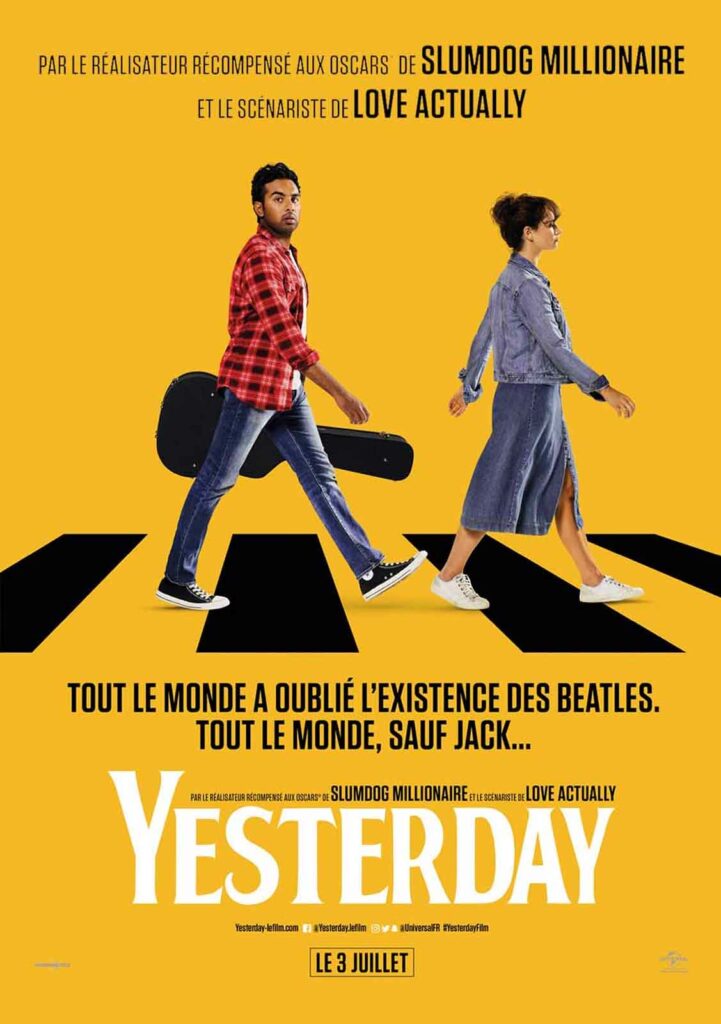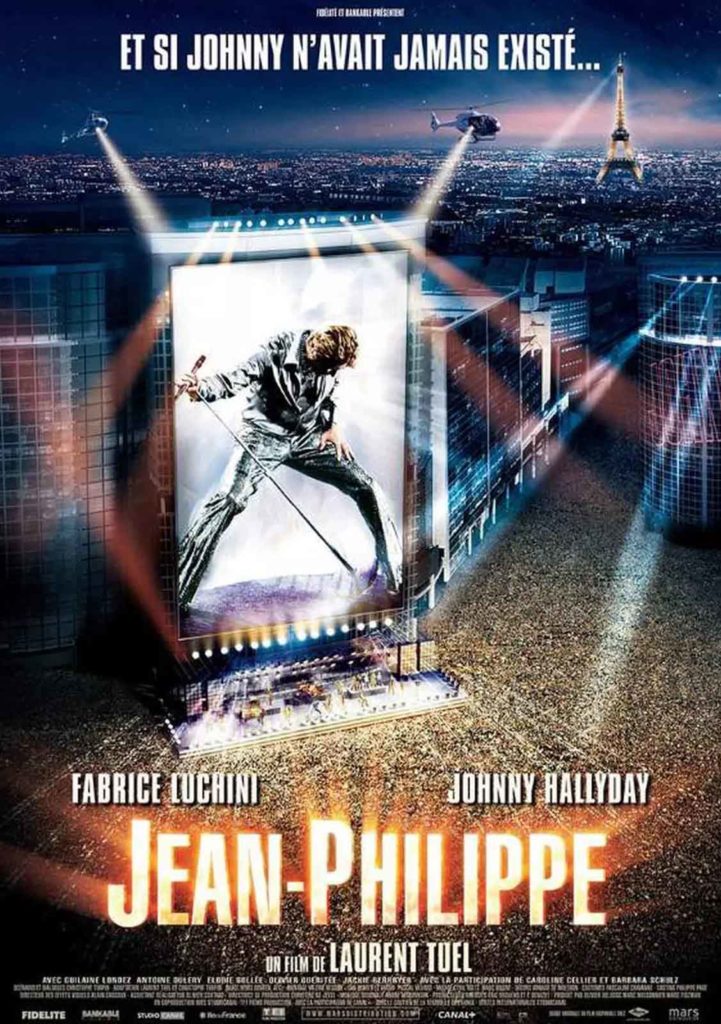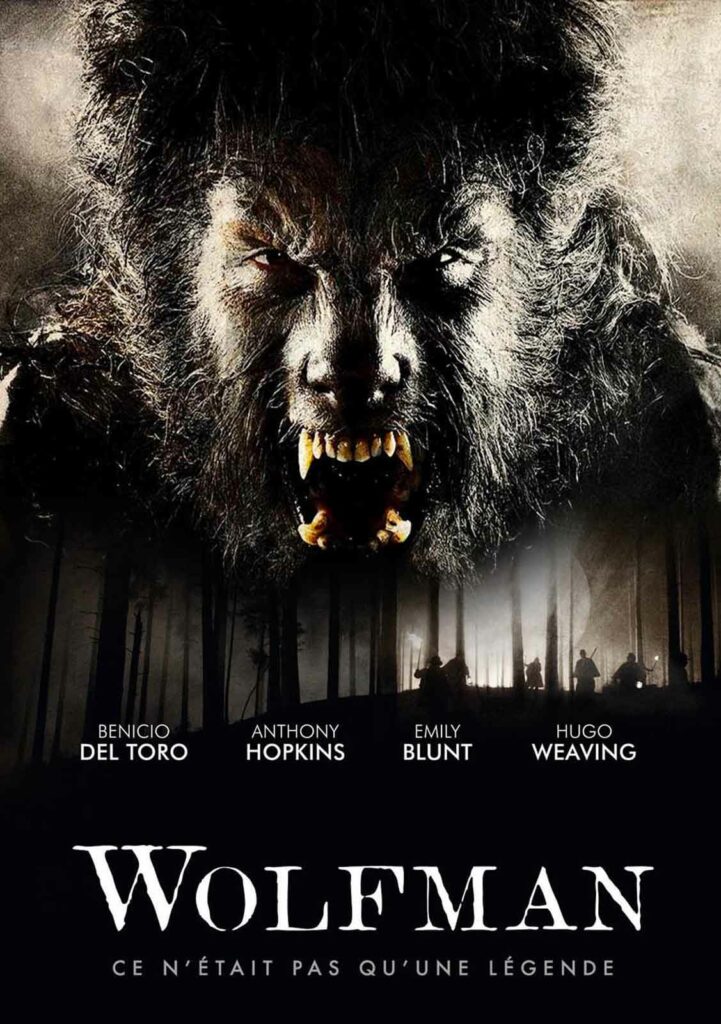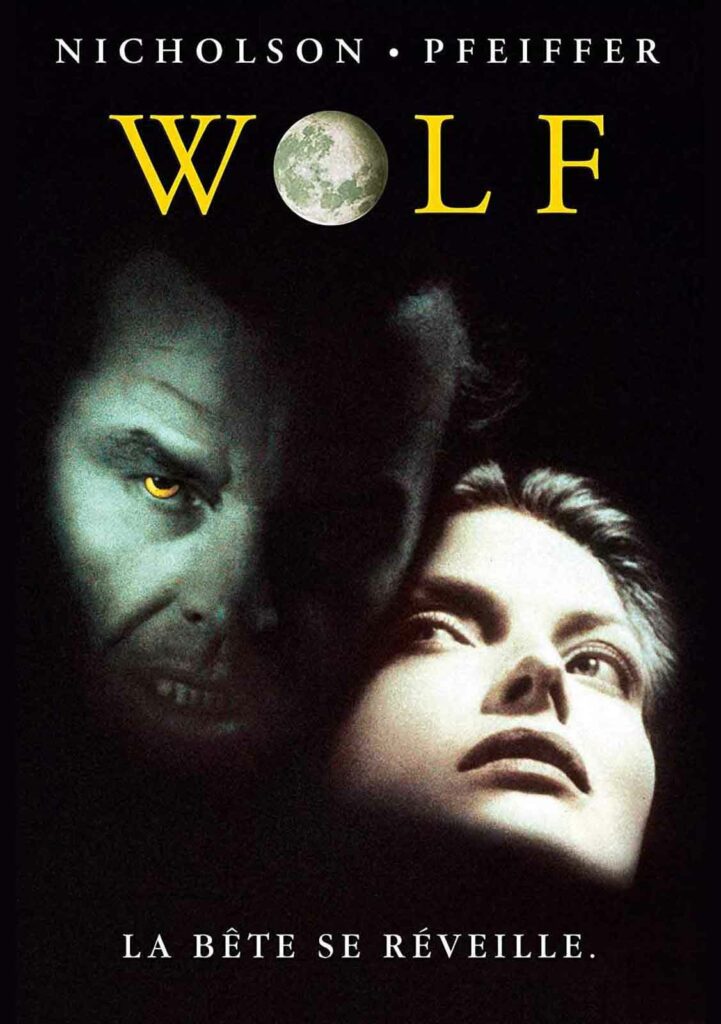Millie Bobby Brown et Chris Pratt errent dans un monde alternatif où les humains et les robots ne sont plus autorisés à cohabiter…
THE ELECTRIC STATE
2025 – USA
Réalisé par Anthony et Joe Russo
Avec Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Ke Huy Quan, Stanley Tuddi, Woody Norman, Giancarlo Esposito, Jason Alexander, Martin Klebba, Martin Hinkle, Michael Trucco
THEMA ROBOTS
Ce titanesque blockbuster de science-fiction, l’un des longs-métrages les plus coûteux de l’histoire du cinéma au moment de sa mise en production (320 millions de dollars de budget), s’inspire d’un roman graphique de Simon Stålenhag paru en 2018. Anthony et Joe Russo, les chouchous du studio Marvel depuis 2014 (Captain America : le soldat de l’hiver, Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame), font l’acquisition des droits du livre un an avant sa publication et envisagent d’en produire l’adaptation en cédant la place du réalisateur à Andres Muschietti (Ça). Universal est alors positionné pour distribuer le film en salles. Mais la concrétisation de The Electric State prend plus de temps que prévu, poussant Muschietti à se retirer pour partir réaliser The Flash. C’est finalement Netflix qui récupère les droits du film en 2022. Les frères Russo prennent en charge eux-mêmes la mise en scène et truffent chaque séquence d’effets visuels et d’images de synthèse à très grande échelle conçus par une myriade de compagnies prestigieuses dont Digital Domain et Industrial Light & Magic. D’où une post-production à rallonge. Le but est manifestement d’en mettre plein la vue aux spectateurs, même si le film ne sera apprécié que sur les petits écrans.


The Electric State est une uchronie. Dans ce monde alternatif, les années 1990 ont été marquées par une guerre dévastatrice entre les humains et les robots, déclenchée lorsque les machines ont réclamé des droits et une autonomie. Les humains ont fini par triompher grâce à l’invention du neurotransmetteur, une technologie permettant aux combattants de piloter à distance des robots guerriers sans risquer eux-mêmes d’être blessés ou tués. Après cette victoire, la paix est revenue dans le monde. La technologie du neurotransmetteur offre désormais à chacun un don d’ubiquité, du moins la possibilité de faire agir à distance un double robotisé tout en restant tranquillement confiné. C’est dans ce contexte que Michelle (Millie Bobby Brown), une jeune fille rebelle ayant perdu son frère et ses parents dans un accident de voiture, vit désormais au sein d’une famille d’accueil. Un soir, sa vie prend un tournant inattendu lorsqu’elle reçoit la visite d’un étrange robot au look cartoonesque qui semble la connaître personnellement. Or les interactions entre les humains et les robots sont strictement interdites depuis la guerre…
Robots sauvages
L’ambition visuelle de The Electric State est indiscutable. Les séquences d’action rivalisent de générosité et d’hypertrophie, les frères Russo enchaînant les tableaux visuels dignes des couvertures de romans de SF pulp à l’ancienne : le robot géant qui traverse le désert en portant un van sur son épaule, les vastes paysages jonchés d’immenses carcasses mécaniques déchues, l’énorme machine bipède qui balance des voitures contre la façade d’un immeuble ou encore cette galerie marchante où grouillent des robots grotesques qui semblent inspirés par les personnages des comic strips des années 20 et 30. Mais l’effet de déjà-vu n’est pas exclu pour autant. Le film puise beaucoup chez Terminator (jusqu’à en reprendre certains effets sonores), A.I. (avec ses robots charognards faits de bric et de broc) et Ready Player One (les combattants commandés à distance par des employés derrière des casques virtuels). Cette dernière influence est renforcée par la bande originale d’Alan Silvestri. D’autre part, si le casting du film est attrayant, chacun semble rester sagement dans sa zone de confort. Millie Bobby Brown est fidèle à son image de jeune héroïne forçant l’adversité avec détermination et anticonformisme, Chris Pratt cabotine dans son registre habituel d’anti-héros sympathique sous influence d’Harrison Ford (il reprend même le look de Han Solo), Giancarlo Esposito joue comme toujours le salaud charismatique… Bref, rien de bien nouveau. The Electric State nous laisse en définitive une impression très mitigée, celle d’un spectacle grandiose qui se donne les moyens de ses ambitions mais peine à sortir du lot. C’est un refrain connu chez Netflix.
© Gilles Penso
À découvrir dans le même genre…
Partagez cet article