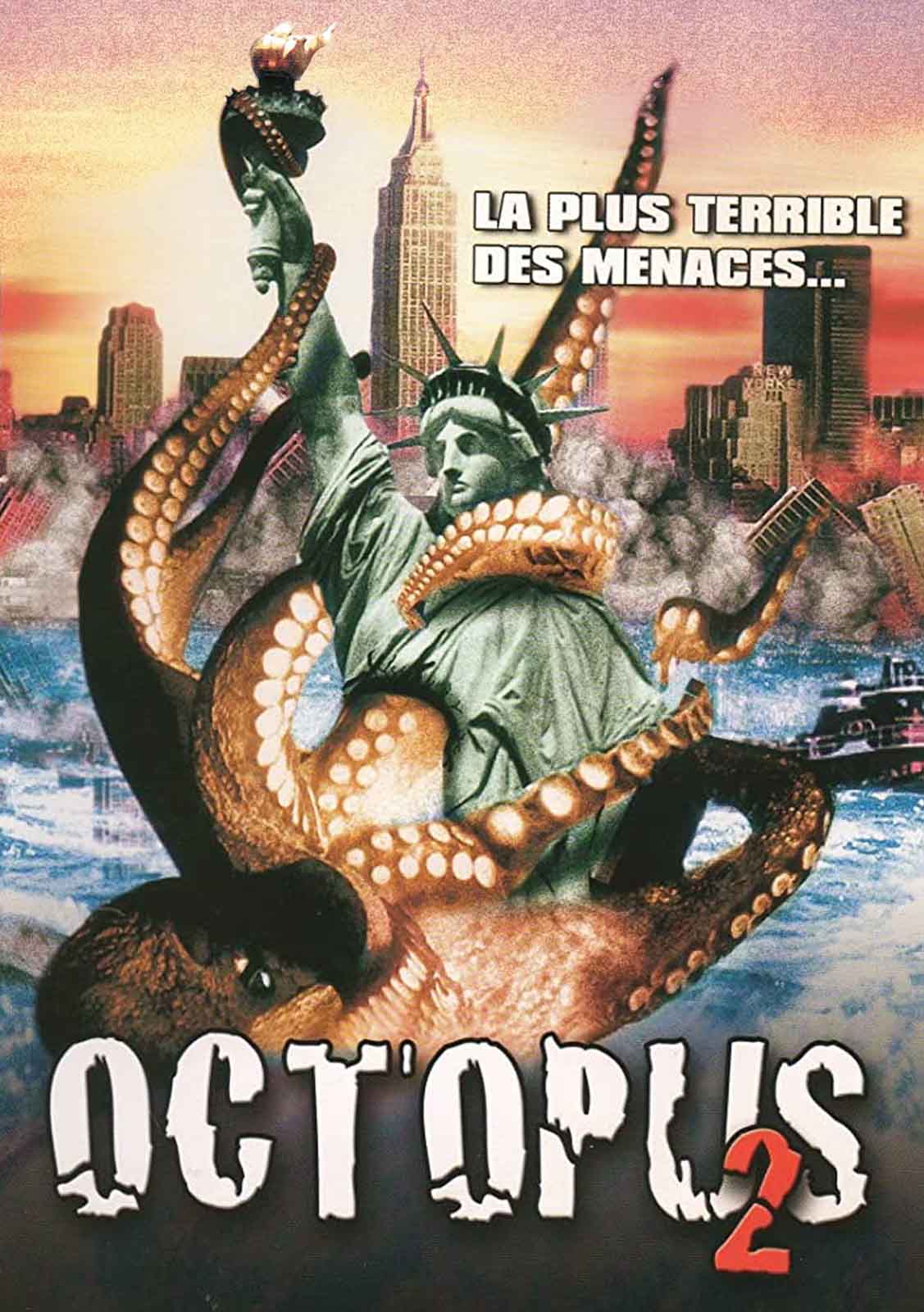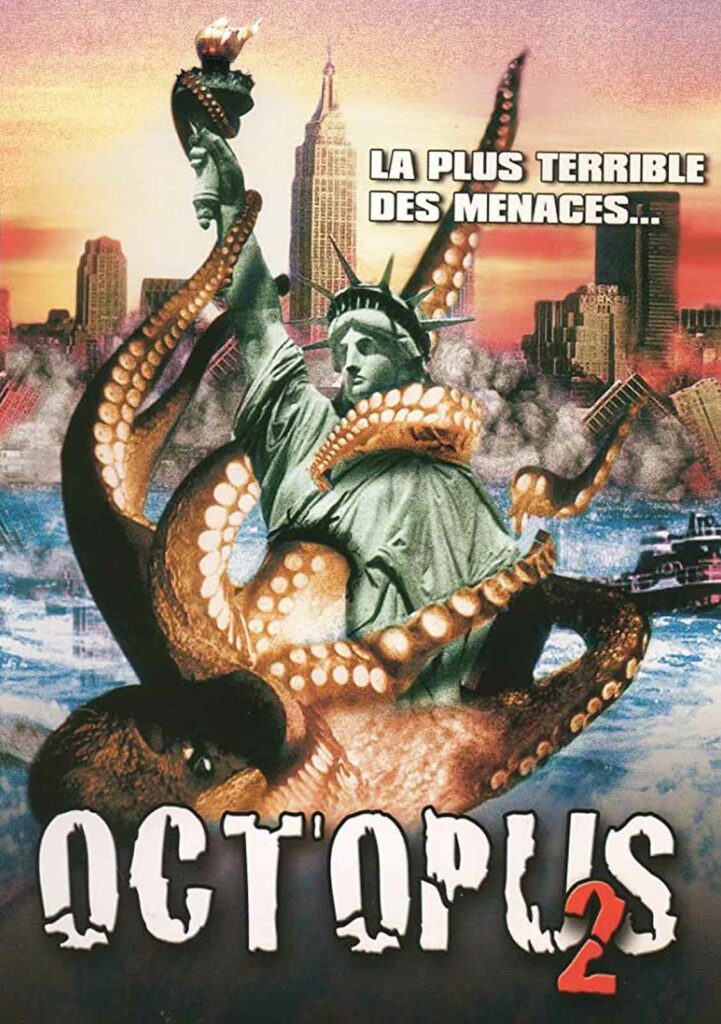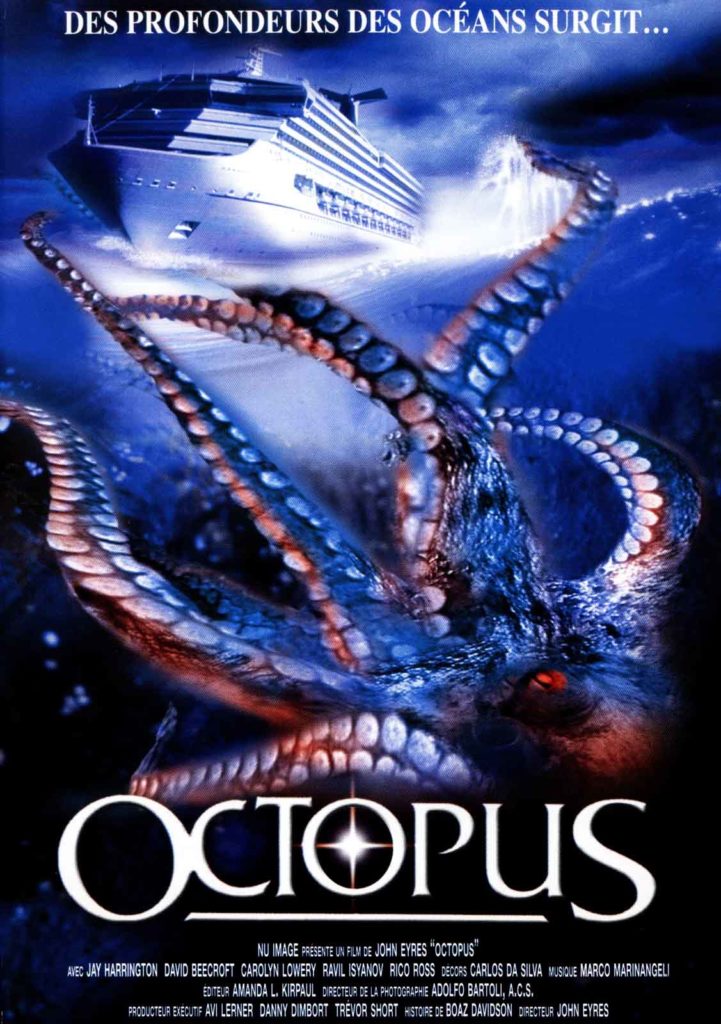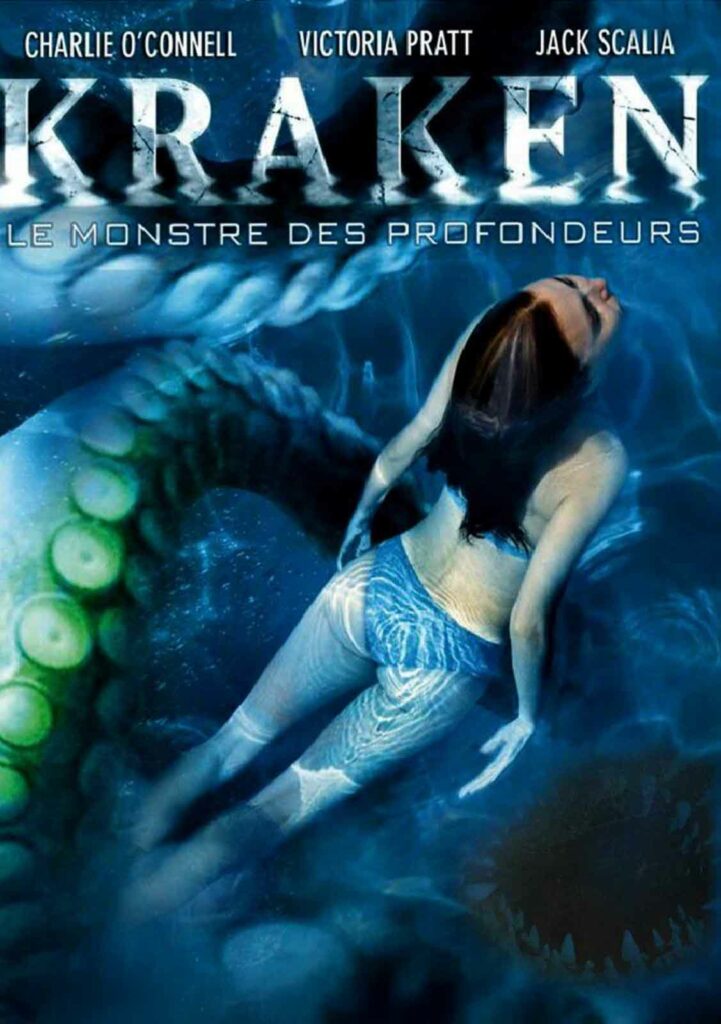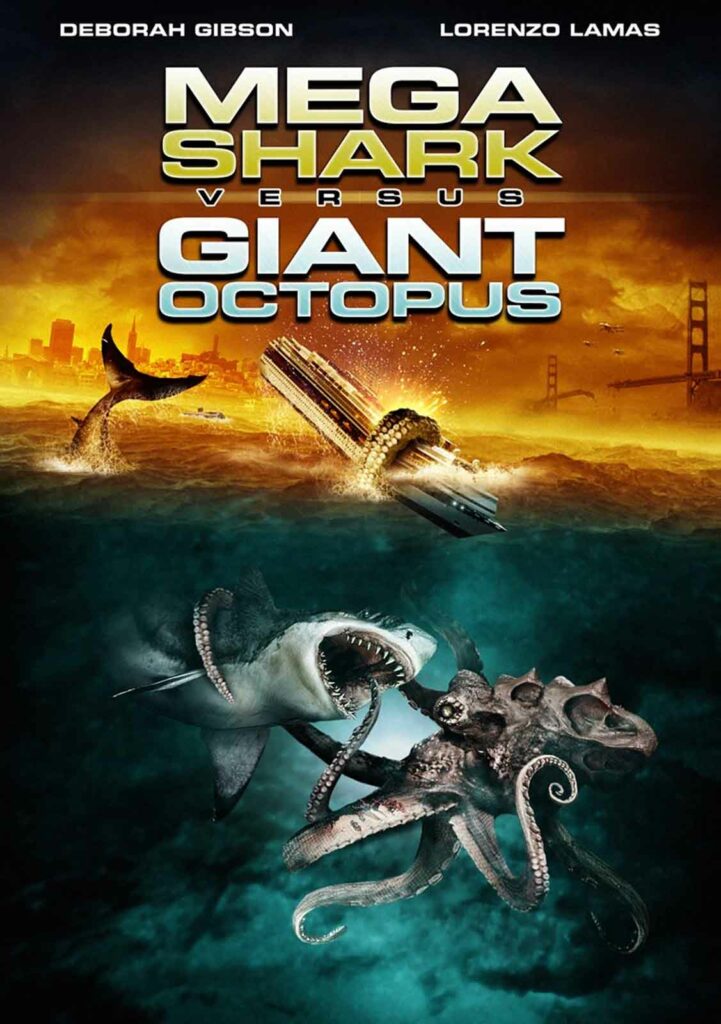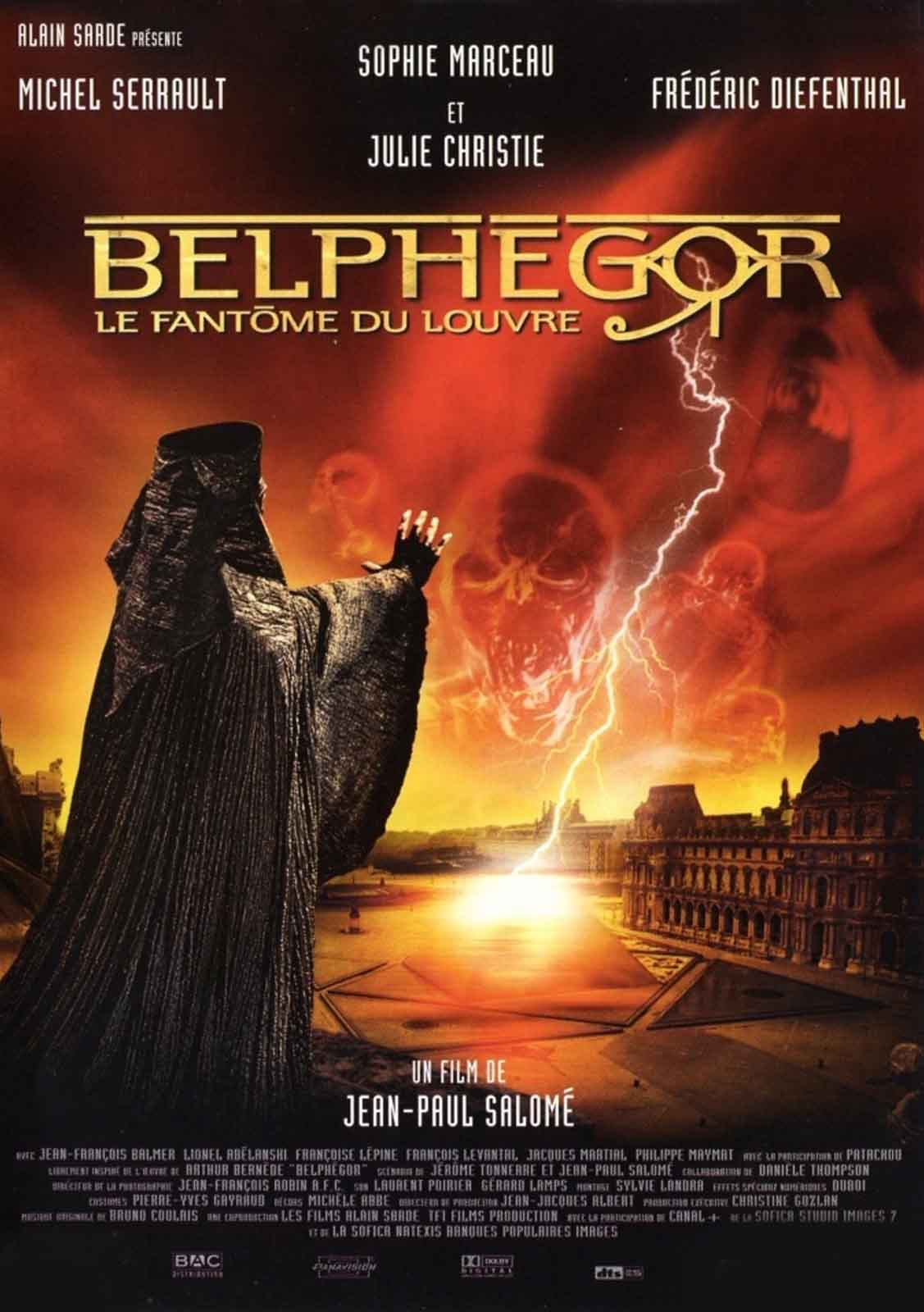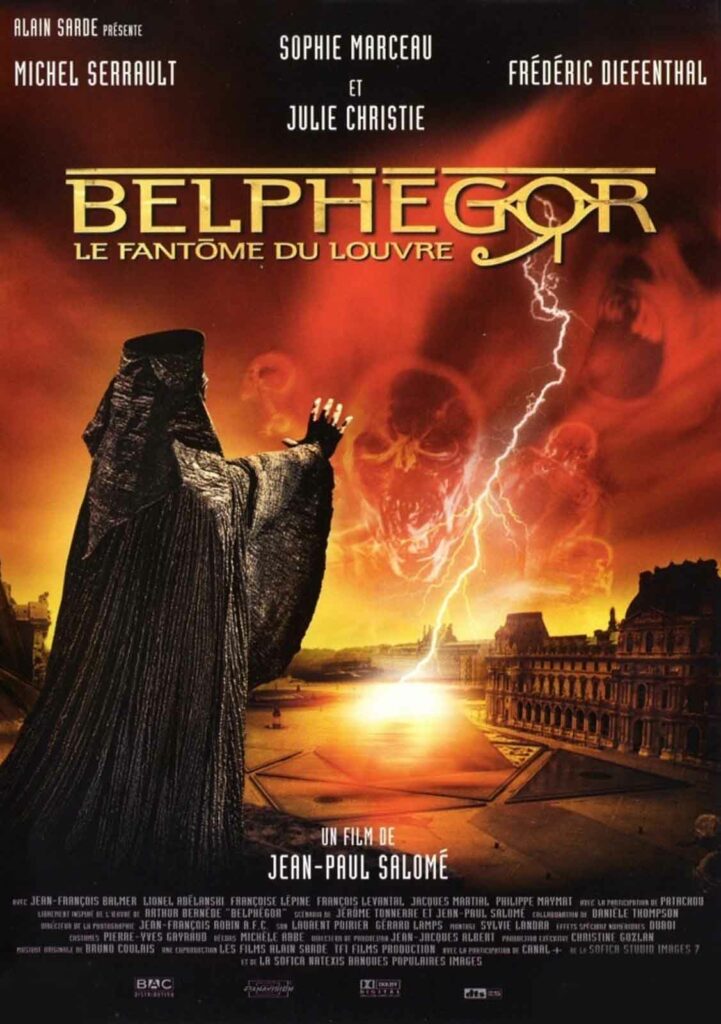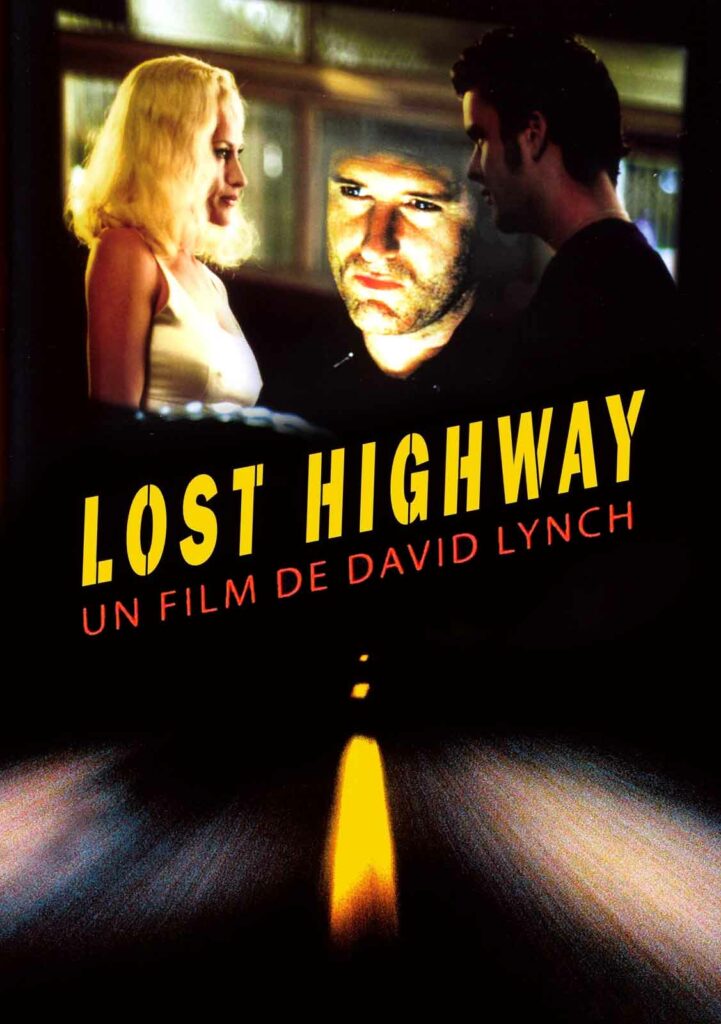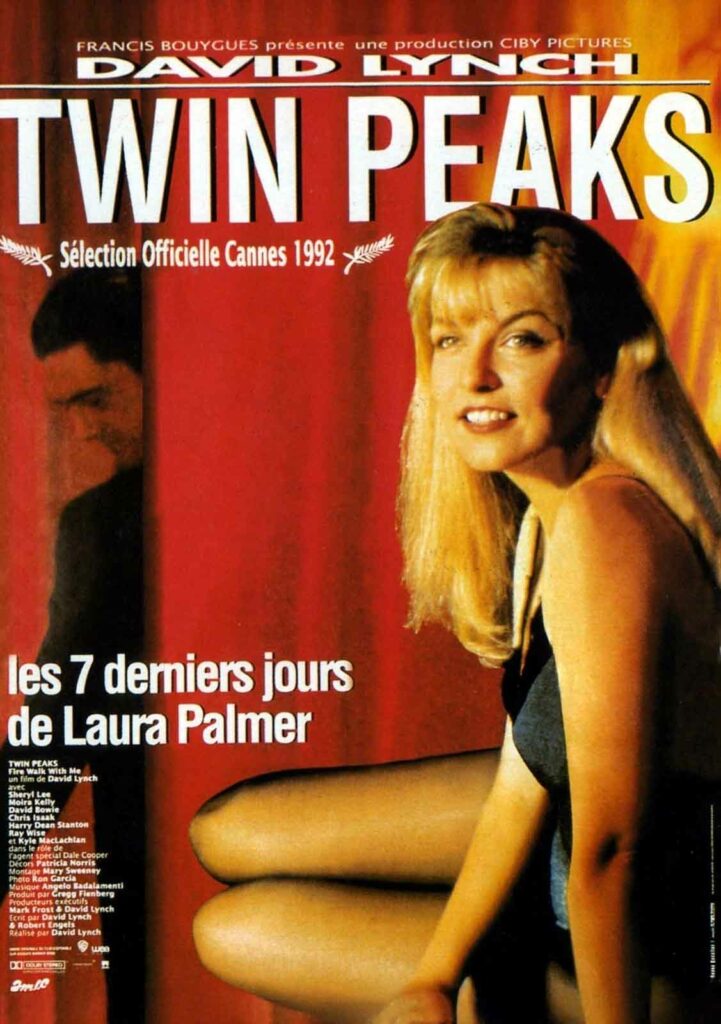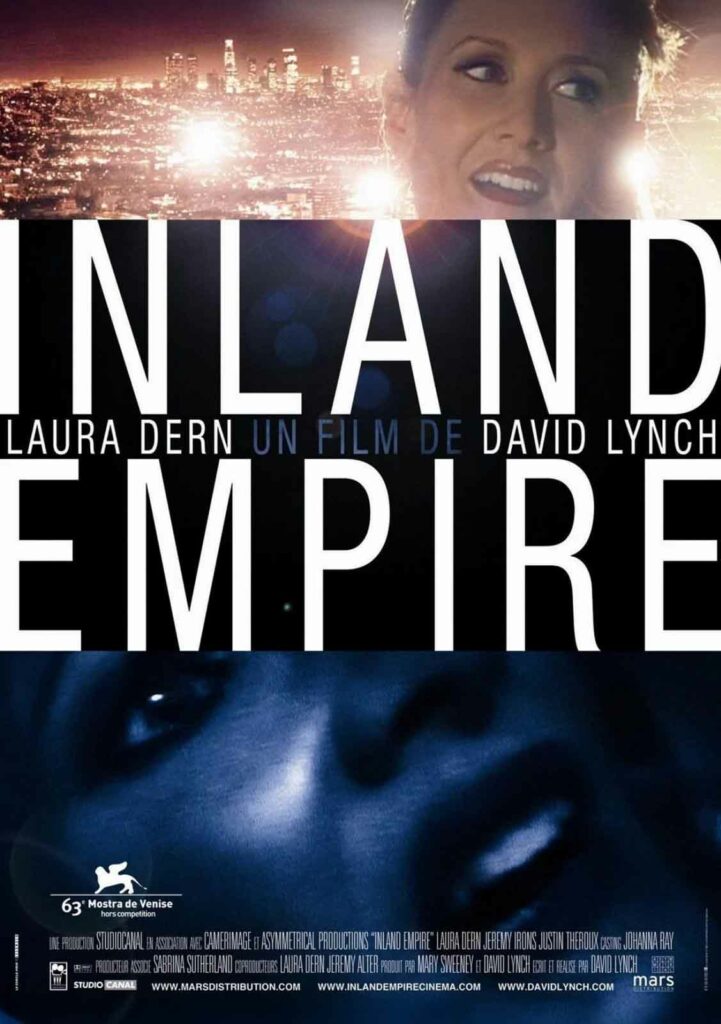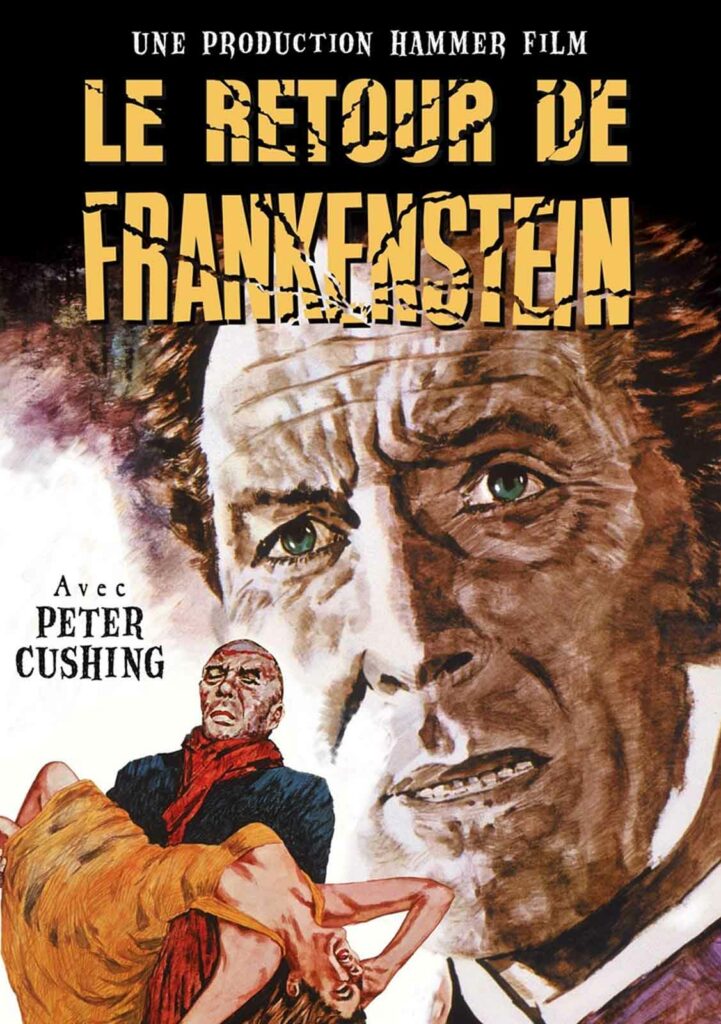Deux scientifiques se sont fixés pour objectif de vaincre la mortalité en découvrant le secret de la vie éternelle…
« Depuis la nuit des temps, l’humanité n’a cessé de se poser une seule et même question dont personne n’a jamais su trouver la réponse : que trouve-t-on après la mort ? » C’est sur ces propos sentencieux prononcés en voix off que démarre Les Mystères d’outre-tombe, tandis que la caméra balaie d’étranges ruines tapissées de toiles d’araignée. Peu après Les Proies du vampire et Le Retour du vampire, Fernando Mendez renoue ainsi avec l’épouvante gothique qui lui réussit si bien, au sein d’un scénario tortueux qui prend place dans un sanatorium abritant plusieurs malades mentaux. Là, le professeur Jacinto Aldama (Antonio Raxel, que l’on vit dans La Tête vivante) rend son dernier souffle. Son confrère, le docteur Mazali (Rafael Bertrand), lui rappelle alors la promesse mutuelle qu’ils se sont faite : le premier qui meurt doit délivrer un message à l’autre depuis l’au-delà, afin de lui permettre de voyager du monde des vivants vers celui des morts. Vaincre la mortalité, découvrir le secret de la vie éternelle, telles sont les ambitions de nos deux savants. Mais évidemment, comme chaque fois que l’homme joue à défier Dieu en pareil contexte, rien ne se passe comme prévu.


Peu après son trépas, Aldama parvient à communiquer avec Mazali, par l’intermédiaire d’une voyante, et lui promet de lui ouvrir la porte de l’autre monde trois mois plus tard. Entre-temps, le fantôme du défunt, dignement drapé dans une cape noire, apparaît à sa fille Patricia, danseuse de cabaret incarnée par la très photogénique Mapita Cortes. Un triangle amoureux s’installe bientôt, la belle étant à la fois courtisée par Mazali et par le jeune interne Eduardo Jimenez (Gaston Santos) qui arbore fièrement la moustache, comme tous les héros masculins du film d’ailleurs. Bientôt, un drame frappe le sanatorium. Une gitane folle furieuse (Carolina Barret) échappe en effet à la vigilance des médecins et jette une bouteille d’acide au visage de l’infortuné Elmer (Carlos Ancira) l’un des infirmiers. Celui-ci, atrocement défiguré (grâce à un maquillage impressionnant qui semble s’inspirer des créations de Lon Chaney), est désormais ivre de vengeance. Tous ces événements convergent peu à peu vers la date fatidique annoncée par Aldama…
L’ironie du sort
Ainsi, par touches successives, Mendez construit un puzzle étrange qui ne prend sa tournure définitive qu’au moment du dernier acte, via un surprenant retournement de situation laissant la part belle à l’ironie du sort. La camarde semble se jouer des protagonistes avec délectation, et ce n’est pas le moindre attrait du scénario de Ramon Obon, abordant avec beaucoup d’originalité les thèmes de la mort et de l’au-delà. Fidèle à ses habitudes, le cinéaste soigne tout particulièrement la mise en forme de son film, notamment à travers des cadrages ciselés, une partition inquiétante de Gustavo Cesar Carrion et une photographie somptueuse signée Victor Herrera. On n’est pas près d’oublier ce sinistre gibet en contre-jour attendant sa victime, la résurrection effrayante de l’homme défiguré, ou encore ce splendide décor de patio dans lequel dansent les ombres des plantes secouées par le vent, et où se nouent tour à tour les romances et les drames d’un récit fort alambiqué.
© Gilles Penso
Partagez cet article