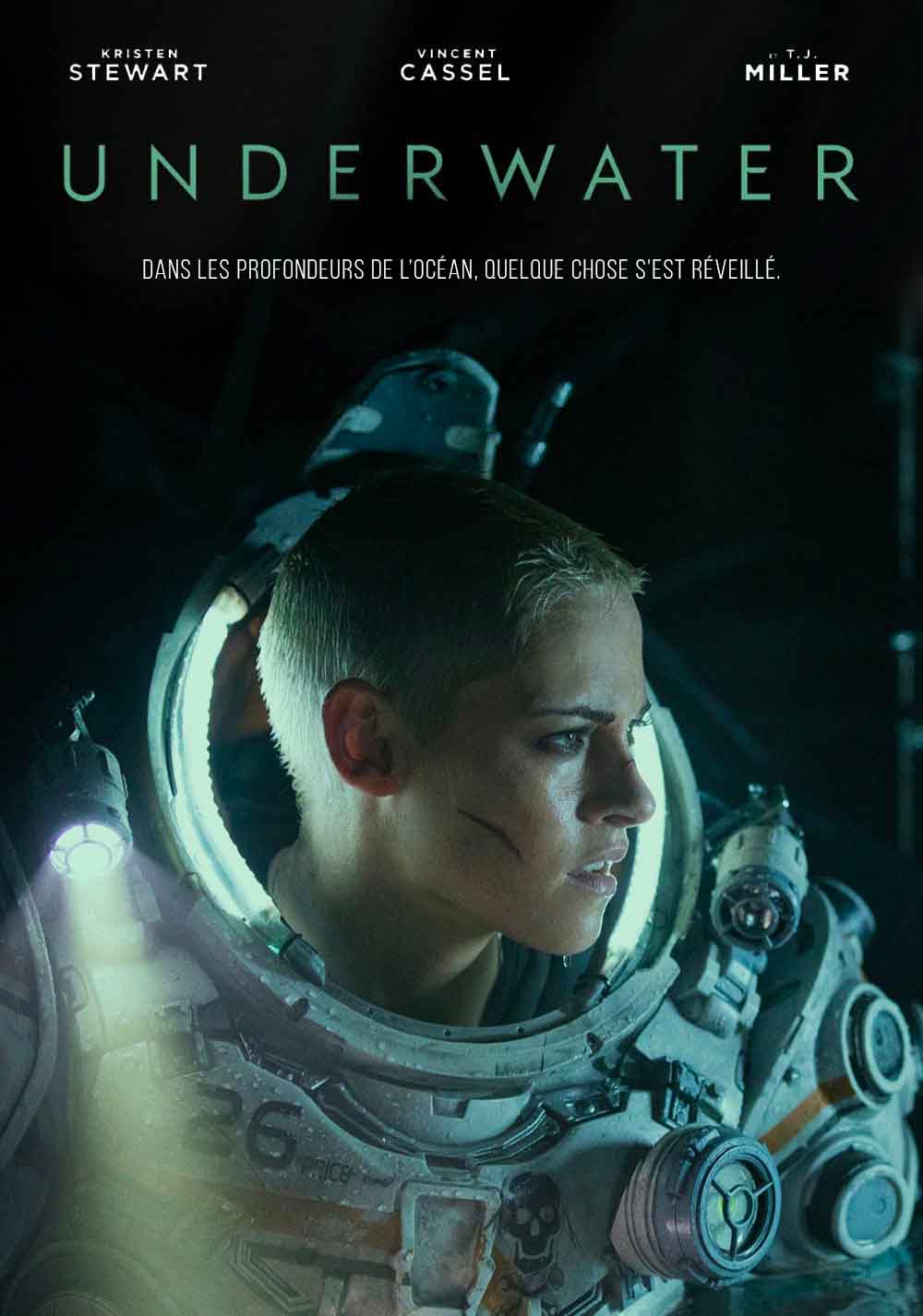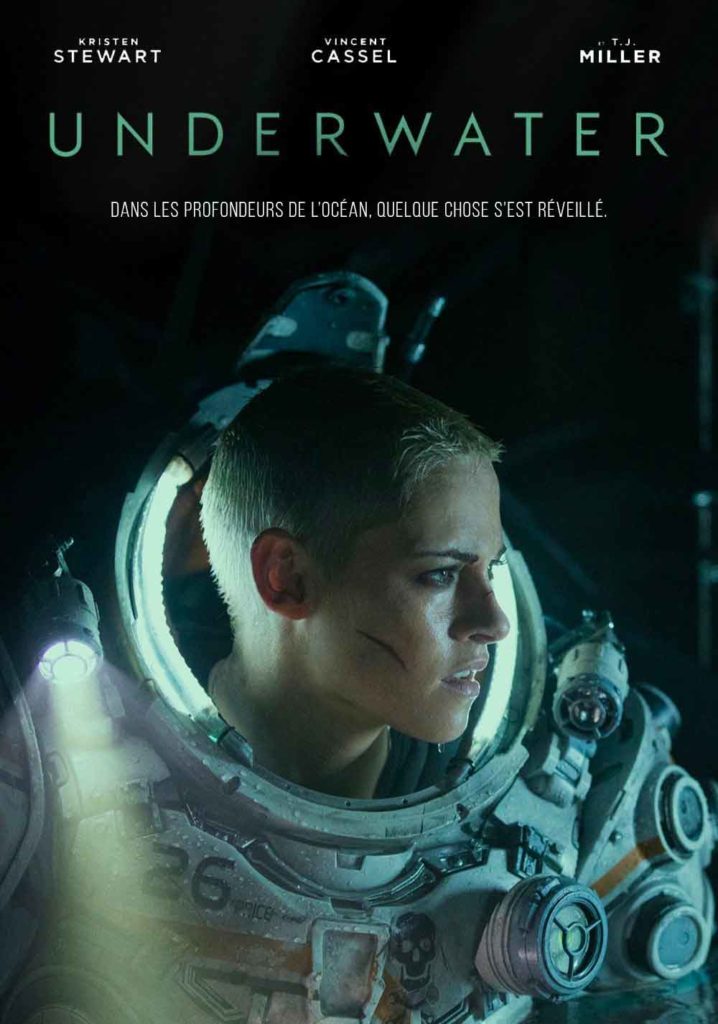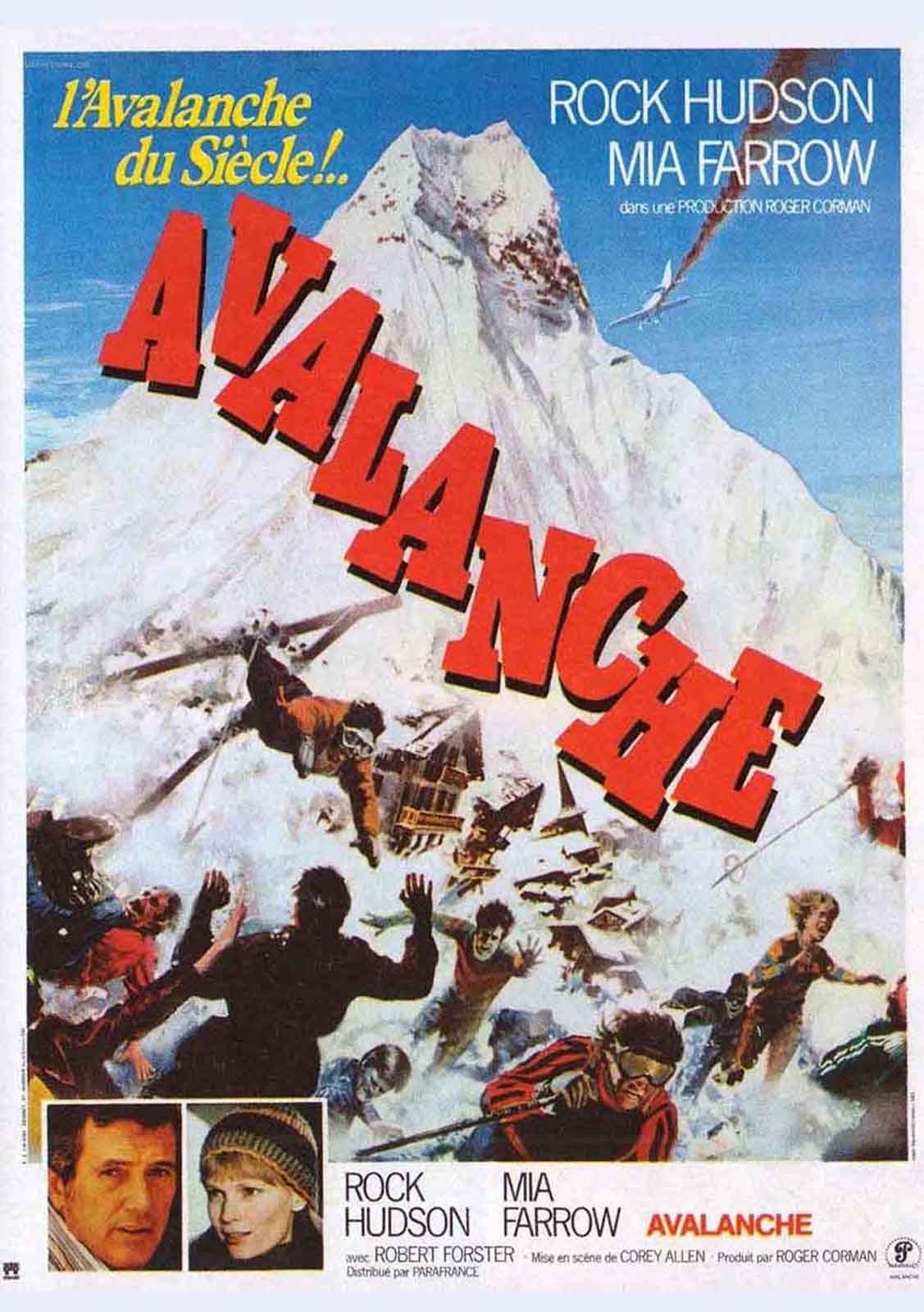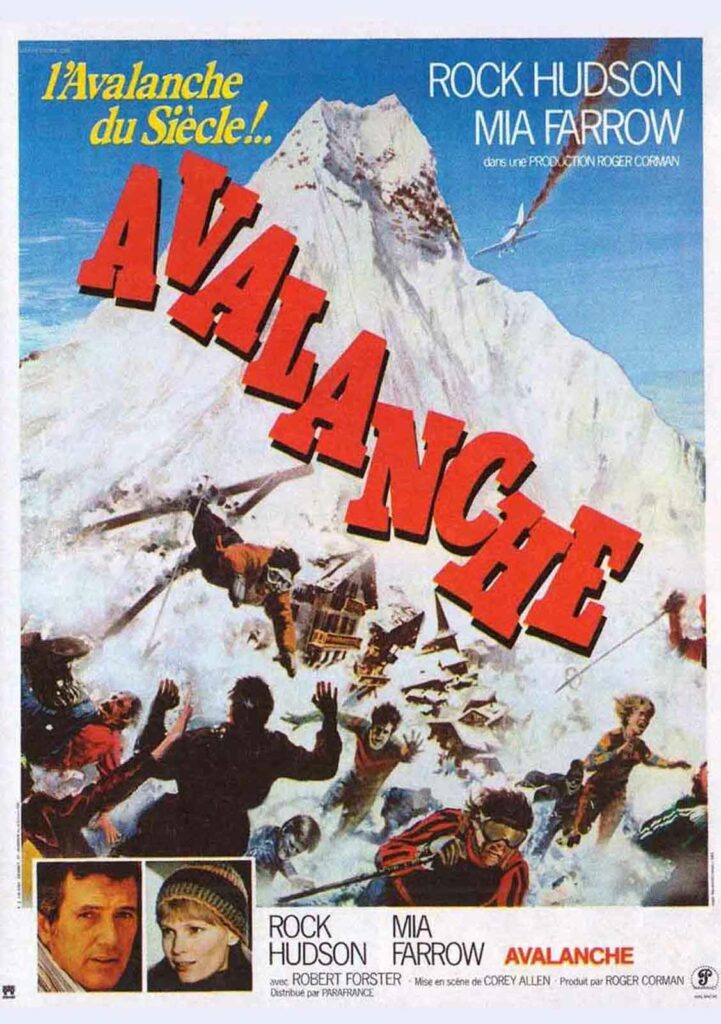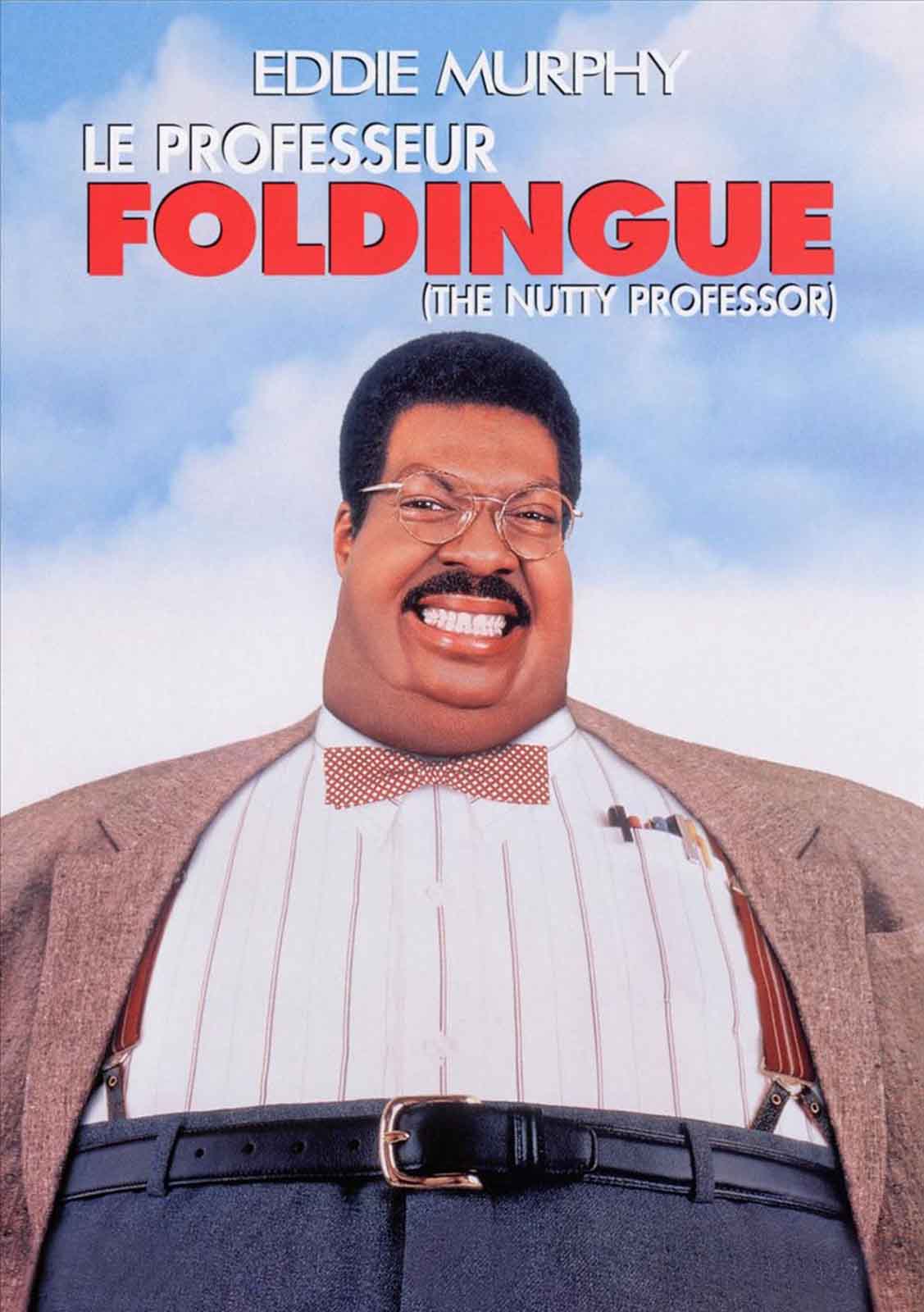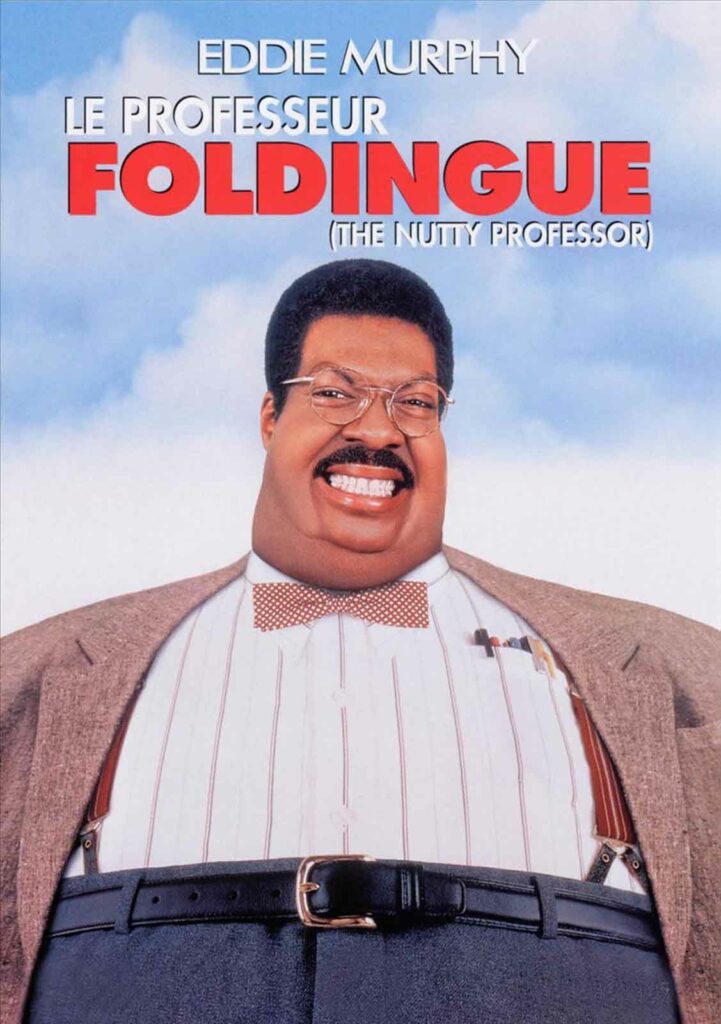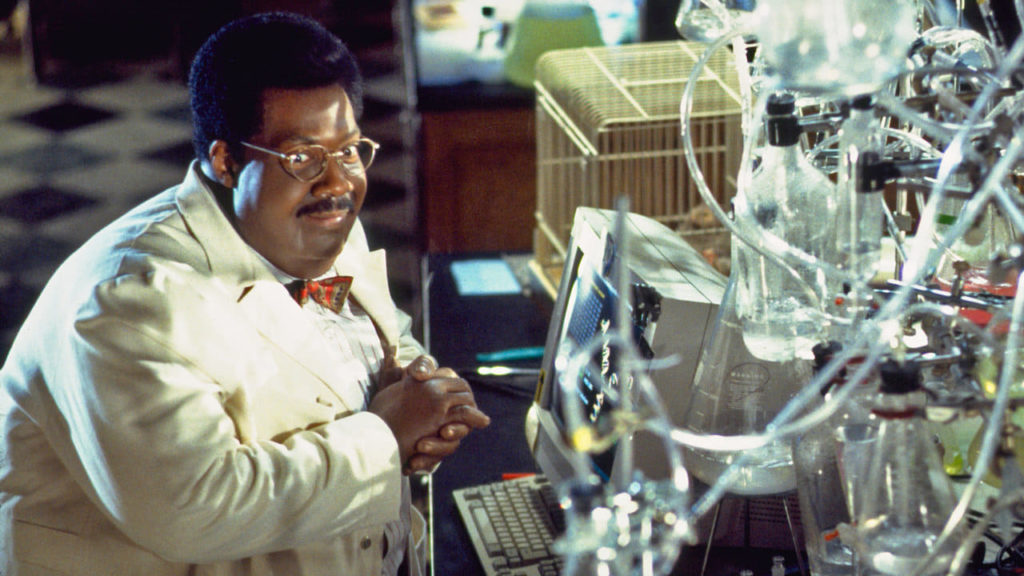Un peintre endeuillé par la mort de sa fille découvre un passage qui l’emmène vers un monde parallèle situé cinq ans dans le passé…
DIE TÜR
2009 – ALLEMAGNE
Réalisé par Anno Saul
Avec Mads Mikkelsen, Jessica Schwartz, Heike Makatsch, Nele Trebs, Rüdiger Kühmstedt, Corinna Borchert, Valeria Eisenbart, Thomas Thieme
THEMA VOYAGES DANS LE TEMPS
Ancien peintre à succès, David cherche un sens à sa vie après s’être rendu responsable de la mort de sa fille. Cinq ans plus tard, après une soirée noyée dans l’alcool, il se perd dans les bois en suivant un étrange papillon et finit par découvrir un tunnel obscur au bout duquel se trouve une porte. Lorsqu’il en franchit le seuil, sa vie bascule. Car le voici désormais dans un monde parallèle, le même que le sien, mais plus jeune de cinq ans. Dans ce monde, sa fille vit encore et son épouse ne l’a pas quitté. Va-t-il pouvoir profiter de cette seconde chance pour racheter ses fautes ? Tel est le point de départ de The Door, magistral tour de force scénaristique écrit par Jan Berger d’après un roman fascinant d’Akif Pirincci. L’incontestable réussite du film repose en grande partie sur les épaules de Mads Mikkelsen, que le grand public avait découvert trois ans plus tôt sous les traits torturés du maléfique « Le Chiffre » dans Casino Royale de Martin Campbell. Le visage buriné, les traits fatigués, le regard froid, il campe ici un anti-héros d’autant moins avenant que la mort de sa fille est consécutive à l’une de ses amourettes extra-conjugales. Tout le talent du comédien et de son metteur en scène consistent dès lors à solliciter la mansuétude du spectateur et l’acceptation des faiblesses de ce protagoniste guère reluisant.


Peu connaisseur en matière de science-fiction, Anno Saul n’utilise les codes du genre que pour mieux exacerber les réactions humaines et titiller les caprices du destin. « Je dois vous avouer que je n’ai jamais vu d’épisode de La Quatrième dimension », confesse-t-il. « En revanche, je me suis beaucoup laissé inspirer par les films de M. Night Shyamalan, notamment Sixième sens, Incassable et, dans une moindre mesure, Le Village. J’aime beaucoup l’équilibre qu’il a trouvé entre le réalisme et le fantastique » (1). Ainsi, lorsque son héros se retrouve face à des situations et des choix impensables, l’argument fantastique cède le pas au drame humain. Car en effectuant un bond dans le passé, David doit faire face à son propre double, plus jeune de cinq ans. Comment peut-il tenter un nouveau départ dans ces conditions ? Ce monde parallèle ne peut manifestement contenir qu’un seul des deux David, mais lequel ?
David contre David
Une séquence charnière, au cours de laquelle le protagoniste tente d’expliquer en termes simples à sa fille qu’il va devenir son « nouveau papa » tout en s’efforçant de faire mieux que le précédent, soulève subtilement toutes les questions existentialistes du récit. Mais le scénario de The Door ne s’en tient pas à son point de départ insolite et aux dilemmes qu’il implique. Car de nouveaux rebondissements inattendus viennent bientôt perturber le récit, dotant l’étrange phénomène d’une dimension plus ample que prévue. Tous ceux qui ne juraient que par la trilogie Matrix en matière de science-fiction philosophique réviseront probablement leur jugement en découvrant The Door. Évacuant toutes citations « érudites », toutes démonstrations nébuleuses et tout effet spectaculaire, cette modeste production germanique nous questionne en toute simplicité sur la condition humaine et trotte longtemps dans nos esprits après son visionnage.
(1) Propos recueillis par votre serviteur en janvier 2010
© Gilles Penso
Partagez cet article