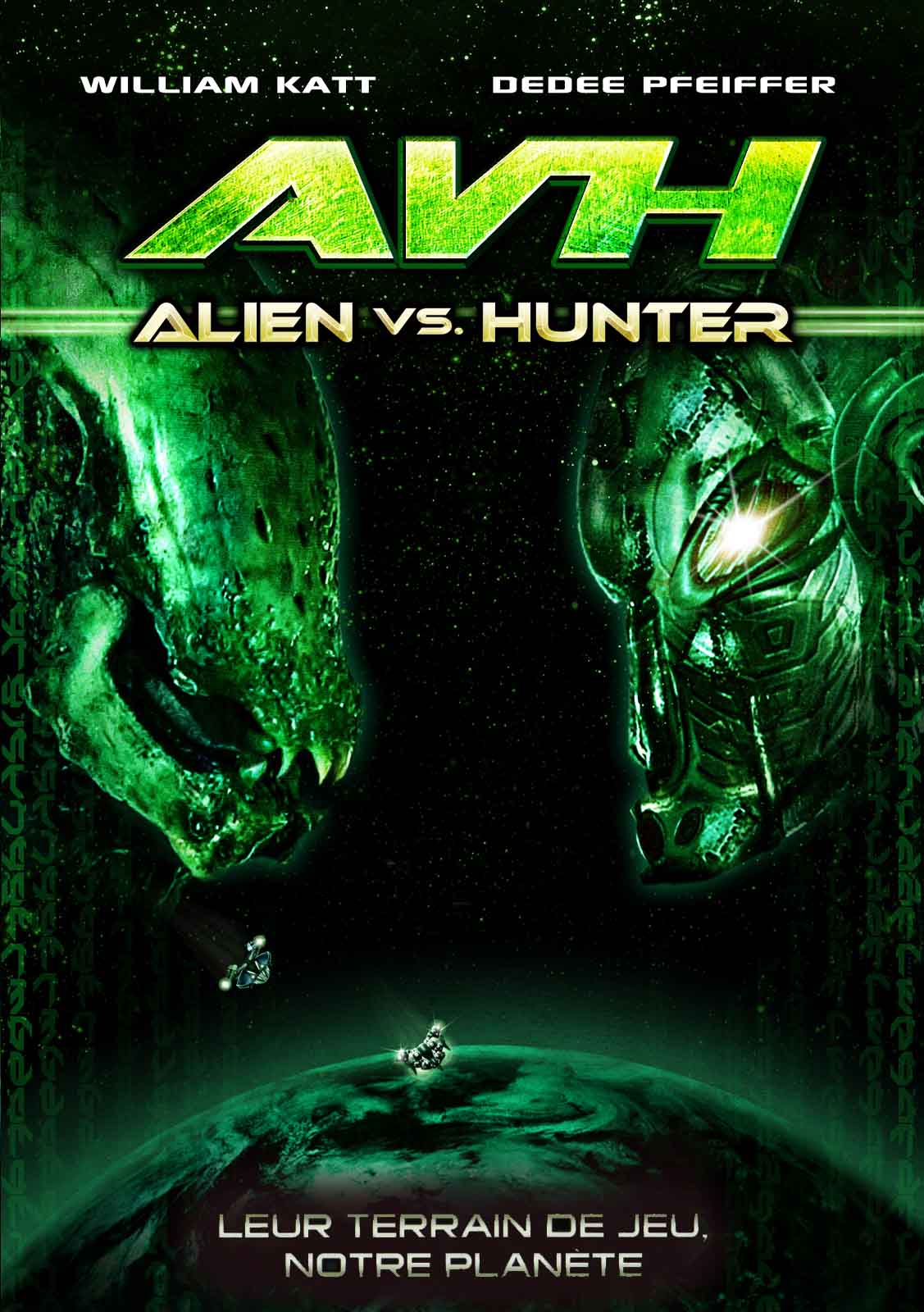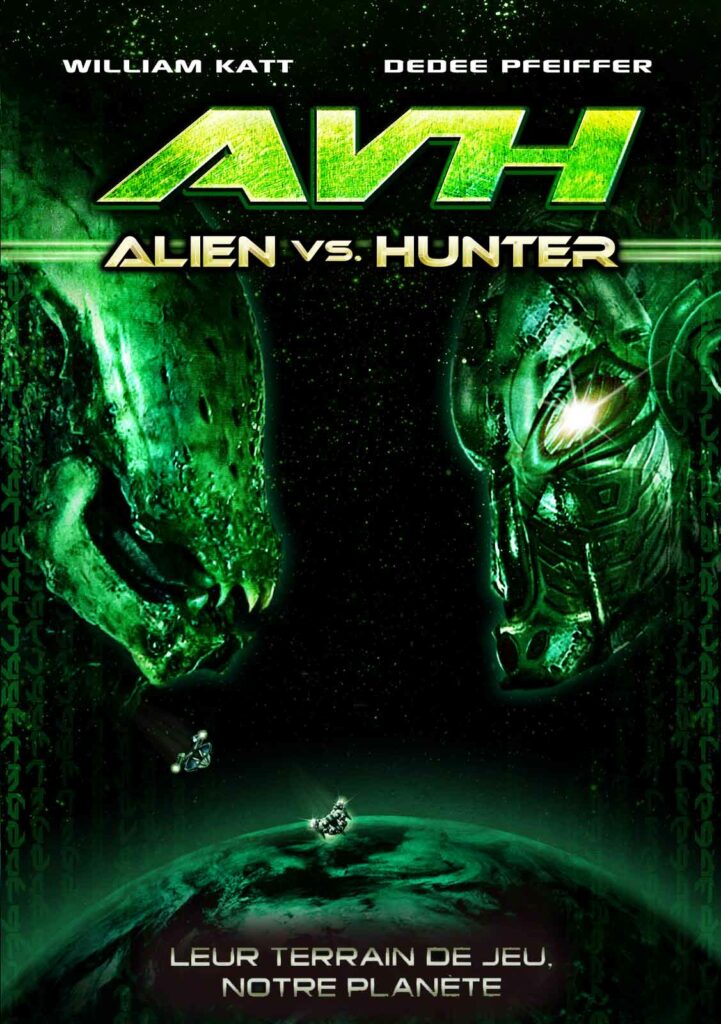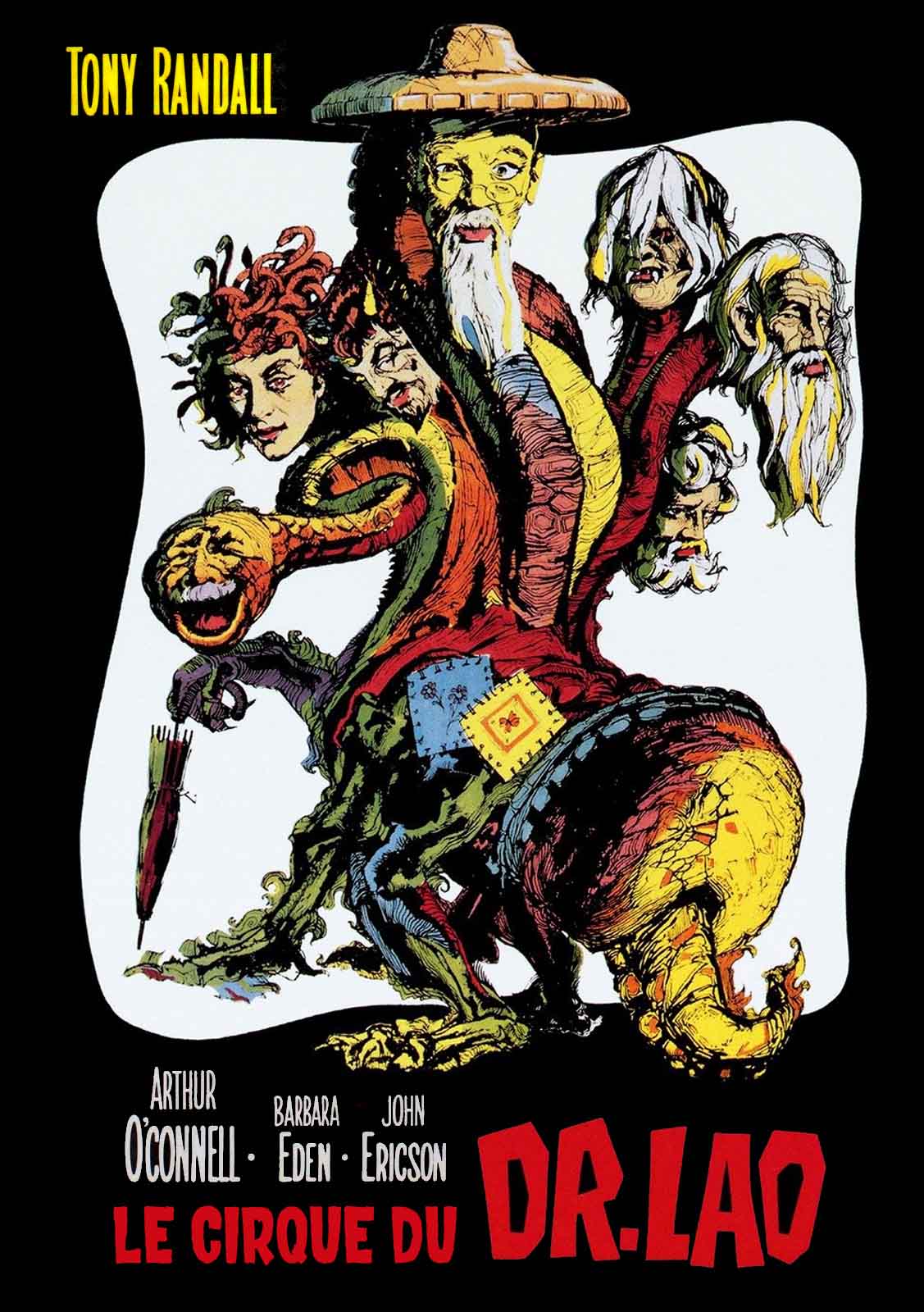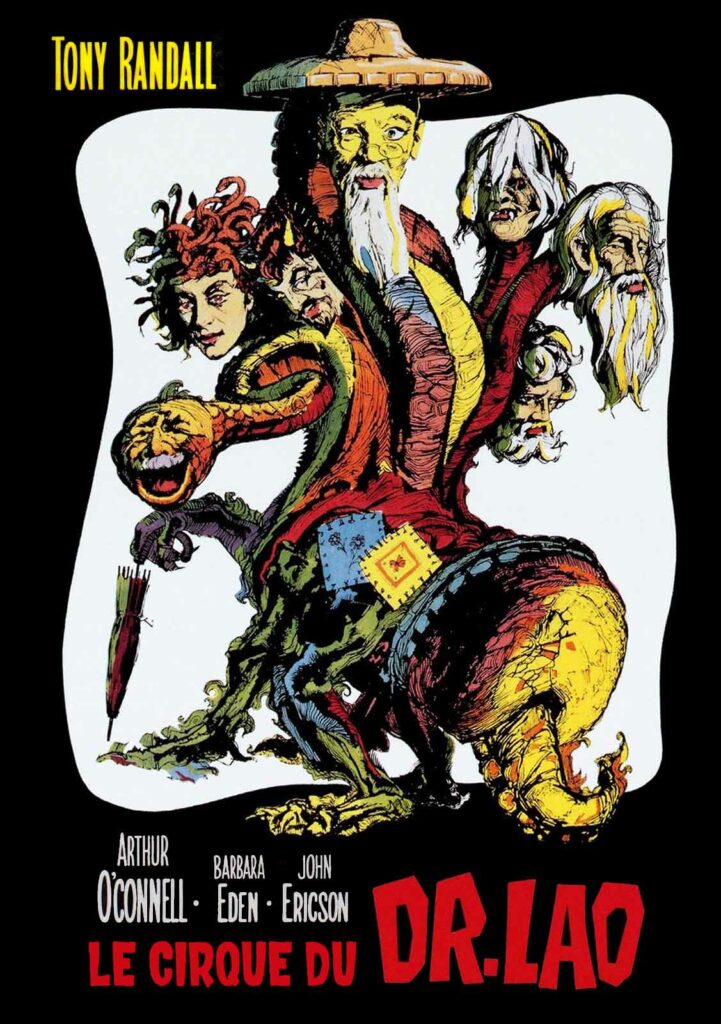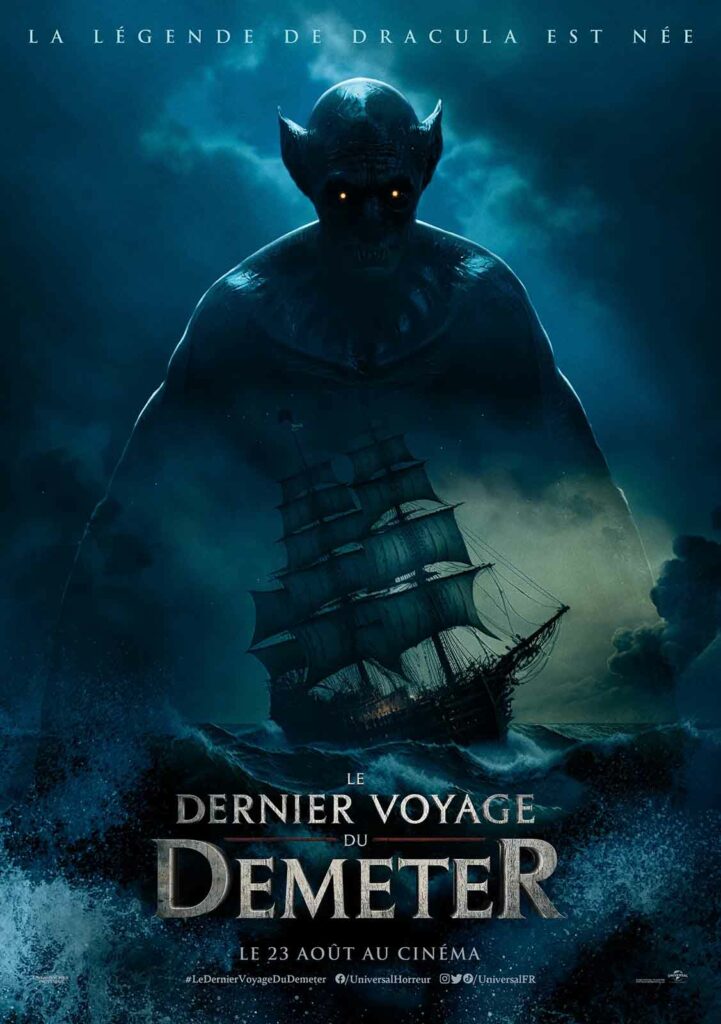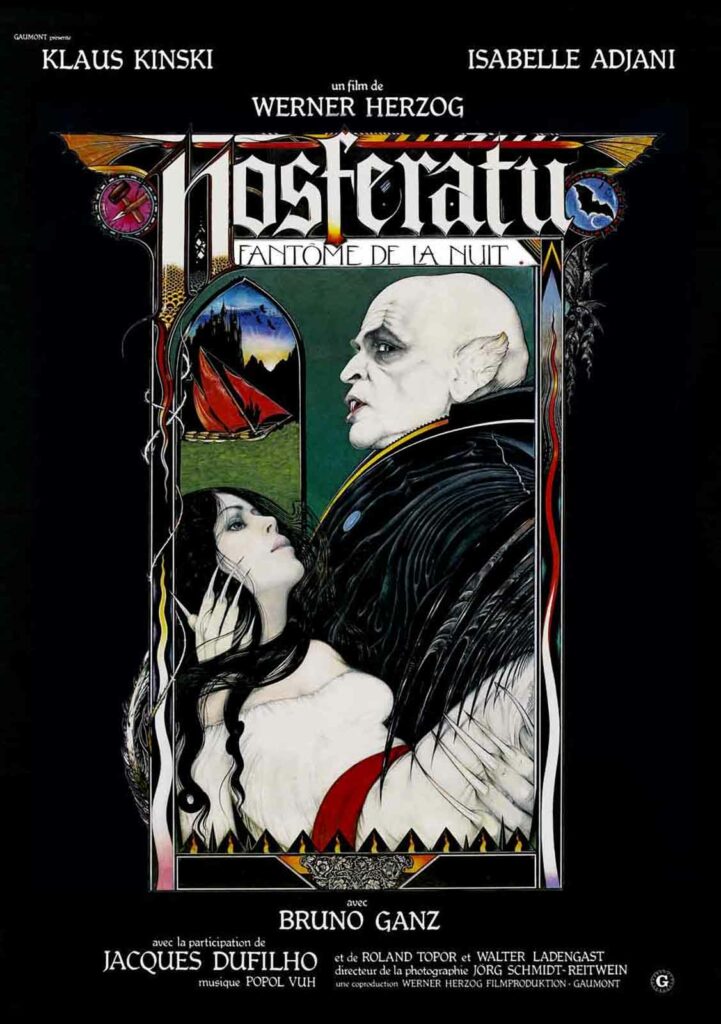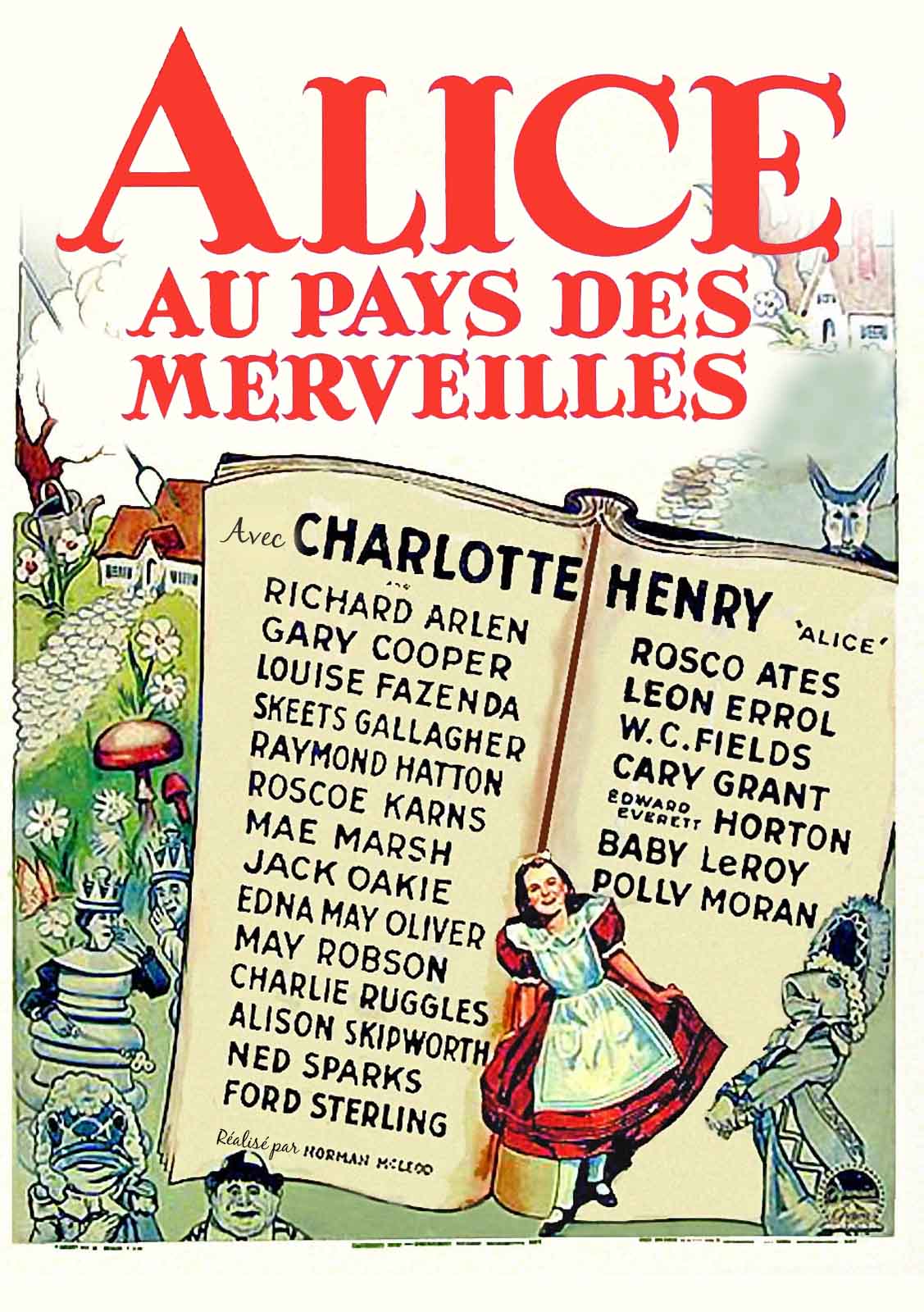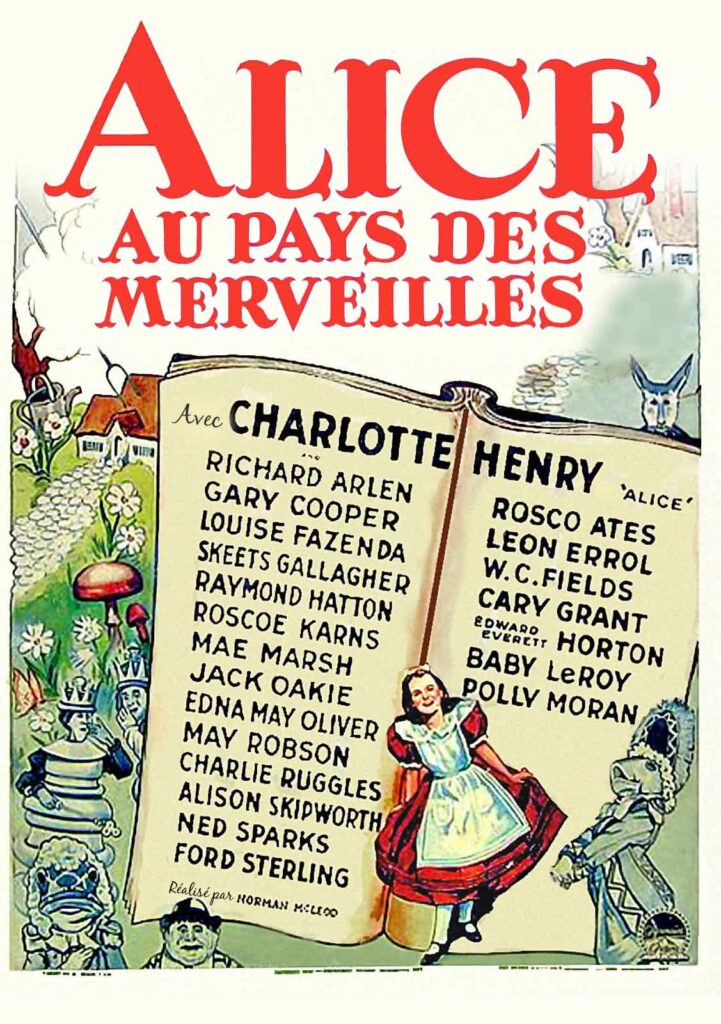Un tueur psychopathe se sert du contenu de sa grande boîte à outils pour massacrer toutes les jeunes femmes qu’il croise…
THE TOOLBOX MURDERS
1978 – USA
Réalisé par Dennis Donnelly
Avec Cameron Mitchell, Pamelyn Ferdin, Wesley Eure, Nicolas Beauvy, Tim Donnelly, Aneta Corsault, Faith McSwain, Marciee Drake, Evelyn Guerrero
THEMA TUEURS
Lorsque Tony Didio, un producteur de Los Angeles qui essaie de faire son trou dans la profession, se rend compte du succès public et populaire de Massacre à la tronçonneuse, il décide de s’engouffrer dans cette brèche et de surfer sur la vogue naissante de ce qui ne s’appelle pas encore le slasher. Didio convie donc les scénaristes Ann Kindberg, Robert Easter et Neva Friedenn à une projection du film de Tobe Hooper et leur donne comme mission d’imaginer une variante autour du même sujet. Le trio se creuse les méninges et écrit finalement un scénario qui n’a plus grand-chose à voir avec Massacre à la tronçonneuse. Leur source d’inspiration serait une série de meurtres en série commis dans le Minnesota en 1967 par un homme s’attaquant aux femmes à l’aide de divers outils. Étant donné qu’aucune trace officielle n’a été trouvée de ce fait divers, il est difficile de savoir s’il a réellement eu lieu ou s’il ne s’agit que d’un argument publicitaire destiné à faire frissonner le public en s’appuyant sur le prétexte de « l’histoire vraie » (ce qu’avait fait du reste Tobe Hooper lui-même en s’inspirant très librement des exactions d’Ed Gein). Tourné en dix-huit jours avec un budget très modeste d’environ 165 000 dollars, La Foreuse sanglante est l’unique long-métrage cinéma de Dennis Donnelly, vétéran de la réalisation d’épisodes de séries TV.


Une atmosphère poisseuse qui annonce à sa manière celle de Maniac s’installe dès les premières minutes du film. Tandis que défile le générique, la caméra adopte la vue subjective d’un conducteur qui sillonne les rues nocturnes de Los Angeles tandis qu’un prédicateur harangue les foules à la radio autour des éternels sujets du bien, du mal, du repentir et de la damnation. Un flash-back très bref nous donne soudain l’aperçu d’un accident de voiture ayant entraîné la mort d’une jeune fille. Notre conducteur quitte alors son véhicule, entre dans une résidence constituée de plusieurs immeubles et commence sa croisade sanglante. La mise en scène nous oblige à entrer dans la peau de cet assassin, ganté et cagoulé, qui trimballe avec lui une grosse boîte à outil. À l’intérieur se trouvent les armes du crime. Une locataire est donc massacrée avec une perceuse, une autre avec un marteau, une troisième avec un tournevis et une quatrième (incarnée par la très peu pudique comédienne Kelly Nichols, future habituée du cinéma « adulte ») à coups de pistolet à clous. Notre roi du bricolage kidnappe ensuite une adolescente de quinze ans, Laurie Ballard (Pamelyn Ferdin), et laisse pantois les forces de polices qui se perdent en conjectures…
Serial bricoleur
La Foreuse sanglante est un film déstabilisant dans la mesure où il combine les effets de style intéressants, les choix narratifs audacieux mais aussi des techniques racoleuses bien peu subtiles et de très grosses maladresses. On ne sait donc trop sur quel pied danser face aux exactions du « tueur à la boîte à outils ». Le montage, parfois expérimental, s’autorise des ruptures inattendues, des inserts très rapides et une mise en parallèle habile entre la mise à mort des victimes féminines et le trépas de la jeune femme du flash-back, source du trauma initial de notre meurtrier. Par ailleurs, chaque meurtre est accompagné d’une chanson (diffusée par la radio ou sur une platine disque) dont les styles variés (jazz, funk, country) créent un décalage surprenant et autorisent même un second degré culotté (notamment les paroles suaves d’une chanson d’amour qui accompagnent un bain de sang). Autre choix étonnant : la véritable identité du tueur n’est pas l’enjeu majeur du film, puisqu’elle nous est révélée à mi-parcours. La mécanique du slasher s’amenuise alors pour céder la place au thriller psychologique déviant. Toutes ces bonnes idées sont hélas gâchées par une direction d’acteurs souvent défaillante (malgré l’implication indiscutable de Cameron Mitchell et Pamelyn Ferdin) et par des comportements absurdes. Le manque de conviction des comédiennes jouant les victimes, qui s’offusquent mollement face au tueur, amenuise ainsi considérablement l’impact des scènes de meurtres. Les derniers rebondissements eux-mêmes manquent cruellement de crédibilité. Interdit au début des années 1980 sur le territoire anglais dans le cadre de la fameuse croisade des « Video Nasties », La Foreuse sanglante aura tout de même eu le mérite de s’éloigner considérablement de son modèle Massacre à la tronçonneuse. Ironiquement, c’est Tobe Hooper qui en réalisera un remake en 2004.
© Gilles Penso
Partagez cet article